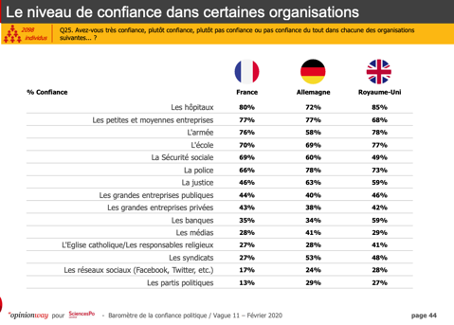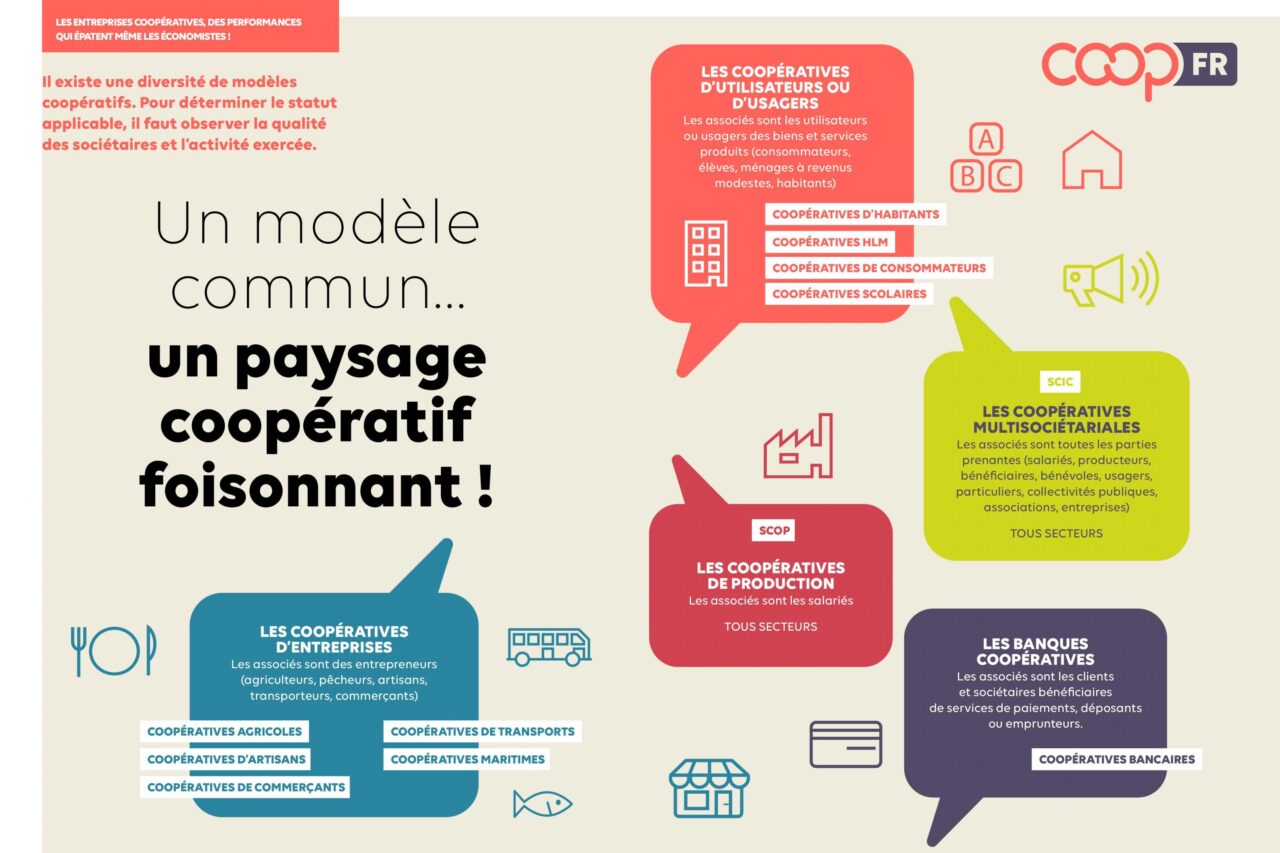Introduction
La vie économique repose sur cinq grandes catégories d’agents économiques : les ménages, les administrations publiques, les entreprises commerciales et financières et les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 1. Les entreprises ont un rôle économique 2 essentiel, celui de produire la majeure partie des biens et services que les ménages et les administrations achètent pour leur consommation ou leurs investissements. Pour cela, les entreprises emploient des travailleurs, s’achètent entre elles des biens et services (dits intermédiaires) et recourent aux services publics fournis par les administrations. Elles consomment de l’énergie et d’autres ressources naturelles, et elles ont des impacts sur la Nature.
Nous verrons à l’Essentiel 1 que la notion d’entreprise est une notion socioéconomique distincte de celle de société, qui est d’ordre juridique. C’est pourquoi nous utilisons principalement ce terme dans ce module : c’est bien cette dimension économique et sociale qui nous intéresse dans ce module. De plus, nos propos portent pour l’essentiel sur les entreprises privées d’une certaine taille (et assez peu sur les entreprises individuelles).
Nous allons tenter de rendre compte de l’utilité et des limites des entreprises et de répondre aux idées reçues les plus généralement rencontrées. Les entreprises sont-elles du côté des problèmes ou des solutions à la crise écologique ? Les efforts réalisés en la matière sont-ils réels, suffisants ou ne sont-ils que des sujets de communication voire de greenwashing 3 ? Faut-il transformer leur forme juridique et/ou leur gouvernance pour qu’elles contribuent d’avantage à résoudre la crise écologique ? Ces questions se posent aujourd’hui avec beaucoup plus d’acuité qu’il y a 30 ans, du fait du dépassement de plusieurs limites planétaires.
Ce module est très lié au module L’entreprise et sa comptabilité, auquel il sera fait référence implicitement ou explicitement.
L’essentiel
Qu’est-ce qu’une entreprise ?
La notion d’entreprise, objet central des critiques faites au capitalisme, est plus complexe que l’image véhiculée par le débat médiatique sur des multinationales controversées.
En réalité, les entreprises sont de nature, de longévité 4 et de tailles très variées : de l’entreprise individuelle, à la multinationale qui opère dans de nombreux pays et secteurs différents, en passant par l’entreprise multiséculaire. Elles évoluent dans des situations réglementaires et concurrentielles et ont des modes de gouvernance extrêmement variables (ex : du métier très réglementé de notaire au monde très concurrentiel des services informatiques). Leur gouvernance, que nous abordons dans l’Essentiel 4, peut également recouvrir des situations très différentes.
Pour se faire une opinion sur le rôle et la responsabilité actuels de l’entreprise dans la crise écologique et sa résorption éventuelle, il est nécessaire de bien définir ce dont il est question. Il s’agit également de comprendre que, selon les acteurs, les représentations et les attentes ne seront pas les mêmes.
Selon les personnes ou les parties prenantes concernées, la perception de l’entreprise est très différente
Pour ses fondateurs, l’entreprise est un moyen de gagner de l’argent, d’exercer un métier et d’être son propre patron. Ce peut être aussi une aventure humaine, risquée, une manière de concrétiser un rêve, une idée. Il peut s’agir pour eux de réalisation personnelle et d’un enjeu de réussite sociale.
Pour les dirigeants non fondateurs (ou pour les fondateurs après quelques années) les motivations peuvent être un peu différentes : envie de gagner un marché, d’éliminer un concurrent, d’imposer un nouveau produit/service, de faire s’envoler le cours en bourse, de servir un actionnaire précis pour augmenter son pouvoir, etc.
Pour les collaborateurs de l’entreprise, les motivations peuvent être variées tout comme le regard porté sur cette entreprise. Historiquement, le travail a pu être considéré comme une fatalité : il faut travailler pour « gagner sa vie ».
Aujourd’hui les motivations peuvent être plus complexes : faire partie d’une équipe de collègues sympathiques, le plaisir de vendre pour un commercial, le besoin de reconnaissance, le sentiment de participer au projet de l’entreprise, à sa « mission » (même si ce terme est parfois connoté) et le sentiment d’y participer pleinement, à la hauteur de ses capacités. En contrepartie, un salaire (et plus généralement une rémunération) est bien sûr attendu. Le niveau de salaire souhaité peut l’être d’ailleurs plus en fonction de considérations d’équité (obtenir un salaire équivalent à celui d’une autre personne « comparable » faisant aussi bien un travail équivalent) que du désir d’avoir un salaire toujours plus élevé. Cela dépend de la culture et des motivations du salarié considéré.
Pour nombre de parties prenantes et d’observateurs, une entreprise est avant tout un corps social, un ensemble de personnes qui interagissent au sein d’un collectif soumis à des règles de natures différentes : le droit (des sociétés, du travail, etc.), les usages sociaux liés au pays concerné, l’organisation et les méthodes de management spécifiques de l’entreprise, l’ambiance résultant des interactions et des initiatives des collaborateurs…
Sur le ou les territoires où l’entreprise est implantée, elle est vue comme pourvoyeuse d’emplois directs et indirects, en suscitant ou stimulant des activités, que ce soit les fournisseurs et prestataires locaux ou via les activités qui se développent pour apporter biens et services à ses salariés. Elle peut également être perçue comme source de nuisances (et en particulier de bruits ou de pollutions).
Pour les financiers et certains dirigeants, l’entreprise se résume à un ensemble d’actifs qui génèrent des revenus, avec plus ou moins de risques, et peuvent être valorisés à plus ou moins long terme par une cession partielle ou totale. Cette vision est proche de celle des économistes qui ont développé la théorie de l’agence, selon laquelle l’entreprise est un ensemble de contrats (voir l’Idée reçue 2).
Pour certains observateurs et militants, et notamment pour ceux qui se revendiquent du marxisme et de ses successeurs, l’entreprise est un lieu de confrontation entre le capital et le travail, l’un subordonnant l’autre par définition.
Selon la vision de l’entreprise qu’on adopte les questions de gouvernance et de partage des revenus se posent et se règlent de manière assez différente y compris au sein d’un même cadre juridique.
L’entreprise vue par diverses disciplines scientifiques
Les diverses disciplines scientifiques voient l’entreprise à l’aune de leur spécialisation. Mobiliser ces différents types de représentations peut aider à comprendre les facteurs qui bloquent la prise en compte des « limites planétaires » dans la stratégie et les décisions de l’entreprise ; ces blocages n’étant pas nécessairement de l’ordre de la rationalité économique.
Sans entrer ici dans une recension exhaustive, prenons quelques exemples.
Dans le champ économique, de nombreuses théories de la firme ont été élaborées. 5
L’une des plus influentes aujourd’hui est celle développée par Milton Friedman et les promoteurs de la théorie de l’agence pour lesquels l’entreprise est vue à la fois comme un ensemble de contrats et comme la propriété de ses actionnaires. Les économistes institutionnalistes la voient eux comme une construction sociale et un collectif régi par des règles explicites ou implicites, point de vue que nous adoptons ici.
Dans une approche sociologique et anthropologique, l’entreprise est perçue comme un lieu d’alliances, de relations, de coopération, et aussi – voire surtout- de conflits, de guerres internes et externes. L’entreprise est une arme de la « guerre économique globale/totale » (remplaçant les bataillons d’autrefois) : les chefs d’entreprise sont les « généraux » du capitalisme.
Dans une approche biologique, l’entreprise doit avoir une raison d’être. Les termes employés souvent dans ce registre sont de l’ordre de la vie et de la mort : l’âme de l’entreprise, son ADN, son écosystème… Si elle perd ce sens, l’entreprise est en danger. Dans cette vision, le ou les fondateurs et la graine de départ qu’ils ont apportée transcendent l’histoire de l’entreprise. Ils sont à la fois des moteurs et des contraintes : il sera difficile aux successeurs de réaliser des mutations qui sortent de cette « matrice » initiale.
Dans une approche psychologique, une entreprise est un théâtre (et parfois un lieu de purge psychologique) qui met en scène des egos (parfois démesurés), des désirs (d’enrichissement, de pouvoir, de reconnaissance, d’accomplissement), des pulsions, des valeurs, des passions, des failles (allant de manque de certaines compétences clés à parfois des profils psycho-pathologiques) depuis ceux du ou des fondateurs à ceux de tous ses contributeurs.
Dans cette conception, la rationalité apparente de l’entreprise (des décisions sur des critères de performance et d’efficience pour sa croissance) est relativement faible par rapport aux rationalités psychiques de ceux qui la créent, la composent et la gèrent.
L’entreprise vue de la statistique publique
Les organismes statistiques publics, tels l’Insee en France, collectent et analysent les données sur les entreprises pour dresser une image de la structure productive du pays, de son évolution dans le temps, et la comparer avec celle d’autres pays.
L’image de l’entreprise et du système productif rendue par ces organismes est donc profondément structurante puisqu’elle sert de support au débat public sur le sujet. C’est pourquoi nous nous sommes attachés ici a bien comprendre ce dont il est question.
L’entreprise une réalité socio-économique
Seulement, comment définir le contour d’une entreprise ? Cette question est moins anodine qu’il n’y paraît. En effet, la réponse sera différente selon la taille et la complexité de l’organisation concernée.
En première approche, on pourrait penser que l’entreprise se définit par son existence juridique. Elle a d’ailleurs longtemps était confondue avec l’ »unité légale » (voir encadré ci-dessous).
Une telle définition est cependant restrictive et traduit mal la réalité économique.
Comme l’explique l’Insee, « beaucoup d’unités légales ne sont pas autonomes : elles appartiennent à un ensemble plus large, qui regroupe plusieurs unités et qui détient le pouvoir de décision, notamment sur la répartition des facteurs de production ou la recherche et développement ». C’est cet ensemble qu’on appelle entreprise et qui fait sens au niveau économique. 6
Enfin, une entreprise c’est également un collectif de travail, un corps social. C’est pourquoi, la notion d’entreprise se retrouve souvent dans le Code du travail, au sein duquel le terme doit être interprété comme un ensemble de travailleurs exerçant une activité commune sous l’autorité d’un même employeur.
Définitions – Établissements, unités légales, entreprises
L’établissement est une unité de production de biens et services (marchande ou non) localisée géographiquement sur un territoire donné (ex : une boulangerie, un entrepôt, une exploitation agricole, un site de production industrielle, un « bureau » d’une société de conseil). Elle est juridiquement dépendante d’une unité légale. Voir la définition de l’Insee et d’Eurostat.
Une unité légale (UL) est une entité juridique de droit public ou privé (société, entreprise individuelle, administration, collectivité, association etc.) 7 Ce peut être une personne morale ou une personne physique (un indépendant par exemple). Elle peut compter un ou plusieurs établissements (ex : une chaîne de boulangeries, de supermarchés etc.). En 2020, 95 % des UL sont mono‑établissement en France. Voir la définition de l’Insee et celle d’Eurostat.
Un groupe est un ensemble de sociétés (une des formes juridiques que peuvent prendre les UL) liées entre elles par des liens juridiques et/ou financiers et contrôlées par la tête de groupe. On parle de multinationale quand au moins deux des sociétés constituant le groupe sont situées dans des pays différents. Voir la définition de l’Insee.
« L’entreprise » » est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. »
Insee 8 Voir la définition d’Eurostat.
Une entreprise peut donc être une unité légale indépendante ou un groupe. En France, toutes les UL et leurs établissements sont identifiés dans le répertoire SIRENE.
Source Les différents niveaux et champs d’observation de l’appareil productif en France – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee
Combien d’entreprises en France ?
L’analyse du système productif implique de se concentrer sur le secteur marchand, et de disposer de données comptables cohérentes et harmonisées.
L’Insee a ainsi défini le champ de la statistique structurelle d’entreprise (aussi appelé « secteurs marchands non agricole et non financier »), duquel sont exclus :
- les secteurs agricoles (sauf les exploitations forestières) et financiers (sauf les holdings et les auxiliaires financiers et d’assurances) car leur comptabilité n’est pas homogène avec les autres secteurs.
- les activités non marchandes (réalisées par les administrations publiques, ou les associations).
- les activités non productives
Il y a en France, 4,5 millions d’entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers (2021).
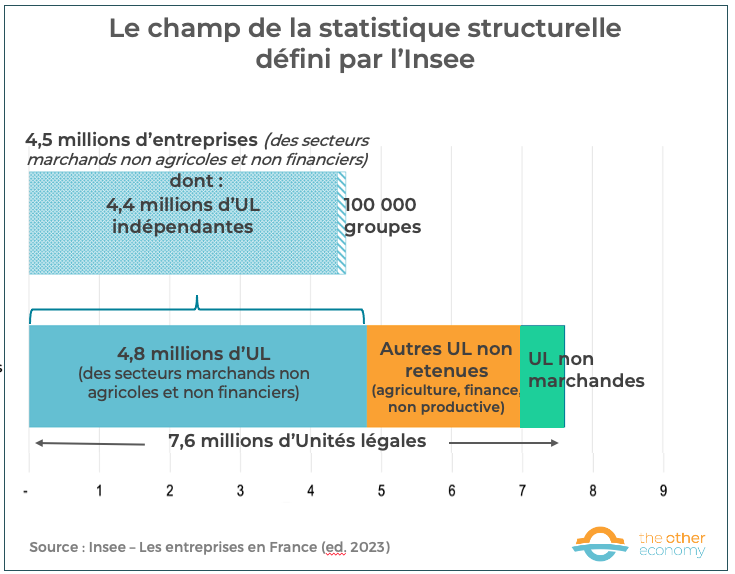
Source Les différents niveaux et champs d’observation de l’appareil productif en France – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee et L’essentiel sur… les entreprises – Insee 2024
Les entreprises ne sont pas nécessairement des sociétés
Quand on parle d’entreprise, il est fréquent d’assimiler ce terme à celui de société. Pourtant, les deux concepts sont différents.
Comme vu au point précédent, l’entreprise désigne une réalité socio-économique, dont le support juridique est constitué par une ou plusieurs unités légales.
La société est une des formes que peut prendre une unité légale, mais ce n’est pas la seule (voir définition ci-après). Les entreprises individuelles sont également très nombreuses. Comprendre cela est important car très souvent les débats qui portent sur l’entreprise concerne principalement les sociétés, donc un mode de gouvernance (partage du pouvoir et de la valeur) et des objectifs bien spécifiques.
Si, l’Insee ne rend malheureusement pas publiques les informations sur les catégories juridiques des 4,8 millions d’unités légales (et a fortiori des entreprises) retenues dans le champ de la statistique structurelle d’entreprises, on peut cependant tirer quelques ordres de grandeur à partir des données portant sur l’ensemble des 7,6 millions d’unités légales.
Répartition des unités légales en France selon la catégorie juridique fin 2021
Fin 2021, sur les 7,6 millions d’unités légales françaises, plus de 55% sont des entreprises individuelles (environ 4,2 millions), 37,6% sont des sociétés (environ 2,8 millions) et 3% des associations (environ 236 000). La catégorie « Autres » comprend en particulier les administrations publiques (administration de l’État, collectivités territoriales, administrations de sécurité sociales etc.).
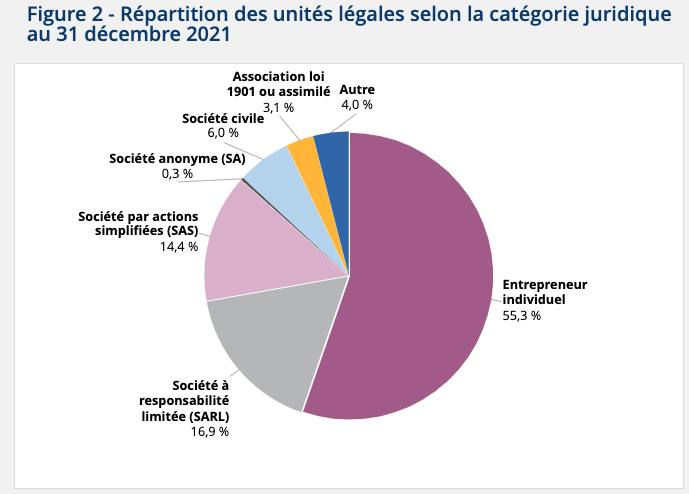
Source Les différents niveaux et champs d’observation de l’appareil productif en France – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee
Le champ de la statistique structurelle d’entreprise recouvre pour l’essentiel les entrepreneurs individuels et les sociétés. Cependant, certains entrepreneurs individuels et sociétés appartiennent aux secteurs agricoles et financiers et sont donc exclus. D’autres peuvent n’avoir aucune activité productive. 9 Certaines sociétés civiles n’ont pas d’activité marchande. 10 Certaines structures répertoriées dans « Autres » , telles les entreprises publiques, peuvent être incluses.
On ne peut donc pas déduire entièrement des statistiques ci-avant la forme juridique des entreprises retenues dans la statistique structurelle par l’Insee. On peut cependant former l’hypothèse qu’au moins une entreprise sur deux relève du statut juridique de l’entrepreneur individuel.
Les différences entre les statuts juridiques
- Les entreprises individuelles
Il s’agit des entreprises créées en nom propre : elles n’ont pas de personnalité juridique distincte de leur fondateur. Jusque très récemment les entrepreneurs individuels étaient responsables des dettes sociales sur leur biens propres (en dehors de la résidence principale). Depuis la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante de 2022, seuls les éléments nécessaires à leur activité professionnelle peuvent être saisis en cas de défaillance professionnelle.
Parmi les entrepreneurs individuels, il existe un statut spécifique : celui de micro-entrepreneur (appelé auto-entrepreneur jusqu’en 2014), qui offre des formalités de création d’entreprise allégées et un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
- Les sociétés
La notion de société est définie dans l’article 1832 du Code civil.
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
Une société est donc une personne morale résultant d’un acte juridique ayant pour objectif premier de réaliser des profits au bénéfice de ceux qui l’ont créée.11
Il existe de nombreux types de sociétés qu’on peut regrouper en deux grandes catégories n’ayant pas les mêmes implications pour leurs fondateurs :
Les sociétés de personnes (partnership en anglais) sont caractérisées par l’importance de la collaboration des associés qui ont créé la société (ou l’ont rejoint). En contrepartie des ressources qu’ils apportent pour former le capital de la société, ils reçoivent des titres financiers appelés parts sociales, dont la cession est très encadrée 12 (à la différence des actions). C’est une façon d’empêcher la dilution du capital. Par ailleurs, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Cela signifie qu’un associé peut être poursuivi pour la dette d’un autre et que les associés sont responsables sur l’ensemble de leurs biens personnels (et non pas seulement professionnels). La confiance entre les associés est donc essentielle.
Les formes juridiques des sociétés de personnes en France sont la société en nom collectif (SNC), la société en participation et surtout la société civile, telles la SCI (société civile immobilière) pour la gestion de bien immobilier ou la SCP (société civile professionnelle), créées pour exercer des professions libérales réglementées (notaires, avocats, commissaires aux comptes, médecins etc.).
Les sociétés de capitaux sont plus centrées sur les titres émis que sur les associés eux-mêmes. Les apports initiaux pour former le capital se traduisent par des titres financiers, les actions, que les associés (ou actionnaires) peuvent librement 13 transmettre (y compris sur une bourse si la société est cotée). Par ailleurs, la responsabilité des associés est limitée à leur apport et ils ne sont pas solidairement responsables.
Les principales formes de société de capitaux en France sont la SA (société anonyme) et ls SAS (société anonyme simplifiée). Les SARL sont considérées comme des sociétés mixtes ou hybrides. 14
Ce premier tour d’horizon permet de comprendre que l’entreprise n’est pas forcément une société alors que les deux termes sont très souvent confondus. La première est un concept socio-économique utilisé pour l’analyse du système productif, la seconde est un statut juridique revêtant des spécificités bien particulières.
Les entreprises sont de toutes tailles, de tous âges et de poids différents sur l’activité productive
Les statistiques portant sur les entreprises sont extrêmement riches. Elles permettent par exemple de comprendre leur très grande diversité que ce soit en termes de taille, de secteurs d’activité et d’impact sur le système productif. Cependant, comme nous le rappelons souvent dans The Other Economy, il est également nécessaire de prendre du recul par rapport aux chiffres pour appréhender les valeurs que recouvrent les différentes façons de compter.
La structure productive est très concentrée
Une façon commune d’observer le monde des entreprises est de les différencier par taille pour évaluer leur poids dans le tissu productif au regard de différents indicateurs (nombre, emploi, chiffre d’affaires, valeur ajoutée, exportations etc.). Des seuils ont pour cela été définis dès 2003 au niveau de l’Union européenne (les États membres étant tenus de respecter les seuils maximaux avec certaines marges de manœuvre).
Seuils permettant de classer les entreprises par taille dans l’Union européenne et en France
Les principales différences entre les deux classifications résident dans le fait que l’Union européenne a créé davantage de subdivisions au sein des PME et que la France a choisi de distinguer les ETI et les grandes entreprises.
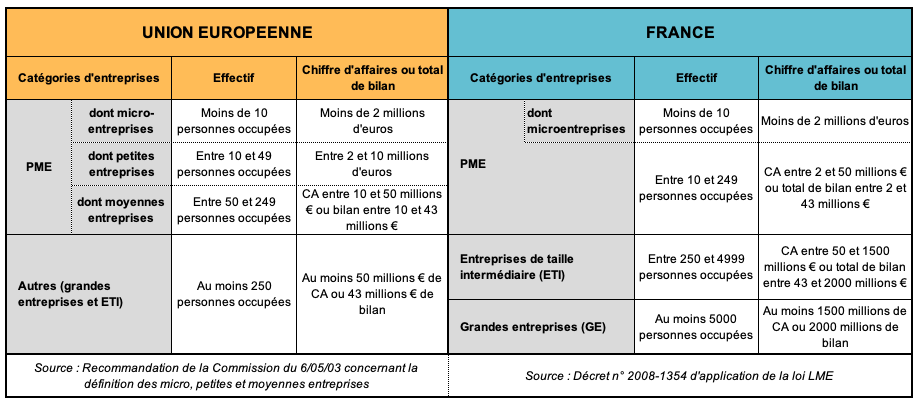
Source Dans une Recommandation de 2003, la Commission européenne a défini des seuils permettant de catégoriser les entreprises en fonction de l’effectif et de données financières (chiffre d’affaire ou total de bilan). La France a transposé les recommandations de la Commission dans un décret d’application de la loi de Modernisation de l’Économie de 2008.
Attention de ne pas confondre la microentreprise (MIC) dont il est question ici qui est un concept statistique et peut prendre la forme juridique d’une entreprise individuelle ou d’une société et le statut de microentrepreneur (abordé dans l’Essentiel 1.4), qui est un statut spécifique d’entreprise individuelle en France.
L’effectif correspond au nombre de « personnes occupées ». Il comprend des salariés de l’entreprises et des non-salariés (propriétaires exploitants, associés très investis, personnes assimilées à des salariés au regard du droit national). 15
Quelques indicateurs sur la structure productive en France par taille d’entreprise
En 2021, les 4,5 millions d’entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers en France réalisent 1 296 milliards d’euros de valeur ajoutée et emploient 14,7 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), sachant que la France compte au total une trentaine de millions d’emplois.
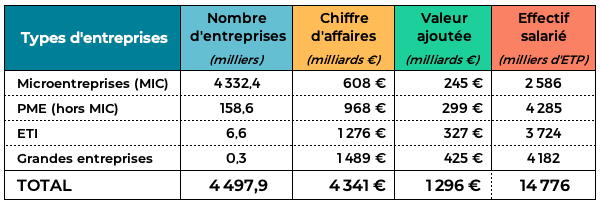
Source L’appareil productif français en 2021 – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee
Champ : secteurs marchands non agricoles et non financiers. Pour une définition, voir l’Essentiel 1.3 Combien d’entreprises en France ?
Comme on peut le constater sur le graphique ci-après, le tissu productif français est très concentré. Si les MIC représentent 96% des entreprises (4,3 millions) en 2021, leur poids est nettement moins important en termes d’effectif salarié (18%) et de valeur ajoutée (19%). A l’inverse, les quelques 300 grandes entreprises représentent 28% des salariés et 33% de la valeur ajoutée.
Le tissu productif français est très concentré (2021)
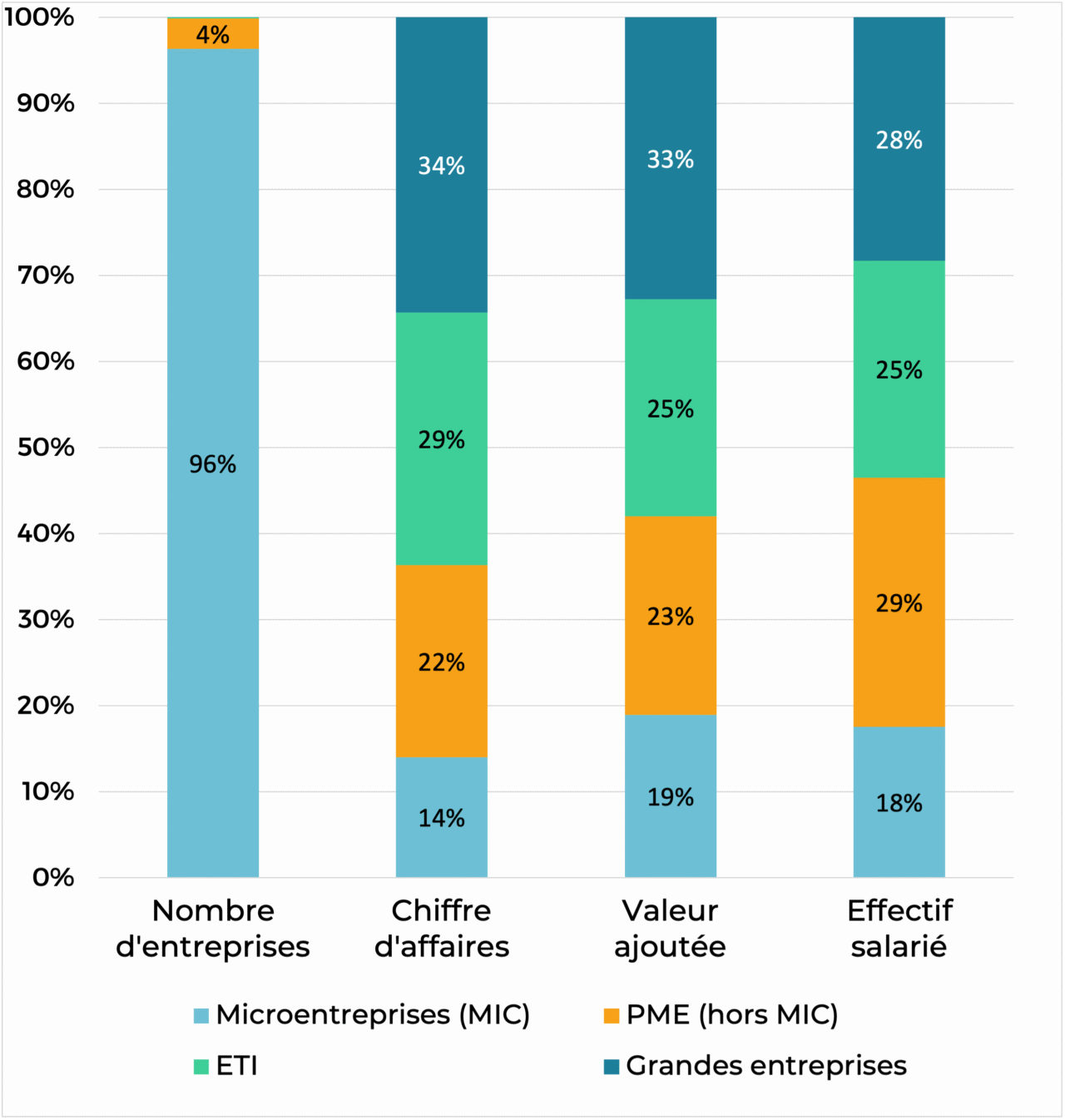
Source L’appareil productif français en 2021 – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee
Champ : secteurs marchands non agricoles et non financiers (Pour une définition voir l’Essentiel 1.3 Combien d’entreprises en France ?)
La situation française n’est pas exceptionnelle en Europe. Partout, les MIC dominent en termes de nombre d’entreprises. Les ETI et grandes entreprises génèrent autour de la moitié de la valeur ajoutée. Sur la question de l’emploi, la situation est plus contrastée : les MIC représentant un peu moins du tiers des personnes occupées dans l’Union européenne, mais seulement 19% en Allemagne et 43% en Italie.
Comparaison de la structure productive dans différents pays de l’Union européenne selon la taille des entreprises
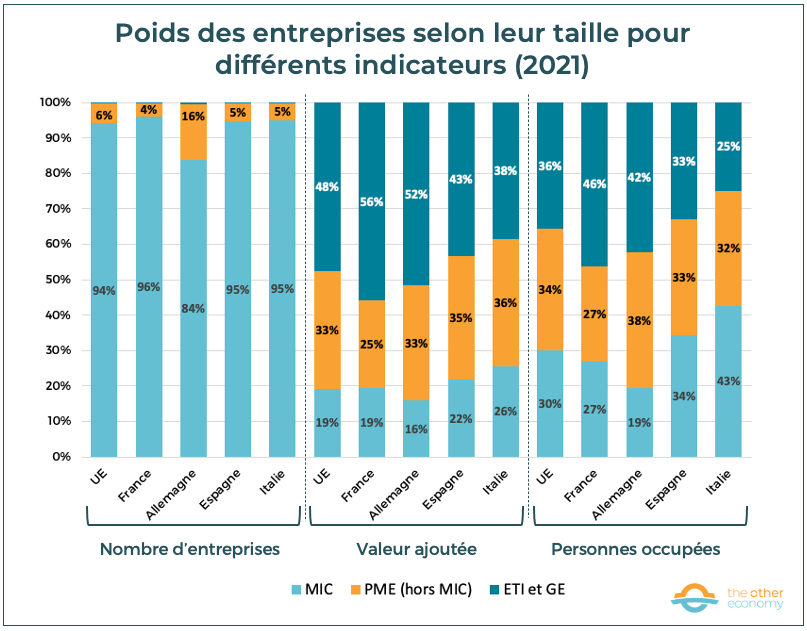
Source Eurostat – Statistiques sur les entreprises par classe de taille et activité de la NACE Rév. 2 (consulté en juin 2024)
Champ : Industrie, construction et services marchands (ce champ est à peu près équivalent à celui secteurs marchands non agricoles et non financiers retenu par l’Insee).
Attention, l’indicateur d’emploi retenu est celui des personnes occupées15 (l’indicateur d’effectif) alors que l’Insee utilise celui de salariés en ETP (toutes les personnes occupées ne sont pas des salariés).
Autres types d’informations disponibles : secteurs, démographie des entreprises etc.
Les instituts statistiques rendent disponibles de nombreuses autres données permettant d’analyser le tissu productif. Il est par exemple possible d’analyser le poids des différents secteurs économiques en matière de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée, d’emploi, d’investissement, d’exportation etc.
Principaux agrégats par secteur d’activité en 2021
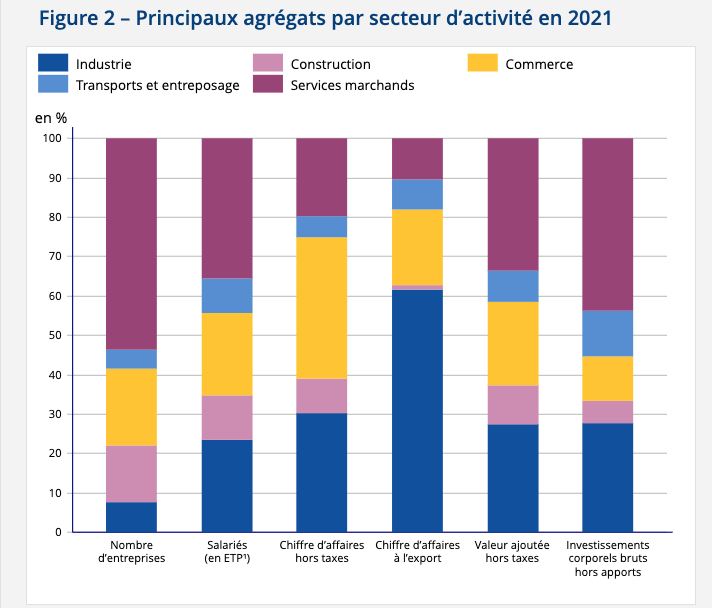
Source Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee
À noter que les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers comptent 3,7 millions d’entreprises réalisant 4142 milliards de chiffre d’affaires. Ils constituent donc une sous-partie17 du champ de la statistique structurelle retenu par l’Insee (que nous avons défini dans l’Essentiel 1) qui compte lui 4,5 milliards d’entreprises pour 4241 milliards de chiffre d’affaires.
Des statistiques existent également concernant la « démographie » des entreprises car celles-ci ne sont pas éternelles. On apprend ainsi par exemple qu’en France, 61% des entreprises créées en 2014 étaient encore actives cinq ans après leur création18. Ce qui en creux signifie que 40% des entreprises « meurent » dans les 5 ans qui suivent leur création19.
Pour en savoir plus
L’Insee réalise chaque année un ouvrage très complet sur Les entreprises en France.
Pour l’Union européenne, le site Eurostat statistics explained propose une section très complète
La nécessaire prise de recul par rapport aux données statistiques
Comme souvent dans The Other Economy, nous souhaitons mettre en évidence l’importance de prendre du recul sur les statistiques. En effet, si elles se basent sur des données concrètes, collectées auprès des acteurs économiques, elles obéissent néanmoins à des conventions c’est-à-dire des choix réalisés par les statisticiens selon des raisonnements et des justifications qui ne peuvent relever d’une objectivité totale par rapport à la description du réel.
Le champ observé par les organismes statistiques n’est pas neutre
Le rapport Les entreprises en France – Édition 2023 de l’Insee est censé présenter « une vue structurelle complète de notre système productif ».
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 1.3, la statistique structurelle d’entreprise porte sur les « secteurs marchands non agricoles et non financiers » qui comprenaient en 2021 4,5 millions d’entreprises correspondant à 4,8 millions d’unités légales.
Pourtant, l’Insee recense près de 7,6 millions d’unités légales actives en France. Le passage d’un chiffre à l’autre a impliqué de faire des choix, d’adopter des conventions justifiées par des considérations techniques (exclusion de la plupart des structures agricoles et financières car ayant des comptabilités différentes des autres secteurs) ou sans justification (exclusion des activités non marchandes).
Cependant, l’ambition étant d’analyser le système productif, le fait d’exclure la production agricole, les services financiers ainsi que toutes les activités non marchandes peut questionner. Doit-on considérer que les services publics d’éducation, de santé, de justice ou de maintien de l’ordre ne participent pas à l’activité productive ? Qu’en est-il également de la contribution des centaines de milliers d’associations ? Ces questions peuvent être légitimement posées tant ces choix conduisent à diffuser un message biaisé sur ce qui constitue le tissu productif d’un pays.
Il est intéressant de mettre les chiffres sur le système productif délimité par l’Insee en regard de ceux concernant l’économie dans son ensemble
La production non marchande par exemple représentait un peu plus de 11% de la production française totale en 202120, et cela sans compter tous les services ne faisant l’objet d’aucune transaction monétaire (par exemple le travail des 12 millions de bénévoles français).
Quant à la valeur ajoutée, elle s’est élevée à 2217 milliards d’euros21 cette même année. Avec 1296 milliards de valeur ajouté, le système productif français tel que délimité par l’Insee en représente donc moins de 60%. Le même type d’analyse est éclairant en ce qui concerne l’emploi (voir l’Idée Reçue 1 Seules les entreprises créeraient des richesses et de l’emploi).
Bien sûr, les secteurs agricole, financier, associatif, les administrations publiques font également l’objet d’analyses statistiques. Mais l’angle donné n’est pas le même. Pour les administrations par exemple, la question des finances publiques (dépenses, dette et déficit) est bien plus mise en avant que celle de leur contribution au système productif. Cette problématique est bien illustrée également par l’économie sociale et solidaire (ESS), située à l’interface entre secteurs marchands et non marchands du fait de la multiplicité des structures qui la composent. Les statistiques très lacunaires sur le sujet permettent tout de même de comprendre que cette part de l’économie centrée sur l’objet social plus que le profit représente une part conséquente de l’activité notamment en termes d’emplois (voir l’Essentiel 4 sur la gouvernance).
Les conventions statistiques en lente évolution n’ont pas été conçues pour percevoir la dimension matérielle de la production
Les conventions statistiques sont le plus souvent élaborées dans un cadre régional (Union européenne) voire international. Elles correspondent aux besoins d’une époque et sont très longues à faire évoluer.
L’exemple de la division sectorielle de l’économie est à cet égard éclairant. Créée en 1993, la NAF (nomenclature d’activités françaises), est « une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale ». Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne (NAVE Rev2), elle-même dérivée de la nomenclature internationale. Elle a été révisée deux fois, en 2003 et en 2008.
Élaborée à une époque où les questions écologiques étaient peu présentes dans le débat public, cette nomenclature n’a pas pris en compte les dimensions de consommation de ressources naturelles et de pollution liées aux activités économiques. D’autres nomenclatures ont donc été élaborées pour traiter de ces questions, telle celle qui structure les grands secteurs de l’économie pour rendre compte des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. La correspondance entre les deux et donc l’analyse du système productif au regard de ces émissions n’est pas évidente.
L’entreprise : un lieu de coopération et de tensions entre de multiples acteurs internes et externes
Les entreprises s’inscrivent dans un environnement institutionnel, humain et naturel
Une entreprise ne peut fonctionner et encore moins se développer sans que de multiples tâches de natures différentes soient réalisées, en interne par des salariés ou en externe par des prestataires de service ou des fournisseurs.
Elle dépend aussi de services publics gratuits ou payants et de la disponibilité d’infrastructures (transport, énergie, déchets, télécom) et d’institutions de qualités (éducation et formation, santé, justice, système de droit etc.). Elle s’insère dans des « écosystèmes » humains (les parties prenantes) et/ou naturels (l’environnement).
Elle est soumise à de nombreuses obligations juridiques : le droit social, le droit des sociétés et le droit fiscal, le droit de l’environnement, le droit des affaires (ou des contrats), de la propriété intellectuelle et de la concurrence. Il existe également certains secteurs qui sont soumis à des réglementations particulières (par exemple en France : la banque, les assurances, les librairies, la presse etc.) et des professions libérales réglementées qui sont soumises à des obligations spécifiques22).
Rappelons enfin que certaines activités sont interdites voire criminelles23. Elles ne sont pas nécessairement anecdotiques au plan économique et certaines d’entre elles sont comptabilisées dans le PIB (voir notre module PIB, Croissance et Ressources planétaires – Sous partie Comment sont définies les limites de la production ?)
Différentes fonctions sont mises en œuvre dans l’entreprise
Le « chef d’entreprise » (une personne ou plusieurs associés) incarne et défend le projet de l’entreprise auprès de ses clients de ses collaborateurs et des autres parties prenantes. C’est aussi un chef d’orchestre qui s’assure que les fonctions à remplir le sont « adéquatement » (c’est-à-dire au niveau de qualité requis pour un coût adapté) et veille à la bonne insertion de l’entreprise dans le ou les écosystèmes avec lesquels elle interagit. C’est un arbitre des nombreux conflits que vit l’entreprise. Ce n’est donc pas juste un gestionnaire, un comptable ou un manager.
Faisons un point rapide sur les fonctions à assurer pour qu’une entreprise fonctionne.
Une entreprise, quelle que soit sa taille, réalise en interne ou fait réaliser par des fournisseurs ou des prestataires de service de multiples fonctions. Le poids des effectifs affectés à telle ou telle fonction dépend bien sûr de la taille de l’entreprise mais aussi de sa « mission » et de son modèle d’affaires.
Qu’est-ce qu’un modèle d’affaires ou business model ?
L’expression modèle d’affaires24 désigne la façon dont une entreprise est censée réaliser des bénéfices. Le modèle d’affaires le plus répandu est évidemment la production et la vente de produits ou services générant une marge. Mais il en existe d’autres. La presse « gratuite » est par exemple un modèle d’affaires spécifique, dans lequel la publicité est la source de revenus principale, ce qui crée des biais dans le choix, la production et la mise en valeur de l’information. Un autre exemple est celui de certains géants du numérique tel Google qui offrent des services gratuits à leurs usagers et tirent l’essentiel de leurs revenus de la vente de publicités ciblées réalisées via l’exploitation des données personnelles de ces mêmes usagers.
Le modèle d’affaires, au même titre que la stratégie, est un aspect crucial dans le succès ou non d’une entreprise. L’Histoire nous montre un nombre important d’échecs ou de réussites fortement liés au modèle d’affaires. La presse écrite, dont les difficultés économiques sont récurrentes, en est un exemple emblématique.
Les financeurs (banquiers, investisseurs) ont besoin de comprendre le ou les modèles d’affaires des entreprises dans lesquelles ils investissent et leur sensibilité à des facteurs externes ou internes. Ne pas bien comprendre ce qui génère les profits d’une entreprise est en effet très risqué.
Source Pour en savoir plus voir la vidéo Comprendre les business models en 5 minutes sur Xerfi Canal
Voici une liste très synthétique des fonctions remplies au sein de l’entreprise, et incarnées de manières différentes selon les cas :
- la définition de la « mission » et de la stratégie à plus ou moins long terme ;
- la vente (marketing, publicité, service commercial, relation aux clients, « business développement ») ;
- la communication externe et interne (via ou non la presse et les médias d’information) ;
- les ressources humaines et la gestion sociale : paie, déclarations sociales, médecine du travail, relations avec les représentants du personnel, recrutement, formation, gestion anticipée des compétences, gestion des maladies, des congés et des départs (démissions, licenciements individuels et collectifs) ;
- la production (et les services qui la soutiennent), la sous-traitance éventuelle et les achats ;
- la gestion de l’informatique (logiciels et matériels) ;
- la gestion comptable et financière : financement de l’entreprise (par le recours au crédit, aux actionnaires, aux marchés), gestion de trésorerie, comptabilité, contrôle de gestion, communication et reporting financier
- le juridique : droit social, droit des sociétés et droit fiscal, droit de l’environnement,
- droit des affaires (ou des contrats), droits de la propriété intellectuelle et de la concurrence etc.
- la recherche fondamentale ou appliquée et le développement de nouveaux produits et services ;
- les relations publiques : relations avec les autorités politiques et administratives au niveau pertinent, les organisations professionnelles, les ONGs et exercice éventuel d’une influence sur ces acteurs ;
- le suivi et le contrôle de la responsabilité sociétale et environnemental de l’entreprise.
L’entreprise n’est pas isolée
Elle s’insère au sein d’un réseau de parties prenantes : clients, personnel, fournisseurs, État et administrations publiques, actionnaires, investisseurs, banquiers. Elle exerce sur un ou plusieurs territoires, elle a des voisins et bénéficie de services et d’infrastructures publics.
Les entreprises ne peuvent vivre et se développer sans l’accord implicite des citoyens, ce qu’on appelle « le permis social d’opérer » ; elles doivent avoir une certaine légitimité qui ne se réduit ni au respect du droit, ni au fait qu’elles peuvent trouver des clients solvables. Cette pression sociale s’exerce sur les dirigeants et leur impose de fait des limites.
Plus prosaïquement, les entreprises doivent inspirer durablement confiance à leurs clients sur la qualité de leurs produits et services et la conformité aux allégations formulées. Elles sont de plus en plus questionnées sur l’ensemble de leurs pratiques sociales et environnementales.
Les grandes entreprises privées, n’inspirent souvent qu’une confiance mitigée comme le montre par exemple l’extrait suivant de la vague 11 du Baromètre de la confiance politique (2020).
La communication des grands groupes est régulièrement mise en doute : en France, un prix Pinocchio a été créé, pour dénoncer le « greenwashing ». Des applications en ligne, telle MoralScore évaluent les entreprises au regard de différents critères (environnement, contribution sociale, respect de la vie privée, conditions de travail etc.). Les étudiants manifestent de plus en plus de recul voire de rejet pour certaines grandes entreprises, et grands groupes ce qui se manifeste par des difficultés croissantes de recrutement.
Comme on le voit dans le baromètre ci-dessous, les dirigeants des grandes entreprises ont plutôt une mauvaise image auprès du public, contrairement aux dirigeants des PME.
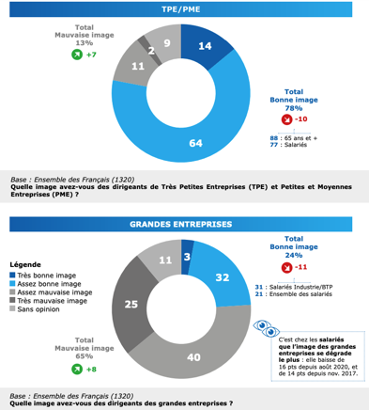
Source Baromètre de la relation des Français à l’Entreprise – Une enquête Elabe pour l’Institut de l’Entreprise – Edition 2023
L’entreprise, carrefour de coopérations et de conflits
L’entreprise est d’abord un lieu de coopération, c’est sa raison d’être.
Si une entreprise est créée c’est que son ou ses créateurs pensent que le regroupement de compétences et de capitaux financiers qu’il(s) imagine(nt) sera plus efficace que leurs actions individuelles, même organisées par des contrats.
Au sein de l’entreprise, les coopérations sont effectives, nécessaires et favorisées par le principe même de l’organisation. Les relations entre les salariés ne sont généralement pas l’objet de contrats précis, chacun a des marges d’appréciation et de manœuvre. Même si les intérêts individuels ne sont pas du tout absents, l’entreprise stimule les services croisés : tu peux me rendre ce service, à charge de revanche…
L’entreprise est aussi un lieu de conflits ou de tensions :
- entre le « patron » et les salariés, le premier devant incarner l’intérêt de l’entreprise (et parfois des détenteurs de capitaux) parfois au détriment de certains salariés ;
- entre l’entreprise et ses fournisseurs/prestataires de service où chacun a des intérêts opposés (les fournisseurs veulent vendre au mieux à leur client (l’entreprise) qui elle veut acheter au mieux…) ;
- entre les salariés où les limites de la coopération peuvent se révéler quand il est question de hausses de salaires, de primes, de promotions et de pouvoirs.
L’art du management (des milliers de livres, de séminaires, de formations sont vendus dans le monde sur ce sujet) c’est précisément de favoriser la coopération sans annihiler l’émulation, l’initiative, et la reconnaissance de celles et ceux qui contribuent le plus et le mieux à ce que l’entreprise atteigne ses objectifs. C’est aussi l’art d’arbitrer les inévitables conflits dont l’entreprise est porteuse.
Syndicats et représentants du personnel
Le plus souvent, l’entreprise est dirigée par les représentants de ses actionnaires (voir l’Essentiel 4 sur les différentes formes de gouvernance25). Ses salariés sont représentés dans et autour des entreprises par des structures chargées de défendre leurs intérêts, de participer à certaines négociations et qui peuvent, le cas échéant, engager un rapport de forces avec les dirigeants. Cette réalité s’est construite et n’est pas née spontanément. Par ailleurs, ces structures ont plus ou moins de poids et de pouvoir selon les époques et selon les pays.
Le développement du syndicalisme a permis d’obtenir des droits sociaux
Le capitalisme au XIXe siècle et au début du XXe siècle a évolué sur le plan social principalement du fait de conflits visant à obtenir des droits sociaux.
Les années 1880 ont marqué la naissance du syndicalisme en Europe, dans une période marquée par la notion de lutte des classes (entre le prolétariat et le patronat). Il s’est développé au sein de grands sites industriels, où le travail humain a été progressivement parcellisé pour augmenter sa productivité, puis de plus en plus mécanisé, automatisé, et enfin robotisé. En engageant un rapport de forces avec les gouvernements notamment via la grève, les syndicats ont contribué à obtenir des avancées sociales et une amélioration des conditions de travail.
Quelques étapes des avancées sociales en France
- 1841 : Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans.
- 1864 : Droit de grève toléré.
- 1874 : Création de l’inspection du travail.
- 1884 : Loi Waldeck-Rousseau autorisant la création de syndicats.
- 1892 : Temps de travail des femmes limité à 11h et interdit la nuit.
- 1898 : Responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident du travail.
- 1900 : Temps de travail limité à 10h.
- 1906 : Loi instaurant le repos dominical (qui avait été supprimé en 1880).
- 1910 : Retraites ouvrières financées par les employés, les employeurs et l’État.
- 1919 : Temps de travail limité à 8h.
- 1936 : Semaine de quarante heures, congés payés, droit de se syndiquer librement, instauration du délégué du personnel, loi sur les conventions collectives de travail.
- 1941 : Instauration du régime de retraite par répartition et du minimum vieillesse.
- 1944 : Création du régime général de la sécurité sociale conformément au programme du Conseil national de la Résistance.
- 1946 : Reconnaissance du droit à l’emploi et du droit de grève dans le préambule de la constitution de la IVe République (repris dans celui de la V7 République).
- 1950 : Instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui devient le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 1970.
- 1956, 1963 : 3è et 4è semaines de congé payé.
- 1982 : 5è semaine de congé payé + loi sur les 39h hebdomadaires + Lois Auroux sur le droit d’expression et la négociation collective.
- 1983 : Age légal de la retraite à 60 ans.
- 1986 : Création du Revenu minimum d’insertion.
- 1998 : Semaine de 35h (Loi Aubry)
- 1999 : Couverture maladie universelle.
Source En savoir plus sur la page Politique sociale en France de Wikipédia
Le pouvoir syndical, est encore très puissant pendant les 30 Glorieuses (1945-1975) avec des différences notables selon les pays : certains particulièrement dans l’Europe du Nord, connaissant des taux de syndicalisation beaucoup plus importants que d’autres.
Taux de syndicalisation, 1961 – 2000
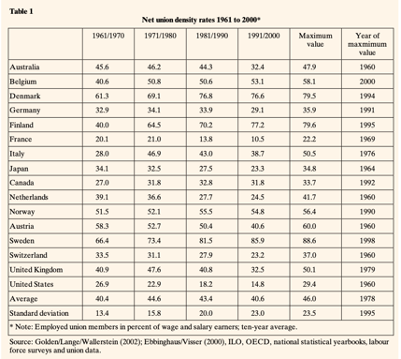
Source Trade Union Density in International, Institute for Economic Research, Munich, 2004
Part de membres de syndicats parmi les personnes salariées, moyenne sur 10 ans.
Au cours des dernières décennies, les taux de syndicalisation refluent un peu partout (voir base de données sur la syndicalisation de l’OCDE 2000-2020). C’est particulièrement le cas en France il s’effondre à partir de la fin des années 1970 pour stagner autour de 10%26. Par ailleurs, une étude de la Direction des statistiques du ministère du travail (DARES) de 2017 montre l’affaiblissement de la participation des salariés aux activités syndicales avec un net décrochage autour de 2010.
Les causes du recul syndical sont variées et diffèrent selon les pays :
- le déclin des activités industrielles et manufacturières, l’externalisation croissante dans les grands groupes, le développement de l’intérim sont autant de facteurs empêchant les travailleurs de se regrouper ;
- des évolutions culturelles et idéologiques (avec une individualisation et un consumérisme croissant dans la société concomitant d’un déclin plus général des activités militantes) ;
- des changements programmatiques au sein des partis politiques, des conditions de travail et de rémunération, et des lois « sociales » ;
- le peu de représentativité des syndicats dans les pays comme la France où ils représentent de moins en moins de salariés.
Parallèlement au développement du syndicalisme, des lois sociales ont accru la place des représentants du personnel au sein de l’entreprise
Cette place reste cependant le plus souvent limitée. Dans l’exemple français que nous détaillons ici, les représentants du personnel ont un pouvoir d’expression (et en outre pas forcément de l’ensemble des salariés…), pas toujours de consultation et encore moins de co-détermination ou de co-décision.
Si le code du travail, né en 1910, n’a cessé d’évoluer, les lois Auroux de 1982 en ont modifié plus d’un tiers. Ces textes constitués de 2 ordonnances et de 4 lois, ont renforcé le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, ont doté le comité d’entreprise d’un budget de fonctionnement, consacré l’obligation d’une négociation collective annuelle et créé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que le droit de retrait.
La dernière grande réforme du droit du travail date de 2017 avec les ordonnances Macron qui ont, sur un plan général, instauré un droit du travail moins favorable aux salariés. Ces ordonnances ont de plus fusionné les différentes instances représentatives existantes (délégués du personnel, CHSCT et comité d’entreprise) dans une instance unique le Comité Social et Économique (CSE), obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
Les missions du CSE consistent essentiellement à présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés (salaire, convention collective, application du code du travail), et à promouvoir de bonnes conditions de travail. Le CSE peut également réaliser des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, saisir l’inspection du travail et dispose d’un droit d’alerte (en cas d’atteinte aux droits des personnes ou à leur santé, en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il est obligatoirement consulté sur certaines questions relatives à la vie de l’entreprise, à sa stratégie et à l’emploi27 mais l’employeur reste libre de tenir compte ou pas de cet avis.
Les questions environnementales ont fait une entrée tardive dans le droit d’expression des salariés
Les CHSCT devaient être réunis en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant (ou ayant pu) porté atteinte à l’environnement et aux salariés. En 2017, la création du CSE élargit le droit d’alerte aux atteintes à l’environnement.
La loi climat et résilience (art 40) de 2021 élargit les mission du CSE en précisant que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il assure une expression collective des salariés sur les décisions des dirigeants de l’entreprise « notamment au regard de [leurs] conséquences environnementales » (art. L2312-8 du code du travail). Enfin, les enjeux de la transition écologique sont intégrées aux négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Enjeux et variété de la Gouvernance
Comme nous l’avons vu dans l’Essentiel 1, l’entreprise désigne avant tout une réalité socio-économique. Elle peut avoir pour support juridique soit une personne physique (entrepreneur individuel), soit une (ou plusieurs) personne morale (société, coopérative, mutuelle etc.). Nous nous intéressons ici essentiellement aux personnes morales puisque le gouvernement (ou la gouvernance) de l’entreprise implique l’existence d’une structure collective.
Nous avons défini le gouvernement de l’entreprise comme « un ensemble de dispositions légales, réglementaires ou pratiques qui délimite l’étendue du pouvoir et des responsabilités de ceux qui sont chargés d’orienter durablement l’entreprise », étant entendu qu’orienter l’entreprise signifie « prendre et contrôler les décisions qui ont un effet déterminant sur sa pérennité et donc sa performance durable ».
Nous allons voir que la gouvernance concerne différents types de pouvoirs, et que selon les formes d’organisation juridique des sociétés privées, les actionnaires y tiennent un rôle plus ou moins important.
Les quatre pouvoirs de la gouvernance
Dans son livre, La gouvernance d’entreprise (PUF, 2018), Pierre-Yves Gomez décompose les responsabilités liées à la gouvernance en quatre pouvoirs qui sont représentés dans le schéma ci-après.
Cette typologie lui permet d’analyser chaque gouvernance organisationnelle en fonction de deux questions clefs : qui détient chacun de ces pouvoirs, formellement ou tacitement ? Comment ces pouvoirs sont-ils exercés par les personnes qui les détiennent ?
Les 4 pouvoirs de la gouvernance d’entreprise
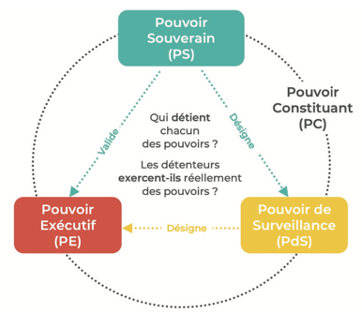
Source Benchmark des nouveaux modèles de gouvernance, Heart Leadership University et Prophil (2022)
Le pouvoir constituant fixe l’ensemble des lois et règles établissant le cadre dans lequel le gouvernement de l’entreprise pourra s’exercer. Il s’agit principalement du cadre juridique national et international. Ce pouvoir est donc principalement exercé par la puissance publique et en particulier l’État.
Le pouvoir souverain est celui qui fonde les autres -en respectant le pouvoir constituant- et assure leur continuité. Il est détenu par les actionnaires dans les sociétés, par les sociétaires dans le cas des coopératives ou des mutuelles, par les membres pour les associations. Parmi ses prérogatives, on retrouve notamment la validation des comptes annuels, de la gestion réalisée par le pouvoir exécutif ainsi que la désignation des administrateurs (qui détiennent le pouvoir de surveillance).
Le pouvoir de surveillance a pour fonction d’administrer l’organisation ce qui implique notamment la responsabilité de désigner ses dirigeants (détenteurs du pouvoir exécutif) et de sélectionner les orientations stratégiques parmi celles qu’ils proposeront et de contrôler les résultats. Ce pouvoir est exercé par le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance.
Le Pouvoir exécutif est exercé par le ou les dirigeants de l’organisation. Il a pour rôle de définir la stratégie et de la mettre en œuvre. Il doit rendre des comptes au détenteur du pouvoir souverain.
Quelle est la gouvernance « classique » des sociétés privées ?
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
L’objectif de la société est donc être de dégager des bénéfices pour ses fondateurs. Pour certains économistes tels Milton Friedman, chef de file de l’école de Chicago28, la maximisation des profits pour l’actionnaire doit même être le seul objectif de l’entreprise.
Un cadre général favorable aux actionnaires
Nous allons voir comment cet objectif se traduit via la concentration des pouvoirs (souverain, de surveillance et parfois du pouvoir exécutif) dans les mains des actionnaires. Cela ne signifie pas que toutes les entreprises sont uniquement guidées par la recherche de « création de valeur » pour les actionnaires, mais que les dispositions générales rendent un tel objectif possible. C’est devenu la situation largement dominante pour les grandes entreprises cotées en bourse.
Le pouvoir souverain est détenu par l’assemblée générale des actionnaires, chacun ayant des droits de vote généralement proportionnels29 aux parts du capital social de la société qu’il détient (voir notre fiche sur le capital pour en savoir plus). Cette assemblée vote les comptes annuels, valide la gestion passée et les projets à venir et élit les membres du Conseil d’administration (CA), détenteur du pouvoir de surveillance30.
Les administrateurs ont des pouvoirs très étendus, précisés dans les statuts. A minima, le CA élit son Président parmi ses membres, désigne le directeur général de l’entreprise qui exercera le pouvoir exécutif, et contrôle la gestion de l’entreprise. Dans certaines entreprises, ces deux fonctions sont assumées par une seule personne, le Président-directeur général.
Ce cadre général peut donner des situations très différentes selon la façon dont chacun de ces pouvoirs est alloué et exercé
Par exemple, dans une entreprise familiale les pouvoirs sont souvent concentrés dans les mains du fondateur et éventuellement de ses proches. C’est très différent d’une société anonyme cotée en bourse où les actionnaires n’ont le plus souvent aucun lien avec la création de l’entreprise. Par ailleurs, selon la concentration de l’actionnariat (ex : quelques gros actionnaires ont la quasi-totalité des droits de vote, ou à l’autre extrême un actionnariat très diffus avec une multitude de petits actionnaires), l’exercice de la gouvernance ne sera pas le même.
Dans certains cas, le pouvoir constituant a donné beaucoup plus de place aux salariés.
En Allemagne (et de nombreux pays européens selon des dispositions variées31) la « codétermination » a été mise en place depuis les années 1970 : les salariés sont présents au CA et peuvent représenter 50% des membres (pour les entreprises de plus de 2000 salariés). Ils ne sont cependant jamais majoritaires (la voix du Président comptant double et n’ont donc pas la possibilité de prendre des décisions sans obtenir l’accord d’au moins un administrateur représentant les actionnaires.
En France, dans les entreprises employant plus de 1 000 personnes, les salariés nomment un à deux administrateurs chargés de les représenter et disposant des mêmes obligations et responsabilités que les représentants des actionnaires.
Il est important de bien différencier la co-détermination (où les salariés détiennent une partie du pouvoir de surveillance via leurs représentants au CA) et les instances de représentation du personnel au sein de l’entreprise qui ont le plus souvent uniquement un pouvoir consultatif. En France, le Comité social et économique (CSE) n’est obligatoirement consulté que dans certains cas spécifiques. De plus, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte l’avis rendu.
La gouvernance des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
S’il n’existe pas de définition formalisée de l’ESS, les contours du concept font assez largement consensus. Selon l’OCDE, l’ESS regroupe un ensemble d’organisations dont l’activité est « motivée par la réalisation d’objectifs sociétaux, par les valeurs de solidarité, la primauté des personnes sur le capital, et, dans la plupart des cas, par une gouvernance démocratique et participative ».32
En France, le cadre juridique fixé par la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire retranscrit bien cela. L’ESS est « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine » auquel les entreprises choisissent d’adhérer moyennant le respect de plusieurs conditions :
- poursuivre un objectif autre que le seul partage des bénéfices ;
- une gouvernance démocratique, prévue dans les statuts ;
- les bénéfices ou « excédents » sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise et les réserves obligatoires ne peuvent pas être distribuées.
On peut dire en simplifiant que l’ESS se caractérise par la priorité donnée aux personnes et par la limitation de la lucrativité (pour la part des structures de l’ESS qui sont à but lucratif).
Les entreprises de l’ESS sont au service des personnes et le font valoir ; elles n’ont pas à rémunérer de capital et ne sont pas dirigées par les représentants des apporteurs de financement.
Cette lucrativité limitée permet de protéger les structures de l’ESS des cessions et autres restructurations liées aux opérations « capitalistiques » (c’est-à-dire ayant pour objet principal de dégager de la valeur pour les actionnaires ou propriétaires de parts sociales).
Cependant, cela signifie également que ces structures ne peuvent attirer de manière massive l’épargne des ménages car elles ne rémunèrent ni le risque, ni le fait de se priver de l’usage immédiat de l’argent placé, ni le coût d’opportunité (le gain lié aux options d’investissement alternatives).33
Quelles sont les structures de l’économie sociale et solidaire ?
La loi distingue :
- les acteurs statutaires qui relèvent automatiquement de l’ESS de par leur statut : les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations ;
- les entreprises ayant reçu l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) qui sont des sociétés commerciales répondant aux critères ci-avant.
Toutes les structures de l’ESS ne sont donc pas des organisations à but lucratif.
Plus de détails sur les différents types de structures sur le site de BPI France.
Sans entrer dans le détail de tous les types de structures, nous nous concentrons ici sur deux exemples.
La société mutuelle (ou mutuelle34) est, en droit français, « une personne morale de droit privé à but non lucratif », immatriculée au Registre national des mutuelles et soumise aux dispositions du Code de la mutualité. Elle ne verse pas de dividende et l’intégralité des bénéfices est investie en faveur des adhérents.
Les mutuelles ont comme objectif la couverture des risques (santé, assurances diverses). Les adhérents sont les clients de la mutuelle. Ils élisent, selon le principe un adhérent une voix, des délégués qui, rassemblés en assemblée générale35, élisent à leur tour les membres du Conseil d’administration (également adhérents de la mutuelle). Celui-ci dispose des prérogatives spécifiques au pouvoir de surveillance (voir les détails dans le code de la mutualité) et notamment le fait de désigner le dirigeant opérationnel. Comme on le voit, les adhérents jouent ici le même rôle que les actionnaires d’une société. À noter cependant, que le pouvoir souverain est par construction très dilué en raison du principe un adhérent une voix.
Les coopératives
Le socle juridique de toutes les coopératives est fixé par la loi de 1947 portant statut de la coopération qui définit la coopérative comme « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. » (Art. 1)
Chaque coopérateur dispose d’une voix à l’assemblée générale et les profits doivent être prioritairement réinvestis dans la coopérative. Il est cependant possible de verser les excédents à leurs membres associés, dans des conditions définies par les lois spécifiques à chaque type de coopérative.
Il existe plusieurs grands types de coopératives
Toutes les coopératives n’ont pas toutes la même forme juridique : par exemple, les SCOP et les SCIC prennent la forme de société anonyme ou de SARL alors que les coopératives agricoles « forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales » (voir art. L521-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Notons, enfin, que les coopératives rassemblent des structures à l’objet très divers dont on peut, pour certaines, se poser la question de l’utilité sociale (si ce n’est dans leur objet au moins dans la mise en œuvre). Ainsi, le Crédit Agricole est une banque coopérative36. C’est aussi l’une des quatre banques systémiques françaises.
La gouvernance des SCOP (Société coopérative et participative)
Dans une SCOP, les salariés sont au centre de la gouvernance. Ils doivent détenir au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote qui s’organisent selon le principe « une personne, une voix ». Ainsi, les salariés prennent les décisions qui les concernent au premier chef, notamment en élisant les dirigeants de la SCOP et en validant les grandes orientations stratégiques lors de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les bénéfices sont obligatoirement partagés en trois parts : la « part entreprise » désigne les réserves impartageables, qui restent dans l’entreprise ; la « part travail » est redistribuée aux salariés ; et la « part capital » est reversée aux associés (salariés et non-salariés) sous forme de dividendes ;
En 2023, il y avait environ 2697 Scop en France, regroupant 60 000 salariés (dont 70% de salariés associés) et générant un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros. Si elles sont en général de petite taille, elles comptent également de très grosses entreprises quelquefois multinationales, comme le groupe Up (ex-Chèque déjeuner). Autre élément de distinction entre les Scop : certaines sont très militantes, ont un projet de transformation sociale ; d’autres sont avant tout soucieuses de résultats économiques.
En savoir plus : Anne-Catherine Wagner Coopérer. Les Scop et la fabrique de l’intérêt collectif, CNRS éditions, 2022 ; Reprise d’entreprise par les salariés : les leçons de Duralex et de Brandt, Alternatives Economiques, 2025 ; Le site de la Confédération générale des Sociétés coopératives.
Des modèles alternatifs de sociétés commerciales « classiques »
Au-delà de l’ESS, il existe des formes de gouvernance permettant de faire en sorte que, sans que le profit soit rejeté, sa maximisation ne soit pas la boussole prioritaire des dirigeants.
Ces alternatives sont plus profondes que l’affichage de bonnes pratiques de responsabilité sociale et environnementales, restant subordonnées à l’impératif de rentabilité maximale. Il s’agit de statuts alternatifs ou de dispositions juridiques spécifiques qui permettent que l’entreprise ne soit pas asservie à la seule performance financière, sans abandonner pour autant la possibilité de réaliser des profits et de rémunérer le capital.
Les fondations actionnaires
Né en Europe du Nord dans les années 192037, le modèle de « fondation actionnaire » est un modèle de propriété et de gouvernance d’entreprise qui répond à la volonté des actionnaires (souvent les fondateurs) d’une société commerciale de préserver le projet de l’entreprise et de la protéger sur le long terme (contre les rachats hostiles, les exigences de rendements etc.)
Concrètement, les actionnaires donnent à une fondation leurs parts sociales (en partie ou en totalité) et les droits de vote qui y sont associés, dans une proportion qui peut varier (ce n’est pas nécessairement une part = une voix) et dont le nombre détermine le pouvoir de décision de la fondation, en tant qu’actionnaire, sur la stratégie de l’entreprise.
N’appartenant à personne et ne pouvant donc être rachetée, la fondation protège ainsi le capital de l’entreprise et son projet en fonction du mandat qui lui est donné. Elle est par définition un actionnaire d’intérêt général, stable et de long terme. Grâce aux dividendes ou à d’autres dons, elle peut exercer en parallèle une mission philanthropique en soutenant des causes d’intérêt général.
La fondation actionnaire n’est pas en compétition avec d’autres actionnaires pour exiger des rendements plus élevés ; elle peut donc faire preuve de « tempérance » en la matière, d’autant qu’elle a un intérêt objectif à assurer la pérennité de l’entreprise qui est sa source durable de financement.
Certaines fondations sont susceptibles de se passer de dividendes ; d’autres définissent des règles de répartition des dividendes visant à garantir le financement du développement de l’entreprise détenue.
Mais « statut ne fait pas vertu », et certaines fondations actionnaires reçoivent des dividendes significatifs. Par ailleurs, le fait d’avoir une fondation actionnaire au capital n’est évidemment pas un gage d’optimisation des performances environnementales et sociales.
En France38, les sociétés Adam, Naos, Léa nature, les Laboratoires Pierre Fabre, l’Institut Mérieux, par exemple, sont détenues en partie par des fondations actionnaires. En Europe, de nombreuses autres entreprises sont dans le même cas : Baur, BMW, Bosch, Carlsberg, Electrolux, Lego, Maersk, Migros, Rolex, Saab, SEB, Velux,Victorino, Carl Zeiss (l’une des premières)…
Les sociétés à mission
Suite au rapport Notat-Sénard39, la loi Pacte de 2019 a introduit le concept de société à mission40, sur le modèle de ce qui existait déjà aux États-Unis.
Quand une société souhaite obtenir cette qualité, elle doit définir dans ses statuts une raison d’être et des objectifs d’impact social et environnemental. Elle doit également se doter d’un « comité de mission » composé de différentes parties prenantes en charge de suivre et d’évaluer l’exécution de la mission (par ailleurs contrôlée par un organisme tiers indépendant accrédité).
La société à mission est une avancée car elle permet aux dirigeants de s’opposer de manière constructive aux éventuelles pressions d’actionnaires pour plus de rentabilité si elles contredisent la mission et inversement. En juin 2024, il existe près de 1650 sociétés à mission, principalement des PME mais aussi quelques ETI et quelques grandes entreprises.
À noter que la loi Pacte a également créé une nouvelle forme d’actionnariat via le « fonds de pérennité », structure hybride, jouissant de la personnalité morale, permettant la détention et la transmission de titres de société (c’est sa vocation première) et qui peut soutenir des causes d’intérêt général.
Le mouvement du steward ownership
Le concept de « steward ownership » a été forgée par la Purpose Foundation41 pour proposer une « troisième voie » aux entreprises, entre primauté de l’actionnaire et non-lucrativité.
Ce modèle poursuit les objectifs suivants :
- replacer les personnes réellement impliquées dans l’entreprise au cœur de la gouvernance ;
- aligner les structures de gouvernance sur une vision de long-terme, au service de la mission de l’entreprise ;
- lier les droits de vote à d’autres intérêts que les seuls intérêts financiers ;
- proposer une nouvelle forme de succession, qui assure la pérennité d’une entreprise au-delà de son fondateur tout en limitant la propagation des inégalités par l’héritage via la démocratisation du capital.
Ce modèle est organisé autour de deux principes :
- « Self-governance » : le contrôle de l’entreprise demeure en son sein, aux mains de personnes directement impliquées dans sa mission.
- « Profits serve purpose » : les profits servent la mission et sont réinvestis dans l’entreprise, auprès des parties-prenantes ou mis au service d’actions philanthropiques. Une « juste compensation » (limitée) est offerte aux investisseurs.
Il peut se matérialiser via deux familles de dispositifs :
- la structure de l’actionnariat : la fondation actionnaire, le perpetual purpose trust
- des mécanismes statutaires : création d’actions sans droit de vote pour les investisseurs (à dividende préférentiel), actions à double droit de vote et/ou sans dividende octroyées aux parties prenantes de long-terme, golden share (action à droit de veto) confiée à un organisme tiers (fondation, État, ONG, etc.) pour garantir la poursuite de la mission, etc.
A ce jour, une centaine d’entreprises ont été accompagnées par la Purpose Foundation, comme Bosch, Novo-Nordisk, Mozilla ou Stapelstein42… La Purpose Foundation cite plusieurs études43 qui constatent un meilleur taux de survie et une meilleure performance financière des entreprises détenues par des fondations au Danemark (pays précurseur en matière de fondations actionnaires).
Il est cependant encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la question de savoir si ces nouveaux modèles conduisent à mieux intégrer les limites planétaires dans les décisions prises ; ils sont en outre aujourd’hui limités en nombre, par leur caractère « volontaire » et par certaines difficultés juridiques (en France). Ils ont cependant l’immense mérite de montrer que recherche du profit comptable (voir notre module sur la comptabilité de l’entreprise) et de l’intérêt général ne sont pas irréconciliables.
Pour en savoir plus
- La gouvernance d’entreprise, Pierre-Yves Gomez, PUF, collection Que sais-je ?, 2018
- Les travaux de recherche de l’association Heart Leadership University sur la gouvernance
- Les travaux de recherche du cabinet Prophil sur les Fondations actionnaires et les sociétés à mission
- Steward-Ownership. Rethinking ownership in the 21st century, Purpose Foundation, 2019
- Structure et diversité des modèles actuels de gouvernement d’entreprise – Partie I et II, Christophe Clerc, rapports pour l’OIT, 2020
- L’économie sociale et solidaire. Timothée Duverger, La Découverte, 2023
- Codétermination : les salariés ont leur mot à dire, Podcast de France Culture, 2024
La focalisation sur la maximisation du profit pour l’actionnaire pose de nombreux problèmes écologiques et sociaux
A partir des années 1970, l’idée selon laquelle l’entreprise doit avoir pour objectif premier de maximiser ses profits pour rémunérer ses actionnaires (voir l’Idée reçue 2)44 s’impose peu à peu que ce soit dans la littérature académique, dans le discours des décideurs politiques et économiques ou dans les pratiques des grandes entreprises Cette doctrine, qui a pour beaucoup la force de l’évidence, se traduit dans les faits par de nombreux impacts négatifs, ou au moins par une forte tension entre exigence de rentabilité financière et respect de contraintes environnementales et/ou sociales.
Rendement attendu du capital financier et limites planétaires
Une entreprise soumise à des exigences de rentabilité financière élevée45 est nécessairement dirigée avec une forte pression, quelle que soit la qualité humaine du dirigeant et son talent managérial.
Définition – Qu’est-ce que le rendement attendu du capital financier ?
Lors de la création d’une entreprise, le ou les fondateurs apportent des ressources46 pour constituer le capital social de l’entreprise. Celui-ci est divisé en actions (ou parts sociales), attribuées aux fondateurs (dès lors, dénommés actionnaires) en proportion de leur contribution. La détention de ces actions donne des droits de participation aux décisions de l’assemblée générale de la société et des droits financiers (via le versement de dividendes). Une fois émises, les actions peuvent être vendues soit lors d’échanges bilatéraux, soit publiquement sur des marchés organisés (bourses).
Pour les actionnaires, ce capital est un placement qui peut d’une part rapporter des revenus par la distribution de dividendes quand l’entreprise fait des bénéfices, et d’autre part se valoriser si la valeur des actions augmente (s’il les vend, leur propriétaire réalise une plus-value). Le rendement du capital c’est ce qu’il rapporte à l’actionnaire sous au moins une de ces deux formes.
Si une entreprise est cotée en Bourse c’est parce qu’elle promet un rendement, généralement élevé, pour attirer les investisseurs. Contrairement à une idée reçue, ce rendement attendu ne se traduit pas nécessairement par des gains financiers immédiats (des dividendes) pour l’actionnaire. La promesse de rendements élevés peut être tenue par la seule valorisation des actions (qui peut résulter d’éléments différents, comme la notoriété de la marque, la croissance des ventes etc.). C’est ce qui explique que les actions d’entreprises comme Amazon ou Tesla aient connu des valeurs élevées alors que les entreprises elles-mêmes étaient déficitaires.
Face à de telles exigences, les contraintes environnementales et sociales dont le respect n’est pas rendu strictement obligatoire par le législateur passent généralement au second plan, car elle sont de nature à affaiblir la rentabilité à court terme donc le rendement des capitaux.47
Même quand il existe des normes, les dirigeants peuvent chercher à les contourner, que ce soit en externalisant ou en délocalisant une partie de leur activité dans des pays aux normes sociales et environnementales moins élevées, ou en fraudant (comme l’a montré, par exemple, le « dieselgate »).
Cela ne signifie pas que toutes les entreprises soumises à de fortes exigences de rendement, ne font rien en matière environnementale ou sociale. Tout d’abord certaines activités à impact positif pour l’environnement peuvent connaître des croissances importantes et des valorisations financières élevées. Ensuite, la pression des consommateurs peut constituer un moteur. Les scandales sanitaires, les désastres sociaux (comme l’effondrement du Rana Plaza en 2013) ou environnementaux peuvent ainsi faire évoluer les dirigeants, sous la pression des consommateurs, mais c’est le plus souvent d’avantage dans une démarche réactive que proactive. Enfin, l’anticipation de tensions sur les matières premières peut conduire des dirigeants à encourager la sobriété d’usage ou à accélérer le recyclage sans empêcher le maintien de bénéfices significatifs.48
Mais à l’évidence il s’agit aujourd’hui d’exceptions. La meilleure preuve en est que malgré de nombreuses déclarations d’intention, notre économie « tirée » par les grandes multinationales (dont le pouvoir est excessif, voir l’Essentiel 10) est encore très (et beaucoup trop) extractive et carbonée.
Enfin, le taux de rémunération attendu du capital est déterminant pour le financement de la transition écologique. Les taux actuels du capitalisme financier sont largement excessifs et reconnus comme tels. Ils sont en général bien supérieurs à ceux que la plupart des projets d’investissement écologique peuvent délivrer. Ce n’est cependant pas une fatalité : d’une part, ces taux ont été plus bas dans l’histoire économique ; d’autre part il existe des entreprises qui ne sont pas soumises à une telle pression. Les structures de l’économie sociale et solidaires, les mouvements des entreprises à mission, de la purpose-economy ou du steward ownership que nous avons présentées dans l’Essentiel 4 sur les différentes formes de gouvernance d’entreprise visent précisément à se soustraire à cette « tyrannie du rendement ».
Une conception très étroite de la valeur créée par l’entreprise
En réaction à l’influence grandissante de la théorie de la maximisation de la valeur pour l’actionnaire, de nombreux travaux ont été développés pour dénoncer la baisse depuis les années 1980 de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée aux Etats-Unis et en Europe49 ; et pour affirmer l’importance du partage de la valeur entre actionnaires et salariés. Les multiples scandales sur les dividendes versées par les grandes entreprises ainsi que sur les rachats d’action viennent régulièrement alimenter ces débats.
Qu’est-ce que la valeur ajoutée ?
En comptabilité d’entreprise, la valeur ajoutée c’est le chiffre d’affaires moins les consommations intermédiaires (achats de biens et services nécessaires à la production). C’est un indicateur de gestion qui permet de mesurer la valeur financière que l’entreprise génère une fois qu’elle a payé tous ses fournisseurs et prestataires. Elle est partagée entre la rémunération des salariés, les impôts et taxes, les investissements et la rémunération du capital (la dette et les dividendes).
Au niveau macroéconomique, le PIB est composée de la somme de la valeur ajoutée générée par tous les acteurs économiques publics et privés. Cette valeur ajoutée est là aussi répartie entre rémunération des salariés, rémunération du capital, investissement et prélèvements publics.
Source Pour en savoir plus voir notre module sur le comptabilité d’entreprise et celui sur le PIB, la croissance et les limites planétaires.
Le sujet du partage de la valeur gagne à être élargi au-delà de la seule question du capital et du travail. En effet, les promoteurs de la valeur actionnariale identifient la « valeur créée par l’entreprise » au profit ce qui est très restrictif. C’est bien plus le chiffre d’affaires qui représente cette valeur, celle pour laquelle les clients paient.
Considérée ainsi, il est évident que la valeur est partagée entre toutes les parties prenantes : les fournisseurs et prestataires de service, les salariés, la collectivité publique via l’impôt et les charges sociales, les actionnaires via les dividendes, les banquiers le cas échéant et enfin l’entreprise elle-même (investissements, développement).
Chacune de ces parties prenantes reçoit « sa part » en fonction soit de réglementations (fiscalité, métiers réglementés, politique monétaire), soit du « marché » (plus ou moins réglementé, plus ou moins oligopolistique) et des rapports de force qui en découlent (entre travailleurs, dirigeants et actionnaires, entre donneurs d’ordre et fournisseurs etc.). C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles l’entreprise est source de coopérations et de conflits (voir l’Essentiel 3) : c’est grâce à l’action coordonnée que permet l’entreprise que les uns et les autres « reçoivent » leur part, la part de chacun étant limitée par celle des autres.
Raisonner de façon binaire, en opposant travail et capital, revient à oublier toutes les autres parties prenantes qui pâtissent également de la doctrine de maximisation actionnariale : les fournisseurs et prestataires dont on va exiger les prix les plus bas, la collectivité publique via les pressions pour réduire les impôts pesant sur les entreprises, ou pour amoindrir les normes imposées à l’entreprise pour limiter ses nuisances.
Ajoutons enfin que si la valeur financière est la métrique aujourd’hui dominante, elle n’est qu’une dimension du capital global de l’entreprise et de la valeur tout court : les entreprises ont une plus ou moins grande utilité sociale (cette dernière étant parfois nulle, voire négative) ; elles ont souvent des impacts négatifs sur l’environnement (voir l’Essentiel 9) ; certaines parties-prenantes peuvent préférer une rétribution non-financière (ex : réduction des horaires, formations, contrat annualisé pour un fournisseur…) à une augmentation etc.
Écarts de rémunération et inégalités
Le niveau de rémunération des dirigeants des grandes entreprises fait régulièrement la une de l’actualité. Les hausses constatées en la matière sont notamment la conséquence de la prédominance de la doctrine de la valeur actionnariale qui a conduit à aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires notamment via la rémunération (part variable, bonus, stock option etc. voir l’Idée reçue 2).
Cette question n’est pas neutre en termes de cohésion sociale : quand un dirigeant est payé des dizaines de millions d’euros alors que son entreprise est vendue au plus offrant50 ou s’engage dans la réduction massive des coûts (voire licencie ou délocalise), cela envoie des signaux difficiles à supporter pour beaucoup de citoyens.
C’est encore plus difficile si parallèlement, le gouvernement développe une rhétorique sur les efforts à faire en termes de droits sociaux tels les retraites, le chômage ou plus généralement de réduction des dépenses publiques.
Comment sont fixés les salaires ?
En règle générale, les entreprises fixent les salaires par comparaison aux pratiques observées pour des postes analogues dans des entreprises comparables (taille, secteur d’activité, performance financière etc.). Elles peuvent évidemment faire un peu mieux ou un peu moins bien, selon l’urgence du recrutement et le caractère plus ou moins stratégique de leurs besoins sur les postes considérés. On peut, cependant, dire en première approximation que c’est « la loi du marché » qui s’impose à tous. Un salarié ou une entreprise auront du mal respectivement à être payé et à payer un salaire durablement très différent de la moyenne du marché.
Le « marché » du travail ne rémunère pas forcément un travail en fonction de sa « valeur sociale ». (Sur ce sujet, voir également L’essentiel 8 « Les inégalités ne sont pas toutes injustes » dans notre Module sur les inégalités).
La crise du Covid a bien montré que des métiers essentiels étaient très mal rémunérés et très mal reconnus. A l’inverse, l’anthropologue David Graeber a mis en évidence l’existence de « bullshit jobs« 51, des emplois qui n’ont pas de sens y compris pour les salariés eux-mêmes, alors qu’ils sont bien rémunérés et reconnus. Les salaires exorbitants des stars du football ou du cinéma sont parfois « justifiés » par la « loi du marché », qui ne se soucie ni de morale, ni de cohérence entre valeur sociale du service rendu et rémunération. Il y a là matière à intervention publique, la cohésion sociale étant clairement en jeu dans la croissance d’écarts de rémunération sans fondement sérieux.
Le salaire n’est pas fixé en fonction de la productivité du travail52, contrairement à une idée reçue chez la majorité des économistes. Cette productivité est généralement impossible à mesurer sauf dans des cas très précis et limités. Et elle n’est jamais complètement individualisable : la contribution d’un salarié dépend de l’organisation, des équipements dont il dispose et de ses collègues.
Le salaire peut ne pas être le seul élément de rémunération d’un salarié qui peut comprendre en plus :
- la distribution d’une partie des bénéfices aux salariés : en France c’est le cas de la participation légale pour les entreprises d’une certaine taille ou des accords d’intéressement.
- une prime annuelle liée de manière plus ou moins objective à la performance.
- une participation au capital via de nombreux dispositifs (stock-options, attributions d’actions gratuites, bons de souscription d’action, des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise etc.)53
- des avantages en nature : tickets restaurant, mutuelle payée par l’entreprise, voiture ou logement de fonction etc.
Par ailleurs les dirigeants peuvent se voir attribuer des compléments exceptionnels (une prime de bienvenue, une prime de départ, une « retraite chapeau », etc. ).
Le ratio d’équité : la voie de la transparente pour limiter les écarts de rémunérations
Une des principales voies mises en œuvre à ce jour par les gouvernements pour influer sur les écarts de rémunérations est celle de la transparence : favoriser l’autorégulation des acteurs en rendant les données publiques.
Le ratio d’équité compare la rémunération totale54 du (ou des principaux) dirigeant à la rémunération moyenne des salariés à temps plein dans l’entreprise. Par exemple, si ce ratio est de 100 dans une entreprise, cela signifie que le directeur général gagne 100 fois plus que la rémunération moyenne de ses salariés.
Instauré depuis 2018 aux Etats-Unis et au Royaume Uni, il a été introduit dans les pays de l’Union européenne à la suite de la directive SRD II (2017). Celle-ci a été transposée en France par la loi Pacte de 201955 qui a rendu obligatoire la publication de ce ratio pour les entreprises cotées.56
Le ratio d’équité aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le ratio d’équité serait passé de 20 en 1965, à plus de 300 (voir 400) dans les années 2000 pour « retomber » autour de 200 après la crise financière.
CEO Pay in 2012 Was Extraordinarily High Relative to Typical Workers and Other High Earners – Economic Policy Institute (2013)
Le ratio d’équité en Europe et en France
Rapport entre la rémunération des PDG et le salaire moyen
Le rapport entre la rémunération totale des PDG et le salaire moyen dans 350 entreprises cotées de 11 pays européens en 2015 serait de 96.
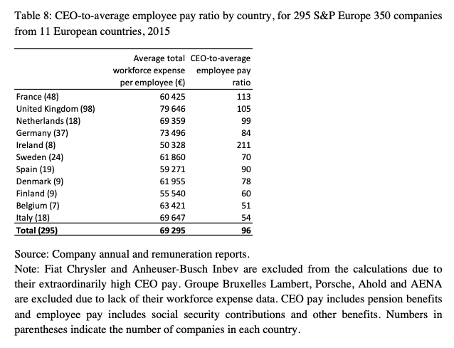
Source Executive compensation in Europe: Realized gains from stock-based pay – INET (2018)
Cet article a ensuite été publié sous une version révisée dans Review of International Political Economy : Patricia Kotnik, Mustafa Erdem Sakinç, Executive compensation in Europe: realized gains from stock-based pay, 2022.
En France, au sein du CAC 40, le rapport entre le revenu moyen des PDG (5 millions d’euros) et la rémunération moyenne de leurs employés était de 53 (72 par rapport à la rémunération médiane) en 2019. Ce chiffre cache des différences importantes d’une entreprise à l’autre : ainsi dans les entreprises Dassault Systèmes et Sanofi le ratio d’équité s’établit respectivement à 268 et à 107.
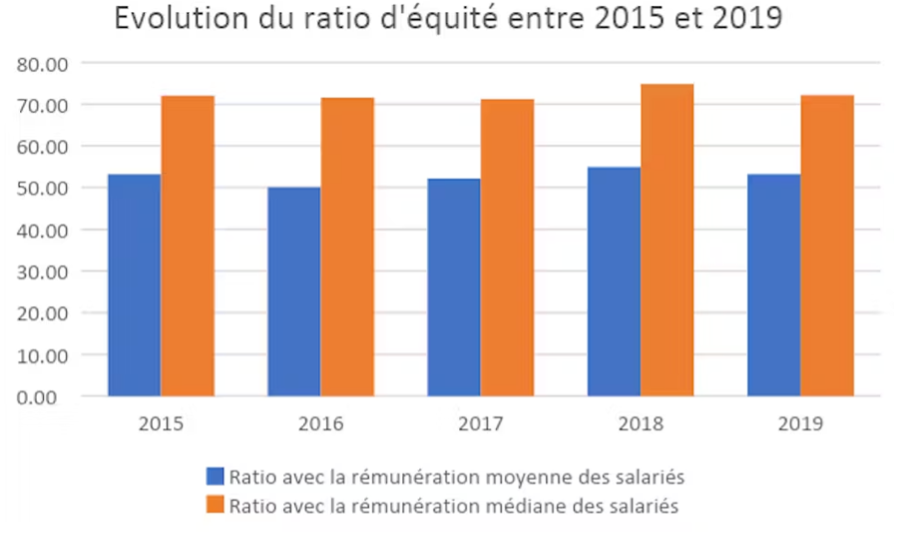
Source Rémunération des dirigeants : la transparence ne fait pas tout, Mohamed Khenissi, Vanessa Serret, The Conversation (27/07/2020).
De nombreuses critiques ont été émises quant à l’intérêt de ce ratio.57
- Les statistiques sont particulièrement sensibles à l’évolution des revenus du seul PDG. Beaucoup plus volatile que la moyenne des salaires, il explique souvent au premier ordre l’évolution des ratios d’équité.
- Comme tout indicateur, ce ratio peut être l’objet d’interprétations. Par exemple, en France, la loi n’ayant précisé de périmètre, il est possible de calculer le ratio d’équité sur la seule société mère qui est souvent une holding comptant quelques dizaines de salariés ce qui conduit à sous-estimer le ratio par rapport à ce qu’il serait on considérant la totalité du groupe. Ainsi, en se fondant sur le seul déclaratif, l’édition 2024 de l’étude Critères RSE et rémunération évalue le ratio d’équité à 73 en 2023 pour les entreprises du CAC 40. « Les calculs de l’agence de conseil en vote Proxinvest Glass Lewis donnent des résultats différents : un ratio moyen de 130 en faveur des dirigeants du CAC 40 pour l’année 2022 »« . »58
- Le ratio d’équité se limite à la comparaison entre la rémunération des principaux dirigeants (voire du seul PDG) et la moyenne des revenus. Il serait bien plus intéressant de comprendre la répartition des revenus de manière plus détaillée en particulier les écarts entre le premier décile ou centile (selon les effectifs) et les autres déciles au sein de l’entreprise, comme toute mesure des inégalités .
Enfin, et c’est la dimension la plus importante, la transparence et la bonne volonté des acteurs, ne suffisent pas pour atteindre l’objectif de limitation des écarts de revenus
Plusieurs années après sa mise en place en France, le ratio d’équité n’a pas produit d’effet tangible sur les écarts de rémunération. Très peu d’investisseurs s’en sont saisis comme d’un outil de gouvernance actionnarial, et l’impact sur le grand public est faible.58
Seules des actions volontaires de la puissance publique permettraient d’avoir un impact réel comme l’ont proposé Gaël Giraud et Cécile Renouard (en proposant d’établir un ratio de 12 entre le salaire maximal et le salaire minimal).
Cela peut passer par le plafonnement des rémunérations. En France, depuis 2012 dans les entreprises publiques la rémunération des dirigeants nommés par le ministre de l’économie (c’est-à-dire les mandataires sociaux et en particulier le DG ou le PDG) ne peut excéder un plafond fixé à 450 000 euros.60
Il est également possible d’utiliser l’impôt sur le revenu. A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la dernière tranche de l’impôt sur le revenu a atteint des sommets aux États-Unis limitant dans une certaine mesure l’intérêt des très hautes rémunérations : à la veille de l’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir (1981), le taux d’imposition pour un célibataire était de 70% sur la tranche de revenu au-delà de 460 000 dollars.61
Comment se finance une entreprise ?
L’entreprise est un organisme vivant qui naît, se transforme et peut disparaître. À toutes les étapes de son existence, la question du financement est vitale.
Créée par ses fondateurs, elle vit et se développe en fonction de son environnement, de ses parties prenantes et des décisions prises par ses dirigeants. Elle peut évoluer fortement soit de manière organique en développant son activité (par des embauches, l’achat de nouveaux équipements etc.), soit par l’acquisition (ou la fusion avec) d’autres entreprises, soit par des cessions partielles ou totales de certaines de ses activités. Elle peut aussi mourir, si elle n’est plus rentable ou si le dirigeant ne trouve pas de repreneur. Une autre cause possible est le manque de trésorerie, c’est-à-dire d’argent disponible pour que l’entreprise puisse respecter ses engagements financiers (paiement des factures fournisseurs, des impôts et taxes, des salaires, des frais bancaires, etc.). Elle se trouve alors en situation de « cessation de paiement »), ce qui est une cause de faillite pouvant conduire à la dissolution de l’entreprise.
Dans cette partie, nous allons voir quels sont les besoins de financement d’une entreprise et comment ils peuvent être satisfaits et quel est leur impact sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise.
Pourquoi les entreprises ont-elles besoin de financement ?
On distingue en général :
- les besoins de long terme pour financer les investissements nécessaires à la création et au développement de l’entreprise ;
- les besoins de court terme pour financer le cycle d’exploitation.
Financer la création et les investissements : les besoins de long terme
Toute création d’entreprise implique des investissements qui peuvent être importants si l’entreprise est fortement capitalistique (ex : développement d’activités industrielles, mise au point de médicaments etc.) ou très limités (ex : consultant indépendant qui n’a besoin que d’un ordinateur). Les investissements initiaux peuvent également servir à financer les premiers stocks.
Ensuite, au cours de la vie de l’entreprise de nouveaux investissements peuvent être nécessaires pour acheter de nouvelles machines, s’implanter dans d’autres régions ou à l’international, concevoir de nouveaux produits, développer des plateformes informatiques etc.
Définition – Qu’est-ce qu’une entreprise fortement capitalistique ?
Il s’agit d’une entreprise qui utilise beaucoup de capital productif pour générer son chiffre d’affaires : les machines, les bâtiments, l’achat de brevet, de fonds de commerce, la recherche et développement, la création de base de données etc. Par extension, cette expression désigne également le besoin en ressources financières (autofinancement, capital apporté par les actionnaires, dette, subventions) pour financer ce capital productif.
On retrouve ici toute l’ambiguïté du mot capital :
- Le « capital productif » se situe à l’actif du bilan62 d’une entreprise (ce sont les immobilisations).
- Le « capital social » de l’entreprise, situé au passif du bilan, désigne les ressources apportées par les actionnaires et se matérialise par des titres financiers (les actions).
- Dans le monde de la finance, les « capitaux » peuvent aussi désigner les ressources financières de l’entreprise au sens large.
Investir c’est parier sur l’avenir : l’entrepreneur anticipe que les bénéfices tirés des ventes futures générées grâce aux investissements permettront de rembourser leur coût au fur et à mesure des années.
C’est pour cela que lors de l’enregistrement comptable, les investissements sont amortis sur plusieurs années (leur coût est réparti sur plusieurs exercices au lieu d’être compté en totalité lors de la première année). Par contre, l’entreprise doit bien sûr décaisser toutes les sommes dues au moment où l’investissement est réalisé (ex : payer les fournisseurs de machines ou les entreprises de BTP construisant des bâtiments etc.).
Des financements adaptés sont donc nécessaires. Ils peuvent prendre plusieurs formes que nous détaillons dans les parties 6.2 à 6.4.
Comprendre la différence entre enregistrement comptable et flux de trésorerie
- Le compte de résultat d’une entreprise est un document comptable qui retrace les flux annuels de charges (achats, salaires, impôts, taxes et charges sociales, amortissements des investissements, etc.) et de produits (vente de biens et services, subventions, produits financiers etc.). Le solde (appelé « résultat ») permet de déterminer si l’entreprise a fait des pertes ou des bénéfices dans l’année.
- Le tableau de trésorerie retrace quant à lui les « mouvements d’argent » en temps réel.
- Il peut y avoir des différences significatives de temporalité entre l’enregistrement comptable et l’encaissement (ou le décaissement) effectif.
- Le cas de l’amortissement des investissements présentés ci-avant en constitue un exemple. Nous détaillons ci-après l’exemple des différés entre enregistrement d’une facture et décaissement effectif lors du cycle de production.
Financer le cycle d’exploitation : les besoins de court terme
Une fois les investissements réalisés et l’éventuel stock initial financé, l’entreprise entre dans le cycle d’exploitation.
Côté dépenses, elle paie les salaires de ses employés, les achats et autres fournitures, ses éventuels frais financiers, ses impôts, taxes et charges sociales.
Côté recettes, elle encaisse le produit de ses ventes, bénéficie éventuellement de subventions, ou de revenus financiers (si elle a par exemple des participations dans d’autres entreprises).
À court terme, la principale source de financement de l’entreprise est issue de ses ventes.
Cependant, même si l’entreprise a un résultat positif au niveau comptable elle peut manquer de trésorerie et avoir des difficultés à honorer ses engagements financiers. En effet, en pratique, il peut y avoir des différés de paiement et d’encaissement par rapport au moment où la facture est émise. Par exemple, beaucoup de PME fournissant de grands groupes ou des administrations sont payés plusieurs mois après livraison, alors qu’elles ne peuvent différer le paiements de leurs salariés.
À l’inverse, les entreprises de la grande distribution encaissent leurs clients « comptant » et paient leurs fournisseurs à deux mois (en théorie)63 : elles sont donc en partie financées par leur cycle d’exploitation.64 de façon générale, les grandes entreprises payent leur fournisseurs avec plus de délais que les PME65.
Selon les cas, les entreprises ont donc un besoin plus ou moins important en fonds de roulement (BFR), c’est-à-dire d’argent disponible en caisse pour faire face à leurs obligations ou pour renouveler leurs stocks en attendant d’avoir vendu leur production et/ou d’avoir encaissé les paiements. Dans la grande distribution, le BFR est négatif (puisque les consommateurs achètent des biens que les distributeurs n’ont pas encore payés) alors que pour certaines PME ou pour des agriculteurs, il peut être très important.
Le financement de ce BFR peut être assuré par les bénéfices non distribués des années précédentes (l’autofinancement). Il peut l’être aussi par un crédit bancaire (adossé par exemple à l’escompte d’effets de commerce ou via des techniques telles l’affacturage). Schématiquement, l’entreprise apporte une facture à la banque ou à un autre organisme financier qui lui accorde un prêt du montant (avec intérêt) le temps que la facture soit réglée par le client.
Les différents types de financements de long terme
Les entreprises disposent de plusieurs sources66 de financement de long terme :
- l’autofinancement intervient quand les dirigeants décident (avec la validation des actionnaires) de réinvestir les bénéfices de l’entreprise dans son développement ;
- le capital et les avances d’associés ;
- l’emprunt : via les prêts bancaires ou sur les marchés financiers ;
- les « dons » qui prennent le plus souvent la forme d’aides publiques (subventions, avances remboursables, crédits d’impôts etc.). Ce point est développé dans l’Essentiel 7.
La part relative de ces sources de financement diffère selon les pays et les périodes de l’Histoire. Le recours aux prêts bancaires est beaucoup plus important en Europe qu’aux États-Unis. Le recours aux marchés de capitaux se développe partout dans le monde depuis 20 ans. Il dépend aussi de la taille des entreprises : les marchés financiers sont, par exemple, difficilement accessibles pour les PME (au moins en Europe).
Ces sources de financement peuvent provenir de différents types d’acteurs : les institutions financières bien sûr (bancaires ou non), mais aussi l’État (et plus généralement les acteurs publics), les individus, ou d’autres entreprises (en particulier dans le cas des crédits intragroupes). Il n’y a pas nécessairement une correspondance entre un type de financeur et un type de financement. Par exemple, les acteurs publics peuvent accorder des crédits, investir en capital ou accorder des subventions. Les plateformes de financement participatif (ou crowdfunding) constituent un autre exemple : il s’agit de plateformes qui recueillent une multitude d’apports de petits montants afin de financer un projet précis mené par une société (mais aussi une association ou un particulier). Le financement peut prendre la forme d’un don, d’un prêt, ou encore d’une participation au capital.67
Ces diverses sources n’ont pas les mêmes contreparties en termes de gouvernance.
- L’autofinancement est la source de financement la moins contraignante, si ce n’est qu’il faut réussir à faire des bénéfices à un niveau suffisant pour réaliser des investissements ce qui est difficile quand les besoins sont importants.
- Le financement par le capital donne des droits aux actionnaires : détenir la majorité du capital (au sens des droits de vote associés aux actions) donne le pouvoir de direction.
- Les prêts ne donnent pas de pouvoir de gestion mais peuvent être conditionnés à des garanties et/ou des covenants68, ce qui peut conférer aux prêteurs une forte capacité d’influence.
- Les aides publiques peuvent être assorties de conditions.
Enfin, les risques que prennent les financeurs ne sont pas les mêmes. Quand la liquidation (c’est-à-dire la « mort » d’une entreprise) est actée, les actifs (bâtiments, machines, brevets etc.) sont vendus et le produit des cessions est utilisé pour rembourser les créanciers dans un ordre bien défini :
- Certaines créances des salariés de la société sont toujours payées en premier. Il en va de même des frais de justice, de greffe et de mandataire judiciaire.
- Viennent ensuite les créanciers fiscaux et sociaux.
- Puis les autres créanciers privilégiés, ceux qui bénéficient d’une « sureté » accordée par la société (par exemple une banque ayant octroyé un prêt et bénéficiant d’une hypothèque sur les locaux commerciaux).
- Viennent enfin les créanciers dits « chirographaires », c’est-à-dire ceux ne bénéficiant d’aucun privilège, qui sont souvent nombreux.
Le plus souvent, le capital n’est pas récupéré par les actionnaires, le produit de la vente des actifs ne couvrant pas l’ensemble des passifs.
Le financement par le capital
Le ou les fondateurs d’une entreprise apportent des ressources permettant de constituer le capital social de l’entreprise. Elles sont matérialisées par des actions, c’est-à-dire des titres financiers qui peuvent ensuite être vendues sur des marchés organisés (les bourses) ou lors d’échanges bilatéraux. Au cours de la vie de l’entreprise, les dirigeants peuvent décider de demander aux actionnaires existants d’apporter de nouveaux financements ou alors essayer de trouver de nouveaux investisseurs en capital, de nouvelles actions étant alors émises.
Ces actions donnent des pouvoirs à ceux qui les possèdent pour participer aux décisions stratégiques affectant l’entreprise. Cela concerne notamment l’affectation des bénéfices (quand il y en a) que les actionnaires peuvent décider de se distribuer (sous forme de dividendes).
Quelles raisons justifient la rémunération des apports en capital ?
Le capitalisme s’est développé pour de nombreuses raisons dont l’une est relative à la rémunération du capital financier. Les entreprises industrielles et assimilées69 ont besoin de beaucoup de capitaux financiers. Ceux-ci sont apportés directement ou indirectement par des épargnants qui, en contrepartie demandent une rémunération, pour au moins trois raisons :
- cet apport s’accompagne de la privation de la jouissance immédiate du capital considéré,
- l’apport en capital est plus risqué qu’un prêt (si ce dernier est accordé après une analyse sérieuse) et suscite donc une demande de rémunération intégrant une « prime de risque » par rapport à un prêt.
- cet apport est généralement70 assez peu liquide (il n’est pas possible de récupérer son apport à tout moment). L’incertitude sur la date possible pour retrouver la jouissance du capital a un coût pour l’apporteur.
Si la rémunération du capital est légitime, les excès en la matière sont très problématiques, que ce soit pour la pérennité de l’entreprise, ou pour des raisons écologiques et sociales (voir l’Essentiel 5).
Nous présentons ci-après les trois principales formes d’apport de capitaux (le capital familial, le capital investissement et la bourse) sachant qu’il existe bien sûr des cas hybrides (une partie du capital étant en bourse ou détenue par un financier et l’autre étant familial par exemple).
Le capital familial
Dans de très nombreuses entreprises, la première source d’apport en capital vient souvent de l’épargne du fondateur, et éventuellement de sa famille et de ses proches. C’est le cas général pour les petites entreprises qui se lancent mais pas uniquement : de très grands groupes71 ont réussi à maintenir le contrôle quasi exclusif du capital par la famille.
En théorie, le capital familial devrait se préoccuper avant tout de la réussite du projet du ou des fondateurs ainsi que de la pérennité et de la bonne transmission de l’entreprise. Cela implique n’est bien sûr pas de poursuivre des objectifs de rentabilité, nécessaire pour garantir le contrôle de l’entreprise et se prémunir des crises économiques et plus généralement aux aléas de la vie de l’entreprise72. Cependant, en théorie, ces « valeurs » de long terme devraient être prioritaires par rapport à la maximisation du rendement financier à court terme.
En réalité, le capitalisme familial peut être redoutablement prédateur comme le montre le cas des milliardaires bien connus73. Et il n’est pas toujours un modèle de transparence ou de qualité managériale. Selon une étude publiée par Family Capital en 2021, les entreprises familiales cotées sont moins bien notées que des entreprises cotées non familiales par le département ESG risk assessment74 de PwC Luxembourg. Si ces données sont bien sûr à prendre avec précaution comme toutes celles concernant la notation ESG tant elles dépendent des méthodologies, elles n’en restent pas moins intéressantes en termes de comparaison notamment en termes de transparence (l’absence de données publiques se traduisant par de mauvaises notes).
Il y a là un apparent paradoxe, car on peut croire qu’une entreprise familiale devrait penser plus à sa « durabilité » au sens physique et financier. C’est parfois le cas… mais pas toujours. Tant qu’il n’y a pas de risque immédiat sur l’amont, ou de pertes de parts de marché évidentes, la recherche de profit reste le plus souvent la règle (famille ou pas)…
Les fonds d’investissement (private equity)
Les fonds d’investissement apportent des financements en entrant dans le capital d’entreprises non cotées en bourse75 pour une durée déterminée (rarement au-delà de 10 ans).
Constitué d’une équipe de professionnels de l’investissement, ils sont en général spécialisés sur un secteur (ex : immobilier) ou sur une phase de la vie de l’entreprise.
Les différents segments du private equity
- le capital-risque finance les jeunes entreprises gourmandes en financement (ex : secteur des hautes technologies nécessitant beaucoup de R&D). On trouve également dans ce segment les business angels, individus qui investissent une partie de leur fortune dans de jeunes entreprises tout en apportant éventuellement des conseils aux dirigeants.
- le capital-développement cible les entreprises plus matures, qui ont besoin de capitaux pour continuer à grandir.
- les fonds de LBO (ou capital-transmission) investissent dans la transmission d’entreprise (grand groupe qui se défait d’une de ses filiales, entreprise familiale qui a un pb de succession, retrait de la bourse d’une entreprise).
- les fonds de capital-retournement rachètent les entreprises en difficulté.
Les acteurs du private equity investissent les ressources qui leur ont été confiées par d’autres institutions financières (en particulier mais pas uniquement celles qui collectent l’épargne publique telles les assurances, les fonds de pension, les banques etc.). Leur besoin de « visibilité » sur la situation financière des entreprises dans lesquels ils investissent est important car ils rendent des comptes réguliers aux institutions qui leur ont confié les fonds. Ils attendent de la direction des entreprises qu’elle « délivre » ce qu’elle a promis en particulier en termes de rendement financiers.
La bourse
Afin de trouver des capitaux supplémentaires, les dirigeants d’une entreprise peuvent décider d’introduire tout ou partie de son capital sur une Bourse, par exemple Euronext, principale place boursière de la zone euro, le New York Stock Exchange ou le Nasdaq aux Etats-Unis.
Ensuite, les actions peuvent être échangées librement entre les acteurs intervenant sur ce qu’on appelle le « marché secondaire » de la bourse (voir encadré).
Les acteurs intervenants sur la bourse sont de différents types et ont plus ou moins de moyens et de pouvoir : les gestionnaires d’actifs (qui placent les fonds collectés directement auprès des épargnants ou ceux d’autres institutions financières comme les assurances, les banques, les fonds souverains etc.) sont les plus puissants mais on trouve aussi des banques ou des assurances (qui placent l’argent collecté via les livrets d’épargne ou l’assurance vie par exemple), les fonds spéculatifs, les fonds souverains, les détenteurs de grosses fortunes ou encore de petits épargnants plaçant directement leurs avoirs (via des courtiers ou une banque en ligne).
Définition – Marché primaire et marché secondaire
Les bourses sont des marchés organisés permettant de faire appel public à l’épargne. Elles sont composées de deux segments assurant chacun des fonctions bien distinctes.
- Le marché primaire (celui du « neuf ») permet à l’entreprise d’obtenir de nouveaux financements. Cela correspond au moment où elle introduit tout ou partie de son capital en bourse ou lorsqu’elle procède à une augmentation de capital.
- Le marché secondaire (celui de « l’occasion ») permet aux acteurs financiers d’échanger les actions déjà mises en circulation. Il ne s’agit donc plus d’apporter des financements à l’entreprise mais d’assurer la liquidité de ses actions , c’est-à-dire le fait que ceux qui les achètent peuvent les revendre facilement.
Le marché primaire ne représente qu’une petite partie des transactions. En 2006, par exemple, « sur Euronext, la Bourse qui opère notamment à Paris, les introductions en Bourse et les augmentations de capital ont représenté 79 milliards d’euros, alors que l’ensemble des ventes d’actions a totalisé 2345 milliards d’euros ».76
Par ailleurs, dans une étude de 2021, l’économiste Catherine Lubochinsky a dressé un constat inquiétant sur ce mode de financement des entreprises : « Les Bourses ne financent plus, en flux nets (c’est-à-dire introductions et augmentations de capital moins rachats d’actions), les économies américaine et européenne depuis déjà une vingtaine d’années »« . »77
Les acteurs intervenants en bourse sont exigeants à la fois en termes de liquidité (pouvoir vendre à tout moment leurs actions) et de rendement financier.
Ces exigences contraignent fortement les dirigeants qui peuvent être licenciés et remplacés par des dirigeants plus « efficaces » s’ils ne donnent pas satisfaction.
C’est en particulier le cas quand une entreprise est contrôlée par un bloc majoritaire (un ou quelques acteurs financiers détiennent la majorité des actions, le reste étant réparti de manière diffuse) principalement tourné vers la performance court terme. Notons qu’individuellement les actionnaires minoritaires « diffus » n’ont que très peu de pouvoir78 sur la vie de l’entreprise. Seuls les détenteurs d’une majorité relative ont du pouvoir car les décisions de l’assemblée générale (dont celle de nommer le président du conseil d’administration ou du directoire) se font en général selon le principe « une action une voix ».79
Dans le cas d’une entreprise dont le capital n’est pas « contrôlé », c’est-à-dire dont l’actionnariat est très diffus (les actions sont détenues par une multitude d’acteurs sans lien entre eux), la direction de l’entreprise peut avoir plus de marge de manœuvre. Elle s’expose, cependant, à un risque de « raid hostile ». Si le cours de bourse est trop bas par rapport à son potentiel (qui serait atteint par un management plus « dur »), des actionnaires prédateurs peuvent en profiter pour acheter massivement les titres des actionnaires diffus, via une OPA hostile (appelée « raid »). S’ils parviennent ainsi à prendre le contrôle de l’entreprise, ils disposent alors des pouvoirs pour tenter d’améliorer la rentabilité à court terme de l’entreprise, afin de tirer une plus-value significative de la revente à terme de leurs actions. Cette amélioration de la rentabilité de l’entreprise passe souvent par la réduction des coûts (salariaux, de R&D, d’investissement) ou la revente d’actifs ce qui revient à sacrifier la pérennité de l’entreprise.
Des fonds spéculatifs se sont spécialisés dans ce type d’opérations. Les auteurs d’une étude publiée en 202080, analysent les impacts de 1234 campagnes menées par des hedges funds entre 2000 et 2016. Selon ces travaux, si les performances immédiates en termes de valeur de marché et de profitabilité sont bien là à court terme, les impacts négatifs à long terme sont négatifs. Dans les 5 ans qui suivent un »raid », 4% à 8% des emplois ont été détruits, la R&D a été affaiblie, la prise en compte des questions de responsabilité sociale et environnementale s’est effondrée et la compagnie périclite avec une baisse de valeur de ses actions pouvant aller jusqu’à 10%.
L’endettement peut prendre deux formes principales
Le crédit bancaire
Les banquiers prêteurs ont deux objectifs : être remboursés du montant du prêt et encaisser les intérêts de ce prêt. Ils ne cherchent pas à (et ils n’ont pas compétence pour) s’impliquer dans la direction de l’entreprise à qui ils prêtent. Ils sont même très attentifs à éviter tout risque juridique en la matière : s’ils étaient soupçonnés d’ingérence, ils pourraient être considérés comme responsables de fait et condamnés à combler le passif en cas de difficultés de trésorerie.
Dès lors, les prêts bancaires ne s’accompagnent pas d’un pouvoir de décision. Ils sont en revanche :
- étudiés pour limiter le risque de non remboursement (d’où la célèbre expression « on ne prête qu’aux riches ») ;
- assortis de dispositifs pour limiter le risque au cas où le débiteur serait en défaut : des garanties ou des covenants68 contraignant les débiteurs à donner régulièrement des informations économiques sur leur situation afin de permettre au banquier d’anticiper la survenue d’une insolvabilité.
L’émission de titre de créances (ou obligations) sur les marchés financiers
L’émission obligataire est une opération soumise à de nombreuses contraintes juridiques et fiscales ; elle n’est le plus souvent pas accessible aux petites entreprises.
Comment fonctionne l’émission d’obligations ? Explication simplifiée
Imaginons que l’entreprise TOE ait besoin de deux millions d’euros. Elle peut demander un prêt à son banquier ou vendre sa dette à différents investisseurs (en particulier des gestionnaires d’actifs) sous forme de titres financiers appelés titres de créance, par exemple 200 titres de 10 000€.
Ces titres ont trois caractéristiques :
> le montant prêté, appelé nominal ou principal (ici 10 000€),
> la maturité ou échéance du prêt (dans un, deux, trois … dix ans).
> le taux d’intérêt (par exemple 2%) qui constitue la rémunération du créancier par l’emprunteur.
À la différence d’un crédit bancaire, l’émetteur d’un titre de créance ne paie chaque année que les intérêts. Le principal est remboursé au moment où l’obligation arrive à échéance.
Comme pour les actions, l’entreprise reçoit des financements au moment de l’émission des titres, c’est-à-dire quand elle trouve les premiers acheteurs. Ensuite, ces titres peuvent être échangés sur le marché obligataire ce qui fait monter ou baisser leur valeur de marché en fonction de la demande plus ou moins importante pour ce titre.
L’entreprise cherche bien sûr à obtenir des prêts à un coût minimal. Or le niveau du taux d’intérêt dépend de plusieurs facteurs :
- L’environnement macro-économique : le niveau général des taux d’intérêt dans l’économie qui est influencé par la politique monétaire de la banque centrale (plus d’information dans notre module sur la monnaie). La politique monétaire très accommodante des Banques centrales lors de la dernière décennie a ainsi eu un impact global pour maintenir les taux d’intérêt bas pour l’ensemble des acteurs.
- La situation spécifique de l’entreprise et la perception des risques par les prêteurs (situation financière de l’entreprise, secteur d’activité, positionnement concurrentiel). Cela implique comme pour le crédit bancaire des efforts de reporting financiers importants (et le plus souvent cadrés) afin que les investisseurs obligataires puissent décider ou non d’acheter l’obligation.
- La situation des titres de créances déjà émis par l’entreprise : quand leur valeur de marché est supérieure à leur valeur nominale (ce qui traduit une forte demande), cela se manifeste par la possibilité pour l’entreprise d’émettre de nouvelles obligations à un taux moins importants que précédemment. Et inversement.
Les banquiers et les prêteurs en général ont une forte influence sur les entreprises, à commencer par le fait qu’ils imposent de fait des formats de reporting et de performance conditionnant l’acceptation de leur prêt ou de l’achat de titres.
Les entreprises paient des impôts et reçoivent des financements publics
Le débat sur la fiscalité des entreprises se résume souvent à un affrontement binaire entre ceux qui jugent qu’elles devraient être davantage taxées (en particulier les plus grandes), et ceux pour qui toute forme d’imposition est nuisible à l’activité économique. Nous allons tenter ici de clarifier les termes du débat et d’apporter quelques ordres de grandeur.
Quelques définitions : prélèvements obligatoires, impôts, cotisations sociales
-On appelle prélèvements obligatoires (sur les entreprises comme sur les ménages) l’ensemble des impôts et cotisations sociales reçus par les administrations publiques (APU) sans contrepartie directe et immédiate. 82
-Les impôts, taxes et autres contributions sont des versements réalisés par les individus et les personnes morales en fonction de leurs capacités contributives aux APU sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.
-Les cotisations sociales sont des versements réalisés aux administrations publiques dans un but déterminé (la protection sociale) et ouvrant des droits à des prestations sociales.
Plusieurs raisons économiques légitiment le fait que les entreprises paient des impôts et des cotisations sociales : contribution au financement public et fiscalité environnementale
D’une part, pour produire des biens et services, elles utilisent des infrastructures 83 et bénéficient, de façon directe ou indirecte, des services publics et de la protection sociale 84 fournis par l’État. Il y a donc une rationalité à ce qu’elles participent à leur financement et les intègrent dans leurs comptes, au même titre que les autres biens et services utilisés pour la production.
D’autre part, la fiscalité (et les aides publiques) peuvent être des outils de politiques économiques pour l’État, en donnant des signaux visant à orienter les comportements et les investissements. C’est en particulier le cas de la fiscalité écologique.
Les entreprises utilisent des ressources naturelles et ont des impacts négatifs sur la nature, pour lesquelles elles ne payent rien. Renchérir le coût des prélèvements sur la nature et des pollutions environnementales (que ce soit via la fiscalité ou les marchés de quotas) est un levier pour réduire ces impacts.
Cela peut aussi contribuer à rendre économiquement rentables les activités de dépollution et de « réparation » des préjudices faits à la nature. À condition d’utiliser l’outil prix en complément des autres (réglementation, interdiction, budget, politique monétaire et prudentielle) , et sans en faire la solution unique aux problèmes environnementaux. Nous abordons ce sujet en détail dans la fiche Doit-on donner un prix à la nature ?
Cette internalisation 85 des impacts négatifs dans les coûts de l’entreprise a plusieurs effets positifs :
- Les clients paient plus cher un bien ou service qui a un impact négatif sur la nature : c’est la « vérité » des prix. Cela nécessite cependant que toutes les entreprises soient bien soumises au même type de fiscalité. Sinon l’effet est contre-productif : les consommateurs pourraient choisir les produits d’une entreprise plus polluante que les autres simplement parce qu’elle n’est pas soumise aux mêmes mécanismes environnementaux (et donc fournit des produits moins chers). C’est tout le problème posé par les importations de produits venant de pays non soumis à des taxes ou des marchés de quotas comme ceux en vigueur dans l’Union européenne.
- Les entreprises qui offrent des solutions peuvent faire valoir auprès de leurs prospects et clients le bénéfice qu’ils en tireraient (en réduction d’écotaxes).
En Europe, les taxes environnementales sont relativement faibles. La Commission européenne les évalue à 55 milliards d’euros en France, soit 2% du PIB et 4,5% du total des prélèvements obligatoires. 86 La plus grande part provient des taxes portant sur l’énergie. Nous n’aborderons pas ici le mécanisme de quotas de CO2 (voir fiche à venir)
L’entreprise fait supporter ses charges et impôts à ses clients
L’entreprise répercute toutes ses charges, y compris fiscales, dans ses prix de vente. Par construction, son chiffre d’affaires (ou plus rigoureusement le total de ses produits) est égal au total des charges plus le bénéfice.
Ce sont donc in fine les clients (et, en fin de chaîne, les consommateurs) qui, via leurs achats, « paient » les impôts des entreprises, de même que toutes les autres charges, ainsi que le bénéfice. Si une entreprise parvient à dégager un bénéfice, c’est que ses prix de vente (incluant donc les prélèvement obligatoires) sont jugés acceptables par ses clients.
Cette simple constatation ne signifie bien sûr pas que le niveau des prélèvements obligatoires n’a aucun impact. Il est évident qu’augmenter les impôts de façon trop importante peut nuire à la rentabilité des entreprises, en augmentant trop leurs charges et donc les prix que leurs clients sont prêts à accepter. C’est particulièrement le cas quand elles sont en compétition avec d’autres sociétés n’ayant pas le même niveau d’imposition.
Par ailleurs, un changement de fiscalité se traduit, au moment de sa mise en place, de manière complexe.
Imaginons qu’un des impôts de production augmente :
- certaines entreprises décident de transférer cette hausse aux clients en augmentant leurs prix de vente, avec un risque de réduction des ventes.
- d’autres ne pouvant pas transférer la hausse aux clients (en général pour des raisons concurrentielles ou réglementaires) voient leur bénéfice diminuer.
- pour d’autres encore, un mix des deux cas précédents sera mis en place.
Dans le cas d’un allègement de fiscalité, les trois cas s’observent également ; il n’est donc pas certain qu’un tel allègement profite aux consommateurs ou, au contraire, aux seuls actionnaires…
Il est donc faux de dire en toute généralité que les impôts pesant sur les entreprises sont payés par les entreprises et non les ménages ; et aussi faux de nier tout impact d’un changement de structure fiscale sur les performances des entreprises.
Quels sont les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises et les aides publiques dont elles bénéficient ?
Les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises comprennent les cotisations sociales, les impôts dits de production, les impôts sur les bénéfices, les impôts sur les produits, (mais pas la TVA, pour laquelle les entreprises sont des collecteurs pour le compte du Trésor public, et qui ne rentrent pas dans leur prix de revient ni dans leur compte de résultat).
Il n’est pas facile d’en estimer le montant global. En effet, si certaines données sont disponibles ce n’est pas le cas de toutes. Nous allons ici préciser ces éléments.
Vue d’ensemble des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises et des aides publiques
En 2023, en France, la contribution des sociétés non financières (SNF) aux prélèvements obligatoires s’est élevée à 345 milliards d’euros soit 27% du total des PO (et 12% du PIB). Les subventions versées par les APU au SNF se sont élevées à 69 milliards cette même année.
Depuis la fin des années 1970, les prélèvements obligatoires pesant sur les sociétés non financières oscillent entre 12 et 13% du PIB.
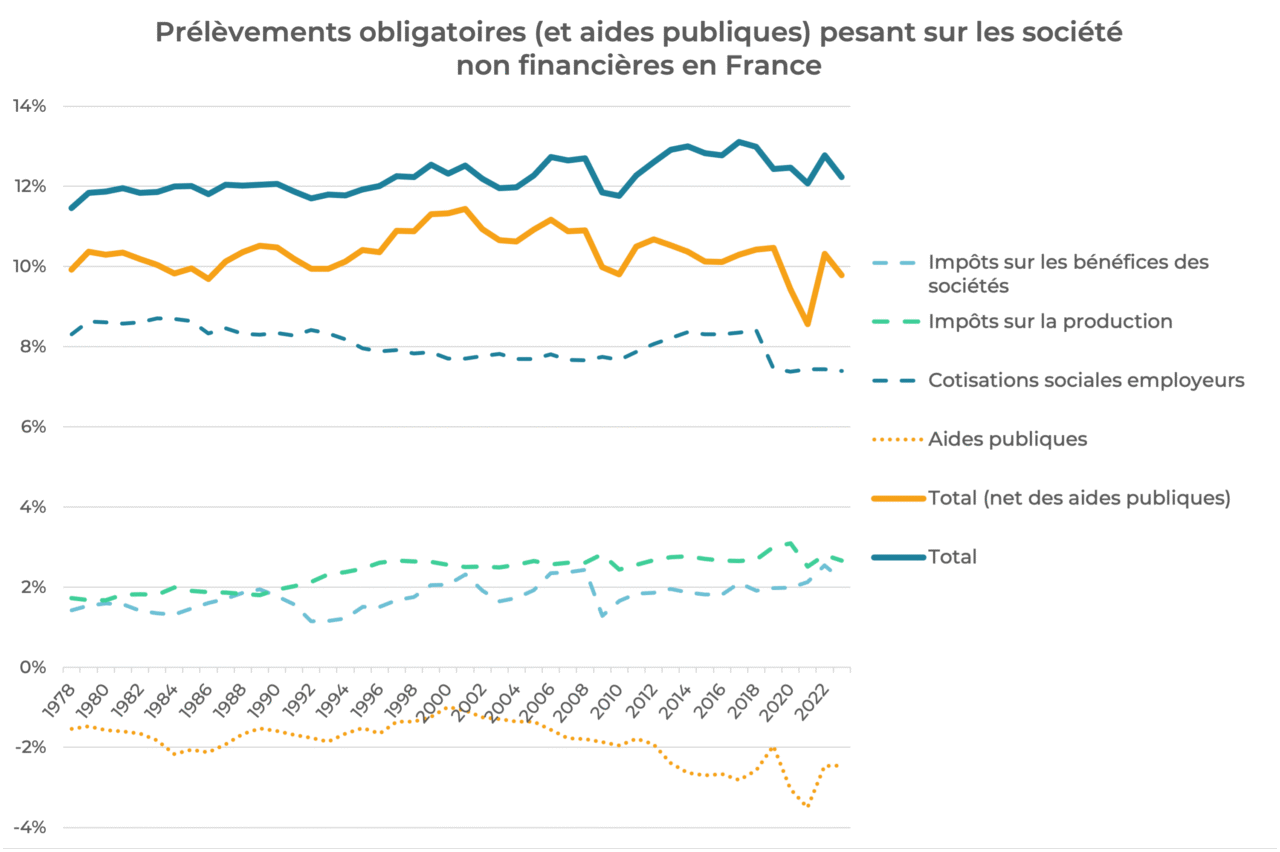
Source Les comptes de la Nation 2023 (tableaux : 7.101 sur les comptes des SNF ; 1.106 pour le PIB et 3. 217 sur les principaux impôts par catégories).
Commentaires :
– Le périmètre retenu ici est celui des sociétés non financières. Il est donc différent de celui des statistiques structurelles d’entreprises de l’Insee (voir l’Essentiel 1). En particulier, il ne comprend pas les entreprises individuelles car les statistiques ne sont pas toutes disponibles sur données longues (en particulier celles relatives à l’impôt sur le revenu).
– Les cotisations sociales payés par les employeurs au trésor public sont en réalité un peu moins élevées que celles présentées ici. Les chiffres disponibles en comptabilité nationale les mélangent en effet avec les cotisations à des régimes facultatifs d’assurance sociale (fonds de pension) qui ne relèvent pas des prélèvements obligatoires. Ces dernières sont en augmentation régulière depuis les années 2010. 87
– Comme on va le voir ci-après d’autres prélèvements obligatoires (les impôts sur les produits, les cotisations sociales salariales) sont intégrés à la comptabilité des SNF mais les statistiques disponibles ne permettent pas de les mettre en évidence.
Les impôts sur la production
Ces impôts sont liés à l’activité de production elle-même et reposent chacun sur une des trois catégories d’assiette fiscale suivantes : les salaires et la masse salariale, le capital foncier et productif (les actifs de l’entreprise) ou divers soldes intermédiaires de gestion (le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée). Les principaux impôts de production sont les taxes pesant sur le foncier et celles pesant sur la valeur ajoutée.
Pour l’entreprise, ces impôts constituent des coûts de production 88 qui sont donc intégrés dans le prix de vente. Une variation à la baisse peut donc se traduire par une hausse des marges et/ou une baisse des prix de vente. La répartition entre ces deux effets dépend de nombreux facteurs, à commencer par l’intensité de la concurrence.
Plus de détails sur les impôts de production dans la partie 7.4.
Les impôts sur les bénéfices des entreprises
À la différence des impôts de production, les différents impôts sur les bénéfices ne pèsent pas sur les coûts de l’entreprise, mais uniquement sur son résultat. Ils n’ont donc pas d’impact direct sur sa compétitivité. Ils peuvent, cependant, avoir un effet indirect, en réduisant sa capacité relative à constituer des réserves, puisqu’ils diminuent ses profits qui peuvent être soit distribués aux actionnaires sous forme de dividendes, soit réinjectés dans l’entreprise sous la forme de réserve. Il serait, de ce point de vue, pertinent d’imaginer une fiscalité qui favorise la constitution de réserves par rapport à la distribution de dividendes.
Le principal impôt de cette catégorie est l’impôt sur les sociétés (l’IS).
Il est parfois dit que l’IS serait un impôt sur le capital de l’entreprise ou sur les revenus de ses actionnaires. C’est inexact. L’IS est un impôt sur les bénéfices de l’entreprise, pas sur son capital et encore moins sur ses actionnaires (qui payent à titre personnel l’impôt sur les revenus qu’ils peuvent tirer de l’entreprise quand ils se versent des dividendes ou quand ils réalisent une plus-value en vendant les actions).
Le taux de l’IS a récemment fait l’objet d’une baisse importante pour l’aligner sur la moyenne internationale. Comme l’explique l’économiste Olivier Passet, 89 cette baisse ne s’est cependant pas manifestée au niveau des recettes fiscales. En effet, la baisse des impôts de production et des cotisations sociales en amont a produit une hausse des marges et donc un élargissement de l’assiette de l’IS.
Plus de détails sur l’IS dans la partie 7.4.
Les impôts sur les produits
Il s’agit des impôts payés par unité de bien et service produite ou échangée. Ce sont, pour la plupart, des impôts indirects. 90 Le plus important est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne pèse pas sur les comptes des entreprises (voir encadré).
D’autres taxes sur les produits sont par contre payées par les entreprises (et par les ménages) au moment de l’achat. C’est par exemple le cas des taxes sur l’énergie (carburant, gaz, électricité) ou des celles liées aux transactions immobilières (achat d’immeubles). D’autres taxes sur les produits ciblent spécifiquement certaines entreprises : la taxe générale sur les activités polluantes, la taxes sur les services numériques et télécommunications. 91
La TVA ne pèse pas sur les comptes (de la plupart) des entreprises
La TVA est globalement « transparente » pour la plupart des entreprises 92 qui jouent essentiellement un rôle de « collecteur » pour le compte du Trésor public. Concrètement, l’entreprise soumise à la TVA facture les produits et services qu’elle vend, en appliquant le taux de TVA adéquat sur leur montant Hors Taxes (le client paie donc le total TTC). Quand l’entreprise réalise des achats, elle paie le montant TTC. À la fin de l’exercice fiscal, les montants de TVA collectés sur les ventes et payés sur les achats doivent s’égaliser. S’il y a un écart positif (l’entreprise a facturé plus de TVA qu’elle n’en a collecté), l’entreprise le reverse au Trésor public. Si l’écart est négatif, le Trésor public rembourse l’entreprise.
Le commerce international se fait hors TVA. Toutes choses égales par ailleurs, remplacer des prélèvement obligatoire pesant sur les couts de production de l’entreprise vers la TVA est favorable à la compétitivité internationale des entreprises (en réduisant leurs prix de vente HT) et pèse relativement plus sur les biens et services importés. C’est l’intérêt du mécanisme connu sous le nom de TVA sociale.
Les cotisations sociales
Les entreprises versent des cotisations sociales qui contribuent aux différents piliers de la sécurité sociale : la maladie (qui couvre également la maternité, l’invalidité et le décès), le chômage, les accidents du travail et maladies professionnelles, la famille, la vieillesse. 93
Les cotisations dites patronales (ou employeurs) sont payées par les entreprises (et non par le patron…) de même que les cotisations salariales. Les deux sont donc intégrées dans leurs coûts de production et contribuent à la « couverture sociale » du salarié. Le taux des cotisations n’est pas le même selon le niveau de salaire (il est par exemple très faible au niveau du SMIC). 94
La différence principale entre cotisations salariales et patronales tient au fait que les premières viennent en déduction du salaire brut de l’employé. En conséquence, si l’État décide de réduire les cotisations salariales, cela engendre normalement une augmentation du salaire net versé à l’employé sans impacter les comptes de l’entreprise. Par contre, une réduction des charges patronales se traduit par une baisse des coûts pour l’entreprise, sans impact immédiat pour le salarié. 95
À partir des années 1990, il y a eu un remplacement progressif d’une partie des cotisations sociales par des taxes portant sur les revenus (les salaires mais aussi les revenus du patrimoine). Il s’agit en particulier de la contribution sociale généralisée(CSG)et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qui sont venues remplacer une partie des cotisations salariales sur la fiche de paie.
Depuis 2019, la réduction des cotisations sociales patronales à la suite de la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de charge pérenne est bien perceptible.
Les aides publiques
Si les entreprises paient des impôts et des charges sociales, elles bénéficient d’aides dites budgétaires sous des formes diverses (essentiellement des subventions et des aides à l’investissement). Celles-ci se sont élevées à 69 milliards d’euros en 2023. 96
Un rapport de l’Institut de Recherches Économiques et Sociales 97 paru en 2022 a évalué à 157 milliards d’euros en 2019 les aides publiques aux entreprises en comptant non seulement ces aides budgétaires mais aussi les « dépenses fiscales » (appelées parfois niches fiscales, qui sont les mécanismes permettant des réductions d’impôts, dont le crédit d’impôt) et les réductions socio-fiscales (exonérations de cotisations sociales employeurs).
Zoom sur les impôts et taxes directs
Les impôts et taxes directs pesant sur les entreprises regroupent deux des catégories vues précédemment : les impôts sur la production (voir partie 7.3.2) et ceux pesants sur les résultats des entreprises (voir partie 7.3.3)
En 2022, leur total s’élevait à 188 milliards d’euros, soit environ 15% du total des prélèvements obligatoires 98 et 7% du PIB. Les principaux sont l’impôt sur les sociétés (l’IS), les différentes taxes pesant sur le foncier et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Détail des impôts directs pesant sur les sociétés et les entreprises individuelles en France de 2019 à 2022
Champs : ces chiffres portent sur l’ensemble des sociétés (financières et non financières) et des entreprises individuelles. Ils sont donc différents de ceux retenus au 7.3 pour analyser les PO sur longue période (qui ne portent que sur les société non financières 99) et de ceux retenus par l’Insee dans la statistique structurelle d’entreprise (voir l’Essentiel 1).
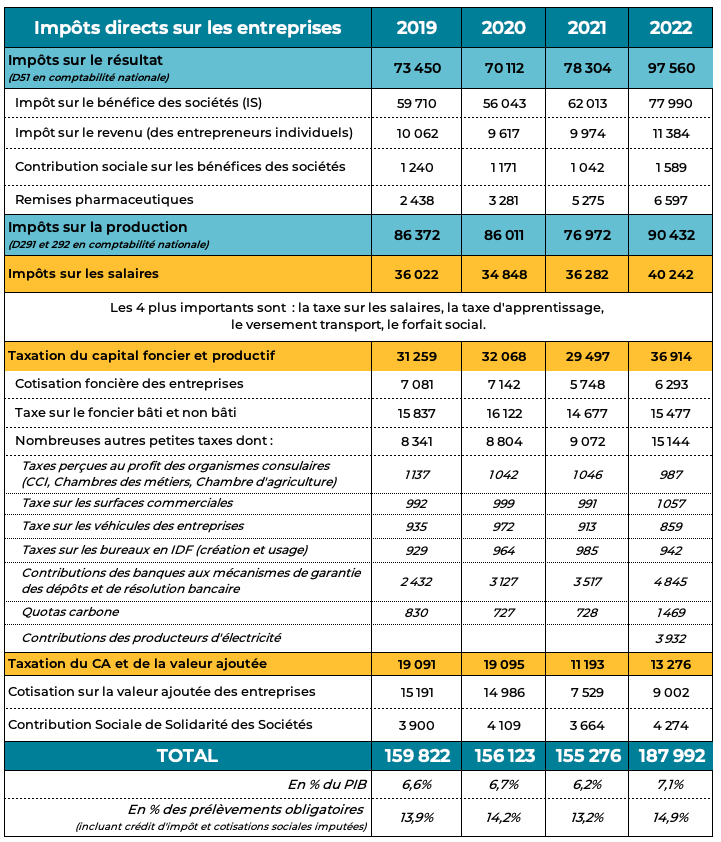
Source Les comptes de la Nation 2023 (tableaux portant sur les comptes des SNF 7.101, des EI 7.102, des SF 7.201, sur le PIB 1.106 et sur les principaux impôts par catégories 3. 217) et Les entreprises en France en 2023 (pour le chiffre de l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels_ nous n’utilisons pas les autres données de cette publication car elles sont moins exhaustives que celles présentées dans ce module et que certains impôts, tels la taxe sur les salaires, sont présentés comme payés par les entreprises en totalité alors que ce n’est pas le cas).
Quelques remarques :
– Les crédits d’impôts (16 milliards en 2022) n’ont pas été retirés du montant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés car ils sont considérés comme des dépenses publiques (aussi appelée dépenses fiscales) par la comptabilité nationale et non comme un moindre prélèvement fiscal.
-De nombreuses taxes (environ 20 milliards d’euros) sont spécifiques à certains secteurs (et/ou temporaires) et ne touchent donc pas les entreprises dans leur ensemble.
-En 2022, les impôts de production payés par les entreprises représentent 71% du total de cette catégorie d’impôt qui touchent également d’autres acteurs économiques (les ménages paient la taxe foncière ; les associations, les hôpitaux, les ménages 100 paient des impôts sur les salaires et la main d’œuvre).
Les impôts de production
Comme on l’a vu, les impôts de production constituent une partie des charges d’exploitation des entreprises. C’est pourquoi, ils sont l’objet de revendications régulières de la part des syndicats patronaux et d’études économiques controversées sur leurs effets sur la compétitivité et l’emploi. L’argument souvent mis en avant est qu’ils « majorent les coûts de production et les prix des entreprises et réduisent leur compétitivité, au détriment de l’emploi et du pouvoir d’achat ». 101 Par ailleurs, ils sont plus importants en France que dans le reste de l’Europe.
Evolution des impôts de production en France et en Europe
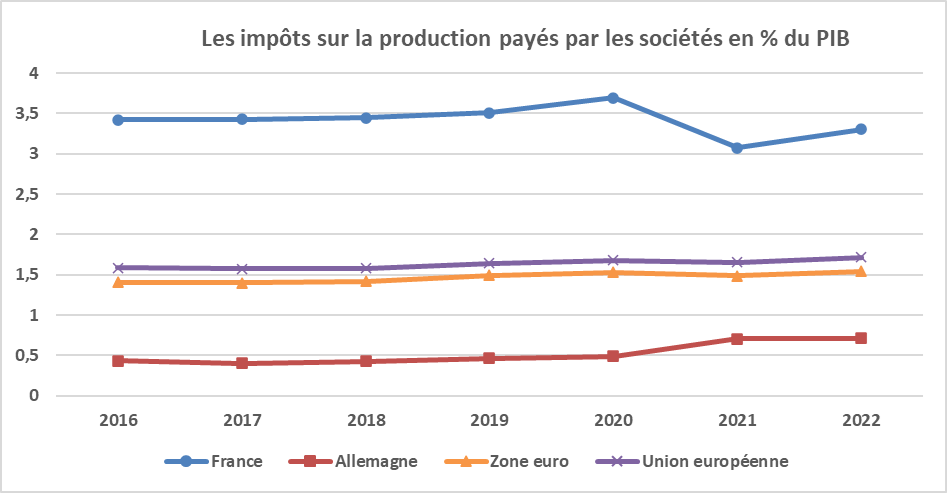
Source Les impôts sur la production, Fipeco
Il est cependant problématique d’avoir un raisonnement global sur ces impôts de production. D’une part, comme noté précédemment, rien ne garantit que la baisse de ces impôts se traduise par celle des prix de vente. Elle peut aussi provoquer une augmentation des bénéfices éventuellement versés aux actionnaires.
D’autre part, certains de ces impôts s’appliquent à la plupart des entreprises, mais ce n’est pas le cas de tous : d’autres sont spécifiques à des secteurs et/ou à des zones géographiques 102, d’autres encore ne concernent que les entreprises d’une certaine taille. 103 Certaines taxes peuvent être temporaires. 104 Enfin, au-delà de l’aspect budgétaire, certains impôts, comme les écotaxes, peuvent avoir un objectif d’orientation des entreprises (Voir en 7.1) : l’objet premier des quotas carbone est de renchérir les émissions de CO2, la taxe sur les bureaux vise à rendre cette activité moins rentable dans une zone tendue en termes de logements.
Seule une analyse impôt par impôt, au regard des objectifs visés, des éventuels problèmes économiques qu’il pose, et de ce qu’il rapporte, a donc un sens.
L’impôt sur les sociétés (IS)
Depuis 2022, le taux statutaire de l’IS, celui qui est inscrit dans la loi 105, s’élève en France à 25% au-delà de 38200 euros de bénéfice (et 15% en-deçà).
L’IS est calculé sur le « bénéfice imposable », qui correspond de façon très simplifiée au résultat avant impôt corrigé de diverses possibilités prévues par le Code fiscal (exonérations diverses, déduction de certains revenus tels les cessions d’actifs taxées à des niveaux différents etc.) 106
Le taux pertinent à regarder est donc plutôt le taux effectif, calculé en divisant le montant de l’IS effectivement payé par le montant du bénéfice. Ce calcul n’est cependant pas simple à effectuer du fait de l’insuffisante disponibilité des données et des nombreuses questions méthodologiques. 107
En France, comme partout dans le monde, le taux statutaire n’a cessé de baisser depuis les années 1980. 108 C’est une des conséquences de la mondialisation et de la compétition internationale, qui conduit à un alignement des taux d’imposition par le bas. En effet, les États se livrent à une concurrence fiscale afin de favoriser les entreprises implantées sur leurs territoires, d’en attirer de nouvelles ainsi que les investisseurs. Notons que c’est le même type de mécanisme qui conduit à une course au moins disant social et environnemental.
Cette concurrence fiscale est active au cœur même de l’Union européenne, les traités européens ayant toujours maintenu la souveraineté fiscale des États membres. C’est ainsi par exemple que l’Irlande a adopté, dans les années 1990, une fiscalité ultra-concurrentielle avec un taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés de 12,5% dans le but d’attirer les investisseurs. Les Pays-Bas et le Luxembourg peuvent également être considérés comme des paradis fiscaux.
Taux statutaire moyen de l’impôt sur les sociétés par région et par décennie
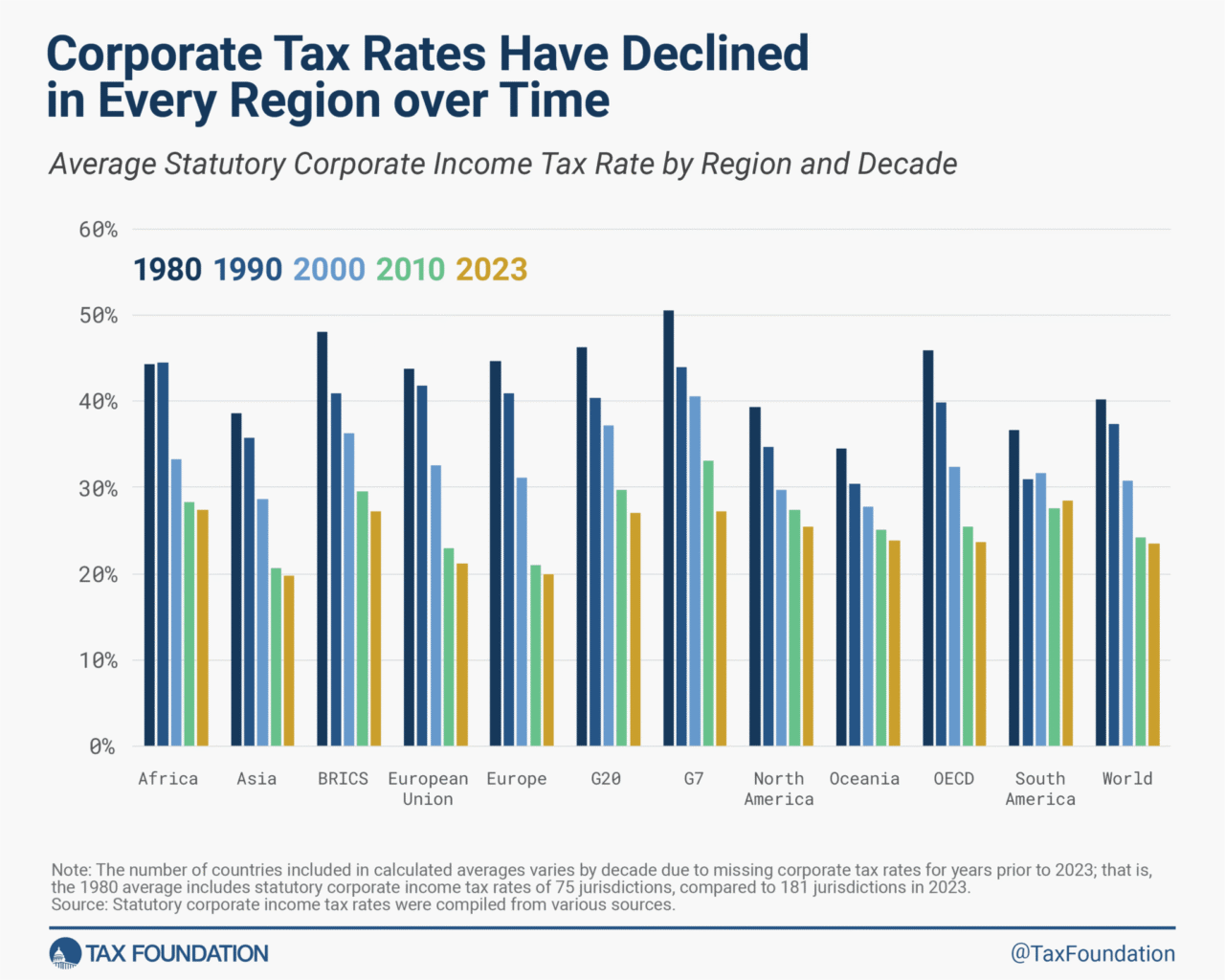
Source Corporate Tax Rates around the World, Tax Foundation, 2023
L’absence d’harmonisation fiscale internationale et l’existence de paradis fiscaux 109 conduit de plus à des pratiques d’évasions fiscales. En effet, les multinationales paient leur IS pays par pays. Elles peuvent donc s’organiser pour « déplacer » (légalement on parle alors d’optimisation fiscale ou en fraudant) des profits de sorte à réduire les bénéfices qu’elles réalisent dans les pays où les taux d’IS sont importants.
Ces pratiques sont sources de pertes fiscales très importantes pour les États. Il n’est évidemment pas possible de connaître précisément le niveau de ces pertes. Mais il est possible de les estimer en ordre de grandeur.
Dans leur recherche Missing Profits, publiée en 2022, les économistes Thomas Tørsløv, Ludvig Wier et Gabriel Zucman estiment qu’à l’échelle mondiale près de 40% des profits des multinationales (près de 1000 milliards de dollars en 2019) sont dissimulés dans les paradis fiscaux chaque année. Pour la France, cela représenterait une perte de recettes fiscales de plus de 13 milliards de dollars.
Les impôts non payés par ces entreprises le sont par d’autres contribuables ou conduisent à la réduction de services publics qui sont socialement redistributifs. C’est donc une source d’injustice évidente et perçue par les citoyens.
Par ailleurs, cela conduit à des distorsions de concurrence : toutes les entreprises n’ont évidemment pas les moyens de payer des conseillers fiscaux nécessaires à des pratiques d’optimisation fiscale, pas plus que de réaliser les montages juridiques complexes permettant de localiser les profits ailleurs que dans leur pays d’activité. Comme noté dans un rapport du Conseil d’analyse économique cela crée « une distorsion de la concurrence et l’émergence d’industries concentrées avec quelques entreprises ayant un pouvoir de marché considérable. » 110 Le droit fiscal favorise de fait les multinationales au détriment des autres entreprises.
Cette situation délétère a fini par conduire à une réaction des États coordonnée par l’OCDE avec le projet contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS). Le G20 a adopté en octobre 2021 la proposition de l’OCDE d’une réforme à deux piliers concernant les multinationales :
- réaffecter une part minimale des profits consolidés de l’entreprise aux pays sources de ces profits.
- imposer un taux effectif minimum de 15% aux profits consolidés.
Pour en savoir plus, voir la partie Les paradis fiscaux sont une source inacceptable de pertes fiscales pour les États dans notre module sur la finance.
Les entreprises communiquent, font de la publicité et rendent des comptes
Les entreprises sont soumises à des obligations de reporting (sur leurs activités, leur situation financière et parfois leurs impacts extra financiers) qui dépendent de leur taille et de leur secteur d’activité. Ces obligations sont beaucoup plus fortes et plus contrôlées pour les entreprises cotées.
Outre les obligations légales, les entreprises rendent des comptes à leurs parties prenantes (banquier, actionnaire, État, client ou fournisseur, représentants du personnel…). Enfin, elles communiquent auprès de leurs clients et font de la publicité sur les produits et services qu’elles vendent.
Toutes ces occasions de communiquer permettent de mettre en avant les atouts de l’entreprise et autant que possible de ne pas souligner ses faiblesses.
Le reporting financier
Historiquement ce sont d’abord des données comptables et financières qui ont fait l’objet d’obligations de reporting avec deux types de destinataires principaux :
- l’État, puisqu’elles servent à établir les niveaux d’imposition de chaque société,
- les investisseurs (créanciers et actionnaires) en particulier pour les sociétés cotées.
Dans l’Union européenne, la Directive comptable unique (2013) a uniformisé les obligations des entreprises en la matière.
Les états financiers doivent se composer à minima du compte de résultat, du bilan et de ses « annexes ».111
Ces documents sont :
- communiqués à l’administration fiscale via la « liasse fiscale » afin de déterminer l’impôt à payer s’il y a lieu ;
- publiés dans le registre national des entreprises pertinent (en France il s’agit du Greffe du Tribunal de Commerce ) ;
- présentés à l’assemblée générale de l’entreprise qui arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats s’ils sont positifs.
À partir d’une certaine taille112 et/ou selon le secteur, les entreprises ont des obligations supplémentaires.
Elles doivent publier un rapport de gestion qui contient un « exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée »113 ainsi que d’autres informations (telles les perspectives d’avenir, les activités en matière de recherche et développement etc.) Elles sont également tenues de faire contrôler leurs états financiers par des commissaires aux comptes indépendants.
Les groupes d’entreprises doivent publier des comptes et des rapports de gestion consolidés qui sont établis par la « société mère » à partir des comptes individuels des différentes filiales qu’elle contrôle.
Des dispositions ont été prises pour lutter contre la corruption et l’évasion fiscale
Les grandes entreprises impliquées dans l’extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres matériaux ou dans l’exploitation de forêts primaires doivent publier les détails des paiements supérieurs à 100 000 € qu’elles ont effectués aux gouvernements au cours d’un exercice budgétaire (Chapitre 10 de la Directive 2013/34/UE).
À partir de 2024, les sociétés mères des groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires annuel consolidé est supérieur à 750 millions d’euros doivent déclarer dans un rapport spécifique rendu public les recettes, les bénéfices réalisés, l’impôt sur les sociétés payé et le nombre d’employés pays par pays. (Chapitre 10bis de la Directive 2013/34/UE).
Les sociétés cotées en bourse ont des obligations particulières
Depuis 2005, elles doivent publier leurs états financiers selon les normes comptables internationales IFRS.114 Par ailleurs, elles sont tenues de communiquer des informations supplémentaires destinées aux investisseurs.115 En France elles doivent réaliser un document d’enregistrement universel qui synthétise les informations concernant l’activité et les facteurs de risque de l’entreprise.116 Par ailleurs, elles doivent communiquer des informations de façon beaucoup plus régulière que les entreprises non cotées (souvent sur une base trimestrielle) et faire part d’alertes en cas de prévisionnel « d’atterrissage » (résultat prévisionnel de fin d’année) inférieur au budget indiqué dans le document de référence.
Toutes ces informations sont centralisées et publiées sur le site de l’AMF.
Le reporting extra-financier
Depuis la fin du XXe siècle, les entreprises font l’objet d’une demande croissante de divulgation d’informations sur les dimensions sociales et environnementales de leurs activités, ainsi que sur leurs pratiques de gouvernance. Initié par les investisseurs dits « responsables »117 et par les grandes institutions internationales118, ce mouvement en faveur du reporting extra-financier a gagné en importance à partir de l’année 2015, celle de la COP21 sur le climat. Lors d’un discours à la Lloyds, Mark Carney, alors gouverneur de la Banque d’Angleterre, affirme que le changement climatique est un facteur de risques financiers systémiques. L’enjeu du reporting extra-financier (climat en particulier) sort alors des services dédiés à l’investissement « responsable/durable/vert/éthique » pour gagner en importance stratégique dans l’univers de la finance. Aujourd’hui, face à la profusion des référentiels, standards et normes de reporting, l’heure est à la normalisation avec, au centre des débats, un affrontement entre les visions anglo-saxonne et européennes.
Émergence et développement d’une industrie du reporting extra-financier
Les besoins d’informations des investisseurs « responsables » ont donné naissance à un écosystème d’acteurs vivant du reporting et le rendant possible. Des associations ou des entreprises ont été créées pour proposer des référentiels de reporting et/ou pour collecter et analyser les données.119 Le métier de la notation extra-financière, évaluant les entreprises sur la base de critères ESG (environnementaux, sociaux de gouvernance), pour le compte des investisseurs, a émergé au sein d’équipes dédiées dans les sociétés de gestion d’actifs ou les banques, ou via la création d’agences de notation indépendantes.
De nouveaux standards de divulgation d’information non financières sont également venus d’initiatives publiques comme la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Lancée par le Conseil de stabilité financière à la suite de la COP21, la TCFD a proposé, dans son rapport de 2017, un cadre de reporting climatique des entreprises, aujourd’hui largement partagé au niveau mondial.
Au fur et à mesure de son développement, le secteur s’est fortement concentré. Le marché de la notation est ainsi aujourd’hui dominé par les leaders mondiaux de la notation financière (les « Big Three » : Moody’s, S&P et Fitch), qui se sont positionnés en établissant leur propre système de notation et/ou en rachetant les petites agences historiques.120
L’Europe pionnière des obligations réglementaires ESG
La France fait figure de précurseur. En 2001, avec la loi relative aux nouvelles régulations économiques (art.116), c’est le premier pays à inscrire dans sa réglementation l’obligation pour les entreprises cotées de rendre compte, dans leur rapport de gestion, de la façon dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Au fil des lois (et pour se mettre en conformité avec le droit européen), le cadre de reporting a été précisé, le nombre d’entreprises concernées étendu, et des dispositifs de contrôles par des tiers mis en place.
L’Union européenne s’est saisie du sujet en 2014 avec la directive sur le reporting extra-financier (dite « NFRD » pour Non-Financial Reporting Directive) qui introduit l’obligation pour chaque entreprise de plus de 500 salariés de réaliser une déclaration de performance extra-financière.
Le cadre d’abord très souple, a été rendu plus contraignant par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises de 2022 (dite « CSRD » pour Corporate Sustainability Reporting Directive). Les déclarations doivent désormais être vérifiées par un organisme tiers indépendant. Le champ d’application a été élargi à plus d’entreprises et une dimension extraterritoriale a été introduite (des entreprises non européennes exerçant sur le territoire de l’UE peuvent être concernées). Enfin, la directive a surtout amélioré l’encadrement et l’harmonisation du reporting avec la définition des normes « ESRS » (European Sustainability Reporting Standards), dont le premier volet (les normes « tout-secteur »121) a été adopté fin 2023.
La double matérialité au cœur de la bataille des normes
Aujourd’hui, deux visions du reporting extra-financier s’opposent de chaque côtés de l’Atlantique avec au cœur du dissensus un enjeu important en matière de durabilité : celui de la matérialité du reporting.
L’Union européenne a introduit le principe de double matérialité au cœur des normes ESRS qui viennent d’être édicter. Comme le note Laurence Scialom, c’est une évolution importante car « cela revient à reconnaître que la responsabilité des entreprises et des institutions financières ne s’arrête pas à leur performance financière, et qu’elles doivent également gérer et assumer la responsabilité des impacts négatifs réels et potentiels de leurs décisions sur les personnes, la société et l’environnement »« . »
C’est également la position adoptée par la Chine (pour ses entreprises cotés à partir d’avril 2026).
Définition – Le principe de matérialité
Selon les normes comptables américaines US GAAP, « la matérialité est un principe comptable selon lequel tous les éléments qui sont raisonnablement susceptibles d’influer sur la prise de décision des investisseurs doivent être enregistrés ou présentés en détail dans les états financiers d’une entreprise »« . »
Ce principe a été élargi au reporting extra-financier afin en particulier de le limiter aux informations pertinentes au regard des enjeux concrets portés par l’entreprise.
- La « simple matérialité » transpose le principe comptable et se concentre sur la matérialité financière. Le reporting doit porter sur les risques de pertes de valeur qui pèsent sur l’entreprise, et donc sur ses financeurs, du fait des risques ESG (sociaux, environnementaux et de gouvernance).
- La « double matérialité » est beaucoup plus large : elle inclut les risques ESG mais aussi les impacts que l’entreprise a sur l’environnement, la société et ses parties prenantes (la matérialité d’impact).
De l’autre côté de l’Atlantique, l’International Sustainability Standards Board (ISSB)122 créé fin 2021, est le grand concurrent de l’UE en la matière. Au sein de la Fondation IFRS, l’ISSB est en effet l’équivalent, pour le reporting extra-financier, de l’IASB (International Accounting Standards Board) qui a créé les normes comptables internationales IFRS.
En juin 2023, l’ISSB a publié les normes IFRS S1 (sur les informations à divulguer par les entreprises quant aux risques et opportunités que les enjeux de durabilité leur font courir) et IFRS 2 (plus spécifique aux questions climatiques). Un agenda de recherche portant sur la nature et le capital humain a également été annoncé en 2024.
À chaque fois, la logique est celle de la simple matérialité ; et s’inscrit donc dans la continuité de l’analyse financière standard : l’important est d’évaluer les risques pour l’entreprise et ses investisseurs et non pas l’impact de l’entreprise sur son environnement humain et naturel. Cette conception porte une vision délétère de la durabilité ; la nature n’est vue comme importante (matérielle) que du fait de ses impacts financiers.
Comme l’a très justement noté Alexandre Rambaud123, le principe de simple matérialité s’inscrit dans la vision aujourd’hui dominante selon laquelle l’entreprise aurait pour objet principal de maximiser ses profits pour rémunérer des actionnaires, uniquement intéressés que par les gains financiers. C’est une conception très réductrice de l’entreprise et des investisseurs, qui peuvent considérer d’autres dimensions que le profit. C’est ce qu’a, par exemple, rappelé l’Asia Investing Group on Climate Change à l’ISSB en 2022, dans sa réponse à la consultation internationale sur les futures normes IFRS S1 et S2 : « plusieurs investisseurs ont des mandats plus holistiques [que ceux retenus par l’ISSB], qui vont au-delà de la seule création de valeur financière. »
Au-delà de cette bataille des normes, il ne faut pas perdre de vue le fait que la transparence n’est qu’un des outils de la transition écologique
Le reporting a des aspects positifs. La divulgation (et donc la recherche) de données extra-financière permet aux entreprises de prendre conscience de leurs impacts, condition préalable à l’action. Les informations ainsi rendues publiques donnent, de plus, aux parties prenantes (les investisseurs en premier lieu, mais aussi les acteurs publics ou les ONG) des outils pour challenger les pratiques des sociétés.
Cependant, la transparence est loin d’être suffisante pour transformer le business model d’une organisation et au niveau macro-économique pour faire bifurquer l’économie vers un modèle moins carboné, extractif et prédateur. Comme noté dans l’idée reçue 4, les notations ESG faites sur la base du reporting extra-financier ne sont pas un gage de pratiques responsables des entreprises, et encore moins de réorientation massive des flux financiers. Et pour cause, les indicateurs sociaux ou environnementaux ne jouent pas jeu égal avec les données financières : les décisions stratégiques des entreprises restent très largement dominées par les objectifs de performance financière quel qu’en soit les coûts humain et écologique.
Pour en savoir plus
- La directive CSRD et les normes ERS expliquées par l’Autorité des marchés financiers
- Normes extra-financières : Etats-Unis et Europe se livrent une intense bataille politique, Laurence Scialom, 2023
- L’ISSB s’attaque au capital humain et à la biodiversité… mais toujours pas aux intérêts financiers non durables, Alexandre Rambaud, 2024
Les information destinées aux consommateurs
Les entreprises communiquent de nombreuses informations à leurs clients.
Historiquement, cela a d’abord pris la forme de la publicité : qu’elle soit sur les produits eux-mêmes, affichés dans nos villes, dans la presse, dans des brochures dédiées déposées dans les boîtes aux lettres, à la télévision ou sur internet, la publicité est omniprésente dans la vie moderne caractérisée par le consumérisme.
Comme nous l’expliquons dans une fichée dédiée, la publicité est aujourd’hui problématique . Elle accroît la consommation et promeut des modes de vie délétère, elle peut être dangereuse dans certains secteurs comme celui de la santé, elle utilise des ressources naturelles et financières conséquentes, elle n’est pas neutre politiquement (notamment en termes de valeurs promues).
Insistons ici sur le fait que la publicité peut être outrancière pour induire le consommateur en erreur voire mensongère en vantant ou suggérant des qualités que le produit n’a pas. Dans le domaine écologique, c’est le terme de greenwashing qui désigne ce type de pratiques. Il est utilisé pour la première fois en 1986 dans un court essai de Jay Westerfeld124, activiste américain qui dénonçait la pratique d’hôtels incitant les résidents à réutiliser leurs serviettes de toilette sous l’argument de sauver la planète alors qu’il s’agissait prioritairement de réduire les coûts de nettoyage. La première définition apparaît en 1991 dans une étude relative à la publicité environnementale125 et le mot fait son apparition en 1999 dans le Concise Oxford English Dictionary. Le greenwashing peut être utilisé pour faire croire aux qualités écologiques qu’un produit n’a pas en réalité, ou plus largement pour faire paraître plus ambitieuse qu’elle ne l’est la stratégie de développement durable d’une entreprise (tout en passant sous silence ses impacts négatifs). Ces pratiques sont d’autant plus problématiques qu’il est particulièrement difficile pour le consommateur de décrypter le vrai du faux en matière environnementale.
Face à ce constat, les législateurs ont (plus ou moins tôt et avec plus ou moins de force selon les pays) introduit des dispositions permettant de poursuivre les entreprises pour publicité mensongère. Elles prennent en particulier la forme d’actions en justice (menée en France par des associations de consommateurs) pouvant mener jusqu’à des amendes, ou à la réparation de préjudices. Ce type de disposition a été étendu -tardivement- à certaines formes de greenwashing.
Si la publicité est un outil au service des entreprises, elles sont également tenues de donner de nombreuses autres informations aux consommateurs du fait de la réglementation. En France et Europe, le législateur a étendu le champ des éléments à faire paraître sur les produits que ce soit à la suite de scandales sanitaires ou pour poursuivre des objectifs de durabilité. Il existe par ailleurs de nombreux labels publics donnant des informations sur les produits.
Quelques exemples d’informations obligatoires et/ou de labels
- Informations sur la composition des produits alimentaires (et mention des allergènes potentiels)
- Lieux d’origine (et dispositif de traçabilité en particulier dans l’alimentation)
- Étiquette énergie pour informer sur la consommation des appareils électro-ménagers, des bâtiments ou des voitures,
- Nutri-score sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires transformés
- Indice de réparabilité pour limiter les déchets électriques et électroniques
- Ecolabel européen (et label AB en France) pour garantir un minimum de qualité écologique du produit ;
- Eco-score textile sur la qualité environnementale des vêtements
Il n’est pas toujours facile pour le consommateur de faire la part des informations officielles de celles qui relèvent de la publicité. Tout d’abord, les entreprises concernées sont actives dans l’élaboration des normes et des « étiquettes » qui en découlent. C’est ainsi, par exemple, que le nutri-score a fait l’objet d’un intense lobbying de l’industrie agro-alimentaire pour en affaiblir la portée.126 Le label HVE (haute valeur environnementale)127 certifiant les exploitations agricoles fait quant à lui l’objet d’intenses critiques pour les faibles garanties écologiques qu’il apporte. Ensuite, de nombreux labels voire des logos privés ont vu le jour : certains vont plus loin que la réglementation (comme le label Demeter en matière agricole) mais une grande partie relève de la pure communication.128 On est alors très proche du greenwashing évoqué ci-avant.
Limiter les impacts de l’entreprise sur la nature ne suffit pas, il faut réorienter les business models
Pour certains, les entreprises, étant au cœur de l’emploi et de l’innovation, devraient être au centre de l’attention des politiques publiques, avec comme priorité de garantir leur compétitivité et leur croissance. Le bien-être économique global découlerait de telles orientations129. Pour d’autres, les entreprises, soumises à la « loi du profit », seraient des lieux d’exploitation et de prédation, ainsi que la cause principale de la destruction de la nature et de l’asservissement de l’humain par l’humain. Il faudrait donc surtout les encadrer pour limiter leur poids dans l’économie et leurs impacts, voire les socialiser130 ou les nationaliser131. D’autres enfin, dans le sillage du mouvement du développement durable initié par le rapport Brundtland de 1987 puis accéléré par le sommet de Johannesburg en 2002, pensent que les entreprises peuvent contribuer à la transition écologique à condition de développer leur responsabilité sociale et environnementale (point que nous développons dans l’Idée reçue 4 sur la RSE). Nous allons ici nous pencher ici d’une part, sur les impacts écologiques des entreprises et, d’autre part, sur les théories et les pratiques qui ont émergé autour d’entreprises et de modèles d’affaires moins prédateurs voir contributifs.
Évaluer les impacts directs et indirects des entreprises
Les entreprises ont des impacts négatifs directs ou indirects sur la nature
Elles consomment des minerais et des métaux, de l’énergie, de l’eau ; elles tuent des êtres vivants et détruisent des écosystèmes notamment via les activités d’extraction, l’emprise au sol des infrastructures et des bâtiments ; elles émettent des gaz à effet de serre, des pollutions chimiques et produisent des déchets etc.
Les impacts des entreprises peuvent être :
- directs quand ils sont liés aux actifs (machines, usines, parc de véhicule etc.) contrôlés ou exploités par l’entreprise dans son périmètre juridique132 : le chauffage et l’emprise au sol d’un bâtiment lui appartenant, les polluants émis par le processus de production etc.
- indirects quand ils sont liés aux activités situées en amont (celles des fournisseurs, par exemple les impacts d’une mine d’où sont extraits les minerais utilisés par l’entreprise) ou en aval (celles des clients, par exemple les pollutions liées à l’usage des voitures par les clients d’un constructeur automobile) de l’activité de l’entreprise elle-même.
Le terme empreinte est utilisé pour désigner l’ensemble de ces impacts : on parle d’empreinte carbone (voir notre fiche Compter les émissions des gaz à effet de serre), d’empreinte biodiversité, d’empreinte eau, d’empreinte matières133 (qui est pour l’instant essentiellement développée au niveau d’un territoire.
L’entreprise n’a évidemment ni la même responsabilité, ni les mêmes marges de manœuvre selon qu’il s’agit de ses impacts directs ou indirects
Cependant, sa capacité à agir et donc sa responsabilité ne sont jamais nulles. Pour les impacts amont et aval, elles sont partagées.
Par exemple, un constructeur automobile partage la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre et des polluants de l’air avec l’usager de la voiture. Il a en effet la possibilité de construire et de mettre sur le marché des voitures moins polluantes à l’usage. L’usager a aussi une responsabilité liée à la voiture qu’il a choisi d’acheter et à son type de conduite. Sur l’amont de sa chaîne de valeur, le constructeur peut contraindre ses fournisseurs par des cahiers des charges exigeants au plan environnemental et social, tout en acceptant d’y mettre le prix.
Un industriel de l’agro-alimentaire, une chaîne de restauration collective peuvent recourir à des emballages moins polluants ou recyclables ; ils peuvent proposer des plats limitant le recours aux aliments carnés etc. Comme pour l’automobile ils ont des marges de manœuvre sur les cahiers de charges. Et là aussi les consommateurs ont leur part de responsabilité.
L’entreprise a intérêt à évaluer l’ensemble de ses impacts
Cela lui permet de comprendre à quel point son modèle d’affaire « dépend » des pollutions sur lesquelles elle a une influence directe mais aussi indirecte. Elle peut ainsi évaluer le risque de voir sa rentabilité mise à mal par des réglementations ou des dispositifs fiscaux visant à limiter lesdites pollutions, en amont ou en aval de son périmètre juridique. Elle a également tout intérêt à savoir quelles sont les ressources stratégiques dont dépend sa production. C’est bien sûr la même chose bien sur le plan social.
La stratégie qui consiste à influencer les pouvoirs publics pour éviter des durcissements réglementaires ou fiscaux peut faire gagner du temps mais n’est évidemment pas satisfaisante sur le plan éthique (et rend le recrutement des jeunes parfois plus difficile) et pas nécessairement la meilleure au plan économique.
Pour évaluer ses impacts, et pouvoir ensuite les réduire, l’entreprise peut réaliser ou faire réaliser des calculs d’empreinte (cf ci-dessus) plus ou moins détaillés (par filiale, par site, par type de polluants etc.). Elle peut également mobiliser les méthodes d’analyse de cycle de vie afin de réaliser un bilan environnemental multicritère d’un produit, d’un service ou d’un procédé (voire de l’entreprise elle-même) sur l’ensemble de son cycle de vie c’est-à-dire de l’extraction de la matière première à l’a transformation en déchet (ou au réemploi).
Agir : réduire les impacts et transformer le business modèle de l’entreprise
L’évaluation n’est bien sûr pas un objectif en soi. Elle n’a d’intérêt que dans une visée prospective : il s’agit de déterminer une feuille de route, aussi appelée « plan de transition »134, en vue de réduire les impacts considérés voire de transformer profondément le business modèle de l’entreprise.
Disposant des ordres de grandeur et de cette feuille de route, l’entreprise peut chiffrer puis lancer des actions.
Le plus souvent, quand les entreprises agissent, elles se contentent d’optimiser l’existant pour réduire leurs impacts, mais sans transformer profondément leur activité
Il s’agit par exemple :
- d’optimiser les process pour économiser énergie, eau, matières premières, artificialisation des d’espace etc. ;
- de revoir les sources d’énergies utilisées (développer l’approvisionnement en énergie renouvelable) ;
- de prêter attention à la provenance des matières premières (éviter les métaux provenant de zones de conflits, privilégier les matières recyclées, limiter le recours aux produits chimiques voire les remplacer par de la chimie verte etc.) ;
- de limiter des déchets générés et les pollutions chimiques (soit traitement, soit réorientation).
Une véritable prise en compte des enjeux écologiques implique de se poser la question de l’objet de l’entreprise, de son modèle d’affaire, du cœur de ses activités
Dans quelle mesure l’entreprise exerce-t-elle une activité qui contribue à la transition ou plus généralement au bien commun ?
Dans certains secteurs, tels ceux de l’éducation, de la santé ou du soin aux personnes, la contribution au bien commun est de prime abord évidente. L’objet est alors de se concentrer sur la mise en œuvre de l’activité et ses impacts tant du point écologique, qu’humain (ce qui n’est pas négligeable car une entreprise peut être prédatrice dans ses pratiques, quelle que soit le domaine d’activité135).
Dans d’autres, répondre à cette question demande des renoncements et réorientations majeurs. Au niveau macroéconomique, réussir la transition implique en effet d’abandonner nombre d’activités, telles l’exploitation des énergies fossiles, la production et l’usage massif de pesticides, les produits à usage unique jetable etc. Au sein de l’entreprise, cela veut dire renoncer aux activités les plus polluantes ou consommatrices. C’est par exemple le constat de Sophie Robert-Velut, DG des laboratoires Expanscience, quand elle annonce début 2023 que Mustela, une des marques du groupe, arrêtera de commercialiser les lingettes en France en 2027 (soit 20% du chiffre d’affaires de la marque). C’est également ce que font certaines entreprises énergétiques en décidant de vendre leurs actifs fossiles (ou mieux, mais plus rare, de les fermer) et de réorienter leurs activités vers les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique.
Considérer le modèle d’affaire de l’entreprise, c’est envisager non plus de corriger l’activité économique pour qu’elle soit plus propre, mais d’orienter ou de réorienter le cœur business pour avoir un impact positif. En voici quelques exemples :
- le remplacement de produits polluants par d’autres qui le sont moins : la fabrication de vélo (et la construction de pistes cyclables) en remplacement de la voiture ; la production ou l’usage de matières recyclées (par exemple l’aluminium, l’acier, le textile, le papier…) au lieu de matières vierges ; la production d’énergie renouvelables au lieu d’énergies fossiles ;
- les modèles d’affaires fondés sur l’extension de la durée de vie des produits : la réparation (si possible avec des composants recyclés) des appareils électroménagers ou électroniques, le réemploi, le reconditionnement (ex : des téléphones portables) ;
- les activités visant à économiser l’eau ou l’énergie : la production de matériaux isolants, la rénovation énergétique des logements, les services informatiques visant à réduire les consommations d’énergie ou d’eau (de bâtiments, d’équipements pour les entreprises ou les ménages etc.) ;
- les modèles d’affaire visant à vendre l’usage (énergie, mobilité, lavage) plutôt que la possession d’un bien (l’économie de fonctionnalité) ;
- la transformation des activités directement liées au vivant pour qu’elles soient régénératives plutôt que destructrices : l’agroécologie, agroforesterie, les bio cosmétiques, chimie verte etc. ;
- Les activités visant à réparer les destructions faites : dépollution des sols et des océans, renaturation des sols, entretien d’espace naturels, reforestation etc.
Dans de nombreux cas, ces produits, infrastructures, procédés peuvent avoir des effets principaux positifs et néanmoins des effets « collatéraux » négatifs.
C’est pourquoi :
- Avoir un objet social à visée écologique ou « durable » n’exonère pas de veiller à réduire au maximum les impacts de son activité (qui existent forcément) ;
- Il importe d’avoir une vision d’ensemble, rigoureuse et partagée de l’ensemble des impacts écologiques car certaines activités positives sur une dimension peuvent avoir des impacts négatifs sur une autre (ex : le réseau ferré est positif pour le climat par rapport à la voiture mais détruit des habitats et fragmente les territoires ce qui impacte négativement la biodiversité).
C’est pour cela que la Commission européenne a élaboré une taxonomie des activités économiques en fonction de leurs impacts positifs et négatifs sur 6 grands objectifs environnementaux (atténuation et adaptation au changement climatique, biodiversité, eau, pollution, économie circulaire).
La taxonomie européenne : de quoi s’agit-il ?
La taxonomie européenne est une classification qui a pour objectif d’aider les entreprises et surtout les investisseurs à identifier les activités « durables sur le plan environnemental ».
Pour être qualifiée ainsi une activité économique doit respecter quatre conditions :
1/ elle contribue substantiellement à un ou plusieurs des 6 objectifs environnementaux identifiés.136
Il existe trois catégories d’activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des 6 objectifs environnementaux : les activités dites « environnementalement durables » ont un impact positif sur l’objectif considéré ; les activités dites « habilitantes » permettent à d’autres activités de contribuer à l’atteinte d’un des six objectifs ; enfin, les activités dites « transitoires » (qui ne concernent que l’objectif d’atténuation du réchauffement climatique) sont celles qui ont les meilleures performances dans un secteur quand il n’existe pas d’alternative bas-carbone économiquement ou technologiquement viable.
2/ elle ne cause pas de préjudice important à l’un des cinq autres objectifs (c’est le principe du « do not harm »).
3/ elle doit respecter des garanties minimales en matière de droits sociaux et humains (tels que définis dans plusieurs textes internationaux).137
4/ Afin d’évaluer dans quelle mesure les conditions 1 et 2 sont bien remplies, une liste de critères techniques a été élaborée. Pour l’instant, elle concerne 90 activités économiques et seulement les deux premiers objectifs environnementaux (atténuation et adaptation au réchauffement climatique). La liste des critères est consultable sur le Taxonomy Compass.
En savoir plus : Le EU taxonomy navigator regroupe plusieurs outils assez bien faits pour s’y retrouver. La lecture du règlement sur la taxonomie (2020) permet par ailleurs de comprendre les grands principes. Voir également une explication assez claire sur le site de l’AMF.
Conceptualisation des nouveaux modèles économiques : économie circulaire, entreprise contributive, entreprise régénérative
Fonder la valeur économique d’une entreprise sur sa contribution au bien commun
Comme on l’a vu au point précédent, la prise en compte des problématiques écologiques s’est manifestée par l’émergence (ou la mise en lumière) de domaines d’activité et de pratiques d’entreprise nouvelles. Ce mouvement s’est accompagné de tentatives de conceptualisation de ce que pourraient être de nouveaux modèles économiques pour les entreprises.
C’est ainsi, par exemple, qu’en 2010, la Fondation Ellen MacArthur a été lancée afin de populariser la notion d’économie circulaire (dont les premières mentions remontent aux années 1970) . S’il ne fait pas l’objet d’une définition stabilisé, ce concept oppose schématiquement au modèle économique actuel linéaire (extraire des matières, les transformer, les consommer, puis les jeter) un modèle où les flux de matières vivantes et non renouvelables (minerais en particulier) seraient « circularisés » c’est-à-dire que les déchets des uns constitueraient les nouvelles matières premières pour la production.
Ce concept englobant a permis de placer sous une même bannière de nombreux modèle et pratiques économiques ayant émergés au tournant du XXIe siècle : écoconception, économie de fonctionnalité, recyclage, réparation, réemploi, écologie industrielle etc.
D’autres concepts ont également été proposés.
Fabrice Bonnifet, directeur du développement durable du groupe Bouygues et président du C3D, a ainsi développé dans un livre paru en 2021 la notion d’entreprise contributive définie comme une entreprise « qui contribue matériellement aux biens communs (au sens des Objectifs du Développement Durable – ODD) et au bien-être de l’individu ».
Le concept d’entreprise régénérative, apparu dans les années 2010138, désigne quant à lui les organisations ayant engagé deux mouvements en parallèles : « le premier consiste à réduire ses impacts négatifs aux seuils incompressibles ; le second consiste à générer des impacts positifs nets sur les écosystèmes et les communautés humaines à travers une reconnexion au vivant »« . »
Toutes les entreprises ne peuvent pas être régénératives sur leur périmètre propre puisqu’il est nécessaire pour cela d’avoir un lien direct avec le vivant. Les autres pourront contribuer à la « régénération socio-écologique » en constituant (ou en s’inscrivant dans) « des écosystèmes coopératifs d’acteurs dont certains sont en lien direct avec le vivant non humain, de sorte que l’ambition régénérative porte sur ce collectif d’acteurs, bien davantage que sur chacune des entreprises. »
L’importance du passage à l’échelle
Quel que soit le concept utilisé, il est important de ne pas limiter l’analyse à la dimension microéconomique (une entreprise, un secteur) mais bien de considérer les impacts au niveau macro. Tant que ces nouveaux modèles ne concerneront que quelques entreprises pionnières, maintes fois citées en exemple, l’impact global restera limité voire inexistant.
Cela s’explique par de nombreux phénomènes bien documentés :
- Le risque d’effets rebonds : quand l’activité d’une entreprise permet de réduire les consommations d’énergie, d’eau ou d’autres matières premières, les économies financières réalisées peuvent (qu’elles soient faites par l’entreprise ou par le consommateur) peuvent se reporter sur des achats ou des productions supplémentaires, ce qui annihile l’impact positif au niveau global.
- Le risque que les nouveaux produits se surajoutent au lieu de remplacer les productions « traditionnelles », est bien illustré dans le domaine de l’énergie où les énergies renouvelables n’ont pas remplacé les fossiles. C’est également ce qu’on peut constater dans le secteur textile où le développement de la seconde main n’empêche pas celui de la fast fashion.
- La circularité des matières n’est pas infinie : après plusieurs recyclages la plupart des matériaux voient leur qualité se dégrader, après plusieurs réutilisations/reconditionnement les produits baissent en performance : la fin de vie est inéluctable même si elle peut être repoussée.
- Les économies de ressources naturelles permis par les modèles fondés sur la circularité (recyclage, réemploi, reconditionnement, fonctionnalité) sont rendus caduques tant que la consommation de cette même ressource est croissante au niveau global. C’est ce qu’on très bien montré les travaux de François Grosse : « si la consommation de matière croît de plus de 3% par an – comme c’est le cas depuis un siècle pour le fer et le cuivre, recycler même à 90% nos déchets n’a qu’un effet dérisoire sur la préservation des ressources. »139
Le passage à l’échelle nécessite l’intervention publique
Pour promouvoir de nouveaux modèles d’entreprises, le rôle de la puissance publique est incontournable. Il s’agit d’utiliser tous les outils de la politique économique (fiscalité, réglementation, commande et investissement publics, subventions, politique monétaire) pour améliorer voire construire la rentabilité des projets et secteurs de la transition. En effet, qu’il s’agisse de lancer une entreprise fondée sur un des nouveaux modèles économiques ou de transformer une entreprise pour réduire son impact et la repositionner sur des secteurs et pratiques contribuant à la transition, la rentabilité n’a rien d’évident.
L’environnement concurrentiel est défavorable aux projets de transition
La concurrence avec les modes de production et de consommation en place, que ce soit au sein d’une même entreprise ou au niveau de l’environnement économique global, défavorise les acteurs porteurs des nouveaux modèles. D’une part, les promoteurs du « business as usual » sont puissants, structurés et bien implantés comme en témoigne, par exemple, la difficulté qu’ont de nombreux pays à mettre fin à l’exploitation du charbon, alors qu’il s’agit d’une des priorités pour lutter contre le réchauffement climatique. D’autre part, les activités durables sont mises en compétition avec des activités disposant de technologies matures, de compétences répandues, d’investissements amortis, d’infrastructures en place. Le système existant fixe « le prix de vente » face auquel la rentabilité des solutions écologiques est confrontée. L’investissement public couplé à des réglementations favorisant les nouveaux produits ou marchés apparaît ainsi essentiel pour aider à l’innovation, à l’investissement et à la structuration des filières. Bien souvent, l’impulsion voire l’encadrement public est nécessaire pour permettre l’existence de certaines filières. C’est par exemple le cas de celles du recyclage ou de l’allongement de la durée de vie des produits (réemploi, réparation, reconditionnement). Les industriels fabriquant les produits initiaux doivent les concevoir pour rendre possible la réparation, le reconditionnement et in fine la récupération des matières, activités qu’ils ne vont pas nécessairement mettre en œuvre eux-mêmes.
La demande pour les produits ou les investissements durables ne va pas de soi
Du côté des ménages, les gains individuels de bien-être apportés ne sont le plus souvent pas perceptibles puisqu’il ne s’agit pas de donner accès à des biens et services nouveaux, mais de changer la façon dont ils sont produits et consommés. Parfois, ces gains sont lointains dans le temps (la limitation du réchauffement climatique permis par la réduction des émissions de GES) ou dans l’espace (la réduction des destructions minières liée à l’utilisation de matériaux recyclés ou de produits reconditionnés. Le plus souvent, ce sont des gains de bien-être collectifs. Passer d’une électricité au charbon à une production renouvelable apporte plus à la collectivité (réduction des risques, des déchets, des émissions de CO2, de la pollution de l’air) qu’à l’individu. Enfin, dans de nombreux cas, l’amélioration de la qualité de vie ne sera ressentie que si la majeure partie de la population s’y met. Si un individu décide de prendre les transports en commun au lieu de sa voiture, il ne verra d’impact sur l’air pollué de sa ville que si la majorité des citadins fait comme lui.
Du côté des entreprises, la question de la demande se pose également. C’est particulièrement évident pour la matière recyclée : sans encadrement réglementaire (via un pourcentage obligatoire d’incorporation de matières recyclée dans les produits neufs par exemple), le prix serait le seul facteur de demande. Or les prix des matières premières sont soumis à des aléas peu propices à la structuration de filières.
Le manque d’incitation à agir des dirigeants d’entreprise dans l’environnement économique actuel
Sans même parler de l’importance des changements nécessaire pour transformer le modèle économique d’une entreprise, de nombreux freins sont à l’œuvre dès les premiers niveaux d’actions visant à prendre en compte les impacts écologiques.
- Le manque d’information et/ou de conviction relative à l’ampleur de la crise écologique peut conduire à ne pas prioriser les actions en la matière par rapport au quotidien ; un dirigeant peut commander des calculs d’impacts (par obligation légale ou pour des raisons d’image) sans passer à l’action par manque de conviction (ce qui peut résulter d’un manque d’information).
- La contradiction entre les exigences de rentabilité financière et les engagements climatiques, environnementaux et sociétaux.
- Les surcoûts entraînés par les actions (même les actions de mesure et de diagnostic coûtent, ne serait-ce que du temps des collaborateurs).
Ces surcoûts sont généralement considérés comme dégradant les marges voire la compétitivité de l’entreprise, sans nécessairement de contrepartie tangible. Si les dirigeants sont persuadés de la hausse future du prix de l’énergie et des matières premières, ils peuvent justifier des actions gagnantes sur deux tableaux : la baisse de coûts futurs et la baisse des impacts écologiques. Mais ce n’est pas toujours le cas, du fait de l’incertitude qui pèse sur toute projection de coûts.
Même sensibilisés ou formés, les dirigeants ne voient pas pourquoi ils dégraderaient la performance de leur entreprise pour le bien commun, et avec en outre le risque d’une action marginale si les autres acteurs ne font rien. C’est toujours le même paradoxe qui est en œuvre : l’intérêt immédiat d’un agent économique peut être contradictoire avec l’intérêt général même si à terme les dégradations en cause se révèlent dramatiques pour tout le monde.
Les projets de transition apportent des bénéfices sociaux et environnementaux qui ne sont pas pris en compte dans la formation des prix
C’est particulièrement évident pour tous les projets qui visent à restaurer des écosystèmes pour préserver la biodiversité et retrouver le bénéfice des services écologiques que nous en tirons. Difficile de trouver la rentabilité intrinsèque d’un projet de dépollution des sols, de création ou de restauration de zones humides (pouvant générer une économie locale : pêche, écotourisme…) ou de récifs artificiels (favorables à une activité de pêche, ou d’écotourisme sous-marin).
Des modèles qui nécessitent des investissements de long terme
Dans un livre sur L’économie circulaire, paru en 2023, Franck Aggeri Rémi Beulque, Helen Micheaux mettent en évidence sept points clefs pour la conduite de projet de ce type (p49). Les auteurs insistent notamment sur le besoin d’exploration et d’expérimentation collective dans ces projets pour lesquels il n’existe pas de marché, et pour lequel tous les outils et routines existantes (appels d’offre, évaluation ex ante des coûts) sont inadaptés car relevant de l’économie linéaire. Ils soulignent également le besoin de s’inscrire dans une dynamique de territoire, un écosystème d’acteurs divers tant pour la réalisation des projets tout au long de la chaîne logistique que pour la conception de nouveaux standards, outils et méthodes. Tout cela nécessite du temps et donc des investissements conséquents sans aucune garantie de rentabilité.
Même quand les investissements ont une rentabilité intrinsèque sûre, cela reste problématique si c’est sur le trop long terme. C’est le cas, par exemple, de la rénovation énergétique des bâtiments, essentielle pour atteindre les objectifs climatiques. L’investissement initial est remboursé via les économies d’énergie réalisées sur 10-20 ans. Les ménages sont donc amenés à arbitrer entre cette rénovation, un autre investissement ou une consommation immédiate. Par ailleurs, de nombreux ménages n’ont tout simplement pas les moyens d’investir. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que le marché de la rénovation peine à décoller.
L’importance de l’investissement initial impacte l’économie des projets sur leur durée de vie : le coût du financement est déterminant dans la rentabilité du projet. Par exemple, les coûts d’une centrale à charbon sont répartis entre investissement initial et fonctionnement ; tandis que pour la centrale photovoltaïque, les coûts sont très concentrés sur l’investissement initial. Le coût du financement sera donc beaucoup plus déterminant pour la centrale photovoltaïque, or il dépend de l’environnement monétaire (les taux d’intérêt) et réglementaire (favorable ou non à la filière) et de sa prévisibilité dans la durée.
Tous ces éléments permettent de comprendre qu’il est vain d’attendre que les entrepreneurs se mettent tous simultanément au « vert » et ce d’autant plus que dans de nombreux secteurs, il ne s’agit pas de créer de nouvelles activités mais bien d’amener les entreprises en place à exercer différemment leur métier. C’est pour cette raison que le rôle de la puissance publique reste incontournable : elle doit tenter d’aligner les intérêts des acteurs privés et l’intérêt général. C’est ce qui est fait, par exemple, lorsque des polluants sont interdits, quand une fiscalité environnementale est introduite ou des réglementations écologiques sont mise en place etc. Cependant, au vu de l’ampleur des dégradations écologiques locales et globales actuelles, c’est manifestement insuffisant.
Pour en savoir plus
- L’économie circulaire, Franck Aggeri Rémi Beulque, Helen Micheaux, La Découverte, 2023.
- Croissance soutenable, la société au défi de l’économie circulaire, François Grosse, PUG, 2023.
- Écologie intégrale, pour une société permacirculaire, Christian Arnsperger et Dominique Bourg, PUF, 2017.
- L’entreprise contributive : concilier monde des affaires et limites planétaires, Fabrice Bonnifet et Céline Puff Ardichvili, Dunod, 2021.
- La permaentreprise : un modèle viable pour un future vivable, inspiré de la permaculture, Sylvain Breuzart, Eyrolles, 2021.
- L’entreprise engagée face aux défis du XXIe siècle, Rapport du Groupe de travail présidé par Isabelle Kocher de Leyritz, Le Club des juristes (2024)
- L’entreprise à visée régénérative : fondamentaux et pionniers, Christophe Sempels, 2024 (PDF)
Les entreprises multinationales ont des pouvoirs excessifs
Nous allons évoquer dans cet Essentiel les sociétés multinationales de très grande taille. Les multinationales140 sont des groupes d’entreprises qui ont des filiales dans des pays autres que celui de la société mère. Il y en aurait de l’ordre de 80 000 dans le monde141.
Concernant la taille, sur quels critères s’appuyer pour dire qu’une entreprise est « très grande » ? L’Insee considère qu’une grande entreprise vérifie au moins une des deux conditions suivantes : avoir au moins 5 000 salariés ; avoir plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et plus de 2 milliards d’euros de total de bilan. Le classement par Forbes des plus grandes entreprises mondiales142 s’appuie quant à lui sur le chiffre d’affaires, la capitalisation boursière, les bénéfices et les actifs. Dans le classement 2023143, la plus grande entreprise est une banque américaine, JP Morgan, suivie de l’entreprise pétrolière Saudi Aramco, et de trois banques chinoises. La première française est TotalEnergies, classée 21e avec un chiffre d’affaires de plus de 250 milliards de dollars. Forbes ne donne pas d’informations sur les effectifs, mais on peut situer les ordres de grandeur. Dix entreprises emploient plus de 500 000 personnes, les trois premières étant Walmart, Amazon (chacune dépassant le million), et Foxconn (le sous-traitant d’Apple en Chine). En France, dans le secteur privé, c’est Téléperformance, leader mondial des centres d’appels, qui a les effectifs les plus nombreux en 2023 (supérieurs à 400 000).
Ce gigantisme est dû à la concentration des entreprises, qui s’observe dans de nombreux secteurs (numérique, énergie, agro-alimentaire, finance, pharmacie, mines, négoce de matières premières, etc.), comme on en donnera quelques exemples plus loin. Dit autrement, la course à la taille n’est pas une loi de l’Histoire. Elle a d’ailleurs été encadrée sérieusement, par exemple aux États-Unis, avec la loi anti-trust de 1890 (le Sherman Antitrust Act).
Concentration économique : le paradoxe de la libre concurrence
Selon l’enseignement le plus répandu en économie, la concurrence libre et parfaite serait la source de l’efficacité et de l’optimum économiques. À l’opposé, les positions dominantes et la concentration sur les marchés seraient condamnables, notamment parce qu’elles conduisent à des prix moins favorables aux consommateurs. Elles s’observent pourtant presque partout dans le monde, et dans tous les secteurs. Le paradoxe est donc patent : la théorie économique qui justifie le libre marché s’appuie sur une hypothèse qui est contredite empiriquement, par le fonctionnement même de ce libre marché. Il faut, en effet, à l’évidence des réglementations pour en empêcher les entreprises de grossir – ce qui veut dire s’opposer à la libre concurrence…
Nous allons maintenant revenir à la source de ce paradoxe.
Le raisonnement économique selon lequel la concurrence libre et parfaite conduirait à un optimum se fonde sur une représentation de l’économie dans laquelle chaque entreprise n’a qu’une faible part de marché et n’a pas d’influence sur les prix. On dit que ce sont des « preneurs de prix » : n’ayant pas d’influence significative sur les prix de marché, qui sont fixés par la confrontation d’acteurs diffus, elles sont obligées de les « prendre » tels quels.
Les grandes entreprises peuvent, au contraire, être des « faiseurs de prix » quand elles ont une position suffisamment dominante pour influencer ce prix.144
Le droit de la concurrence vise à empêcher les positions dominantes sur un marché, qui empêcheraient l’entrée de nouveaux acteurs. Dans ce raisonnement, le principal problème d’un monopole ou d’un oligopole, c’est la formation de rentes au profit des producteurs et au détriment des consommateurs.
L’hypothèse centrale qui permet de démontrer qu’une situation de concurrence avec une multiplicité d’agents conduit à un optimum est la « loi » des rendements décroissants.
Dans ce cas, le coût de la dernière unité vendue est plus élevé que celui de la précédente (ou inversement, avec la même quantité utilisée d’un facteur de production, la production augmente de moins en moins). Historiquement cette loi (formulée par Turgot puis reprise et améliorée par David Ricardo) a été mise en évidence dans le domaine agricole, où les terres étaient supposées être exploitées par ordre de fertilité décroissante. Dans un secteur économique où les rendements sont effectivement décroissants, il est facile de comprendre que la taille – donc la concentration- ne sont pas des atouts.
Dans de nombreux secteurs économiques, pourtant, les rendements sont croissants145. L’exemple du numérique est le plus connu, l’industrie du logiciel est à coût marginal nul : la dernière copie d’un logiciel ne coûte rien à produire et sa rentabilité est maximale. Les rendements croissants poussent à la taille et à la concentration : plus un acteur est gros, plus il peut baisser ses prix et écarter la concurrence. La grande majorité des opérations de fusion sont d’ailleurs justifiées par les économies d’échelle qu’elles permettent de faire.
En pratique, décider de sanctionner une position dominante ou de refuser une fusion d’entreprises est difficile. Cela dépend évidemment des détails du droit applicable, et repose sur une analyse délicate : quel est le marché considéré, sur quels critères fonder la décision etc. Une telle décision est par ailleurs politiquement délicate, dans un contexte de mondialisation, où la course à la taille peut être au contraire encouragée (pour avoir des « leaders mondiaux ») dans d’autres pays.
De manière plus sévère, le droit de la concurrence interdit et sanctionne pénalement les ententes et les « cartels »146. L’idée est, là, moins discutable : s’entendre sur les prix, c’est clairement faire obstacle aux concurrents n’appartenant pas à l’oligopole.
La maîtrise des prix et la formation de rentes n’est évidemment pas un sujet anecdotique sur le plan social. Ainsi, dans le domaine alimentaire, la présence d’oligopoles puissants dans la production, le négoce, et la distribution (voir encadré) peut conduire, via des hausses de prix -éventuellement accrues par la financiarisation de ces marchés et les mouvements spéculatifs qui en résultent- à des tensions alimentaires très fortes voire à des famines147. De telles situations peuvent survenir sans que la condition du monde paysan ne s’améliore, auquel les hausses de prix subis par les consommateurs ne bénéficient pas.
La concentration dans le secteur agro-alimentaire
L’univers agro-alimentaire est au centre de la destruction de la biodiversité, et c’est un gros émetteur de gaz à effet de serre (via les engrais, et le méthane des ruminants et des rizières). Face à la multiplicité des paysans et agriculteurs, on observe dans ce secteur une concentration considérable des acteurs, comme le montre le rapport Trade and development 2023 de la CNUCED qui a dénombré quatorze grands groupes régnant sur ce secteur. À eux seuls, les quatre premiers – Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge, Louis Dreyfus – contrôleraient quelque 70% du marché mondial des céréales. En 2022, elles ont réalisé un bénéfice cumulé de plus de 17 milliards de dollars, soit près du triple de leurs résultats de 2020. Dans le secteur de la bière148, trois groupes industriels rassemblent plus de 1400 marques.
On peut aussi mentionner la concentration amont, du machinisme agricole : John Deere, CNH industrial, Kubota (Japon) et AGCO font 53% du marché. Dans le domaine des phytosanitaires : Bayer-Monsanto (Allemagne), Syngenta-ChemChina (Chine), Dupont-Dow (USA), BASF (Allemagne) représentent 84% du marché.
En outre, ces entreprises sont au cœur d’une financiarisation massive des marchés de matières premières agricoles et donc reliées à de puissants acteurs financiers, générant une forte volatilité sur les cours de produits agricoles. Les dernières années de tensions et de risques de pénuries sur les marchés agricoles ont décuplé les appétits, poussés par l’appât du gain.
Les pratiques discutables voire répréhensibles de très grosses entreprises
Sans aller plus loin dans l’analyse économique, nous allons passer en revue certains des dommages sociaux et environnementaux149 que ces très grandes entreprises peuvent générer du fait de leur puissance et de leurs moyens financiers (soit individuellement, soit en agissant à plusieurs via des organisations professionnelles visibles ou des structures de lobbying).
Façonner notre monde physique mais aussi nos modes de vie et nos désirs
Avant même d’évoquer des dommages spécifiques bien visibles, remarquons que les sociétés multinationales façonnent en profondeur notre monde physique, mais aussi nos modes de vie, nos désirs, nos divertissements… Ce sont les multinationales qui conçoivent et construisent les infrastructures (ports, aéroports, routes, usines, etc.) et les grands bâtiments (hôpitaux, hôtels, …), homogénéisant le monde entier : qu’est-ce qui différencie un hôtel de luxe selon qu’il est situé à Kuala Lumpur, New-York, Paris ou Bangalore ? Ce sont les multinationales qui font la mode et le goût. Qu’on pense au fait que L’Oréal dépense le tiers de son chiffre d’affaires150 en marketing et publicité pour imposer ses produits et sa vision de la femme ou de l’homme idéaux. Ce sont les multinationales qui ont créé le monde du jetable. Qui se souvient de l’arrivée des premiers briquets jetables, à l’ère où Shein nous incite à changer de vêtements tous les jours et à jeter ceux qu’on portait hier ? Les multinationales impactent nos divertissements, imposent leurs héros (Mickey et Spiderman sont connus dans le monde entier). Au total, elles réduisent la diversité culturelle et, dans le domaine agricole, la diversité biologique et celle de nos paysages. Enfin, elles influent sur nos comportement sociaux et nos opinions.151
Accaparer des ressources naturelles dans des pays peu développés, en saccageant l’environnement
Les entreprises extractives (énergies fossiles, minerais et métaux) exercent une véritable prédation contre la nature. Cette réalité a été bien documentée dans le rapport d’étude Controverses minières – Volet 1 – Caractère prédateur et dangereux (juin 2021), réalisé par l’association SystExt, spécialisée sur les mines. Dans les pays pauvres, cette prédation se fait aussi au détriment des populations. Directement, en dévastant l’environnement dans lequel elles vivent, voire en recourant à la violence armée.152
Indirectement, en ne rétribuant pas suffisamment le produit de ces extractions. Les accords de partage de production (ou Production-Sharing Agreement, PSA) qui remplacent progressivement les concessions ne sont pas toujours équitables, et ce à deux niveaux : l’État propriétaire de la ressource peut ne récupérer qu’une part faible de la rente, et cette partie de la rente récupérée peut ne pas bénéficier aux populations du pays concernés.
Ces questions sont permanentes pour toute l’industrie extractive mondiale, dont nous verrons en encadré qu’elle est très concentrée, ce qui donne aux leaders mondiaux une puissance considérable et déséquilibre fortement le rapport de forces en leur faveur.
La concentration dans les secteurs des mines et du négoce de matières premières minérales
Le monde des mines et du négoce de matières premières minérales connaît les mêmes caractéristiques de concentration et de financiarisation que le monde agricole. Une petite douzaine de multinationales contrôlent la grande majorité de l’activité minière (Rio Tinto, BHP Billiton, Vale SA, Tata Steel, Anglo American, Jiangxi Copper Corporation, Dundee Precious, Freeport-McMoRan).
Et comme pour les matières agricoles et les énergies fossiles, le négoce de ces matières premières est très financiarisé (citons quelques négociants spécialisés, Vitol, Trafigura, Gunvor, Mercuria). Certains des acteurs (comme Glencore, avec GlencoreXstrata ) ont d’ailleurs des filiales spécialisées dans le négoce.
Influencer voire faire pression sur les décideurs politiques pour affaiblir les réglementations qui leur seraient défavorables
Le lobbying est devenu une pratique banale. Il s’agit pourtant, pour une entreprise ou un groupe d’entreprises, d’influencer, dans le sens de ses/leurs intérêts, les décideurs politiques153 chargés de l’intérêt général. Au Parlement européen, par exemple, une étude de l’ONG Agir pour l’environnement, parue en 2024 a mis en évidence les budgets pratiqués par les équipes de lobby154. Comme le rapporte le média Novethic155, « les 5800 lobbys enregistrés sous la bannière “Associations commerciales et professionnelles” et “Compagnies & groupes” ont dépensé entre 965 millions et 1,3 milliard d’euros dans leurs activités de lobbying sur les onze derniers mois recensés ».
Cette pression peut conduire à une « capture du régulateur » ou capture réglementaire, terme proposé par le « prix Nobel d’économie »156 George Stigler en 1982, pour désigner le fait que les autorités de régulation sont contrôlées par des intérêts privés.157
Dans le cas du changement climatique, les pratiques de lobbying des groupes pétroliers et les moyens financiers déployés sont maintenant bien documentés158. Citons également le traité sur la charte de l’énergie , qui permet aux entreprises d’attaquer les États adoptant des mesures réglementaires (éventuellement pour préserver le climat) contraires à leurs intérêts.
Cette pression sur les États peut aller jusqu’à leur mise en concurrence sur les plans fiscaux sociaux et environnementaux. Les médias témoignent régulièrement de projets d’implantations d’usines ou de sièges sociaux, où la concurrence entre États permet aux entreprises d’obtenir des subventions ou des baisses de charges sociales et d’impôts. Sur cette vaste question, la préoccupation majeure est celle de la course mondiale au moins-disant fiscal en matière d’impôts sur les entreprises, dont l’Impôt sur les Sociétés. Citons simplement le cas de Stellantis, l’entreprise née du regroupement de PSA, Fiat et Chrysler, dont le siège social est aux Pays-Bas pour d’évidentes raisons fiscales159. On peut dire que les Pays-Bas se soumettent aux pressions des multinationales pour les attirer et attirer leurs emplois. C’est encore plus net pour l’Irlande.
Mettre au point des stratégies d’évitement fiscal qui réduisent les ressources des États
Les multinationales ont les moyens d’embaucher des fiscalistes de haut niveau, parfois issus des administrations fiscales, pour adapter, en fonction des fiscalités nationales, leurs organisations et les flux financiers entre sociétés, afin de réduire au maximum les impôts à payer. Ces pratiques sont connues de longue date et un travail considérable a été fait sous l’égide de l’OCDE pour en limiter l’ampleur . Il a été relaté par l’un de ses acteurs clefs, Pascal Saint-Amans, dans son livre Paradis fiscaux Comment on a changé le cours de l’histoire (Seuil, 2023). Ce travail a permis d’amoindrir considérablement le secret bancaire, dans les pays de l’OCDE (avec la mise en place d’obligations de déclarations), et aussi de s’attaquer à l’évitement fiscal des entreprises, avec la mise en place d’un impôt minimum mondial de 15%. Mais le livre donne de nombreux exemples de l’action des multinationales pour contrer tout progrès en la matière. Et le chemin, pour ces raisons, reste long avant que nos systèmes fiscaux ne soient plus justes socialement.
Pour en savoir plus sur les mécanismes et les montants « perdus » par l’évasion fiscale des entreprises, voir notre fiche Évasion et paradis fiscaux
Contrôler les médias, éventuellement en les achetant
En France, la majorité des grands médias sont détenus ou contrôlés par des groupes puissants contrôlés par des milliardaires et/ou leurs familles : Vincent Bolloré et Bernard Arnaud et leurs familles, Xavier Néel, Rodolphe Saadé, la famille Dassault, la famille Bouygues…
Citons au niveau international Rupert Murdoch, le milliardaire propriétaire entre autres de Fox News et du Times.
Médias français, qui possède quoi ?
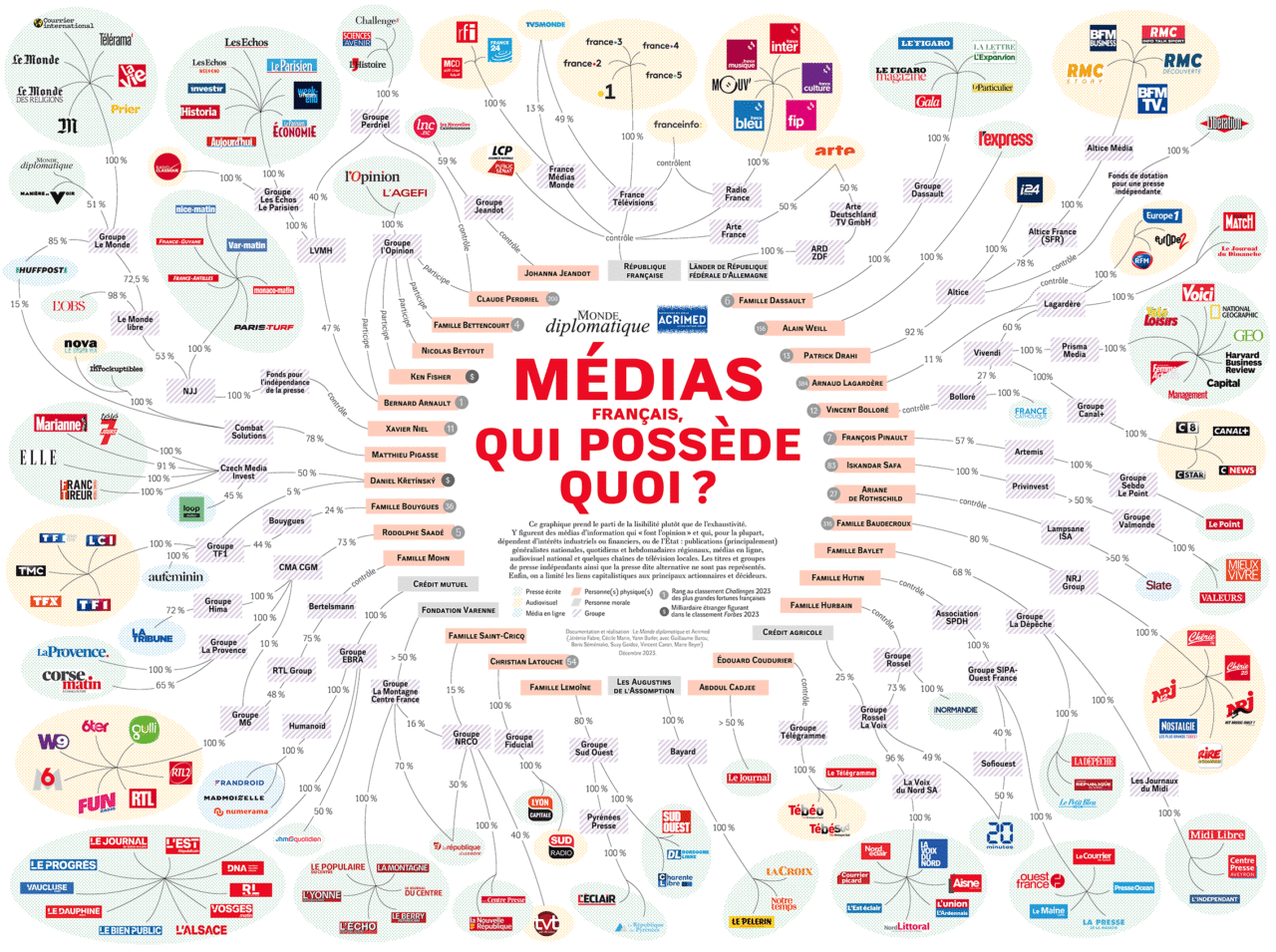
Source Le Monde Diplomatique
Carte mise à jour en décembre 2023.
Influencer le résultat des élections
C’est manifeste aux États-Unis où il n’y a pas de limites en matière de financement des campagnes160, avec le cas emblématique de la famille Koch, dont la fortune provient du pétrole, qui a une influence démontrée sur le climatoscepticisme du camp républicain.
Total des dépenses des candidats au second tour de l’élection présidentielle aux États-Unis (en millions de dollars)
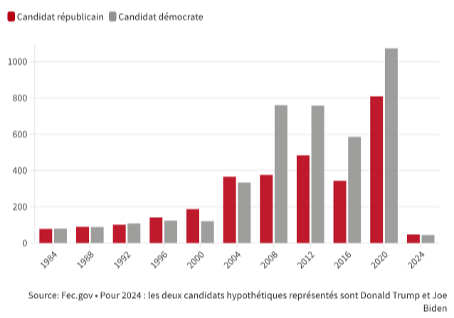
Source Présidentielle américaine : quand les milliards pleuvent sur les candidats, Les Échos (05/03/2024)
Plus récemment161 Elon Musk et d’autres milliardaires se sont engagés à soutenir la campagne de Donald Trump à coup de dizaines de millions de dollars162. Dans d’autres pays, les multinationales peuvent jouer un rôle direct sur les élections. Rappelons l’implication d’ITT163 dans la déstabilisation du président chilien Allende. En Afrique, le rôle du groupe Bolloré dans les élections (au Togo et en Guinée) a été établi devant la justice.164
Nous ne donnons ici que quelques exemples, mais pour en savoir plus, nous vous conseillons le livre de Julia Cagé, Le prix de la démocratie (Fayard, 2018).
Corrompre les fonctionnaires ou le personnel politique dans les pays où c’est possible voire systématisé
Le site de l’Observatoire des multinationales donne plusieurs exemples de ces pratiques.
L’affaire Elf, en 1994, a été révélatrice de telles pratiques françaises en Afrique. Dans les pays autocratiques, ou dans les pays où l’administration est faible et mal payée, il est difficile de faire des affaires sans recourir aux pots de vin et autres pratiques occultes.
C’est évidemment plus facile pour de grosses multinationales qui en ont les moyens financiers et humains. Selon les estimations de la Banque mondiale, citées par Martin Sajdik165, chaque année, « 1 000 à 2 000 milliards de dollars sont perdus à cause de la corruption, soit 10 fois le budget annuel des 34 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques réunis. […] ». Ajoutons que les coûts de la corruption ne sont pas que financiers. La corruption érode la confiance dans les institutions publiques, compromet la protection de l’environnement et exacerbe la pauvreté et les inégalités.166
Diffuser des produits toxiques
Les multinationales peuvent être vues positivement dans certains pays, où elles créent de l’emploi, investissent et, plus globalement, participent au développement économique. Mais si elles sont en position dominante, elles peuvent abuser de cette position pour vendre des produits qui peuvent se révéler nocifs. La distribution de ces produits peut se faire avec le « consentement » des populations impactées par un projet (ou par la diffusion d’un produit, d’un procédé) ou « utilisées » pour tester un médicament167. Elles ne sont pas obligées de corrompre les politiques ou d’acheter au sens strict le consentement des populations pour l’obtenir. On se souvient du scandale du lait en poudre168 dans les années 1970 ; plus récemment Nestlé a été accusée de rajouter du sucre dans ses produits pour bébé, favorisant ainsi l’obésité169. Citons des exemples dans des pays développés : la dépendance des américains aux opioïdes est un scandale et un drame sans précédent170 ; la pollution par les PFAS, « polluants éternels »171 aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Ce sont les médecins qui ont prescrit des drogues, après une stratégie de « marketing » particulièrement bien étudiée et agressive de Purdue Pharma… Mentionnons enfin, parmi bien d’autres projets de ce type, le projet EACOP développé par TotalEnergies qui se targue de ses avantages pour les populations locales, alors qu’il est climaticide et que ses impacts environnementaux et sociaux sont considérables.172
Exercer une domination sur leurs sous-traitants afin de leur imposer des conditions de travail dégradées ou des pressions environnementales excessives
En 2013, l’effondrement du Rana Plaza173 au Bangladesh, qui avait provoqué plus de 1000 morts, a ouvert la réflexion sur les devoirs et responsabilités des sociétés-mères vis-à-vis de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants174. En 2024, un jury étatsunien a jugé la compagnie Chiquita (ex-United Fruit Company175, qui a donné naissance à l’expression « république bananière ») responsable de la mort de huit personnes176 aux mains de la milice paramilitaire AUC, payée par la multinationale pour « protéger ses intérêts » et « résoudre » les conflits avec les travailleurs et syndicats.
La France a été pionnière, en votant une loi sur le devoir de vigilance en 2017. Le parlement européen a voté en fin avril 2024 une directive européenne, la CS3D sur ce devoir de vigilance177, qui vise à obliger les entreprises d’une certaine taille à contrôler les risques de non-respect du droit du travail et de l’environnement dans l’ensemble de leur chaîne de valeur. Plus précisément, la directive exige de ces entreprises (et de leurs partenaires en amont et en aval) de prévenir, de stopper ou d’atténuer leur impact négatif sur les droits humains et l’environnement, y compris aux niveaux de l’approvisionnement, de la production et de la distribution. Cela inclut l’esclavage, le travail des enfants, l’exploitation par le travail, l’érosion de la biodiversité, la pollution ou la destruction du patrimoine naturel.
Corrompre ou instrumentaliser des scientifiques pour qu’ils produisent des études permettant d’instiller des doutes dans l’esprit des citoyens
On doit à deux universitaires américains, Naomi Oreskes et Erik M.Conway178, d’avoir identifié et documenté une méthode utilisée délibérément par les grandes entreprises pour créer du doute et de la confusion dans les esprits des citoyens et des décideurs politiques, quand les preuves scientifiques des effets négatifs de certains de leurs produits deviennent convaincantes et connues. La stratégie ne consiste pas à nier ces preuves, mais à créer des doutes dans l’esprit des consommateurs en avançant d’autres données ou résultats scientifiques : l’industrie du tabac179, face aux risques de cancer lié au tabagisme, a financé des recherches pour créer du doute sur ces liens, en mettant en évidence, par exemple, d’autres causes du cancer des poumons ; l’industrie a ensuite financé des officines pour diffuser les informations générant du doute. Cette stratégie a été mise en œuvre dans plusieurs domaines et notamment dans celui du changement climatique. Elle n’est à la portée que des grandes entreprises, seules capables de mobiliser des scientifiques de haut vol, et de financer les recherches et cabinets de communication ou de lobby. Le secteur énergétique, très concentré, a participé à ces campagnes de manipulation.
La concentration du secteur de l’énergie
Moins de 60 producteurs (multinationales ou entreprises publiques) de pétrole, de gaz, de charbon et de ciment sont directement liés à 80% des émissions mondiales de CO2 fossile depuis l’accord de Paris (voir la base de données Carbon Majors). Cette base de données montre également que 122 entités sont liées à 72% de toutes les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles et du ciment depuis le début de la révolution industrielle. La production de charbon de l’État chinois arrive en tête, avec 14% des émissions mondiales historiques de CO2. C’est plus du double de la proportion de l’ex-Union soviétique, qui occupe la deuxième place, et plus de trois fois supérieure à celle de Saudi Aramco, qui occupe la troisième place. Quant à la major française TotalEnergies, elle développe les hydrocarbures dans le plus de pays du monde -53 pays-, prenant le risque d’enfermer des économies entières dans de nouvelles dépendances aux énergies fossiles.
Idées reçues
Seules les entreprises seraient créatrices de richesses et d’emplois
Les entreprises (sous-entendu privées et commerciales) seraient pour certains la source essentielle de la richesse et de l’emploi ; dès lors, les autres acteurs (publics ou associatifs) seraient peu utiles voire nuisibles à l’activité économique car vivant sur le dos de ces entreprises.
Cette idée reçue repose notamment sur la « loi de Say » . Élaborée il y a plus de 200 ans, cette « loi » postule que toute nouvelle offre de bien ou de service créerait automatiquement sa propre demande. Les entreprises seraient ainsi à l’origine de toute activité économique et donc des emplois. Les politiques publiques qui découlent de telles croyances sont bien identifiées. Il s’agit des politiques dites de l’offre qui visent à faciliter la vie aux entreprises privées en limitant les réglementations et les « rigidités » du marché du travail (c’est-à-dire en schématisant le code du travail), en réduisant le poids de la fiscalité et des charges sociales, en déréglementant les secteurs réglementés (taxis, notaires etc.). Sur ce dernier point, il peut, en effet, être exact que des barrières à l’entrée excessives créent des rentes, et empêchent d’autres acteurs privés de pénétrer un marché où ils pourraient innover, créer des richesses et de l’emploi. Cependant, lever les réglementations ne crée pas magiquement de l’emploi, cela peut même être l’inverse.
Plus généralement, l’idée que seules les entreprises du secteur privé créent de la richesse et des emplois ne résiste pas à l’analyse. On a déjà vu dans l’Essentiel 2 que l’analyse qui est faite par l’Insee du système productif concerne moins de 60% de la valeur ajoutée générée par l’économie française en 2021. Nous nous concentrons ci-après sur la question de l’emploi.
D’après les données disponibles180, en France, plus de trois emplois salariés sur dix ne relèvent pas des entreprises privées et commerciales.
Répartition de l’emploi salarié en France par type d’employeur
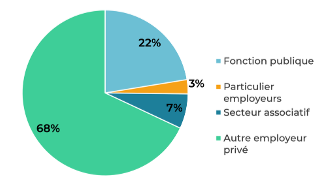
Source Pour le secteur associatif : Les chiffres clefs de la vie associative 2023 (p14). Pour les autres employeurs : Estimations d’emploi – Insee Résultats – L’emploi en France en 2021 (tableau t103).
Les emplois non-marchand, parfois considérés comme « improductifs », sont non seulement nécessaires à la vie économique mais souvent vitaux
Le secteur non-marchand est vaste : il couvre les services publics, les services rendus par le monde associatif (une partie de l’Économie sociale et solidaire).
Nous ne rentrerons pas ici dans le débat sur la taille du secteur public. Notons simplement que les entreprises et les citoyens bénéficient -sans toujours s’en rendre compte (précisément parce qu’ils ne les paient pas directement)- des services publics qu’il s’agisse de la sécurité, de la justice, de la qualité des infrastructures, des services administratifs au sens large etc.
Concernant le monde associatif, citons juste quelques exemples : les associations caritatives qui livrent de la nourriture aux plus pauvres évitent la sous-nutrition de millions de personnes en France. Les parents sont bienheureux du bénévolat très majoritaire dans le monde des clubs sportifs ou des services culturels pour enfants.
En outre, les « services non marchands » (soins à la personne, culture etc.) donnent un travail indispensable à ceux qui sont employés et des « bénéfices » essentiels à ceux qui en bénéficient. Souvent ces services n’ont pas la rentabilité attendue par les capitaux privés et il serait absurde de vouloir les privatiser pour des raisons idéologiques.
Il n’est pas prouvé que le privé soit plus efficace
La gestion de l’eau et des déchets, par exemple, est parfois réalisée par des entreprises privés et parfois par le public. La question de la bonne gestion dépend des situations précises et du contexte. Il existe au moins autant d’exemples allant dans un sens que dans l’autre.
Dans le domaine médical, les comparaisons internationales font douter de l’idée que le privé serait « moins cher ». Dans le domaine de la dépendance et de la retraite, les Ehpad privés font-ils mieux que les structures publiques ? Au vu du scandale ORPEA181, on est en droit d’en douter. Les opérateurs privés qui se lancent ou développent le business des maisons de retraite, sont d’abord intéressés par l’immobilier et sa valeur financière. Ils voient les soins et l’attention à porter aux personnes âgées, comme des coûts à optimiser et qui pourraient dégrader la rentabilité du business.
Il faut cependant éviter le manichéisme : des Ehpad privés peuvent être gérés convenablement (si le montage financier laisse assez de place aux salaires et aux achats indispensables au confort des résidents, donc si les exigences de rendement des investisseurs sont raisonnables). Des Ehpad publics peuvent aussi être mal gérés. L’affaire ORPEA aura cependant servi de révélateur à un secteur majoritairement en difficultés financières à la suite du COVID, aux problèmes de personnel qui en ont résulté et aux augmentations de charges liées aux conséquences énergétiques de la guerre d’Ukraine.
Il est nécessaire de définir ce qu’on considère comme de la création de « richesses »
Assimiler la création de richesse à la valeur ajoutée dégagée par les entreprises – et, par extension. au niveau d’un pays, au PIB et à sa croissance – est extrêmement réducteur.
Un pays est avant tout riche de son patrimoine au sens large, comme nous l’expliquons dans le module sur le PIB. Plus généralement, un État est riche de tout ce qui fait qu’il fait bon y vivre. Il serait préférable de parler de prospérité ou de bien-être social. Les services qui visent à préserver les écosystèmes, services souvent non rentables et assurés par le secteur public, participent à la richesse du pays. Les services sociaux et médicaux participent à la qualité de vie et à la santé, un indicateur majeur de la prospérité d’un pays.182
L’accroissement de la productivité du travail n’est pas que bénéfique
La productivité du travail désigne le rapport entre la production réalisée et le travail nécessaire pour y parvenir183. Comme nous le montrons dans le module Travail et Chômage, depuis deux siècles, les gains de productivité spectaculaires ont « libéré » une partie des humains d’un travail manuel harassant. On ne peut nier que cette productivité accrue est en grande partie le fait des entreprises qui lèvent des capitaux, investissent dans des machines et améliorent les procédés.
Il serait absurde de ne pas reconnaître l’intérêt de cette libération. Mais pas au point d’en faire un mantra, et d’orienter toute l’activité économique vers ces seuls progrès au détriment de tous les autres. La recherche à tout prix de la productivité peut, en effet, s’avérer néfaste. Par exemple, dans les secteurs des soins à la personne ou de l’éducation, le temps passé est souvent une source de qualité (donc de valeur) du service rendu. Qualifier ces secteurs d’improductifs (parce que leur productivité ne croit pas) est tout simplement ridicule !
Embaucher n’est pas nécessairement synonyme de création de nouveaux emplois
Cela dépend du contexte. Ainsi Amazon, qui a déclaré créer 4000 emplois en 2021 en France, en a aussi détruit, mais chez ses concurrents ou assimilés. Le bilan n’est pas facile à établir sans étude spécifique.
On peut, de plus estimer qu’une entreprise qui « marche bien » est plutôt une entreprise plus productive que ses concurrentes et qu’elle « détruit » donc des emplois, toutes choses égales par ailleurs. En effet, si elle est économiquement plus efficace c’est qu’elle emploie moins de personnel que ses concurrents.
Les dirigeants ne devraient s’occuper que de la création de valeur pour leurs actionnaires
La plupart des gens aujourd’hui diraient que les entreprises n’ont qu’un seul but : maximiser la richesse de leurs actionnaires, mesurée par le cours de l’action. Les autres objectifs – servir les clients, fabriquer de bons produits, fournir de bons emplois – ne sont considérés comme des objectifs légitimes que dans la mesure où ils augmentent la « valeur actionnariale ».
Professeur de droit des affaires à la Cornell School of Law, Lynn A. Stout retranscrit ici une opinion largement répandue qui a façonné, au cours des dernières décennies, la gouvernance et les pratiques de la majorité des grandes entreprises. Elle conduit à une focalisation sur la réalisation de profits à court terme, dommageable en termes écologique, social voire pour la pérennité de l’entreprise elle-même184 (voir l’Essentiel 5 ainsi que notre module sur la finance). Or comme nous allons le voir, cette opinion n’a aucun fondement juridique ou économique.
De quand date la domination idéologique de la valeur actionnariale, comme objectif premier de l’entreprise ?
Le questionnement sur l’objet social de l’entreprise est relativement récent
Ce questionnement apparaît au début du XXe siècle, avec l’émergence de grandes entreprises cotées en bourse et détenues par une multitude de petits actionnaires. Avant cela, la question ne se posait pas vraiment : la plupart des entreprises étant contrôlées et dirigées par un ou plusieurs actionnaires (le fondateur, sa famille ou ses proches) très impliqués, leur objet dépendait de la volonté de ceux-ci et pouvait être varié (profit, aventure entrepreneuriale, bonne santé et croissance à long terme de l’entreprise elle-même etc.).
Dans les grandes entreprises cotées, un autre mode de direction se met en place. Elles ne sont plus dirigées par les fondateurs ou leurs descendants, mais par des dirigeants/ gestionnaires embauchés pour cela par les conseils d’administration (élus par l’Assemblée générale des actionnaires, voire l’Essentiel 4 sur la gouvernance).
D’où l’émergence d’un questionnement autour du rôle de ces gestionnaires. Doivent-ils gérer l’entreprise uniquement en vue de servir les actionnaires ou en fonction d’objectifs plus variés ? Pendant la plus grande partie du XXe siècle, c’est la seconde philosophie, dite « managériale », qui l’emporte, mais les choses changent à partir des années 1970.
Milton Friedman : l’entreprise au service de la valeur actionnariale
Dans les années 1970, les économistes de l’école de Chicago28 développent une rhétorique selon laquelle l’analyse économique « prouverait » que la finalité de l’entreprise est de faire gagner de l’argent à ses « propriétaires », à savoir les actionnaires (ce qui est faux comme nous allons le voir plus loin). Le meilleur moyen d’évaluer la performance d’une entreprise consisterait à regarder l’évolution du prix des actions sur le marché.
Cette pensée est incarnée par Milton Friedman, chef de file de l’école de Chicago. En 1970, il écrit dans le New York Times un article au titre explicite « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits ».
Il y reprend une thèse déjà développée dans son ouvrage Capitalism and Freedom (1962) : l’idée que l’entreprise pourrait avoir une responsabilité sociale autre que de dégager des profits pour ses actionnaires est subversive voire dangereuse, car elle revient à confier à des personnes privés (les dirigeants de l’entreprise) un pouvoir de décision sur ce qu’est l’intérêt global de la société.
La théorie de l’agence : aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires
La théorie de l’agence explore comment faire en sorte que l’entreprise serve effectivement les objectifs de l’actionnaire.
Selon cette théorie, « la plupart des organisations ne sont que des fictions juridiques qui servent de lien à un ensemble de relations contractuelles entre individus. »186 L’entreprise n’est pas une entité en tant que tel mais « un nœud de contrats entre individus ». Tout questionnement sur les objectifs, ou les fonctions de l’entreprise est donc erroné.
Partant de ce postulat, il s’agit d’analyser la relation contractuelle entre les actionnaires, considérés comme les propriétaires de l’entreprise, et les « agents », c’est-à-dire les dirigeants engagés par les actionnaires pour la gérer. Il est évident que ces derniers connaissent beaucoup mieux l’entreprise et peuvent donc être amenés à agir en vue d’intérêt différents de ceux des actionnaires.
Un des enjeux clefs sera donc de trouver des mécanismes permettant d’aligner les intérêts des agents avec ceux des actionnaires. La gouvernance d’entreprise est alors conçue comme un moyen de « discipliner » le dirigeant en l’incitant à agir dans le sens de l’actionnaire et en le sanctionnant s’il ne le fait pas.
Quand la théorie académique transforme les pratiques du monde des affaires
Ces thèses trouvèrent un écho important dans les milieux académiques
D’une part, l’image de « rigueur scientifique » apportée par l’économie a exercé une forte attraction sur les milieux du droit des société. Il en est, ainsi, par exemple du mouvement « Law and Economics » qui vise à appliquer les méthodes et postulats de l’analyse économique aux institutions du système juridique (contrats, droit de propriété, sanctions pénales…). D’autre part, les économistes se sont lancés dans la production d’innombrables études empiriques testant la relation entre le cours de l’action (considéré comme l’indicateur mesurant la performance de l’entreprise) et d’autres variables (structure du conseil d’administration, capitalisation, fusions) pour découvrir les clefs de la « bonne gouvernance d’entreprise ».
Les thèses académiques sur la prééminence de la valeur actionnariale ont servi de support au mouvement de la corporate governance
Celui-ci s’est manifesté par l’élaboration puis l’adoption de réformes du droit des sociétés afin d’augmenter les droits de l’actionnaire et/ou de limiter le pouvoir des dirigeants. Au cours des dernières décennies, nombre de réglementations aux États-Unis puis en Europe ont ainsi eu pour objectif d’inciter les dirigeants à se concentrer sur la valeur pour l’actionnaire.
Il en va ainsi de tous les mécanismes visant à encourager le fait de lier la rémunération des dirigeants au cours de bourse (part variable en plus du fixe, stocks options). C’est également un des objectifs sous-jacent dans l’élaboration des règles comptables internationales avec le poids croissant pour les grandes entreprises cotées de la comptabilité en « juste valeur ».
Enfin, c’est surtout dans les milieux d’affaires eux-mêmes que s’est peu à peu imposée le fait d’envisager l’entreprise comme étant avant tout au service de ses actionnaires
Dans les milieux financiers, ce discours a trouvé d’autant plus d’échos qu’il s’est développé en même temps que libéralisation des marchés financiers. La logique court-termiste se développe autant chez les fonds spéculatifs que chez les investisseurs institutionnels (comme les fonds de pension, ou les assurances, les fonds souverains), alors même qu’ils sont censés se projeter à long terme.
Dans les grandes entreprises cotées, les dirigeants mettent eux-mêmes peu à peu en place, en accord avec les conseils d’administration, les dispositifs visant à aligner les intérêt de la direction avec ceux des actionnaires : politique de rémunération, distribution de stocks options, réduction de l’indépendance des conseils d’administration (avec par exemple le recul des conseils d’administration à mandat échelonnés, qui rendaient plus difficile la prise de contrôle hostile)187. Le cas de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis est typique. Sur les 36 millions de rémunérations reçus en 2023, le salaire fixe ne représente que 2 millions, le reste est constitué de bonus et de primes en actions.188
C’est ainsi également que se développent les pratiques visant à procéder à des rachats massifs d’actions (de la société) pour augmenter le cours de bourse. Au total, comme noté dans l’Essentiel 6 sur le financement des entreprises, on peut se demander si les actionnaires des sociétés cotées en Bourse les financent encore véritablement ou si la Bourse n’est plus qu’une grande machine à extraire de la valeur de l’entreprise.
Ces mesures qui touchent à la gouvernance ont des conséquences bien concrètes en termes opérationnels, avec la multiplication de mesures court-termistes (externalisation des emplois, baisse des investissements, de la Recherche et Développement).
Une idéologie sans aucun fondement juridique
La société n’est pas la propriété de ses actionnaires
Comme nous l’avons vu dans l’Essentiel 1, les sociétés par action sont des personnes morales avec une personnalité juridique propre. Elles ne sont donc la propriété de personne : elles détiennent des biens, concluent des contrats et commettent éventuellement des délits en leur nom propre.
Les actionnaires sont les propriétaires des actions, ce qui leur donne des droits limités : un actionnaire de Renault peut voter en assemblée générale (AG) pour élire un conseil d’administration ; il peut toucher des dividendes s’il a été décidé d’en distribuer pendant l’AG. Mais il n’est pas propriétaire des usines ou des stocks de voiture (même au prorata de sa détention du capital). D’un point de vue juridique, les actionnaires ne sont en fait pas tellement différents des autres créanciers, des fournisseurs ou des employés. Tous ont des relations contractuelles avec l’entreprise. Aucun n’est « propriétaire » de l’entreprise elle-même.
Il n’existe aucune obligation légale de gérer l’entreprise en vue de maximiser la valeur pour l’actionnaire
Le cas des États-Unis
Cette idée n’a pas de fondement juridique. C’est ce que nous explique Lynn A. Stout189 pour les États-Unis, pays de naissance de l’idéologie friedmanienne. Selon le code des sociétés du Delaware, où se sont constituées la majorité des entreprises du Fortune 500 (index phare de la bourse américaine), « une société peut être constituée ou organisée en vertu du présent article pour mener ou promouvoir toute activité ou tout objectif licite ».190
Elle n’a donc pas pour objet de servir en premier lieu ses actionnaires. Il serait cependant possible d’écrire dans les statuts de la société qu’elle a pour objet de maximiser la valeur actionnariale, mais quasiment aucune entreprise ne le fait.
L’absence d’objectif légal de maximiser la valeur actionnariale est également validée par la jurisprudence, principale source de droit aux États-Unis.
La Business Judgment Rule (Règle du jugement d’affaires), doctrine juridique qui existe dans presque tous les pays de common law191, a pour objectif de protéger les dirigeants (administrateurs ou salariés) des poursuites consécutives à leurs décisions de gestion. Elle établit192 que tant qu’ils ont agi de bonne foi, en étant suffisamment informés et sans conflits d’intérêts, les tribunaux n’ont pas à remettre en cause la validité de leur décision concernant ce qui est le mieux pour la société (et cela, même quand les décisions se sont révélées commercialement négatives). Aux États-Unis, de nombreux jugements rendus en invoquant cette doctrine affirment que « en dehors d’un ensemble limité de circonstances telles que définies par le jugement Revlon »193« , un conseil d’administration, tout en étant toujours tenu d’agir de façon informée, n’a pas pour devoir en soi de maximiser la valeur actionnariale à court terme, même dans le contexte d’une offre publique d’achat ».194
Le cas de la France
Selon l’article 1832 du Code civil « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », et jusqu’en 2019, l’article 1833 se limitait au fait que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
Ces deux articles qui font du bénéfice à partager entre les associés (les actionnaires) la finalité de l’entreprise ont été très discutés et ont fait l’objet de propositions de modifications substantielles195 notamment dans les discussions qui ont précédé la loi Pacte de 2019.
Si cette dernière n’a pas modifié l’article 1832 et donc l’objet de la société qui reste de faire du profit, elle a cependant complété l’article 1833 avec la disposition suivante : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » La notion d’intérêt social est intéressante : elle met bien en valeur qu’il s’agit de l’intérêt de la personne morale elle-même, qui peut être distinct de celui de ses actionnaires. Par ailleurs, la question des enjeux sociaux et environnementaux a été introduite.
La valeur actionnariale n’existe pas !
La notion de création de valeur est une conception floue et trompeuse
L’idéologie selon laquelle les dirigeants ne doivent s’intéresser qu’à la « valeur créée pour l’actionnaire » a réussi à imposer dans les milieux économiques une expression on ne peut plus confuse : celle de « création de valeur ».
D’une part, cela revient à confondre valeur et argent alors que cette notion renvoie à des catégories morales (les valeurs) et humaines (utilité sociale ou écologique de l’entreprise) bien supérieures à la seule dimension pécuniaire. Dans le module sur la comptabilité nous expliquons comment le vocabulaire comptable (profit, valeur, coût) loin d’être neutre, est structurant de notre vision de l’économie.
D’autre part, cela limite cette valeur monétaire à l’enrichissement de l’actionnaire (par distribution de dividendes ou augmentation de la valorisation des actions qu’il détient). Or la valeur (au sens monétaire) créée par l’entreprise est distribuée bien au-delà d’elle-même. Comme nous l’avons vu dans l’Essentiel 5 sur les méfaits de l’idéologie visant à maximiser la valeur actionnariale, c’est bien plus le chiffre d’affaires que le profit qui représente la valeur créée par l’entreprise : celle-ci est donc partagée entre toute les parties prenantes (les fournisseurs et prestataires de service, les salariés, la collectivité publique via l’impôt et les charges sociales, les actionnaires via les dividendes, les banquiers le cas échéant et enfin l’entreprise elle-même via les investissements, le développement).
Il n’y a pas un, mais des actionnaires aux besoins et préoccupations divers
Comme l’explique très bien Lynn A. Stout, « l’actionnaire est un terme fictif ».189
Les modèles sur lesquels se basent les économistes promoteurs de la valeur actionnariale présument l’existence d’une entité homogène, bien identifiée, guidée uniquement par la volonté de maximiser son utilité (via la hausse du cours de bourse). Or bien sûr une telle entité n’existe pas.
Les actionnaires sont des personnes (morales ou physiques) dont les besoins et les préoccupations divergent en fonction de leur horizon d’investissement, du degré de diversification de leur portefeuille, et de leurs intérêts pour d’autres types d’actifs financiers. Ils peuvent également avoir des points de vue sur l’éthique et la responsabilité sociale de l’entreprise. Ainsi, rien de commun entre : le manager d’un fond spéculatif qui cherche à maximiser les rendements à très court terme et renouvelle les actifs de son portefeuille plusieurs fois par an ; le gestionnaire d’un fond de pension qui a besoin de dégager des rendements réguliers et sur le long terme ; ou encore l’investisseur particulier, préoccupé de ce que son argent ne finance pas le réchauffement climatique.
Comme le dit Lynn A. Stout : « L’idéologie de la valeur actionnariale se concentre sur les intérêts d’un sous-groupe étroit d’actionnaires, ceux qui sont les plus myopes, les plus opportunistes, les plus disposés à imposer des coûts externes et les plus indifférents à l’éthique et au bien-être d’autrui. »189 Or comme nous l’avons expliqué dans l’Essentiel 5 cette idéologie à des conséquences bien concrètes : elle conduit les dirigeants à se focaliser sur les résultats à court terme, en sacrifiant les enjeux de long terme qu’il s’agisse des enjeux écologiques, du bien être des salariés, mais aussi parfois même de la viabilité de l’entreprise elle-même.
Pour en savoir plus
- The Problem of Corporate Purpose, Governance studies, Lynn A. Stout, 2012
- The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public, Lynn A. Stout, Berrett-Koehler Publishers, 2012
- L’ISSB s’attaque au capital humain et à la biodiversité… mais toujours pas aux intérêts financiers non durables, Alexandre Rambaud, Novethic (16/05/2024)
- L’entreprise n’appartient pas à ses actionnaires ! Vidéo d’Olivier Favereau, Xerfi Canal
- L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances, du Travail, 2018 (PDF)
La compétitivité des entreprises serait une fin en soi
La compétitivité d’une entreprise désigne sa capacité à soutenir la concurrence internationale. Dans quelle mesure est-elle capable de vendre et fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchands sur un marché donné en situation de concurrence ? La compétitivité s’évalue au travers de la dynamique de la part de marché de l’entreprise.
On distingue habituellement :
- la compétitivité prix repose sur l’écart entre le prix de vente de l’entreprise et celui de ses concurrents et dépend donc de ses coûts de l’entreprise (travail, achats, coût du financement etc.) dans une économie donnée ;
- et la compétitivité hors-prix qui repose sur la capacité d’innovation, l’amélioration de la productivité et de la qualité, permettant une « montée en gamme » et donc une hausse du prix de vente.
Les enjeux de compétitivité varient selon les contextes
Dans une situation de concurrence équitable (tous les concurrents sont soumis aux mêmes règlements, impôts et taxes, ainsi qu’à un accès équivalent aux matières premières, aux services et infrastructures etc.), la compétitivité dépend principalement des décisions prises par l’entreprise, dans les domaines où elle a la main : le choix de ses produits et services, leur qualité, sont recrutement, sa stratégie de communication, la qualité de son service après-vente, etc.
Dans une situation de monopole, l’entreprise n’a pas besoin d’être compétitive ; dans nos économies, elle est cependant quand même obligée de proposer un rapport qualité-prix minimal, car des offres alternatives finissent en général par se développer ou bien parce que la pression des citoyens devient trop forte.
Les entreprises exposées à la concurrence internationale sont dans une situation différente et en générale de concurrence asymétrique. Une entreprise peut être concurrencée dans son pays par des importations en provenance d’entreprises étrangères bénéficiant d’avantages réglementaires, fiscaux, sociaux ou monétaires. Elle peut également essayer d’exporter dans un pays où ses concurrentes bénéficient de tels avantages.
Prenons quelques exemples d’entreprises françaises, qui peuvent être généralisés facilement.
- Des entreprises françaises de transports en camion concurrencées par des entreprises européennes étrangères pouvant faire travailler en France des salariés (dits « détachés ») en payant les charges sociales de leur pays d’origine éventuellement beaucoup moins élevées qu’en France.
- Des entreprises agricoles dont la production en France est soumise à des normes environnementales, alors que leurs concurrentes étrangères peuvent exporter des productions où les normes sont moins exigeantes (voire inexistantes).
- Des entreprises soumises au marché de quotas de CO2 européen (l’ETS), concurrencées par des entreprises qui ne paient pas de coûts pour le CO2 qu’elles émettent à la production et subissent comme dans le cas précédent moins de contraintes environnementales.
- Des entreprises en concurrence avec des producteurs implantés dans des pays à bas-salaires et/ou à monnaie sous-évaluée (cela a été longtemps les cas du Japon, des « dragons asiatiques » et bien sûr de la Chine). Dans les deux cas, ces entreprises peuvent exporter sur le marché français à des prix moins élevés que les producteurs français (coût des salaires moins importants ; prix de vente moins important du fait du taux de change).
- Des entreprises en concurrence avec d’autres qui grâce à l’importance de leur marché domestique ont pu réaliser des investissements technologiques ou industriels massifs (cas du numérique et des GAFAM).
Face à ces formes de dumping environnemental, social ou monétaire, et sans politique publique visant à rééquilibrer cette concurrence, il est très difficile pour les entreprises de résister si ce n’est dans des « niches » spécifiques en réussissant à se démarquer très adroitement. Mais le pari est difficile à tenir sur la durée.
Il ne faut pas s’étonner que la France se soit fortement désindustrialisée dans les 40 dernières années. L’État n’a pas cherché à rééquilibrer la concurrence, considérant qu’elle était bénéfique aux consommateurs. Dès lors, des entreprises ont disparu ou se sont adaptées en se concentrant ou en délocalisant quand c’était possible leur production dans des pays à bas coûts (ce qui a été facilité par la baisse du coût du fret international et la libéralisation des mouvements de capitaux). La France s’est cependant spécialisée dans quelques grands secteurs : le luxe, la cosmétique, la pharmacie, l’industrie du transport (spatial, aéronautique, automobile, ferroviaire), le tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire.
Pour justifier ces abandons, les économistes invoquent généralement la théorie des avantages comparatifs : aucun pays n’a à se battre dans des secteurs où ses entreprises sont relativement moins compétitives et il doit viser à se spécialiser là où elles ont des avantages. Cette théorie ne résiste pas à l’analyse. D’une part, parce que les échanges internationaux ne sont pas guidés par des finalités internationales d’efficacité économique mais plutôt par des enjeux de domination. D’autre part, parce qu’un pays, dans un tel contexte, peut s’affaiblir sur tous les fronts. Enfin, et c’est essentiel ici, parce que le coût d’une telle concurrence est à l’évidence écologique et social. Les inégalités mondiales et au sein de chaque pays ont augmenté et la crise écologique est presque devenue hors de contrôle.
La compétitivité d’une nation, une notion floue et un but dangereux
Face aux difficultés que rencontrent les entreprises du fait de la concurrence internationale, certains soutiennent que l’économie du pays dans son ensemble doit être compétitive. Si les charges sociales, les impôts, les salaires sont trop élevés pour les entreprises exportatrices, il faut les baisser même si cela mène à une baisse de la qualité et de la place des services publics ou des dispositifs de solidarité nationale.
C’est la notion de « compétitivité d’une nation » dont nous allons voir qu’elle est discutable, voire vide de sens, comme le dit l’économiste Paul Krugman198. Prenons l’exemple de l’Allemagne pour illustrer cette affirmation.
L’Allemagne a voulu accroître sa compétitivité avec les lois Hartz entre 2003 et 2005, en réformant le code du travail. Les entreprises exportatrices allemandes ont alors bénéficié d’un double avantage : un coût du travail plus faible et une flexibilité accrue de la main d’œuvre, venant s’ajouter à l’accès aux pays d’Europe de l’Est ayant une main d’œuvre peu coûteuse, nouvellement accessible depuis la chute du mur de Berlin. Cette stratégie a bénéficié pendant de nombreuses années à l’Allemagne, au détriment de ses partenaires européens. Elle s’est traduite par des excédents commerciaux massifs. A-t-elle bénéficié à la population allemande ? L’ augmentation du taux de pauvreté concomitante à la baisse du taux de chômage permet d’en douter.
La crise du Covid, la guerre de l’Ukraine et la guerre économique avec la Russie nous ont montré l’inanité de telles politiques. Le retour à des notions de bon sens comme celle de souveraineté économique et énergétique montre, en creux, que l’absence de telles considérations conduit à prendre des risques majeurs, sur ce qui fait le « bien-être social » d’un pays : la santé, l’autonomie énergétique et plus généralement sa capacité à maîtriser la production ou l’approvisionnement des biens et services considérés comme essentiels.
Concilier compétitivité et bien vivre ?
Nous avons besoin des entreprises et du dynamisme qu’elles donnent à la vie économique. Une partie d’entre elles se confrontent à la concurrence internationale, ce qui est inévitable dans un monde complexe et technologique.
En revanche, il n’est pas souhaitable que les entreprises soient soumises à la violence des marchés sans protection. Cette « loi des marchés » est tout simplement celle du plus fort. Est-il dans l’intérêt d’une nation que certaines de « ses » entreprises se fassent éliminer parce qu’elles sont moins performantes économiquement que ses concurrentes d’un autre pays ? Cela se discute, surtout quand la souveraineté d’une nation ou l’accès de ses citoyens à des biens ou services essentiels comme la nourriture, l’énergie ou les médicaments sont en cause ; ou quand les emplois disparaissent au profit d’autres pays. La concurrence internationale conduit à la réduction des coûts, donc des prix payés par le consommateur. Mais le citoyen (qui est aussi producteur et peut devenir chômeur) ne s’y retrouve pas toujours, et peut accepter de payer plus en tant que consommateur pour un surcroît d’autonomie ou d’emplois.
Est-ce possible de protéger certaines entreprises ou certains secteurs de cette violence des marchés ? Oui bien sûr, sauf si l’on se soumet à une doxa qui ferait du libre-échange un bien absolu.
Pour commencer, en matière sociale et environnementale, l’État doit veiller à appliquer des « mesures miroirs »199, qui rétablissent l’équilibre de la concurrence entre les entreprises de tous pays, vendant des produits sur le territoire. Cela peut se faire à l’occasion de la négociation des traités commerciaux bilatéraux, qui se substituent en ce moment à celle de traités multilatéraux, moins en vogue depuis des années. Plus profondément, la « puissance publique » (européenne et française) peut et doit définir des politiques « industrielles » identifiant les secteurs stratégiques où les entreprises doivent être aidées et éventuellement accompagnées. Cette réflexion doit nécessairement intégrer les enjeux, devenant vitaux, d’accès aux matières premières, à l’énergie aux ressources naturelles. Elle doit viser à mettre en œuvre une économie circulaire.
Le développement de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) suffirait à réduire les impacts négatifs des entreprises
Depuis le tournant du XXe siècle la notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue incontournable pour aborder les impacts des entreprises sur les humains et l’environnement. Après avoir retracé l’histoire de la RSE et explicité les contours de ses implications concrètes pour les entreprises, nous montrerons que, malgré son intérêt, elle reste à ce jour un domaine périphérique, non structurant des entreprises.
Les origines théoriques et académiques de la RSE
Si les préoccupations quant aux impacts des entreprises naissent avec l’émergence des grandes entreprises elles-mêmes à la fin du XIXe siècle, la paternité de la notion de RSE est en général attribuée à l’économiste Howard Bowen qui répond dans Social responsibilities of the businessman (1953) à un questionnement des églises protestantes américaines sur l’éthique des affaires et la responsabilité du chef d’entreprise. Selon Bowen, les dirigeants d’entreprise doivent intégrer dans leurs décisions, sur une base volontaire, les valeurs et les objectifs économiques et sociaux portés par la société. Il insiste sur le rôle des pressions que peuvent jouer la société civile et le marché pour faire advenir véritablement cette responsabilité sociale. Les décennies suivantes sont marquées par des débats académiques sur la définition du concept, avec notamment les travaux de Keith Davis et Archie Carroll, ainsi que par l’arrivée de nouvelles idées telle la théorie des parties prenantes dans les années 1980.200
À partir de la fin des années 1970, le concept de RSE se voit vivement contesté par les économistes de l’école de Chicago28. La seule responsabilité de l’entreprise serait de maximiser la valeur pour l’actionnaire. L’idée de RSE serait inepte voire dangereuse.
Peu d’évolutions pourraient miner aussi profondément les fondements mêmes de notre société libre que l’acceptation par les dirigeants d’entreprise d’une responsabilité sociale autre que celle de faire le plus d’argent possible pour leurs actionnaires. C’est une doctrine fondamentalement subversive. Si les hommes d’affaires ont une responsabilité autre que celle du profit maximum pour les actionnaires, comment peuvent-ils savoir ce qu’elle est ? Des individus privés autodésignés peuvent-ils décider de ce qu’est l’intérêt de la société ?
La concrétisation de la RSE passe d’abord par des démarches reposant sur l’engagement volontaire des entreprises
À la fin du XXe siècle, avec la prise de conscience croissante des enjeux écologiques et de l’impact des grandes entreprises, la RSE commence à devenir plus concrète.
La parution en 1987 du rapport Brundtland, Notre avenir à tous202, installe le concept de développement durable, défini comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». De plus en plus, la RSE apparaît comme la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, déclinés en 17 grands objectifs depuis 2015.
Les objectifs de développement durable
En septembre 2015, l’Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Celui-ci se décline en 17 Objectifs de développement durable (ODD), évalués au moyen de 169 cibles et 231 indicateurs. Les ODD servent souvent de référence au rapports RSE réalisés par les entreprises.

Source The Global Goals
Des démarches volontaires sont proposées aux entreprises par des organisations internationales, telles l’OCDE et l’ONU (voir encadré), mais aussi par des initiatives privées. Le plus souvent il s’agit de codes, de pactes ou de chartes auxquels les entreprises adhérent et dont elles doivent rendre compte par la suite. Cela peut prendre également la forme de référentiels permettant ensuite d’obtenir une certification ou un label.
Quelques grands référentiels internationaux
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont publiés pour la première fois en 1976. Il sont présentés dans l’édition 2023 comme des « recommandations »203 » que les gouvernements adressent conjointement aux entreprises multinationales en vue d’améliorer leur contribution au développement durable et de remédier aux répercussions négatives associées à leurs activités sur les individus, la planète et la société ».
Le Pacte mondial (Global Compact) est une initiative des Nations Unies lancée en 2000.
Les entreprises qui y adhèrent doivent rédiger chaque année une communication montrant comment elles respectent les 10 principes (relatifs notamment aux droits humains, à l’environnement et à la lutte contre la corruption) du Pacte ainsi que leur contribution aux objectifs de développement durables adoptés par l’assemblée générale de l’ONU en 2015.
La norme ISO 26000, publiée en 2010, est destinée aux entreprises et organisations qui s’engagent à fonctionner de manière socialement responsable. Elle fournit des lignes directrices visant à accompagner les organisations dans l’application des notions de développement durable sur six grandes thématiques.204
Ces initiatives peuvent concerner un secteur particulier (dont elles émanent le plus souvent)
Par exemple, l’initiative Responsible Care, lancée en 1984 par l’industrie chimique du Canada, est aujourd’hui l’initiative mondiale du secteur en matière de RSE. En signant la Responsible Care Global Charter, une entreprise de la chimie s’engage à mettre en œuvre six grands principes de durabilité visant « la gestion sûre des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, la promotion de leur rôle dans l’amélioration de la qualité de vie et la contribution au développement durable ». Les différentes fédérations professionnelles proposent des outils de management et de gestion pour mettre en œuvre les grands principes de cette charte. Selon l’International Council of Chemical Associations, elle avait été signée, en mars 2024, par 580 entreprises mondiales de fabrication de produits chimiques, représentant au total 96% des plus grandes entreprises chimiques du monde.
Parmi toutes ces initiatives, le secteur de la finance occupe une place particulière
En effet, en plus d’être le destinataire des démarches RSE au même titre que n’importe quelle entreprise, ce secteur est également à l’initiative d’une demande croissante de reportings ESG (environnemental, social, de gouvernance, voir encadré) pour toutes les autres entreprises.
Lancé en 2006 par le Secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, les Principes pour l’investissement responsable ont été élaborés par un groupe international d’investisseurs institutionnels en vue de fournir un répertoire d’actions à mettre en œuvre sur une base volontaire en vue d’intégrer des critères ESG dans les pratiques d’investissement. Les signataires (près de 5400 en mars 2023205) sont tenus de rendre compte annuellement de leurs pratiques en matière d’investissement responsable.
Les Principes de l’Équateur, dont la première version date de 2003, sont le référentiel des institutions financières (principalement les banques) pour le financement de projets. En les signant, un établissement s’engage à prendre en compte un certain nombre de critères d’évaluation sociaux et environnementaux dans le choix des projets financés. L’initiative comptait 128 institutions signataires en mars 2024.
Le développement du reporting extra-financier et des indicateurs ESG
Le reporting extra-financier consiste pour les entreprises à rendre compte de leur impact en renseignant des indicateurs dits ESG, c’est-à-dire relatifs à l’environnement, aux aspects sociaux et sociétaux, et à leur gouvernance.
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 8, cette demande de reporting a été initiée par des acteurs privés en particulier des investisseurs, ou des organisation de la société civile (telle la Global Reporting Initiative). Arrivée dans un second temps, la réglementation du reporting s’est surtout développée en France (à partir de la loi NRE de 2001) puis en Europe, d’abord de façon très souple. Puis, face à la multiplication des différents labels, standards et référentiels, l’Union européenne a décidé de promulguer un règlement pour les acteurs financiers (la SFRD), puis une directive visant à uniformiser les pratiques des entreprises européennes et opérant sur le continent (la CSRD). En réaction, les acteurs privés anglo-saxons ont eux aussi commencer à élaborer, au sein de la Fondation IFRS (précisément dans l’International Sustainability Standards Board (ISSB)), des standards internationaux concurrents.
Notons que les notions de RSE et d’ESG sont souvent considérées comme interchangeables, ce qui est dommageable. Cela revient à assimiler la mise en œuvre d’une politique à sa mesure.206
Pour en savoir plus voir l’Essentiel 8.2 sur le reporting extra-financier et l’Idée reçue 5 sur les indicateurs ESG.
Le développement d’un cadre réglementaire plus contraignant
Si la logique volontariste de la RSE reste dominante, on constate une inflexion au cours de la dernière décennie, dont témoigne notamment l’évolution de la définition européenne.
En 2001, la Commission européenne adopte dans un Livre Vert207 une définition de la RSE comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ».
En 2011, elle va un cran plus loin. La RSE est désormais définie comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » ; assumer sa responsabilité consiste à engager avec les parties prenantes « un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base ».208
On passe ainsi d’une logique purement volontariste à une vision qui touche davantage au cœur du business de l’entreprise. À la notion d’action volontaire est substituée la notion de maîtrise d’impacts.
La Commission affirme également dans sa communication de 2011 que les normes de RSE peuvent relever du droit souple (soft law) mais aussi être contraignantes (hard law) : « les pouvoirs publics devraient avoir un rôle de soutien en combinant intelligemment des mesures politiques facultatives et, le cas échéant, des dispositions réglementaires complémentaires. »
Sans prétendre à l’exhaustivité, tentons d’identifier une typologie des différentes « mesures RSE » prises par les autorités publiques :
- les mesures encourageant ou obligeant à réaliser un reporting extra-financier ;
- le respect des normes internationales relatives aux droits humains et les interdictions qui en découlent (travail des enfants, travail forcé etc.) ;
- la réglementation (via des normes d’émissions pour les voitures par exemples ou la performance énergétique des bâtiments), voire l’interdiction de certaines activités jugées trop polluantes (par exemple, en France les différentes lois visant à interdire les objets plastiques à usage unique ; l’interdiction de substances chimiques ou de matériaux dangereux pour la santé tels l’amiante ou les PFAS ; ou pour l’environnement, tels les CFC, responsables du « trou de la couche d’ozone » etc.) ;
- des mesures visant à limiter les impacts de gestion des entreprises quel que soit le secteur avec par exemple le décret tertiaire (obligation de rénovation énergétiques des bâtiments tertiaire) ou la loi d’orientation des mobilités (2019) qui comporte différentes mesures visant à réduire l’usage de l’automobile dans les entreprises ou à électrifier le parc.
- les mesures visant à favoriser l’émergence d’entreprises se dotant d’un objet social allant au-delà de la recherche du seul profit (tel la loi PACTE en France, voir l’Essentiel 4.4)
- les mesures visant à accroître la responsabilité des entreprises multinationales, en particulier relativement aux actions menées par leurs fournisseurs et sous-traitants.
La RSE reste un domaine périphérique de l’entreprise
À partir des années 1990, la RSE s’est traduite par plusieurs évolutions dans les entreprises
Dans les entreprises d’une certaine taille (ETI ou grande entreprise), des postes de responsables développement durable ou RSE (disposant parfois d’équipes dédiées, parfois de correspondants dans les autres services) ont été créés ; des associations professionnelles ont également émergé tel le C3D en France.
Ces équipes ont été en charge de répondre aux demandes de reporting extra-financier provenant d’investisseurs ou d’obligations réglementaires, de produire le rapport de développement durable, et éventuellement de mener la politique philanthropique, de conduire les réflexions sur les stratégies de durabilité de l’entreprise, sur l’amélioration des process etc.
Malgré ces développement encourageants, force est de constater que le profit reste l’objectif structurant
Comme le note l’avocat Daniel Hurstel, « la RSE n’affecte qu’à la marge le modèle actuel de l’entreprise ». Pour lui, elle « peut être qualifiée de « périphérique » »« . En effet, dans le meilleur des cas, elle redresse, influence et corrige le fonctionnement de l’entreprise, mais elle ne remet pas en cause sa finalité, ni l’organisation sociale qui en découle. Elle relève d’une vision où les interactions de l’activité avec son environnement sont encore appréhendées comme des zones de risques pouvant générer des coûts. »209
Pour la philosophe Cécile Renouard, la RSE devrait être envisagée de façon globale et concerner tous les aspects de la vie de l’entreprise : utilité sociale du produit, mode de gouvernance et de partage de la valeur, modèle technique de production, dimension comptable et fiscale, condition de travail, effet sur les biens communs et sur la collectivité locale. Or, trop souvent, elle est cantonnée aux améliorations des process à la marge ou à une logique du moindre mal (si ce n’est pas nous, d’autres le feront en faisant moins attention que nous). Elle se limite souvent à la mise en évidence de bonnes pratiques ponctuelles sur le plan opérationnel, ou d’activités philanthropiques sans lien avec l’activité.
Les différentes responsabilités de l’entreprise
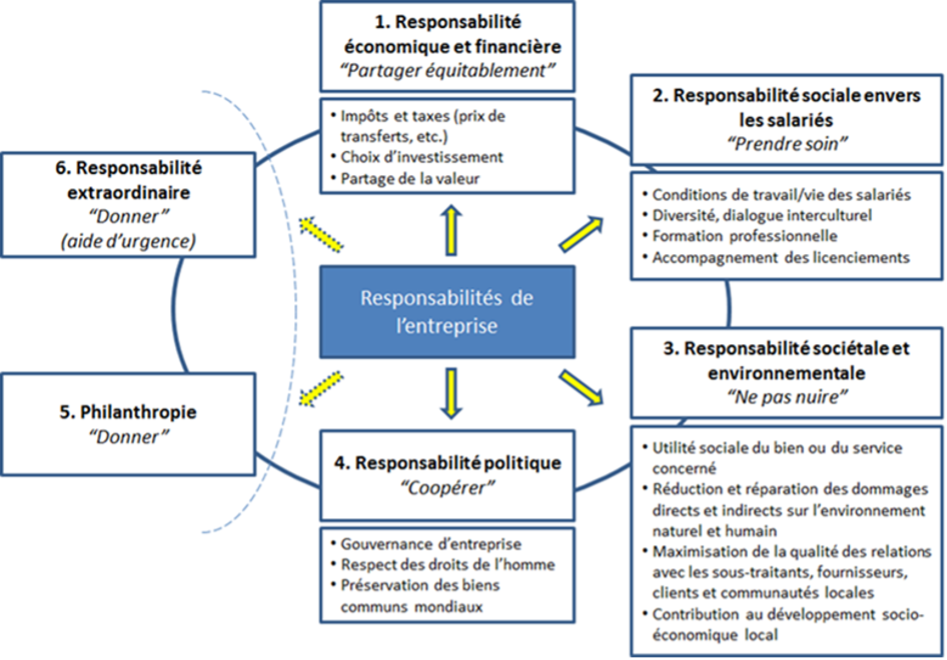
Source Cécile Renouard, Éthique et entreprise, Éditions de l’Atelier, 2015
Responsabilité sociale de l’entreprise et irresponsabilité de l’actionnaire
Dans un article éclairant, l’économiste Guillaume Vuillemey pose une question très peu présente dans le débat sur la RSE : « La responsabilité sociale n’est-elle pas condamnée à être un mot creux dès lors que les personnes physiques qui possèdent, gèrent, et tirent les bénéfices d’une entreprise jouissent elles-mêmes d’une responsabilité très limitée ? »210
En effet, les actionnaires d’une entreprise bénéficient d’une responsabilité limitée : ils ne peuvent pas être tenus financièrement responsables des agissements d’une entreprise pour un montant supérieur à leur investissement initial.
Cet état de fait ne s’est généralisé qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Auparavant, les actionnaires étaient responsables financièrement pour les agissements d’une entreprise bien au-delà de leur apport en capital initial211. Cette responsabilité limitée trouve sa justification dans le fait que les nombreux petits actionnaires seraient trop éloignés de la gestion de l’entreprise et auraient trop peu de pouvoir pour être tenus responsables de ses activités. Ce qui est entendable concernant l’actionnariat diffus, l’est nettement moins dans le cas d’actionnaires contrôlant la majeure partie du capital surtout lorsqu’il s’agit de maison-mères par rapport à leurs filiales.
Pour Guillaume Vuillemey, cette responsabilité limitée est à la source de nombreux effets pervers, que ce soit pour les créanciers de l’entreprise (en cas de prises de risques excessives des actionnaires), mais aussi et surtout pour la société dans son ensemble. Elle permet la privatisation des profits, qui bénéficient aux actionnaires, et la socialisation des coûts, par exemple des dommages écologiques causés par l’activité économique.
La RSE ne lui apparaît pas comme une alternative satisfaisante parce qu’elle relève d’une vision essentiellement abstraite de la responsabilité : il s’agit « d’une responsabilité dans l’absolu, illimitée, qui ne fait référence à aucun lieu particulier ni à aucun dommage concret ».210 À l’inverse, la responsabilité de l’actionnaire relève de la conception traditionnelle du terme : il s’agit de la responsabilité de quelque chose de concret (des dettes, des dommages spécifiques).
La RSE ne peut donc constituer qu’un contrepoids très imparfait aux dérives consécutives à l’irresponsabilité de l’actionnaires ; et ce d’autant plus que le concept lui-même n’est pas non plus exempt de risques de dérives.
Les risques de dérives de la RSE
Pour Guillaume Vuillemey, « La “responsabilité sociale” de l’entreprise est un concept intrinsèquement abstrait et flou, qui laisse donc la place à des abus graves ».210 Elle peut devenir un argument de vente (et donc in fine de maximisation des profits pour les actionnaires). Les responsables RSE sont ainsi souvent amenés à justifier l’importance de leur fonction et les coûts qu’elle engendre (salariaux et autres), en tentant de démontrer leur contribution à la rentabilité de l’entreprise (amélioration de la détection et donc de la gestion des risques, capacité à anticiper certaines tendances sociétales utiles en termes de marketing et d’image). Il y a là évidemment une confusion des genres problématique.
La RSE peut également être le support d’un discours laissant penser que l’autodiscipline est suffisante et les réglementations optionnelles.
Elle pose des questions en termes de hiérarchisation des valeurs, laissée à la libre appréciation des entreprises (qui peuvent choisir de mettre en avant telle bonnes pratiques au détriment d’autres).
Ces dérives sont d’autant plus prononcées que RSE et reporting ESG sont souvent confondus. Or comme on va le voir dans l’idée reçue suivante, une bonne note ESG ne présume en rien de la stratégie d’une entreprise.
Ainsi, malgré son intérêt, la responsabilité sociale de l’entreprise apparaît comme largement insuffisante pour véritablement réorienter l’activité des entreprises, notamment les plus grandes. Comme le note Daniel Hurstel, « il faudrait […] que profits et enjeux sociaux s’appuient sur des forces comparables – les dirigeants seraient alors conduits à arbitrer l’éventuel conflit, voire à l’anticiper, en vue de trouver un équilibre ».209 Plusieurs évolutions sont pour cela nécessaires : nous avons ici évoqué celle du droit, que ce soit par la voir du rétablissement d’une responsabilité des actionnaires (au moins les plus gros), ou du devoir de vigilance. On peut aussi évoquer l’évolution de la comptabilité, des outils réglementaires et fiscaux etc.
Pour en savoir plus
- Jacques Igalens, Splendeurs et misères de la RSE, Edition EMS, 2023
- Cécile Renouard, Éthique et entreprise, Editions de l’Atelier, 2015
- Morgane Tirel, RSE, ESG, compliance : éléments pour une distinction, Revue Lamy Droit des affaires, 2023
- Daniel Hurstel, Responsabilité sociétale ou revenu de l’actionnaire : faut-il choisir ? in Rapport Moral sur l’argent dans le monde, Association d’économie financière, 2013
Les bonnes notes ESG seraient gages d’éthique et de performance financière
Comme on l’a vu dans l’idée reçue précédente, depuis les années 1990 les grandes entreprises, en France et en Europe se sont mises au développement durable et à la RSE, c’est-à-dire à intégrer au moins en affichage les enjeux sociaux et environnementaux dans leur réflexion voire dans leur stratégie.
Ce mouvement s’est accompagné d’une demande croissante de reporting extra-financier de la part d’investisseurs, ou pour répondre à des obligations réglementaires surtout en France puis dans l’Union européenne (en savoir plus dans l’Essentiel 8.2 sur le reporting extra-financier).
Ce reporting consiste à évaluer puis divulguer des informations sur les impacts de l’entreprise via des indicateurs dits « ESG ». Le G de gouvernance complète le E d’environnement et le S de social, l’idée étant que ces trois domaines sont en fait interdépendants. Il est réalisé par les responsables développement durable ou RSE. Les principaux indicateurs sont communiqués dans des rapports annuels qui mettent également en valeur les avancées des entreprises ainsi que les bonnes pratiques dans ces trois domaines.
Des agences de « notation sociale et environnementale » ou « notation extra financière » (pour simplifier, nous dirons ESG dans la suite) se sont créées en France215, en Europe et aux États-Unis pour évaluer de manière extérieure ces pratiques, comme les agences financières évaluent la robustesse des entreprises sur le plan financier. Elles analysent les rapports et communication des entreprises, leur demandent éventuellement des informations complémentaires, et leur attribuent des « notes ESG » selon des méthodologies (et donc des pondérations entre les différents critères) qui leur sont propres.
Des labels sur l’investissement responsable (comme le label ISR en France) se sont également développés pour aider les épargnants à orienter leur épargne vers les fonds qui basent leur stratégie d’investissement sur des critères extra-financiers en plus des indicateurs financiers traditionnels.
Notations ESG et indicateurs d’impact environnementaux : deux approches très différentes, voire opposées
La notation ESG est née dans le monde… de la notation, avec pour objectif d’évaluer la performance de l’entreprise de manière aussi quantitative que possible, dans des domaines non couverts par la notation financière. Cette approche doit être distinguée de celles qui ont été développées dans les années 1990 (l’Analyse de cycle de vie), et dans les années 2000 pour le climat, avec le bilan carbone. Certes ces outils d’évaluation sont maintenant utilisés par les entreprises dans leur reporting ESG, mais il est utile de comprendre en quoi ces approches sont fondamentalement différentes, ce que nous allons illustrer par le bilan carbone.
Le but du bilan carbone est d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes d’une entreprise et, simultanément, la « dépendance » de cette entreprise à ces émissions : si elles sont réduites par obligation réglementaire ou pour d’autres raisons, que peut faire l’entreprise ? Cette approche n’a pas pour but a priori de faire valoir une performance, mais plutôt de sensibiliser les dirigeants à des risques.
On peut relever deux différences très nettes par rapport à l’approche ESG :
- les estimations sont faites en ordre de grandeur pour aider à la décision. Ce sont donc des outils de pilotage et non de reporting.
- elles n’ont pas pour but de s’intégrer dans une notation globale, où les divers volets de la durabilité font l’objet de pondérations, déterminées par l’agence de notation.
Lorsque les milieux financiers se sont saisis de l’outil du bilan carbone, la différence d’approche a été très nette. Dans les années 2015, après la COP21 de Paris, des gestionnaires d’actifs, comme Amundi en France, ont souhaité connaître le « poids carbone » de leurs portefeuilles, dans une optique de communication ESG en direction de leurs investisseurs et parties prenantes. Pour cela, ils ont limité la mesure du poids carbone aux émissions directes (le SCOPE1). Du point de vue d’une approche de bilan carbone, c’est presque inutile : pour la très grande majorité des entreprises, le poste le plus important et significatif est celui des émissions indirectes amont et aval (le SCOPE3). Se limiter au Scope 1, c’est donc rester largement aveugle aux risques qu’est censé révéler le bilan carbone.
Pour en savoir plus sur le bilan carbone et comprendre ce que recouvrent les scopes 1, 2 et 3 voir notre fiche Compter les émissions de GES .
Il n’y a pas de doute que le mouvement en faveur de cette prise en compte d’enjeux écologiques et sociaux va dans le bon sens.
Il est cependant important de rappeler deux écueils.
Une entreprise ayant une bonne note ESG peut avoir des pratiques discutables, voire condamnables, sur le plan social ou environnemental
Les médias révèlent régulièrement des scandales (comme en 2022, celui d’ORPEA216 et des Ehpad) ou des anomalies significatives qui concernent des entreprises pourtant bien notées par les agences de notation ESG.
Le cas de Total est emblématique , cette entreprise a de très bonnes notes ESG, ce qui ne l’empêche pas de développer en Afrique EACOP217, un projet désastreux pour l’environnement, les populations locales qui sont déplacées et le climat.
Il y a à cela trois raisons principales :
- Les indicateurs ESG ne couvrent pas tous les domaines qui relèvent de (ou concernent) l’éthique des affaires. Nous nous limiterons ici à la question fiscale. Peut-on se targuer d’être exemplaire et avoir des pratiques d’optimisation fiscale abusive ? Or les responsables RSE ne couvrent pas ce domaine, réservé au directeur financier ou du directeur fiscal. Et des entreprises peuvent être bien notées au plan RSE en ayant des pratiques abusives au plan fiscal.
- La notation ESG n’a rien d’une science exacte et est, en pratique, particulièrement complexe. Les données à analyser peuvent être difficiles d’accès, difficiles à synthétiser et parfois subjectives. S’il s’agissait de vérifier la conformité aux lois sociales et environnementales, ce ne serait déjà pas si facile, tant la matière est touffue. Mais il s’agit en général d’aller plus loin. Faire des analyses solides coûte cher et les acheteurs de données extra-financières ne sont aujourd’hui pas prêts à en payer le prix.
- Se pose en permanence une question d’arbitrage entre critères -ou d’agrégation de critères-, qui sont très nombreux dans la construction de la notation. Comme pour la notation financière, les acteurs (notamment financiers) exigent des notes synthétiques. Dès lors se posent de redoutables problèmes d’agrégation. Faut-il faire une moyenne arithmétique des notes obtenues sur chaque critère ? Dans ce cas une mauvaise note sur un critère environnemental par exemple peut être compensée par une bonne note sur un autre relevant de la politique salariale de l’entreprise ou de la gouvernance. Faut-il faire une moyenne géométrique qui donne plus de poids aux mauvaises notes. Faut-il exiger des notes minimales pour tout critère ?
Les bonnes pratiques ESG ne peuvent être justifiées au motif qu’elles permettraient une meilleure performance financière
Les responsables développement durable ou RSE sont très généralement soumis à une forte pression de la direction générale, de la direction financière, et plus généralement de leurs collègues. La question posée, lancinante, est la suivante : en quoi les dépenses ou investissements faits au motif RSE sont-ils utiles à la performance de l’entreprise ? Ne sont-ils pas que des coûts sans valeur ou sans contrepartie ?
La question est incontournable, si ce n’est légitime, puisque les entreprises sont supposées « créer de la valeur » (pour leurs actionnaires), et qu’elles cultivent le sens de la performance, les pratiques de « chasse aux coûts inutiles » et, symétriquement, des choix permanents des initiatives (marketing commerciale ou industrielle) propres à augmenter les profits de l’entreprise.
De nombreuses études tentent de répondre à la question, et les ambassadeurs de la RSE (internes ou externes à l’entreprise) souhaitent généralement que la réponse soit positive. L’argument généralement mis en avant, c’est que le développement d’une pratique RSE au sein d’une entreprise améliore l’information des dirigeants, leur perception des risques de moyen ou long terme, et des attentes des parties prenantes (dont les clients et les actionnaires), qui ne se ramènent pas à des considérations financières.
Quant aux études académiques portant sur les liens entre performance financière et RSE, elles sont l’objet de discussions de fond. Citons le cas le plus emblématique.
L’économiste Andrew King a fait en 2023 l’analyse critique218 d’une des études les plus citées219 au monde, visant à prouver que les entreprises s’engageant le plus dans la « durabilité » ont de meilleures performances financières que leurs homologues « à faible durabilité ». Il montre que ces conclusions posent des problèmes majeurs d’interprétation et de choix d’échantillonnage. Le débat est ancien. Dans un article de 2008, « RSE et/ou performance financière : points de repère et pistes de recherche », les économistes Jean-Pierre Ponssard et Patricia Crifo concluaient que les études « n’aboutissent pour l’instant à aucun consensus ».
On peut avancer plusieurs explications à ce phénomène.
Tout d’abord, ces analyses se basent sur de petits échantillons, avec un horizon temporel trop court et ne permettant pas de contrôler les biais en terme de risque, taille des entreprises, ou secteurs représentés dans les portefeuilles et indices ISR par exemple. De surcroît, les variables varient fortement d’une étude à l’autre, limitant par là-même la pertinence des comparaisons avancées220. Pour Margolis et Walsh (2001)221 par exemple, sur 95 articles sur les liens entre RSE et performance financière, on peut identifier 70 manières différentes de mesurer la performance et 27 échantillons différents.
Ensuite, comme l’explique Aurélien Acquier222 : « La majorité des travaux académiques – visant à tenter de relier ESG et performance financière – s’appuient sur l’ESG comme proxy, en agrégeant de nombreux paramètres. »
« L’ESG permet 1) de mesurer la transparence de l’entreprise sur un ensemble de risques extra-financiers et 2) de positionner leurs efforts par rapport à leurs pairs et du coup, peut être pris comme un signal de réputation dans le secteur. »
« Mais il n’y a pas de lien direct entre cette mesure et une trajectoire de réduction de l’impact écologique de la firme (ou de l’ampleur des investissements à consentir pour y arriver), et c’est tout le problème par rapport à la question initiale. »
Enfin, la question est en fait mal posée et ce pour deux raisons principales.
- La logique de la performance « RSE » n’est pas alignée a priori avec la logique financière. Ce sont deux champs distincts. Pour prendre un exemple caricatural, une entreprise qui vend des produits dépassés finira nécessairement par « perdre de l’argent », quelles que soient ses pratiques internes de management ou de gestion environnementale. La RSE ne permet absolument pas de prendre conscience de cette obsolescence.
À l’inverse, des dirigeants d’entreprises très performantes au plan financier peuvent avoir des comportements managériaux « inhumains » ou vendre des produits destructeurs de l’environnement ou dangereux pour la santé.
- Pour les entreprises soumises à de fortes exigences de rendement financier, forcément court-termistes, le « financier » est plus déterminant que la RSE.
Concrètement, dans ces entreprises, le responsable RSE n’est pas rattaché au directeur financier.
Les normes et règlements sociaux et environnementaux seraient des freins à la liberté d’entreprendre
Rappelons tout d’abord que la liberté d’entreprendre est considérée comme d’ordre constitutionnel en France223 et fait partie de la Charte européenne des droits fondamentaux (art 16). De plus, la jurisprudence sur la liberté d’entreprendre a fluctué au cours des vingt dernières années.
Quel que soit son statut au plan constitutionnel, il est évident que, comme toute liberté, la liberté d’entreprendre ne peut être absolue. Elle est encadrée par des règles juridiques et, plus profondément, par la culture dans laquelle l’entreprise opère. Notons sur ce point que le fait de poser un cadre ne peut être considéré comme un frein à la liberté d’entreprendre, puisqu’il consiste principalement à donner des règles du jeu communes à tous. Il permet d’éviter la loi du fort et il peut être source de créativité .
D’un côté, les entreprises revendiquent régulièrement un assouplissement et une simplification des règles environnementales et sociales, ainsi que des baisses d’impôts, et de cotisations qui pèseraient sur leur rentabilité. De l’autre, elles utilisent des ressources naturelles et de l’énergie, et bénéficient d’un environnement sain, d’un personnel correctement formé, en bonne santé physique et mentale. Leur revendication s’apparente donc à un comportement de « passager clandestin » : elles souhaitent profiter d’un avantage sans en payer le prix.
Il appartient donc à la puissance publique, garante de l’intérêt général et de la justice, de mettre en place les dispositifs adaptés pour limiter les tentations et, dans tous les cas, l’ampleur des préjudices portés par les entreprises aux personnes et à l’environnement par leur activité. La panoplie des outils disponibles en la matière est bien connue : réglementations voire interdictions, fiscalité, développement d’infrastructures, information générale, et surtout, fixation d’un cap et d’une feuille de route.
Le principe de précaution serait un obstacle au progrès
Les impacts des activités humaines sur la nature sont considérables (voir notre module sur les ressources et les pollutions) et parfois mal connus. Par exemple, la majorité des molécules chimiques ont été créées et diffusées sans avoir une connaissance exhaustive de leurs effets sur l’environnement, sur les êtres vivants ou sur la santé humaine.
Il est souvent considéré que les risques sont inévitables (selon l’adage « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs »), et que cela vaut le coup de les prendre si la balance « coûts-bénéfices » est positive. Sans entrer dans le débat de la pertinence de l’analyse coût bénéfice, limitons-nous à dire que cet outil ne peut être mobilisé que pour des impacts « à la marge » d’un système donné. Il est indiqué, au mieux, pour faire des comparaisons entre projets (ou entre situations clairement définies).
Le principe de précaution a été énoncé justement pour faire face aux situations où les risques sont potentiellement très importants, mais où la connaissance scientifique est insuffisante. Comme nous allons le voir, malgré de très fortes critiques sur le fait qu’il bloquerait le progrès scientifique et l’innovation, on ne peut que constater qu’il reste très peu appliqué.
Aux origines du principe de précaution
Depuis le début de l’ère industrielle, il existe de nombreux exemples où les industriels ont mis sur le marché de nouveaux produits dont les impacts sur l’environnement ou la santé humaine, incertains en l’état des connaissances de l’époque, se sont révélés a posteriori graves et irréversibles. Le rapport Signaux précoces, leçons tardives, publié par l’Agence européenne de l’environnement en 2001, en documente de nombreux exemples.
Ainsi, l’amiante (isolant et ignifuge), le plomb (antidétonant dans l’essence), le DDT (pesticide), les PCB (diélectriques), le benzène (solvant) se sont révélés cancérigènes.
On peut également citer les CFC (utilisés comme gaz propulseurs, ou dans la chaîne du froid) à l’origine de la déplétion de l’ozone stratosphérique (communément appelé « trou de la couche d’ozone ») ou encore le DES (diéthylstilbœstrol), utilisé notamment comme régulateur de la ménopause, qui s’est avéré être un puissant perturbateur endocrinien.
Des procédés destinés à générer des économies substantielles se sont avérés très néfastes pour la santé humaine ou pour l’environnement, sans que ces effets aient été anticipés. Il en est ainsi des farines animales utilisées pour l’alimentation des bovins qui ont été à l’origine de la « crise de la vache folle ».
Des pratiques telle la surpêche de la morue en Terre-Neuve , se sont avérés néfastes, que ce soit pour l’environnement, la société ou l’activité économique elle-même : la morue a disparu de Terre-Neuve.
Tous ces scandales sanitaires ou environnementaux ont conduit à la formulation du principe de précaution lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, et plusieurs pays l’ont inscrit dans leur droit national (voir encadré). L’idée de ce principe est de lever les doutes qui peuvent exister sur la nocivité d’un produit, d’un procédé ou d’une technologie, avant de l’autoriser.
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
Le principe de précaution en France et dans l’Union européenne
Depuis le traité de Maastricht de 1992, le principe de précaution est inscrit dans le droit européen selon lequel la politique environnementale de l’UE est « fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »224 En 2000, dans la Communication sur le recours au principe de précaution, la Commission précise que ce dernier ne se limite pas aux questions environnementales, ainsi que les modalités pour y avoir recours.
En France, c’est la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement de 1995 qui introduit dans le droit « le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».225 La France a ainsi atténué la définition de Rio en y ajoutant les notions de réaction « proportionnée » et de « coût économiquement acceptable ». En 2004, le principe de précaution est intégré dans la Charte de l’environnement qui précise que, face à une situation relevant du principe de précaution (incertitude scientifique et risques de dommages graves et irréversibles), les autorités publiques doivent veiller « à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Il devient ainsi un principe d’action menant au développement de la recherche scientifique. En 2005, il prend une valeur constitutionnelle quand la Charte est intégrée au bloc de constitutionnalité français.
Le principe de précaution est reconnu dans de nombreux autres pays tels la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, le Canada ou le Brésil.
Le principe de précaution est très largement critiqué, notamment dans les milieux économiques et industriels
Il lui est reproché de s’opposer au progrès scientifique et à l’innovation. Il est, ainsi, souvent présenté de façon caricaturale : pour éviter tout risque on ne pourrait plus rien faire. C’est par exemple la position adoptée dans le rapport de la Commission Attali pour la libération de la croissance verte (2008) qui recommande de retirer le principe du bloc de constitutionnalité.
Afin de contrer le principe de précaution, l’idée est née de le contrebalancer, voire de le remplacer par un « principe d’innovation ». En France, plusieurs députés ont déposé fin 2014 une proposition de loi constitutionnelle (non retenue) visant à substituer un « principe d’innovation responsable » au principe de précaution dans la Charte de l’environnement226. Au niveau européen, une initiative similaire a eu lieu et a, elle, été couronnée de succès. Le « principe d’innovation », dénué de base juridique (voire de définition) a été introduit dans les textes entourant la création du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe »227. Ce principe a été inventé et promu auprès des instances européennes par le European Risk Forum, une structure de lobbying, dont les membres viennent principalement des secteurs de la chimie, du pétrole et du tabac. L’objectif est le suivant : « Chaque fois que des décisions politiques ou réglementaires sont à l’étude, l’impact sur l’innovation devrait être évalué et pris en compte. »228 Les acteurs de la société civile, dont l’ONG Corporate Europe Observatory, qui a réalisé une enquête approfondie sur l’implication d’ERF229, craignent que ce principe, présenté de façon consensuelle, ne serve de base juridique pour contrebalancer, voire rendre inopérant, le principe de précaution.
Le principe de précaution n’a pas été et n’est pas appliqué avec assez de rigueur
Notons tout d’abord que le principe de précaution ne s’oppose pas à la recherche scientifique : son application demande au contraire d’accroître les recherches scientifiques pour confirmer ou infirmer les risques. Par ailleurs, l’idée d’un « principe d’innovation » n’a simplement aucun sens, d’une part parce que l’innovation étant permanente dans notre système économique et dans notre culture, elle n’a donc pas besoin d’être défendue, et d’autre part, elle ne peut en aucun cas être considérée comme une valeur en soi. Enfin, le principe de précaution ne vise en rien à interdire l‘innovation, mais à l’encadrer scientifiquement.
Malheureusement, cet encadrement est à ce jour largement insuffisant. L’érosion de la biodiversité dans nos régions est due au premier ordre à la diffusion des pesticides dont les néonicotinoïdes230. La dérive climatique n’est pas sous contrôle comme le montre le sixième rapport du GIEC, ou le rapport 2023 du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les risques majeurs que la biologie de synthèse231 nous fait prendre, dont l’origine et l’ampleur sont bien expliquées par Nicolas Bouleau dans son livre Ce que Nature sait (PUF, 2021), devrait clairement faire l’objet de l’application de ce principe et ce d’autant que les bénéfices des expérimentations réalisées ne sont pas clairs.
Cette absence de prise en compte réelle du principe de précaution tient en partie à la puissance du lobbying exercé par les acteurs qui profitent du maintien du système en l’état. Au cours des dernières décennies, des travaux scientifiques ont montré comment certaines entreprises ont réussi à détourner la recherche scientifique pour créer des doutes sur les liens de causalité entre leurs produits et leurs effets sur la santé et l’environnement. Le livre Les marchands de doute de Erik M. Conway et Naomi Oreskes a mis la lumière sur ces pratiques mises au point par l’industrie du tabac et utilisées ensuite dans d’autres cas, comme le trou de l’ozone ou le dérèglement climatique.
Les marchands de doute
Dans cet ouvrage, Naomi Oreskes et Erik Conway, historiens des sciences, rendent compte de façon très documentée de leurs recherches sur la « fabrique du doute ». Ils établissent un lien entre les techniques inventées par les industriels du tabac dans les années 1960-70 et celles des lobbys ayant intérêt à ce que les risques écologiques ou sanitaires soient minorés (pluies acides, ozone, DDT, réchauffement climatique…). Leur stratégie consiste non pas tant à contrer le constat scientifique qu’à semer le doute sur ce constat, la confusion quant à la réalité des menaces pour retarder au maximum l’installation d’un consensus public. Tous les moyens sont bons : décrédibiliser (voire harceler, menacer) les scientifiques, avoir recours à des scientifiques ou experts opportunistes ou naïfs pour mener des études contradictoires, partielles (voire fausses), ou bien en mettant en avant d’autres causes potentielles pour les risques ou dégâts encourus. Leurs travaux ainsi que ceux d’autres scientifiques ont donné naissance à une nouvelle discipline scientifique, l’agnotologie, c’est-à-dire l’étude de la production culturelle de l’ignorance et du doute.
Cette stratégie a également été appliquée dans celui des disparitions brutales d’abeilles, où les producteurs de pesticides ont détourné l’attention de leurs produits pour donner à penser que ces disparitions étaient multifactorielles (varroa, frelon asiatique etc.). Le livre Pesticides, de François Dedieu (Seuil, 2022), sociologue à l’Inrae, montre l’étendue de notre ignorance sur les effets des pesticides, et l’une de ses causes : les autorités administratives de contrôle sont débordées par le nombre de produits et de molécules à contrôler. « Entre 2008 et 2013, 2891 spécialités commerciales différentes de produits sanitaires ont été vendues en France ». Dans ce contexte, le simple bon sens conduit à recommander une baisse sensible de la commercialisation des pesticides.
En conclusion, on peut considérer que non seulement le principe de précaution a plus que jamais sa place, mais qu’il faut prendre des mesures substantielles au niveau du fonctionnement de l’activité scientifique, comme le recommande le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l’Homme232 dans son livre Quelles sciences pour un monde à venir.
Pour en savoir plus
- La fabrique de l’ignorance, documentaire d’Arte (2021)
- Les marchands de doute de Erik M. Conway et Naomi Oreskes
- Et le monde devint silencieux, Stéphane Foucart, Seuil, 2019
- La fabrique du mensonge : comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger, Stéphane Foucart, Gallimard, 2014
- Quelles sciences pour un monde à venir, Conseil scientifique de la FNH, Odile Jacob, 2020
- Signaux précoces et leçons tardives : Le principe de précaution 1896 – 2000 (PDF), Institut français de l’environnement, 2004
La fiscalité serait un obstacle rédhibitoire à la transmission des entreprises en France
Les titres ou les parts d’une société peuvent avoir une valeur monétaire forte.
Pour les entreprises cotées en Bourse, les impôts sur la plus-value, la succession ou sur la fortune ne posent pas de difficulté spécifique relative à leur contrôle. En revanche, dans le cas d’entreprises familiales, la fiscalité peut mettre en péril le contrôle de l’entreprise et le cas échéant l’autonomie de sa direction. En effet, au moment du décès du dirigeant et si la succession n’a pas été préparée233, les ayants droit ont à payer des impôts (principalement l’impôt sur la succession et le cas échéant l’Impôt sur la fortune) qui peuvent les inciter à vendre leurs titres pour payer ces droits, ce qui peut conduire à une perte du contrôle familial. Dans ce cas, l’entreprise peut être cédée en tout ou partie à une multinationale ou à un fonds d’investissement.234
Le cas de l’impôt sur la succession a été traité en France principalement par le pacte Dutreil, mis en place en 1999 et qui a évolué plusieurs fois depuis. Ce dispositif permet, sous certaines conditions, une transmission anticipée aux héritiers, et de voir l’impôt sur la succession fortement réduit. Quant à l’Impôt sur la fortune (ISF), il a été remplacé en France par l’Impôt sur la Fortune Immobilière(IFI), qui ne concerne que le patrimoine immobilier et plus les valeurs mobilières (qui exclut donc, en particulier, la détention de part du capital d’une entreprise).
Deux questions doivent être éclairées :
- Les entreprises familiales sont-elles plus performantes, pérennes et plus responsables que les autres ?
Dans le document de travail Faut-il favoriser la transmission d’entreprise à la famille ou aux salariés ?, publié en 2013 par la Direction Générale du Trésor, les auteurs indiquent que « les études empiriques identifiant les successions des dirigeants concluent que le management héréditaire ne s’accompagne pas d’un accroissement de la profitabilité et de la pérennité des entreprises ». Quant à la question de l’impact écologique et social, on a vu dans l’Essentiel 6.3 que les entreprises familiales pouvaient être redoutablement prédatrices.
2 La fiscalité est-elle un vrai obstacle à leur développement et à leur pérennité ?
Selon, le document de la DGT précité : « La fiscalité de la transmission d’entreprise « n’apparaît plus être un frein à la transmission d’entreprise » selon le Conseil des Prélèvements Obligatoires (2009), qui estime que le frottement fiscal d’une transmission familiale bien préparée se limite désormais à moins de 5 % de la valeur de l’entreprise, et peut même devenir quasi nul au prix de stratégies élaborées requérant l’intervention de spécialistes. »
Depuis la transformation de l’ISF en IFI et la création de fonds de pérennité, cette conclusion ne peut qu’être renforcée.
La « start-up Nation » serait un idéal à atteindre pour l’économie nationale
Le président de la République française Emmanuel Macron a lancé, en 2017, l’idée de la « Start-up nation » et en a fait un mantra politique, vantant la volonté de son gouvernement de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes, en particulier le domaine des nouvelles technologies, afin de contribuer au développement économique du pays.
L’expression est issue d’un livre paru en 2009235 qui tente d’expliquer le succès des entreprises technologiques de l’État d’Israël. Ce discours politique vante aussi l’idée qu’il serait souhaitable que la France fasse émerger de nombreuses « licornes » (c’est-à-dire des startups valorisées à plus de 1 milliard de dollars et non cotées en Bourse).
Ce discours est dangereux pour plusieurs raisons.
- Il conduit les jeunes à confondre start-ups et entreprises. D’après BPI France, « signifiant littéralement « entreprise qui démarre », la startup est liée à la notion d’expérimentation d’une nouvelle activité sur un marché émergent et dont les risques sont difficiles à évaluer ». Elle se caractérise par trois conditions : « la perspective d’une forte croissance, l’usage d’une technologie nouvelle et un besoin de financement important ». L’immense majorité des entreprises ne sont donc pas des start-ups.
- Il fait de la technologie, et du numérique en particulier, une finalité importante, si ce n’est centrale, de l’activité entrepreneuriale, alors qu’elle est en fait marginale en nombre d’entreprises et d’emplois.
- Il pousse à accélérer la « plateformisation » (ou « uberisation ») de l’économie, dont nous ne pouvons faire un rêve ni au plan écologique ni au plan social.
- Il pousse à considérer que « lever beaucoup d’argent » et obtenir une valorisation d’un milliard de dollars est un idéal. En effet, le critère de la levée de fond est placé très haut dans la rhétorique sur la réussite ou non des startups, comme en témoigne, par exemple, la lecture des différents baromètres de la performance économique et sociale réalisés par l’association France Digitale. Cet idéal est néfaste à plusieurs titres. Tout d’abord, sur le plan économique, levée de fond ne veut pas dire rentabilité : selon le baromètre 2022 de France Digitale, à peine un quart des startups avaient atteint la rentabilité (mesurée par un EBITDA positif236) en 2021. Ensuite, les « licornes » sont très peu nombreuses : sur les 1300 startups recensées par France Digitale en 2023, seules quelques dizaines sont des « licornes » (elles sont quelques centaines aux États-Unis, pays qui en compte le plus)237. Enfin, cet idéal est sans fondement éthique, économique, écologique, ou social. Au plan social, il est très difficile de devenir une licorne sans casse humaine ; le management doit être rivé sur son objectif financier et ne doit pas s’embarrasser d’états d’âme ou de contraintes sociales excessives.
- La priorité en termes écologiques et sociaux n’est pas de lancer des start-ups ou des « licornes », mais de transformer les entreprises de sorte que leur modèle d’affaires devienne sobre, bas-carbone et favorable à la biodiversité. Il y a beaucoup d’innovations, beaucoup d’initiatives à conduire pour y arriver et beaucoup d’argent à investir.
- Sur le plan technologique, la priorité est à l’évidence de renforcer l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe, qui ont réussi le tour de force d’être dépendantes de la Chine et/ou des États-Unis aux plans du matériel (hardware) et du logiciel (software)238. Ces graves erreurs sont dues à l’application d’une doctrine libre-échangiste et d’une conception de la concurrence fausse et dangereuse. Nous n’en sortirons pas en misant sur les « licornes », mais en reconstruisant une politique industrielle, et en créant ainsi un cadre permettant le développement d’initiatives privées pertinentes et éventuellement ambitieuses.
Les patrons seraient uniquement guidés par l’argent et le pouvoir
Dans nombre de discours, les chefs d’entreprise -le plus souvent assimilés à ceux des grands groupes- sont présentés comme des personnages détestables. Très riches et bien rémunérés, ils sont accusés de diriger leur entreprise dans leur propre intérêt (enrichissement, prestige, lubie, pouvoir), quelles que soient les conséquences sociales, environnementales ou l’inhumanité du management. Cette image négative des patrons est alimentée par les scandales et les outrances de quelques patrons iconiques, par la médiatisation régulière de leurs revenus (surtout quand ils sont mis en regard de plans de licenciements) et du réel pouvoir d’influence qu’ils ont sur la société.239
Si ce discours n’est pas sans fondement, en particulier en haut de l’échelle sociale, il convient toutefois de se garder de tout manichéisme ; les « patrons » sont de tout ordre, et l’exercice du pouvoir dans l’entreprise, comme ailleurs, expose particulièrement aux dérives comportementales ceux qui s’y attellent.
Leadership et traits obscurs de personnalité
De nombreuses études en psychologie ont montré d’importantes connexions entre traits obscurs de personnalités (voir encadré) et position de leadership. Ainsi, dans un article paru en 2021240, des chercheurs ont exploré les relations entre la « triade noire » et le niveau de leadership. Selon leurs résultats, les personnes ayant un fort leadership affichent des scores de triades noires plus élevés, que ce soit via les auto-évaluations ou celles réalisées par les subordonnés.
Les traits obscurs de personnalité – triade noire, dark factor
Depuis une vingtaine d’année, de nombreux travaux en psychologie ont eu pour objectif d’identifier et d’étudier les « traits obscurs » de personnalité, c’est-à-dire ceux liés à des comportements éthiquement, moralement, ou socialement néfastes.
L’un des concepts ayant eu le plus d’écho est celui de « triade noire » (dark triad)241, trois traits de personnalité particulièrement destructeurs (narcissisme, psychopathie et machiavélisme) et souvent concomitants.
En 2018, sur la base de quatre études réalisées auprès de plus de 2500 personnes, trois chercheurs ont proposé un cadre théorique unificateur, en spécifiant le dénominateur commun des neuf traits sombres les plus étudiés.242
Ce noyau commun, qu’ils appellent le « dark factor », est défini comme la « tendance [d’un individu] à maximiser sa propre utilité – en ignorant, acceptant ou provoquant de manière malintentionnée une désutilité chez d’autres personnes – accompagnée de croyance qui agissent comme des justifications » à ce comportement.
Notons que cette description s’approche des caractéristiques de la figure centrale des théories économiques les plus répandues : l’homo economicus , agent rationnel guidé par l’objectif de maximisation de son utilité sous contrainte.
Source Consultez le Site du Dark factor ; Faire le test du Dark factor en ligne
Ces résultats ne sont pas très surprenants. Dans un environnement caractérisé par la guerre économique et la quête du toujours plus, il n’est pas étonnant que certains traits de personnalité négatifs dominent parmi ceux qui arrivent dans les plus hautes sphères du pouvoir.
C’est ce que notent par exemple Holt et ses coauteurs, dans un article paru en 2017 : « Au cours des dernières décennies, le “leadership” a souvent été assimilé à un comportement scandaleux ou exagéré (voire psychopathique). Cela peut être attribué au fait que l’on s’attend généralement à ce que ces figures de proue soient des individus très sûrs d’eux, voire narcissiques, affichant souvent une gamme de traits révélateurs, tels que le souci de grandeur, l’exhibitionnisme, l’égocentrisme et le manque d’empathie […] De nombreux chercheurs […] ont même postulé que les psychopathes réussissaient très bien dans le monde des affaires parce que l’environnement semble inviter exactement les caractéristiques que ces individus possèdent. »243
Par ailleurs, le fait d’exercer du pouvoir sur d’autres peut aussi exacerber des tendances « négatives » (manipulation, volonté de soumettre l’autre, harcèlement, abus sexuel). Quant à la possession de l’argent, liée au pouvoir, (pas toujours direct, ce peut être du pouvoir d’influence, comme celui des footballeurs et des stars), elle peut également transformer négativement le rapport aux autres. Des psychologues ont montré que la richesse, surtout quand elle est très grande, augmente la distance sociale et réduit l’empathie.244
Notons enfin que lorsqu’on se penche sur les imaginaires du leadership, la figure du leader dominant, visionnaire, tranchant, sûr de lui voire qui inspire la peur, reste très présente dans la société. C’est une des conclusions d’une étude, publiée en 2023 par l’association Heart Leadership University et le cabinet Eranos, sur les imaginaires du leadership chez les jeunes Française245. Les répondants au questionnaire réalisé pour les besoins de cette étude246 étaient invités à choisir, parmi six photographies de personnalités247, celle qui représentait le mieux le leardership tel qu’ils aimeraient qu’il soit aujourd’hui. Elon Musk et Mark Zuckerberg recueillent ensemble près d’un quart des voix (respectivement 15% et 8%), montrant ainsi que l’image du grand patron ayant fait fortune dans des domaines considérés comme d’avant-garde est encore très présente, malgré les scandales qui entourent ces deux personnalités.
Ne pas tomber dans une vision manichéenne
L’image négative des grands patrons rejaillit, via des prises de position de dirigeants politiques ou syndicaux, des films et des reportages, sur l’ensemble du patronat, alors que ce milieu est très hétérogène au plan humain.
Il n’y a pas de commune mesure entre Elon Musk ou Bernard Arnault et un patron de PME, en termes de pouvoir, de rémunération et de fortune ; il existe bien sûr des patrons « humains » dans nombre d’entreprises.
Le patron a un rôle spécifique qu’il est difficile de nier, celui de chef d’orchestre et d’arbitre. Ce rôle implique de prendre des décisions qui peuvent déplaire à une partie du collectif de travail que constitue l’entreprise (et ceci quelle que soit la personnalité du dirigeant).
Même animé des meilleures intentions, diriger une entreprise est un exercice périlleux dans lequel il faut concilier :
- la nécessaire recherche de rentabilité (sans laquelle l’entreprise finit par disparaître) ;
- la prise en compte des contraintes extérieures (réglementaire, conjoncturelle, jeu concurrentiel marqué le plus souvent par une tendance au moins disant social, environnemental) ;
- la perception et l’anticipation des grandes évolutions en cours et à venir (technologiques, sociétales, environnementales) ;
- l’art de diriger les autres avec considération (les collaborateurs étant également des humains et donc pas des anges par définition mais pas non plus des êtres serviles) ;
- voire le respect de la mission et des valeurs de l’entreprise (quand elle s’en est dotée).
Cela nécessite souvent un travail personnel et des apprentissages « techniques » et émotionnels. C’est par exemple ce que propose l’association Heart Leadership University248 avec le parcours du Cœur aux Actes, dans lequel les dirigeants d’entreprise prennent conscience de, et exercent leur « intelligence du cœur » (IDC) afin de transformer leur entreprise en tenant compte des grands défis du XXIe siècle.
Dans ses travaux de recherche, HLU a montré que l’IDC pouvait effectivement s’enseigner (bien plus par la pratique que par la théorie), et que la transformation personnelle du dirigeant qui en résultait menait à une transformation effective de l’entreprise249. Ces travaux ont montré également qu’une telle démarche est complexe et difficile, tant les obstacles sont nombreux : freins internes au dirigeant (en particulier certaines peurs), freins propres à l’organisation (son type de gouvernance et ses rigidités, la culture et la norme commune de pensée, les résistances des collaborateurs), et enfin des freins externes (conjoncturels ou plus structurels tenant à la vision du rôle d’une entreprise).
Qu’est-ce que l’intelligence du cœur (IDC) ?
L’intelligence du cœur permet de décider et diriger une entreprise sans se limiter à l’objectif de performance économique et à une approche rationnelle, argumentée par la logique et les chiffres. Elle se cultive autour de trois fondamentaux : faire confiance à son intuition pour percevoir le monde qui vient et innover différemment ; avoir le courage d’être soi, d’assumer ses valeurs et d’agir en conséquence ; et développer son empathie en apprenant à mieux se connecter aux autres et à son environnement, afin de créer des produits et services utiles au monde, tout en « encapacitant » les collaborateurs. Surtout, l’intelligence du cœur réside dans la combinaison de ces trois aptitudes. C’est particulièrement évident pour le courage sans lequel ni intuition ni empathie ne pourraient s’exprimer.
En savoir plus : voir les travaux de recherche de Heart Leadership University248
Derrière la condamnation des « patrons » peut se profiler l’idée que des structures de gouvernance horizontale, voire d’autogestion, seraient préférables à des modèles « verticaux », très hiérarchiques, souvent associés à l’existence d’un « patron ».
La situation n’est cependant pas si manichéenne.
Rappelons tout d’abord que l’entreprise est un lieu d’engagements, de contrats (avec les clients, les fournisseurs, les salariés, les acteurs publiques, les investisseurs). Tenir ces engagements implique que des responsabilités soient précisées et que des décisions soient prises. Dès lors, il est important pour le ou les dirigeants de clarifier la gouvernance (qui décide de quoi comment ?) et de s’assurer en permanence du « bon niveau » d’implication dans les décisions des collaborateurs.
Ensuite, comme nous l’avons vu dans l’Essentiel 4 sur les enjeux et la variété des formes gouvernance, il est possible d’instituer des modes de gouvernance plus démocratiques que celui de l’entreprise hiérarchique traditionnelle, de telle sorte que le pouvoir soit « partagé », non en fonction du seul taux de détention du capital mais également en fonction de règles définissant le lien entre implication, apport dans/à l’entreprise et participation aux décisions.
- Les associations, coopératives, mutuelles et fondations, sont les principales structures de l’économie sociale solidaire (ESS). Voir l’Essentiel 4 sur la gouvernance. ↩︎
- Les entreprises ont aussi des fonctions sociologiques et culturelles. Elles ont, par exemple, pour rôle d’enrichir leur fondateur (puis actionnaire), de procurer un statut social (au dirigeant), un rôle culturel pour promouvoir tel ou tel mode de vie ou idéologie (ex : secteurs de la mode, des médias, etc.). ↩︎
- Le greenwashing (en français, éco-blanchiment) est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique de manière exagérée / non-fondée. Voir Agostino Vollero, Greenwashing. Foundations and emerging research on corporate sustainability and deceptive communication, Emerald Points, 2022. ↩︎
- Une entreprise plus que centenaire n’a pas les mêmes caractéristiques qu’une entreprise de 5 ans d’existence. ↩︎
- Voir par exemple Olivier Weinstein, Les théories de la firme, Idées économiques et sociales, 2012. ↩︎
- Par exemple, imaginons qu’un constructeur automobile décide de placer son activité commerciale dans une filiale. L’approche par les unités légales va conduire à considérer que cette filiale (et toutes les statistiques qui la concerne : nombre de salariés, chiffre d’affaire etc.) relève désormais du secteur du commerce alors que l’approche par l’entreprise considérera qu’elle fait toujours partie du secteur de l’automobile. Plus de détails dans l’article L’entreprise : un concept économique plutôt qu’une définition juridique, Blog de l’Insee (10/12/2021). ↩︎
- Les unités légales ne se limitent donc pas aux structures ayant une activité marchande. Voir la nomenclature des différentes unités légales retenues dans le répertoire SIRENE. ↩︎
- Cette définition a été formulée pour la première fois dans le Règlement 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté. En France, elle a été reprise dans le Décret n° 2008-1354 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, en application de l’article 51 de la Loi de modernisation de l’économie de 2008. ↩︎
- Par exemple, un entrepreneur individuel qui après s’être déclaré ne réalise aucun chiffre d’affaires. ↩︎
- C’est le cas par exemple des SCI (société civile immobilière) créées pour jouir d’un bien immobilier (dans une même famille, entre amis etc.) et non pour le commercialiser. ↩︎
- Voir notre module sur la comptabilité de l’entreprise pour la définition comptable du terme profit ainsi que pour une mise en perspective sur l’ambiguïté de ce terme (et de nombreux autres termes comptables et économiques employés communément). ↩︎
- Par exemple, elles ne peuvent être échangées sur une bourse. Par ailleurs, l’entrée de nouveaux associés nécessite généralement l’agrément à l’unanimité des autres (sauf clause contraire dans les statuts). ↩︎
- Il est néanmoins possible d’insérer une clause d’agrément dans les statuts pour limiter cette possibilité. ↩︎
- Les parts sociales ne sont pas librement cessibles, ce qui est une caractéristique des sociétés de personnes, mais les associés ne sont responsables que dans les limites de leurs apports, ce qui relève des sociétés de capitaux. ↩︎
- « L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé: a) des salariés; b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national; c) des propriétaires exploitants; d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise. » Source 2003/361/EC. ↩︎
- « L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé: a) des salariés; b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national; c) des propriétaires exploitants; d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise. » Source 2003/361/EC. ↩︎
- Par rapport au champ de la statistique structurelle, les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers ne comprennent pas : les exploitations forestières ; les auxiliaires de services financiers et d’assurance et les holdings ; les entreprises marchandes des secteurs de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. ↩︎
- Source : L’essentiel sur… les entreprises – Insee 2024. Champ : entreprises des secteurs marchands non agricoles créées au premier semestre de l’année de référence, hors auto-entrepreneurs. ↩︎
- Pour en savoir plus sur les défaillances d’entreprises, voir le site de la Banque de France. ↩︎
- La production en France s’est élevée à 4433 milliards d’euros en 2021 dont 507,5 milliards pour la production non marchande (attention la production n’est pas la même chose que le PIB comme nous l’expliquons dans le module PIB, croissance et limites planétaires). Source : Tableau économique d’ensemble (TEE) – Comptes de la Nation 2021. ↩︎
- Source : Tableau Économique d’ensemble 2020 – Les comptes de la Nation en 2020 – Insee. Pour une définition de la valeur ajoutée, voir le module PIB, croissance et limites planétaires. ↩︎
- Par exemple en France : les professions libérales organisées en ordre professionnel (architectes, avocats, experts-comptable, médecins) ; celles exercées par des officiers publics (huissiers de justice, notaires, greffiers) ou celles relevant d’autres cas (auxiliaires médicaux dont l’activité est réglementée par le Code de la santé publique, commissaires aux comptes etc.) En savoir plus sur le site de l’Urssaf. ↩︎
- Voir La face cachée de l’économie, Néolibéralisme et criminalités, Clotilde Champeyrac, PUF, 2019. ↩︎
- Les origines de ce terme, même s’il n’est pas décrit exactement sous sa forme actuelle, remonte aux écrits de Peter F. Druker, The Practice of Management, 1954 (réédition Routledge 2007). ↩︎
- de ses sociétaires pour les mutuelles, de ses coopérateurs pour les coopératives. ↩︎
- Voir La syndicalisation des salariés en France depuis 1949, site de la Dares (consulté le 05/06/24). ↩︎
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE doit être consulté lors de procédures de licenciement collectif pour motif économique. Dans celles de plus de 50 salariés, il doit être consulté chaque année pour les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, ainsi qu’en cas de restructuration et compression des effectifs, licenciement collectif pour motif économique et procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. En savoir plus sur le site CSE-guide.fr et sur le site culture-rh.com. ↩︎
- L’École de Chicago est une école de pensée regroupant un groupe informel d’économistes libéraux défenseurs du libre marché, de la théorie néoclassique de la formation des prix, de l’intervention minimum de l’État dans l’économie, de la neutralité de la monnaie etc. Son nom vient du département d’économie de l’université de Chicago où se trouvaient la majeur partie des économistes adhérent à ces idées. Son chef de file est Milton Friedman, l’un des économistes les plus influents du XXe siècle. ↩︎
- Il y a des variantes possibles, selon les statuts des sociétés, comme par exemple l’existence d’actions à droit de vote double. ↩︎
- Les sociétés peuvent être aussi dirigées par un conseil de surveillance et un directoire. Dans ce cas les présidents (du conseil de surveillance et du directoire) sont nécessairement différents et c’est le directoire qui a le pouvoir de décision opérationnel. Le conseil de surveillance a un pouvoir de contrôle, notamment de la conformité des décisions opérationnelles avec la stratégie. ↩︎
- Pour un état des lieux de la codétermination en Europe, voir les travaux de Christophe Clerc : La codétermination : un modèle européen ?, Revue d’économie financière, 2018 et Structure et diversité des modèles actuels de gouvernement d’entreprise – Partie I et II, rapports pour l’OIT, 2020. ↩︎
- Source : Recommandation du Conseil sur l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale (2022). Il existe d’autres définitions de l’ESS (ou économie sociale, ou économie solidaire) qui sont toutes relativement proches. Par exemple celle de l’Organisation internationale du travail ou celle du Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur l’ESS. ↩︎
- Pour en savoir plus, voir l’article d’Alain Grandjean, La rémunération du capital dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire, blog Les chroniques de l’Anthropocène, (25/08/2023). ↩︎
- Ne pas confondre avec la notion de « mutuelle santé », assurance santé complémentaire proposée par une société mutuelle. Notons ici que par abus de langage, on appelle « mutuelle santé » des complémentaires santé proposées par des sociétés d’assurance à but lucratif. ↩︎
- En réalité, l’ensemble des adhérents constituent l’Assemblée Générale. Cependant, étant donné le nombre de personnes concernées, les statuts de la société mutuelle peuvent prévoir que les adhérents élisent des délégués (ce qui est le cas le plus général). ↩︎
- Les clients du crédit Agricole peuvent devenir sociétaires en souscrivant des parts sociales de l’entreprise ; chaque sociétaire dispose ensuite d’une voix quel que soit le nombre de ses parts. Mais le Crédit Agricole a créé en son sein une Société de droit privé, Crédit Agricole SA, qui le rend capable de concurrencer les autres grandes banques (notamment par sa Banque de Financement et d’investissement CACIB) et qui en fait un organisme largement hybride. En savoir plus sur le site du Crédit Agricole. ↩︎
- Selon les chiffres du cabinet Prophil, spécialiste du sujet, en 2018 au Danemark, 1 360 entreprises étaient détenues par des fondations. À noter que d’autres structures d’intérêt général tels les fonds de dotation relèvent de ce modèle. ↩︎
- Voir Quel avenir pour les fondations actionnaires ? Frédérique Perrotin, Actujuridique.fr (09/11/2017). ↩︎
- À partir également du concept de « société à objet social étendu », proposé par Blanche Segrestin et Armand Hatchuel dans leur livre Refonder l’entreprise, Seuil, 2012. ↩︎
- Le terme a d’abord été introduit en 2015 dans la thèse Les entreprises à mission : Formes, modèle et implications d’un engagement collectif, Kevin Levillain, École nationale supérieure des mines. ↩︎
- La Purpose Foundation est une fondation allemande qui rassemble un réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et de professions juridiques œuvrant pour le développement d’une économie indépendante et vertueuse à travers le modèle de steward-ownership. Elle est adossée au fonds d’investissement evergreen pour proposer des solutions de financement aux entrepreneurs désireux de mettre en place un modèle de steward-ownership. ↩︎
- Voir sur le site de Heart Leadership University une étude de cas portant sur le passage de Stapelstein d’une société traditionnelle a une société dont la gouvernance repose sur les principes du Steward Ownership. ↩︎
- Steward-Ownership. Rethinking ownership in the 21st century, Purpose Foundation, 2019. ↩︎
- Il s’agit en particulier de rémunérer la prise de risque et le fait d’avoir arbitré en faveur d’un investissement dans l’entreprise en question au détriment d’une consommation immédiate ou d’un autre investissement (potentiellement plus rémunérateur). ↩︎
- À noter que ces exigences peuvent ne sont pas nécessairement liées au caractère capitalistique de l’entreprise. Des entreprises de conseil cotées peuvent avoir des valorisations considérables sans que leur métier soit intense en capital physique. ↩︎
- Ces ressources peuvent être apportées en numéraire, en nature ou en industrie. Voir l’article Capital social : quels sont les différents types d’apports ?, Sofia El Allaki, captaincontrat.com, (24/05/2024). ↩︎
- Une attente de rendement élevé raccourcit l’horizon de gestion des décideurs en donnant beaucoup plus de poids aux données présentes et proches qu’aux données lointaines. Cet effet est mathématique (voir notre fiche sur le taux d’actualisation). ↩︎
- C’est par exemple la stratégie affichée en 2022 par le président de l’entreprise de câbles Nexans. ↩︎
- Loukas Karabarbounis, Brent Neiman, The Global Decline of the Labor Share, The Quarterly Journal of Economics, 2014. Sophie Piton, Comment expliquer la déformation du partage de la valeur ajoutée depuis 30 ans ?, SES ENS, 2018. ↩︎
- On pense à la vente d’une partie d’Alstom à General Electric, de Lafarge à Holcim, d’Essilor à Luxottica. Dans tous ces cas, les dirigeants ont empoché des compléments de revenus de plus de 10 millions d’euros. Voir le témoignage d’Arnaud Montebourg (01/03/2023) auditionné par la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale sur la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France. ↩︎
- Bullshit Jobs, David Graeber, Les liens qui libèrent, 2019. Voir la chronique Comment vérifier si votre poste est un bullshit job ?, Chronique d’Isabelle Barth, Xerfi Canal, 2022. ↩︎
- La productivité du travail désigne le rapport entre la production réalisée (mesurée en grandeur physique -nombre de voitures fabriquées par exemple- ou en valeur -on utilise alors la valeur ajoutée) et le travail nécessaire pour y parvenir (mesuré soit en nombre d’heures soit en nombre d’emploi). En savoir plus dans le module Travail et chômage. ↩︎
- Il existe toute une ingénierie financière et fiscale en la matière. Voir par exemple la page Principales caractéristiques des BSA, BSPCE, AGA & Stock-Options sur le site du cabinet Delcade Avocats & Solicitors (consultée le 20 juin 2024). ↩︎
- La rémunération totale comprend le salaire, les bonus, les stock-options et assimilées, les éventuels avantages en nature. ↩︎
- Voir l’article Article L225-37-3 du Code du commerce qui concerne les obligations de divulgation concernant la rémunération des dirigeants. ↩︎
- Pour en savoir plus sur les différentes étapes concernant la transparence de la rémunération des dirigeants voir l’étude Le ratio d’équité Nouvel outil de transparence ?, SIACI Saint Honoré, Janvier 2021. ↩︎
- Sur ce sujet voir notamment : Le ratio d’équité Nouvel outil de transparence ?, SIACI Saint Honoré, Janvier 2021 ; Au-delà du ratio d’équité un nouveau paradigme s’impose : des conseils d’administration créateurs de valeur collective et d’harmonisation des intérêts des parties prenantes, Louise Champoux-Paillé, 2014 ; Rémunération des dirigeants : la transparence ne fait pas tout, Mohamed Khenissi, Vanessa Serret, The Conversation (27/07/2020). ↩︎
- Voir Écarts de salaire : le CAC toujours trop opaque, Alternatives Économiques (11/06/2024). ↩︎
- Voir Écarts de salaire : le CAC toujours trop opaque, Alternatives Économiques (11/06/2024). ↩︎
- Voir le Décret relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social (1953) tel que modifié par le Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012. Il est à noter que cette disposition n’est pas sans poser des problèmes pratiques : voir l’article Entreprises publiques : le salaire pas plafonné pour tout le monde, Challenges (13/06/2012). ↩︎
- Voir l’article Est-il vrai que les Etats-Unis ont taxé les riches à plus de 70% pendant trente ans ?, Libération Checknews (21/03/2019). ↩︎
- Le bilan est un document qui dresse une photo à un instant précis de ce que possède l’entreprise (l’actif) et de ce qu’elle doit (le passif). Voir le détail du bilan d’une entreprise dans notre module sur la comptabilité d’entreprise. ↩︎
- Le délai légal maximal de règlement entre entreprises est fixé à 60 jours en France mais il est difficile à faire respecter par les PME si leurs clients sont des grands groupes. ↩︎
- C’est pour cela que les Mousquetaires ont été en mesure de créer une banque, comme le font aussi certaines compagnies aériennes. ↩︎
- Voir Les délais de paiement se sont réduits en 2024, sauf pour les grandes entreprises qui sont de plus mauvais payeurs, Bulletin n°260 de la Banque de France, Octobre 2025. ↩︎
- Entre ces grandes catégories de financement (et en particulier entre le capital et l’emprunt) il existe toute une série de cas hybrides non détaillées ici. Pour en savoir plus, consultez le référentiel de financement de la Banque de France. ↩︎
- En savoir plus sur le cadre juridique du crowdfunding sur le site economie.gouv.fr et sur les chiffres du secteur en France avec le baromètre du crowdfunding, réalisé par l’association professionnelle financement participatif France. ↩︎
- Un covenant désigne l’ensemble des contraintes que la société doit respecter sauf à déclencher le remboursement anticipé obligatoire du prêt. Le plus souvent, il s’agit de ratios financiers à respecter : par exemple, un ratio de dettes sur fonds propres inférieur à 1. ↩︎
- À l’époque des grands voyages et des grandes découvertes, les entreprises de commerce demandaient d’importants capitaux pour pouvoir démarrer ; comme les entreprises industrielles aujourd’hui, ou le secteur du BTP. ↩︎
- Sauf en général pour les entreprises cotées en Bourse, pour lesquelles la Bourse apporte précisément cette liquidité. ↩︎
- En France, on peut citer ceux de la famille Mulliez par exemple, mais aussi les groupes Bolloré, Bouygues, LVMH. ↩︎
- Une rentabilité insuffisante met l’entreprise en risque si elle fait face à des baisses de vente, ou des accidents industriels. Elle peut alors avoir besoin de financeurs extérieurs, exigeant un droit de regard ou de contrôle. ↩︎
- Voir des exemples dans le dossier réalisé par Alternatives Economiques, Capitalisme d’influence : enquête sur les grands barons de l’économie française, 2023. ↩︎
- Il s’agit du département du cabinet de conseil et d’audit PwC qui analyse les risques que les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) font courir aux entreprises sur le plan financier ou opérationnel. ↩︎
- Il peut cependant arriver que des fonds de private equity prennent une participation minoritaire dans un groupe coté en vue de réaliser une plus-value à moyen terme. ↩︎
- Source : Comment les entreprises se financent ?, Alternatives Économiques (01/01/2008) ↩︎
- Catherine Lubochinsky, Éclipse ou crépuscule ? Pourquoi les Bourses n’ont plus la cote, Institut Messine, 2021. ↩︎
- Le pouvoir des minoritaires dépend des législations ; il est plus fort aux États-Unis qu’en France. Pour la France, voir la page La défense des droits des actionnaires minoritaires, sur le site La Finance pour Tous (consultée le 20 juin 2024). ↩︎
- Il existe des exceptions tel celui des actions à droit de vote double. ↩︎
- Mark R. DesJardine, Rodolphe Durand, Disentangling the effects of hedge fund activism on firm financial and social performance, Strategic Management Journal, 2020. ↩︎
- Un covenant désigne l’ensemble des contraintes que la société doit respecter sauf à déclencher le remboursement anticipé obligatoire du prêt. Le plus souvent, il s’agit de ratios financiers à respecter : par exemple, un ratio de dettes sur fonds propres inférieur à 1. ↩︎
- Les prélèvements obligatoires ne sont pas les seules recettes des APU (même s’ils en constituent la majeure partie). Les autres sources de recettes des APU peuvent également provenir de recettes tirées des activités marchandes exercées à titre secondaire par les APU (redevances pour services rendus, locations, ventes de biens), des paiements partiels des ménages pour des services non marchands (droits d’inscription dans l’enseignement supérieur), revenus de la propriété, transferts de l’Union européenne. ↩︎
- Il s’agit notamment des réseaux d’électricité, d’eau, de télécommunication, de transports, des services de gestion des déchets. Toutes ces infrastructures ne sont pas nécessairement publiques. Quand elles sont privées, leur accès est bien sûr payant. ↩︎
- Système juridique, État de droit, existence d’une main d’œuvre bien formée, en bonne santé et bénéficiant d’une protection sociale etc. ↩︎
- En économie, on appelle “externalité” les répercussions positives ou négatives de l’activité d’un agent économique sur d’autres agents sans contrepartie monétaire marchande « spontanée ». Internaliser les externalités négatives sur l’environnement, c’est leur donner un coût, pour les faire apparaître dans la comptabilité de l’entreprise. Voir notre fiche Doit-on donner un prix à la nature ? ↩︎
- Voir Data on Taxation Trends, Commission Européenne. ↩︎
- On obtient le montant de ces cotisations facultatives en faisant la différence entre les « Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs » (D611) reçues par les APU et celles payées par tous les secteurs institutionnelles (D121). Elles sont passées de 1 milliard d’euros en 2010 (soit 0,5% du total) à près de 16 milliards en 2023 (soit 5,5% du total). Il n’est cependant pas possible de distinguer celles qui relèvent spécifiquement des sociétés non financières. ↩︎
- Ils sont inscrits dans les charges d’exploitation du compte de résultat ↩︎
- Où en est la compétitivité fiscale de la France ?, Olivier Passet, Xerfi Canal, 2024 ↩︎
- Les impôts indirects sont ceux où le redevable (celui qui paie l’impôt au Trésor Public) est différent du contribuable (celui sur qui repose la charge de l’impôt). Par exemple, dans le cas de la TVA, le redevable est l’entreprise et le contribuable est le consommateur final (les ménages ainsi que les personnes morales non soumises à la TVA, telles les associations). ↩︎
- Cette taxe vise à faire en sorte que les GAFAM, « spécialistes » de l’optimisation fiscale, payent un minimum d’impôts en France. ↩︎
- Il existe des structures qui ne sont pas soumises à la TVA comme les entreprises individuelles relevant du statut de la micro-entreprise ou les associations. Dans ce cas, elles ne facturent pas la TVA, et la payent lors de leurs achats de la même façon que les ménages. ↩︎
- Les entreprises peuvent également contribuer volontairement à des régimes complémentaires de retraite. ↩︎
- En savoir plus sur les différents niveaux de taux sur le site de Fipeco. ↩︎
- En revanche, cela réduit la masse des sommes affectées au financement des dépenses sociales, dont le salarié est supposé être bénéficiaire à terme. Pour maintenir ces sommes, il faut bien prélever sur une autre assiette les montants en question. ↩︎
- Les comptes de la Nation 2023 . Dans le tableau 7.101 sur les comptes des SNF il s’agit des lignes Autres subventions sur la production (D39) et Aides à l’investissement à recevoir (D92). ↩︎
- Un capitalisme sous perfusion : Mesure, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises, IRES, 2022. ↩︎
- Les prélèvements obligatoires se sont élevés à 1264 milliards d’euros en 2022 en incluant les crédits d’impôts (23,5 milliards d’euros) et les cotisations sociales imputées (43,8 milliards d’euros). Une fois déduits ces deux postes les PO s’élèvent à 1194 milliards d’euros soit 45% du PIB. ↩︎
- Les impôts directs des SNF, des EI et des SF s’élèvent ici à 188 milliards. Les impôts directs des seules SNF s’élèvent à 142 milliards d’euros. ↩︎
- Lorsqu’ils ont des emplois à domicile. ↩︎
- Voir la fiche Les impôts sur la production, Fipeco, 2023. ↩︎
- Ex : la taxe sur les surfaces commerciales, la contribution des banques au mécanisme de garantie des dépôts, ou encore les taxes sur la création et l’usage des bureaux qui ne concerne que l’Ile de France. ↩︎
- La contribution sociale de solidarité (CSS) des entreprises ne touche que les sociétés réalisant plus de 19 millions d’euros de chiffre d’affaires. ↩︎
- La contribution des producteurs d’électricité en 2022 et 2023. ↩︎
- Article 219 du Code Général des Impôts ↩︎
- Pour plus de détails voir : La Brochure de la fiscalité française, Direction générale des Finances publiques, Octobre 2023 ou le Code Général des Impôts Art. 209 à 217 ↩︎
- Voir par exemple le rapport L’hétérogénéité des taux d’imposition implicites des profits en France : constats et facteurs explicatifs, Institut des Politiques Publiques, 2019, et Statistiques de l’impôt sur les sociétés, publication annuelle de l’OCDE. ↩︎
- Jusqu’en 1985, le taux marginal supérieur de l’IS était de 50%. Il est aujourd’hui de 25%. ↩︎
- Un paradis fiscal se définit par 4 caractéristiques : sa législation bancaire prescrit un secret bancaire absolu ; l’imposition des sociétés et des personnes fortunées est faible ou inexistante ; il est possible d’y créer des sociétés fictives (trusts anglo-saxons, sociétés panaméennes, fondations du Liechtenstein…) ; il y travaille des professionnels de haute qualification, fournissant des dispositifs off-shores clefs en main. ↩︎
- Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets ? Note du conseil d’analyse économique, 2019. ↩︎
- Les annexes donnent des informations visant à expliciter certains éléments des états financiers. Pour en savoir plus sur les principaux documents comptables, consultez notre module sur l’entreprise et sa comptabilité. ↩︎
- Si deux des trois limites suivantes sont dépassées : bilan supérieur à 4 millions d’euros ; chiffre d’affaires net supérieur à 8 millions d’euros ; nombre de salariés supérieur à 50. ↩︎
- Art. 19 Directive 2013/34/UE ↩︎
- Voir le Règlement sur l’application des normes comptables internationales (2002). Pour en savoir plus sur les normes IFRS voir notre module sur l’entreprise et sa comptabilité. ↩︎
- Ces éléments sont détaillés dans la Directive concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (2017). Voir la synthèse de la Directive. ↩︎
- Voir Le document d’enregistrement universel a remplacé le document de référence, Corevi, 2020 ; Guide d’élaboration des documents d’enregistrement universels, AMF, 2021. ↩︎
- parce qu’ils tentent de placer leur fonds en tenant compte des impacts globaux des entreprises et non pas de leurs seuls résultats financiers. ↩︎
- Les premières initiatives incitant les grandes entreprises à rendre des comptes au-delà du seul domaine financier viennent des institutions internationales avec, par exemple, le Global compact des Nations Unis ou les principes directeurs de l’OCDE pour les multinationales. ↩︎
- Par exemple, la Global Reporting Initiative, organisation à but non lucratif créée en 1997, le Climate Disclosure Project et Carbon4Finance sur les indicateurs climat et biodiversité. ↩︎
- Exemple : Vigeo (France) et Eiris (UK) ont fusionné puis ont été rachetées par Moodys ; Trucost (UK) a été racheté par S&P. ↩︎
- Élaborées par l’Efrag (European Financial Reporting Advisory Group) les normes ESRS ont plusieurs niveaux : les normes applicables à toutes les entreprises (tout-secteur), les normes sectorielles, les normes spécifiques aux PME cotées et les normes spécifiques à certaines sociétés non-européennes. ↩︎
- Celui-ci a pu être constitué en absorbant en 2022 la Value reporting Foundation (VRF) qui résultait elle-même de la fusion de deux organismes positionnés de longue date sur le sujet de reporting extra financier : le Sustainability Accounting Oversight Board et l’International Integrated Reporting Council. ↩︎
- Dans une tribune publiée sur Novethic en mai 2024 : L’ISSB s’attaque au capital humain et à la biodiversité… mais toujours pas aux intérêts financiers non durables ↩︎
- Agostino Vollero, Greenwashing. Foundations and emerging research on corporate sustainability and deceptive communication, Emerald Points, 2022. ↩︎
- Norman Kangun, Les Carlson et Stephen J. Grove. Environmental Advertising Claims: a preliminary investigation, Journal of public policy and marketing, 1991. ↩︎
- Voir par exemple : Lobbying contre le Nutri-score : « Une fois de plus, la santé publique est confrontée à des intérêts économiques et politiques », Le Monde (16/11/2021) ; La méthodologie de calcul du Nutri-score continue de favoriser l’artificiel au détriment du naturel, Le Monde (23/12/2021) ; Durcissement du Nutri-score : Se désengager ou améliorer leurs recettes, le dilemme des industriels, Novethic (14/01/2024). ↩︎
- Voir par exemple : La certification agricole « HVE » sous le feu d’une nouvelle critique, Le Monde (25/05/2021) ; Label HVE – Il trompe le consommateur, la justice doit le condamner, Que choisir (23/01/2023) ; « C’est mensonger » : le label gouvernemental HVE attaqué par les agriculteurs bio, Le Parisien (22/01/2023). ↩︎
- C’est le cas par exemple du logo « préserve la couche d’ozone » qu’on trouve sur les bombes aérosols : sans être mensonger ce logo fait croire à une action positive des entreprises concernées alors qu’elles se contentent de respecter la réglementation qui interdit l’utilisation de gaz destructeurs de la couche d’ozone. À noter que lesdits gaz ont souvent été remplacés par de puissants gaz à effet de serre et qui accentuent donc le changement climatique…. ↩︎
- Ce raisonnement est issu d’une part de la « loi de Say » selon laquelle l’offre crée sa propre demande, et d’autre part de la « théorie du ruissellement » selon laquelle l’accroissement des revenus des acteurs les plus aisés (entreprises ou individus) serait bénéfique à l’ensemble de la société. ↩︎
- Ce qui veut dire donner le (ou plus de) pouvoir de décision aux salariés ; c’est le cas des SCOP par exemple. ↩︎
- Ce qui veut dire donner le pouvoir de décision aux représentants de l’État. ↩︎
- Les méthodes relatives au bilan carbone conduisent à distinguer les impacts indirects selon l’intensité du contrôle juridique ou opérationnel. ↩︎
- Nous nous limitons ici aux indicateurs d’empreinte portant sur un impact. C’est pourquoi, nous n’évoquons pas l’empreinte écologique qui en agrège plusieurs. ↩︎
- La directive européenne sur le reporting de durabilité (la CRSD, dont nous parlons dans l’Essentiel 8) de 2022 a rendu obligatoire la réalisation de plan de transition sur les enjeux climatiques pour les grandes entreprises (voir les seuils sur la page Applicable depuis le 1er janvier 2024, qu’est-ce que la directive CSRD ? du site service-public.fr). ↩︎
- L’affaire Orpea a, par exemple, montré comment une entreprise dont l’objet social est de prendre soin des personnes âgées pouvait être profondément maltraitante ; dans le domaine de l’éducation la question du contenu des enseignements et de leur lien avec les limites planétaires est évidemment centrale. ↩︎
- L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Voir art.9 du Règlement sur la taxonomie (2020). ↩︎
- Art. 18 du Règlement sur la taxonomie (2020) « Les garanties minimales visées à l’article 3, point c), sont des procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en œuvre pour s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme. » ↩︎
- Christophe Sempels dir., L’entreprise à visée régénérative : fondamentaux et pionniers, Lumia, 2024. ↩︎
- Interview de François Grosse, Fer, cuivre, aluminium… Les ressources minières seront épuisées d’ici à 50 à 70 ans si nos consommations continuent de croître au rythme actuel, L’usine nouvelle (2023). Voir également son livre Croissance soutenable, la société au défi de l’économie circulaire, PUG, 2023. ↩︎
- Selon l’Insee, une firme multinationale est : « un groupe de sociétés ayant au moins une unité légale en France et une à l’étranger. » ↩︎
- Voir Bertrand Blancheton, Les firmes multinationales, Sciences économiques, Dunod, 2020. ↩︎
- Toutes ne sont pas multinationales. ↩︎
- Au total, ces 2000 entreprises enregistrent 50 800 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 4 400 milliards de dollars de bénéfices, 231 000 milliards de dollars d’actifs et 74 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour mémoire, le PIB mondial en 2023 est de l’ordre de 100 000 milliards de dollars. ↩︎
- Les spécialistes du sujet distinguent le degré de concentration d’un marché et le pouvoir de marché des acteurs dominants. Ce sont en effet deux notions distinctes et, en pratique, les autorités de la concurrence veillent surtout au pouvoir de marché. Mais il est indiscutable que la taille est un élément de pouvoir de marché. Pour aller plus loin voir le Résumé analytique de l’audition sur la concentration du marché – Réunion du 129e Comité de la concurrence OCDE (6-8 juin 2018). ↩︎
- Voir à ce sujet l’excellent livre de David Cayla, L’économie du réel, Deboeck, 2018. ↩︎
- Les cartels sont des oligopoles privés qui s’entendent sur les prix. ↩︎
- Voir Gérard Le Puill, Soustraire l’agriculture à la spéculation mondialisée, La Pensée, 2018. ↩︎
- Ces trois groupes industriels qui rassemblent plus de 1 400 marques de bière – Les Décodeurs, Le Monde (21/07/2017). ↩︎
- Voir la rubrique Exemples des violations des droits humains et les atteintes à l’environnement par des entreprises multinationales d’Amnesty International. ↩︎
- La compétition publicitaire entre L’Oréal et ses concurrents, VoxFi (17/04/2024) ↩︎
- C’est ce que documente notamment David Chavalarias concernant l’influence des réseaux sociaux dans son livre Toxic Data, Flammarion, 2022. ↩︎
- Voir par exemple Liam Downey, Eric Bonds, et Katherine Clark, Natural Resource Extraction, Armed Violence, and Environmental Degradation, Organization & environment, 2010. ↩︎
- Gouvernements, parlementaires et, en Europe, la Commission européenne, banques centrales, autorités de marché etc. En savoir plus dans le livre de Stéphane Horel, Lobbytomie, La Découverte, 2018. ↩︎
- Top 100 des lobbies européens, Agir pour l’environnement, 2024. ↩︎
- 10 lobbyistes par député : les institutions européennes sous le poids des lobbys, Novethic, 2024. ↩︎
- Voir Pourquoi le « Nobel d’économie » n’est pas un prix Nobel comme les autres – Les Décodeurs, Le Monde (09/10/2023) ↩︎
- Voir, pour le cas de la finance, le livre de Laurence Scialom, La fascination de l’ogre, Fayard, 2019. ↩︎
- Les compagnies pétrolières dépensent chaque année 200 millions de dollars en lobbying contre le climat, Libération, (28/05/2019) ; Exxon, Chevron, Shell… les majors pétrolières croulent sous les procès pour déni climatique, Novethic (16/05/24) ↩︎
- Voir Stellantis, la nouvelle étoile automobile qui pâlit déjà, analyse de l’Observatoire des multinationales, 2021. ↩︎
- Voir Présidentielle américaine : quand les milliards pleuvent sur les candidats, Les Échos (05/03/2024). En France le plafond pour les dépenses de campagne pour l’élection présidentielle, premier et second tours compris, est en 2024 de 23 millions d’euros. Les dons d’entreprise sont interdits et les dons des particuliers sont plafonnés à 4 600€. ↩︎
- Voir Elon Musk et le financier milliardaire Nelson Peltz vont-ils amener Wall Street et la Silicon Valley à Trump?, Novethic (03/06/2024). ↩︎
- Citons le cas de Nelson Peltz, évoqué dans l’article de Novethic, Elon Musk et le financier milliardaire Nelson Peltz vont-ils amener Wall Street et la Silicon Valley à Trump? (03/06/2024) : ce financier patron du fonds Trian « s’est fait connaitre par ses raids sur des entreprises dont il veut changer la direction pour augmenter leur rentabilité selon des critères qui ne laissent pas de place aux modèles durables. Il a gagné par exemple en 2022 la bataille d’Unilever et sa présence au conseil d’administration explique en grande partie « « le revirement stratégique de l’entreprise »« , ex-leader mondial de la RSE à l’époque où elle était dirigée par Paul Polman. ». ↩︎
- Voir Une multinationale contre Salvador Allende, Le Monde Diplomatique (août 2023). ↩︎
- Voir par exemple Le parquet financier demande un procès pour Vincent Bolloré pour corruption au Togo, La Croix (07/06/2024) ainsi que la « convention judiciaire d’intérêt public » signée par le groupe en 2021, reconnaissant des faits de corruption et de complicité d’abus de confiance, et le paiement d’une amende de 12 millions d’euros. ↩︎
- Voir quelques exemples sur le site de l’Observatoire des multinationales. ↩︎
- Voir la vidéo What Are the Costs of Corruption? publiée par la Banque Mondiale pour la journée internationale contre la corruption en 2022 et Paolo Mauro, Paulo Medas et Jean-Marc Fournier, Le coût de la corruption, Finances & Développement, FMI, 2019. ↩︎
- Voir le célèbre livre de John Le Carré, La Constance du jardinier, Seuil, 2001. ↩︎
- Le procès de Nestlé à Berne. La poudre de lait tue-t-elle les enfants du tiers-monde ?, Le Monde (25/11/1975). ↩︎
- Voir Le groupe Nestlé accusé d’ajouter du sucre dans le lait infantile vendu dans les pays pauvres, Libération (17/04/2024). ↩︎
- Voir « Antidouleurs : l’Amérique dévastée » : un scandale sanitaire hors du commun, Le Monde (21/02/2019). ↩︎
- La pollution et la dangerosité des PFAS a été révélée en grande partie grâce à un procès aux États-Unis en 2017, raconté dans le film Dark Waters (2019). Pour en savoir plus sur la pollution aux PFAS, voir cet article des Décodeurs du Monde : Les PFAS, une famille de 10 000 « polluants éternels » qui contaminent toute l’humanité (14/01/2025). Lire également la note de Corporate Europe Observatory Au cœur de la lutte des grandes entreprises contre la restriction de l’UE sur les PFAS, 2025, sur le lobby industriel pour affaiblir les régulations européennes. ↩︎
- Voir par exemple Eacop : le projet climaticide de TotalÉnergies en 6 chiffres, Reporterre (28/02/2023). ↩︎
- Voir Effondrement du Rana Plaza, la mort de l’industrie, Le Monde (26/05/2013). ↩︎
- La directive européenne CS3D sur le devoir de vigilance vise précisément à limiter ces risques et à obliger les multinationales à le contrôler dans l’ensemble de leur chaîne de valeur. Voir Le vote difficile de la directive sur le devoir de vigilance : les raisons de la discorde, Le club des juristes (18/03/2024) ↩︎
- Impliquée dans de nombreux scandales politiques, environnementaux et sociaux en particulier en Amérique Latine. Voir l’article Wikipedia United Fruit Company pour en savoir plus. ↩︎
- Voir le communiqué de presse de Earth Rights International qui accompagne les familles des victimes dans la procédure judiciaire. ↩︎
- Voir Directive CS3D : le devoir de vigilance voté, les directions achats des entreprises vont prendre du galon, Stéphane Ouvrard, The Conversation (06/05/2024). ↩︎
- Voir le livre de référence de Naomi Oreskes et Erik M.Conway, Les marchands de doute, Payot, 2014 ; et le livre du conseil scientifique de la FNH, Quelles sciences pour le monde à venir, Odile Jacob, 2020 ↩︎
- Analysé dans le livre de Naomi Oreskes et Erik M.Conway, Les marchands de doute, Payot, 2014. Voir aussi le film Thank you for smoking. ↩︎
- Difficiles à trouver tant ce sujet n’est pas étudié en tant que tel ! ↩︎
- ORPEA est un groupe privé d’EHPAD côté qui a fait l’objet d’une investigation approfondie de la part du journaliste Victor Castanet. Le 26 janvier 2022, son livre Les Fossoyeurs (mis à jour et complété en 2023) a déclenché le scandale Orpea. Il y révèle de nombreux cas de manques de soins, de maltraitance, de management « par la terreur », dans plusieurs établissements de ce groupe. Des malversations financières et détournement d’argent public ont aussi été révélés le tout conduisant à une action judiciaire menée contre les dirigeants. Le groupe a depuis été restructuré. Il est à noter que le groupe avait pourtant une note « ESG » suffisamment bonne pour qu’il soit présent dans des portefeuilles des investisseurs dits « responsables ». ↩︎
- Et si la santé guidait le monde. L’espérance de vie vaut mieux que la croissance, Eloi Laurent, Les liens qui libèrent, 2020. ↩︎
- La production est le plus souvent mesurée en valeur monétaire (on utilise alors la valeur ajoutée pour une entreprise ou le PIB pour un pays). Elle peut également être mesurée en grandeur physique (le nombre de voitures fabriquées par exemple) quand il s’agit d’analyser une entreprise ou un secteur de production. La quantité de travail est mesurée soit en nombre d’heures, soit en nombre d’emplois. ↩︎
- Les difficultés du groupe Boeing, par exemple, sont en grande partie imputables au fait d’avoir mis la valeur actionnariale au centre de sa stratégie au détriment des autres considérations. Voir Comment Boeing a favorisé la valeur actionnariale au détriment de la sécurité et de l’innovation, Novethic (07/05/24). ↩︎
- L’École de Chicago est une école de pensée regroupant un groupe informel d’économistes libéraux défenseurs du libre marché, de la théorie néoclassique de la formation des prix, de l’intervention minimum de l’État dans l’économie, de la neutralité de la monnaie etc. Son nom vient du département d’économie de l’université de Chicago où se trouvaient la majeur partie des économistes adhérent à ces idées. Son chef de file est Milton Friedman, l’un des économistes les plus influents du XXe siècle. ↩︎
- Michael C. Jensen, William H. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 1976. ↩︎
- Dans un conseil d’administration (CA) à mandat échelonné, l’échéance du mandat des administrateurs n’arrive pas au même moment pour tous. Cela offre une protection contre les prises de contrôle hostiles (ayant par exemple pour objectif d’augmenter les profits à court terme en supprimant les dépenses de long terme telles la R&D) puisque les nouveaux acquéreurs ne pourront pas remplacer la totalité du CA dès la première année. ↩︎
- La rémunération de Carlos Tavares est-elle économiquement justifiée ? Alternatives Économiques (24/04/24). ↩︎
- The Problem of Corporate Purpose, Governance studies, Lynn A. Stout, 2012. ↩︎
- Delaware General Corporation Law, §101. ↩︎
- Elle a également été adoptée sous d’autres formes dans les pays de tradition romano-germanique comme l’Allemagne ou la France. Voir La « Business Judgment Rule » américaine et son application en France et en Allemagne, Alexandre Rempp, 2019. Par ailleurs, dans la dernière version des Principes de gouvernances de l’OCDE et du G20 (2023) une règle équivalente est introduite : « Les administrateurs devraient être protégés contre d’éventuelles poursuites judiciaires si une décision a été prise de bonne foi et avec toute la diligence requise. » (Principe VA1). ↩︎
- La Cour Suprême de l’État du Delaware définit la business judgement law ainsi : « It is a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the company ». Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984). ↩︎
- Dans le jugement Revlon, Inc. v. MacAndrews Forbes Holdings, 506 A.2d 173 (Del. 1986), la Cour suprême du Delaware a jugé que les dirigeants étaient tenus d’agir en vue de maximiser la valeur des actions après que la décision de vendre une société a été prise. ↩︎
- Paramount Commc’ns, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140, 1150 (Del. 1990) ; Cet argument est ensuite réitéré dans de nombreux jugements par exemple Air Products v. Airgas, 16 A.3d 98 (Del. Ch. 2011) ; Sutton v. FedFirst Fin. Corp., 226 Md.App. 86 (2015). ↩︎
- Voir la Proposition 2 de 20 propositions pour réformer le capitalisme, Gaël Giraud et Cécile Renouard, Champs (2012) ; Le rôle sociétal de l’entreprise, Groupe de travail du Club des Juristes (2018) ; L’entreprise, objet d’intérêt collectif, Nicole Notat, Jean-Dominique Senard, rapport aux ministres de l’écologie et de l’économie, 2018. ↩︎
- The Problem of Corporate Purpose, Governance studies, Lynn A. Stout, 2012. ↩︎
- The Problem of Corporate Purpose, Governance studies, Lynn A. Stout, 2012. ↩︎
- La mondialisation n’est pas coupable. Vertus et limites du libre-échange, Paul Krugman, La Découverte, 2000 (pour l’édition française). Voir aussi La mondialisation, Alternatives Economiques (01/09/2017). ↩︎
- Les mesures-miroirs visent à conditionner l’accès au marché de l’UE au respect de certaines normes européennes essentielles en matière de durabilité, d’environnement, de santé, ou de bien-être animal notamment. Voir par exemple : Comment protéger nos agriculteurs et l’environnement ? FNH et Institut Veblen, 2021 et Les mesures miroirs, un outil essentiel de mise en œuvre du Pacte vert, Institut Veblen, 2023. ↩︎
- Pour une analyse de la construction et de l’évolution de la notion de RSE, voir Archie B. Carroll, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, 1999. Le pdf du working paper est téléchargeable sur ResearchGate. ↩︎
- L’École de Chicago est une école de pensée regroupant un groupe informel d’économistes libéraux défenseurs du libre marché, de la théorie néoclassique de la formation des prix, de l’intervention minimum de l’État dans l’économie, de la neutralité de la monnaie etc. Son nom vient du département d’économie de l’université de Chicago où se trouvaient la majeur partie des économistes adhérent à ces idées. Son chef de file est Milton Friedman, l’un des économistes les plus influents du XXe siècle. ↩︎
- Ce rapport a été produit par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, lancée par l’ONU en 1983. Gro Harlem Brundtland, Première ministre de Norvège, qui a dirigé sa rédaction, avait pour mission de définir un programme de coopération internationale et pluridisciplinaire sur les problèmes environnementaux. ↩︎
- Les domaines couverts, qui ont évolués au fil des mises à jour, sont aujourd’hui : la publication d’informations, les droits humains, l’emploi et relations professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l’intérêts des consommateurs, la science, la technologie et l’innovation. ↩︎
- Droits de l’homme, relations et conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, consommateurs, développement local. ↩︎
- Voir 2022-2023 Annual Report (p.21). ↩︎
- Morgane Tirel, RSE, ESG, compliance : éléments pour une distinction, Revue Lamy Droit des affaires, 2023. ↩︎
- Livre vert Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Communication de la Commission européenne (COM/2001/0366 final). ↩︎
- Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, Communication de la Commission européenne (COM/2011/0681 final). ↩︎
- Daniel Hurstel, Responsabilité sociétale ou revenu de l’actionnaire : faut-il choisir ? in Rapport Moral sur l’argent dans le monde, Association d’économie financière, 2013. ↩︎
- Guillaume Vuillemey, La responsabilité des actionnaires doit-elle toujours être limitée ?, Opinions & Débats n°19, Institut Louis Bachelier, 2020. ↩︎
- Des formes de responsabilité étendue ont persisté jusqu’à la fin du XIXe siècle voire jusqu’au premières décennies du XXe siècle (en Californie notamment). ↩︎
- Guillaume Vuillemey, La responsabilité des actionnaires doit-elle toujours être limitée ?, Opinions & Débats n°19, Institut Louis Bachelier, 2020. ↩︎
- Guillaume Vuillemey, La responsabilité des actionnaires doit-elle toujours être limitée ?, Opinions & Débats n°19, Institut Louis Bachelier, 2020. ↩︎
- Daniel Hurstel, Responsabilité sociétale ou revenu de l’actionnaire : faut-il choisir ? in Rapport Moral sur l’argent dans le monde, Association d’économie financière, 2013. ↩︎
- C’est Geneviève Férone qui a créé en 1997 la première agence de ce type, Arese, devenu Vigéo, puis Vigéo-Eiris, vendue en 2019 à Moody (une des trois grandes agences mondiales de notation financière, détenue en partie par Berkshire Hathaway (dirigé par le milliardaire Warren Buffett), et par le champion de la gestion passive Vanguard…). ↩︎
- Le livre Les fossoyeurs de Victor Castanet, paru chez Fayard début 2022, révèle des pratiques choquantes au sein de ce groupe d’EHPAD, faisant pourtant partie de fonds supposés ne retenir dans leur portefeuille que des entreprises aux bonnes pratiques ESG. Quelques mois après ce scandale, le groupe a dû se placer sous contrôle judiciaire pour restructurer sa dette. Voir Tarik Chakor, Jean-Christophe Vuattoux, Le scandale Orpea, un cas de « greatwashing » au détriment des patients… et des soignants, The Conversation (13/04/22) et Michelle van Weeren, Affaire Orpea : mais à quoi servent les notations ESG ? The Conversation (18/02/22) ↩︎
- Voir l’article Eacop : le projet climaticide de TotalÉnergies en 6 chiffres, Reporterre (28/02/23). ↩︎
- Andrew A. King, Comment and Replication: The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance, 2023. ↩︎
- Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, George Serafeim, The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance, Management Science, 2014. ↩︎
- Voir l’article de Frédérique Bardinet-Evraert, Comparaison de trois méthodologies ESG : les bases de données extra-financières fournissent-elles la même information ? Recherches en Sciences de Gestion, 2018. ↩︎
- Joshua D. Margolis, James P. Walsh, People and Profits? The Search for A Link Between A Company’s Social and Financial Performance, Psychology Press, 2001. ↩︎
- Professeur à ESCP Business School, communication personnelle. ↩︎
- Voir V. Audubert La liberté d’entreprendre et le Conseil constitutionnel : un principe réellement tout puissant ? Revue des droits de l’Homme, 2020. ↩︎
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – Art. 191 ↩︎
- La formulation du principe de précaution n’a pas changé depuis sa première version formulée en 1995 dans la loi Barnier. Il est aujourd’hui inscrit à l’article L110-1 du Code de l’environnement. ↩︎
- Voir Qui veut la « peau » du principe de précaution, Danièle Favari, Huffpost (21/11/2014). ↩︎
- Décision du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe », et Règlement 2021/695 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe ». ↩︎
- Voir The Innovation Principle, Paul Leaonard (Président de la task force ERF sur le principe de précaution) 2016. ↩︎
- Voir The ‘innovation principle’ trap ; Industries behind risky products push for backdoor to bypass EU safety rules, Corporate Europe Observatory (2018) et Appel pour le retrait du principe d’innovation d’Horizon Europe, Sciences citoyennes (2018). ↩︎
- Voir sur le blog d’Alain Grandjean, Les Chroniques de l’Anthropocène, cette note de lecture de l’écologue Pierre Henri Gouyon, sur le livre de Stéphane Foucart, Et le monde devint silencieux, Seuil, 2019. ↩︎
- Virologie : des accidents de laboratoires nombreux, des expériences de plus en plus dangereuses, Le Monde (07/11/2022). ↩︎
- Alain Grandjean est membre du Conseil scientifique de la FNH, et en a été président de 2019 à 2023. ↩︎
- Nous ne rentrerons pas ici dans les diverses possibilités en matière de préparation qui dépendent de nombreux paramètres (relatif à la situation familiale et managériale et à la fiscalité du pays) et passent en général par un recours à des avocats spécialistes de la question. ↩︎
- Les fonds de « capital privé » (private equity en anglais) ont en effet dans ce cas la capacité de lever des fonds et de recruter des managers. Il faut cependant que la rentabilité présente ou espérée soit suffisante par rapport aux attentes de ces investisseurs. ↩︎
- Israël, La nation startup, Les ressorts du miracle économique israélien, Dan Senor et Paul Singer, Editions Maxima (2011). ↩︎
- Pour comprendre ce qu’est l’EBITDA, voir notre module sur l’entreprise et sa comptabilité. ↩︎
- Voir le baromètre France Digitale 2023 pour le nombre de startups françaises, les chiffres mondiaux du nombre de « licornes » sur Wikipedia et pour la France consultez l’article Les 25 licornes françaises racontées en 4 graphiques, Maddyness (15/03/2022). ↩︎
- La France a un secteur logiciel très performant mais pas dans les grandes applications contrôlées par les GAFAM. ↩︎
- Voir par exemple le dossier d’Alternatives Économiques : Capitalisme d’influence : enquête sur les grands barons de l’économie française (Nov. 2023) ↩︎
- Sandra J. Diller et al. The positive connection between dark triad traits and leadership levels in self- and other-ratings, Leadersh Educ Personal Interdiscip, 2021 ; Sur le même thème voir aussi : Katarina Fritzon, Nathan Brooks, Simon Croom, Corporate Psychopathy: Investigating Destructive Personalities in the Workplace, 2021 ; Clive R. Boddy, Psychopathic leadership: A case study of a corporate psychopath CEO, Journal of Business Ethics, 2015 ; Emily Grijalva et al., Narcissism and leadership: A meta-analytic review of linear and nonlinear relationships, Personnel Psychology, 2013 ; Peter D. Harms et al., Leader development and the dark side of personality, The Leadership Quarterly, 2011 ; Cynthia Mathieu et al., A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction, Personality and Individual Differences, 2014. ↩︎
- Delroy L. Paulhus, Kevin M. Williams, The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, Journal of Research in Personality, 2002. ↩︎
- Les trois traits de la triade noir, le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme, ainsi que l’égoïsme, le désengagement moral, le sadisme, l’avidité, le droit psychologique, et l’égocentrisme. ↩︎
- Svetlana Holt et al., Cultivating Empathy: New Perspectives on Educating Business Leaders, The Journal of Values-Based Leadership, 2017. ↩︎
- Voir en particulier les travaux de Paul Piff et al. :Higher social class predicts increased unethical behavior, PNAS, 2012 ; Michael W. Kraus, Stéphane Côté, Dacher Keltner, Social Class, Contextualism, and Empathic Accuracy, Psychological Science, 2010 ; Joe C Magee, Power and social distance, Curr Opin Psychol, 2020. Paul Piff a vulgarisé dans un TedTalk donné en 2013 les conclusions de certains de ses travaux. ↩︎
- Quels leaders pour préserver notre humanité et faire face aux enjeux du 21ème siècle ? Enquête sur les imaginaires sociaux du leadership (PDF), Heart Leadership University et Eranos, 2023 ↩︎
- Enquête réalisée en ligne sur un échantillon de 1014 répondants représentatif de la population française des 18-30 ans. ↩︎
- Emma Watson, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Gandhi, Harry Potter, Charles De Gaulle. Notons que parmi les personnalités proposées, il n’y a qu’une femme, et qu’une personne non-blanche. ↩︎
- Marion Cohen, co-fondatrice de The Other Economy, est également responsable de la recherche chez Heart Leadership University (HLU). ↩︎
- Voir Le pouvoir du cœur – Étude d’impact et réflexions sur la transformation de la gouvernance des entreprises par l’intelligence du cœur, Prophil et HLU, 2023 ; Intelligence du cœur en action : freins et leviers, Stéphane La Branche et HLU, 2023. ↩︎
- Marion Cohen, co-fondatrice de The Other Economy, est également responsable de la recherche chez Heart Leadership University (HLU). ↩︎