Introduction
La monnaie joue un rôle central dans nos économies tout comme la politique monétaire qui, avec le budget, est l’un des deux piliers les plus importants des politiques économiques. Pour autant, les mécanismes monétaires sont encore mal compris. Ils sont l’objet de tabous dans le débat public mais surtout occasionnent de graves erreurs doctrinales chez les économistes de gauche ou de droite, qui peuvent irriguer les modèles macroéconomiques utilisés par les institutions les plus prestigieuses et fonder des politiques contreproductives, voire dangereuses.
De vrais progrès de compréhension peuvent néanmoins se constater, notamment depuis la mise au point bienvenue d’économistes de la Banque centrale d’Angleterre
L'essentiel
La monnaie est une institution sociale, source de vitalité économique
La monnaie ne se conçoit que dans un système socialement construit et créé par l'homme, qui repose sur la confiance que les membres d’une société lui accordent.
Elle n’est utile que si de nombreuses personnes et organisations l’utilisent et ont confiance dans les avantages qu’elle procure : son utilité croit à mesure de sa diffusion.
Un système monétaire ne peut fonctionner que s’il repose sur des institutions qui maintiennent la confiance. Parmi les institutions au cœur d'un système monétaire, on trouve :
- la banque centrale ;
- le système bancaire privé ;
- la solidité de la fiscalité et du système de collecte de l'impôt ;
- les systèmes judiciaire et pénal (pour l'exécution des contrats) ;
- le système comptable, et notamment la comptabilité en partie double (pour la tenue des comptes d'actif et de passif).
On distingue traditionnellement trois fonctions de la monnaie :
- Outil d’échange des biens et services : la monnaie est le seul objet économique qui puisse être instantanément échangé contre n’importe quel autre. Elle est donc en premier lieu un moyen de paiement, et ne peut être refusée en tant que telle quand elle a cours légal (ou forcé).
- Unité de compte : la monnaie permet d’exprimer en une seule unité la valeur des biens et services.
- Réserve de valeur : elle permet de différer un achat ou un investissement dans le temps. Pour reprendre l’expression de Keynes, la monnaie établit « un lien entre le passé et l’avenir ». Cette troisième fonction explique que la monnaie peut être désirée pour elle-même et non pour être échangée contre des biens et services. C’est le concept de « préférence pour la liquidité », introduit par Keynes : la possession de la monnaie peut parfois apparaître préférable à son utilisation pour n’importe qu’elle autre action économique.
La monnaie a connu au cours des derniers siècles un lent processus d’abstraction
D’abord matérialisée par des métaux précieux (argent et or), le lien entre étalon physique et masse monétaire s’est progressivement distendu. Depuis la fin du système de Bretton Woods et la suspension de la convertibilité du dollar en or par le président américain Nixon en 1971, la monnaie ne repose plus sur aucun étalon physique. Il n’est plus possible de convertir une unité de monnaie en un métal précieux selon un taux prédéfini. La monnaie est aujourd’hui entièrement dématérialisée
Elle s’exprime donc par des signes monétaires qui peuvent prendre différentes formes :
- Les pièces et les billets viennent immédiatement à l’esprit : c’est la monnaie fiduciaire.
- Mais la majeure partie de la monnaie prend, actuellement, la forme d’écritures sur les comptes bancaires (qu’il s’agisse de comptes courants ou de livrets d’épargne, voire de titres financiers) : c’est la monnaie scripturale.
Il existe également une « monnaie scripturale de banque centrale ». Cependant, celle-ci ne s’échange qu’entre les titulaires de comptes ouverts à la banque centrale, à savoir les banques secondaires et le Trésor (voir l’Essentiel 2 à 4). Elle n’est pas utilisée par les agents économiques non bancaires. Elle ne circule pas dans l’économie.
Le rôle économique de la monnaie s’exprime à un double niveau :
- Au niveau microéconomique, elle est utilisée par les agents économiques comme moyen d’échange et d’accumulation privée ;
- Au niveau macroéconomique, la politique monétaire a des effets sur l’activité et sur les prix.
C’est en regardant la répartition de la masse monétaire, son évolution dans le temps et les actifs dans lesquels elle se cristallise (crédits à la consommation à l’investissement, crédit à l’immobilier, actifs financiers) qu’on peut comprendre ce qu’une société fait de son argent.
Selon certains économistes, la monnaie est neutre
En réalité, la monnaie a bien un effet sur l’activité elle-même, ce qu’illustre bien la corrélation entre PIB et masse monétaire (voir encadré ci-dessous).
Masse monétaire et PIB
La quantité de monnaie en circulation est déterminante pour le développement économique.
Il existe une corrélation entre masse monétaire et PIB
Mais une même unité monétaire peut servir à plusieurs échanges ou au contraire être épargnée et ne servir à aucun achat, ce qui se traduit au niveau global par la notion de vitesse de circulation de la monnaie. Dès lors, l’ensemble des revenus des différents acteurs économiques est fonction de la quantité de monnaie disponible et de cette vitesse de circulation qui n’est pas constante. Par ailleurs, les échanges avec l’extérieur peuvent augmenter ou diminuer la masse monétaire en fonction de l'évolution des différents comptes de la balance des paiements du pays concerné.
Cela étant, la corrélation entre masse monétaire et PIB se vérifie en tendance : ils évoluent presque toujours dans la même direction. Quand la masse monétaire augmente, le PIB augmente et inversement. On peut donc en déduire que l’augmentation de la masse monétaire n’est pas systématiquement « transformée » en hausse des prix.
La monnaie est un catalyseur qui rend possible les transactions, et le développement économique qui les accompagne. C’est ce que montre l’histoire du chèque sans provision dans lequel un faux billet permet de rembourser de « vraies » dettes et de stimuler l’activité économique.
La création monétaire provient aujourd’hui principalement de l’activité de crédit des banques secondaires (voir l’Essentiel 4 dans ce module) : elle répond donc à une demande de financement et crée un pouvoir d’achat nouveau. Celui-ci permet de réaliser des investissements, des projets qui sinon ne pourraient voir le jour.
La création monétaire (privée ou publique) peut dans certaines circonstances avoir un effet sur les prix. Si la quantité de monnaie dans l’économie s’accroit mais qu’elle n’est pas utilisée pour générer de nouvelles productions, cela se manifestera par de l’inflation, c'est-à-dire la hausse des prix des biens et services
Par ailleurs, se pose également la question du type d’activité. La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre est un des enjeux majeurs de ce siècle (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions). Si 90% des flux de crédit bancaires vers le secteur de l’énergie financent les énergies fossiles, la création monétaire ne participe pas d’une amélioration de la soutenabilité de notre société.
Tout autant que la question du volume de la masse monétaire, se pose donc également celle de son allocation. Qui (quelles institutions) crée la monnaie ? Qui décide de l’allouer à telle ou telle activité ? De quels outils une société se dote-t-elle pour faire en sorte que la création monétaire réponde aux besoins non seulement de la sphère marchande, mais aussi aux besoins sociaux et aux impératifs écologiques ?
On le voit, toutes ces questions ne sont pas techniques : les débats autour de la monnaie traduisent des enjeux de pouvoir. La monnaie est fondamentalement un bien commun mais selon la configuration institutionnelle qui préside à sa création et à son allocation elle peut être mise au service d’intérêts privés.
 Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
Le cadre institutionnel de la monnaie n’est pas immuable
Comme noté dans la partie précédente, la monnaie est fondée sur la confiance de ceux qui l’utilisent. Si l’acceptation d’une monnaie par le corps social ne se résume pas à sa seule action, la puissance publique
Enfin, le système monétaire en vigueur dans un pays (ou dans une zone monétaire) est le fruit d’une histoire et des spécificités propres à ce pays (ou cette zone). Il s’inscrit également dans un cadre international dans lequel toutes les monnaies n’ont pas le même poids (voir l’Essentiel 10 à 12 dans ce module).
Les banques centrales, clefs de voûte du système monétaire
La banque centrale d'un pays (ou d’une zone) est une institution
Notons, tout d’abord, que la relation entre Etats et banques centrales a beaucoup évolué à travers l’histoire. Les années 1930 et l’après Seconde Guerre mondiale sont marquées par la généralisation du modèle de banque centrale publique, au service des objectifs définis par l’Etat. Aujourd’hui, c’est le modèle de la banque centrale indépendante qui domine (même si elle reste le plus souvent à capitaux publics).
Comme le note Laurence Scialom, « les pratiques des banques centrales et leur sphère d’action ont été très malléables au cours du temps, s’adaptant en permanence au contexte macroéconomique, institutionnel et politique »
- unifier et préserver le système de paiement ;
- assurer la stabilité financière. Ce rôle est double. D’une part, il concerne l’action curative du prêteur en dernier ressort et du teneur de marché en dernier ressort et d’autre part, il recouvre des actions préventives aujourd’hui qualifiées de régulation prudentielle ;
- maintenir la stabilité monétaire et la valeur de la monnaie soit à travers un objectif de change, soit sous forme d’un objectif d’inflation ;
- soutenir les besoins de financement des États en période de crise notamment en temps de guerre.
Ces objectifs ne sont pas apparus simultanément au cours de l’histoire et leur poids relatif diffère selon les périodes et les pays (ou zone monétaire). Ainsi, alors que les premières banques centrales sont nées en Europe au XVII° siècle pour soutenir les besoins financiers des Etats, cette fonction est aujourd’hui largement contestée dans la plupart des grandes économies (voire interdite dans le cas de l’Union européenne), à l’exception notable de la Chine.
Les banques secondaires sont responsables de la création monétaire
Les banques secondaires sont des sociétés privées ou publiques qui ont le pouvoir de créer la monnaie qui circule dans l’économie (voir l’Essentiel 4 dans ce module), en particulier lorsqu’elles accordent des crédits. Elles sont placées sous l’égide de la banque centrale (aussi appelée banque de premier rang) auprès de laquelle elles disposent d’un compte.
A noter que le terme banque recouvre de nombreuses fonctions. Banque de détail, de dépôt, banque commerciale, banque d’affaires, banque d’investissement et de financement… il existe de très nombreuses façons de nommer les banques selon leurs clients ou le type de métier qu’elles exercent. La capacité de création monétaire est liée aux activités dites de « banque de détail » (la gestion des moyens de paiement, la collecte de dépôts et l’octroi de crédits).
Depuis les années 70, le mouvement de dérégulation bancaire s’est notamment manifesté par un effacement des frontières entre leurs différents métiers et par une concentration du secteur menant à l’émergence de méga-banques dont certaines sont dites « universelles », dans le sens où elles exercent à la fois des activités de détail et d’autres activités. Dans ce module, nous appelons « banques secondaires » celles qui ont le pouvoir de création monétaire, quels que soient leur taille et leurs autres domaines d’activité.
La plupart des systèmes monétaires actuels sont les héritiers des politiques néolibérales de la fin des années 1970, inspirées par les théories monétaristes
A partir de la fin des années 1970, l’arrivée au pouvoir d’un personnel politique acquis aux idées néolibérales se manifeste par une évolution du rôle des banques centrales dans la plupart des grandes économies, qu’on peut résumer ainsi :
- Une focalisation sur l’objectif de stabilité monétaire et en particulier sur le contrôle de l’inflation, perçue comme le risque économique majeur.
C’est l’application des recommandations des monétaristes pour lesquels la monnaie n’a d’effet que sur le niveau général des prix, et l’inflation est toujours un phénomène lié à une trop grande quantité de monnaie en circulation dans l’économie. La mission principale des banques centrales doit donc être le maintien de la stabilité des prix à partir d’un contrôle attentif de l’évolution de la masse monétaire grâce à l’outil du taux d’intérêt.
- La généralisation du modèle des banques centrales indépendantes, vu comme la solution institutionnelle au supposé biais inflationniste des décideurs politiques qui, pour des raisons électoralistes, ne seraient pas en mesure de maintenir de façon crédible des objectifs d’inflation.
notemon7
Cette séparation fonctionnelle entre Etats et banques centrales (qui demeurent cependant pour la plupart à capitaux publics) se manifeste en particulier par l’interdiction (en pratique ou en droit dans le cas de l’UE) du financement direct des Etats (dit autrement de l’accès direct des Etats aux prêts ou avances de la banque centrale, qui peut cependant acheter, sur le marché secondaire, des titres de créances publiques - voir les explications sur le quantitative easing dans ce module).
Ces principes deviennent le cadre commun de fonctionnement des banques centrales des pays développés même s’il subsiste des différences. Ils sont poussés à l’extrême dans la zone euro puisqu’ils ont été traduits dans les traités de l’Union européenne et dans les statuts de la Banque centrale européenne (BCE), créée à l’apogée des thèses monétaristes. Ces principes ne sont cependant pas mis en œuvre partout : le système est, par exemple, très différent, beaucoup plus étatisé et administré, en Chine
Les évolutions récentes : stabilité financière et risques climatiques
La crise financière de la fin des années 2000 s’est traduite par plusieurs évolutions récentes.
- La question de la stabilité financière est revenue au cœur du mandat des banques centrales.
Cette grande fonction historique des banques centrales avait été évacuée pendant la période précédente et déléguée à des autorités de régulation financière indépendantes. Le consensus alors dominant était que la stabilité des prix suffisait à assurer la stabilité financière
- Les banques centrales ont élargi leur palette d’interventions à des mesures dites « non conventionnelles » dont le quantitative easing qui se manifeste par l’achat par les banques centrales de titres de dette publique (voir notre fiche sur le quantitative easing
ficheqe ou les explications sur ce sujet dans ce module). - Enfin, la question climatique a également fait son entrée dans le champ d’action des banques centrales depuis le célèbre discours de Mark Carney sur la « tragédie des horizons » (2015). La communauté financière a alors commencé à prendre la mesure des risques systémiques que le réchauffement climatique fait peser à la stabilité financière (voir l'Essentiel 7 dans ce module).
Ces évolutions font dire à certains auteurs que nous sommes à l’aube d’une nouvelle évolution de la doctrine des banques centrales.
 Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
La masse monétaire n’a cessé d’augmenter
Il est tout d’abord important de bien comprendre la différence entre base monétaire et masse monétaire.
La base monétaire (notée M0) est constituée de la monnaie créée par la banque centrale, dite « monnaie centrale »
Elle comprend :
- la monnaie centrale scripturale, c'est-à-dire les réserves que les banques secondaires détiennent sur leur compte à la banque centrale (auxquelles s’ajoutent les facilités de dépôt
notemon11 ). Cette monnaie est créée par la banque centrale pour répondre aux besoins de liquidités des banques secondaires (voir dans l'Essentiel concerné pourquoi les banques secondaires en ont besoin). Elle ne circule pas dans l’économie : elle ne sert qu’aux échanges entre les banques ou entre chaque banque et la banque centrale ; - les billets en circulation dans l’économie : la banque centrale a le monopole de l’émission de billets qu’elle fournit aux banques secondaires pour que celles-ci puissent répondre aux demandes de retrait de leurs clients.
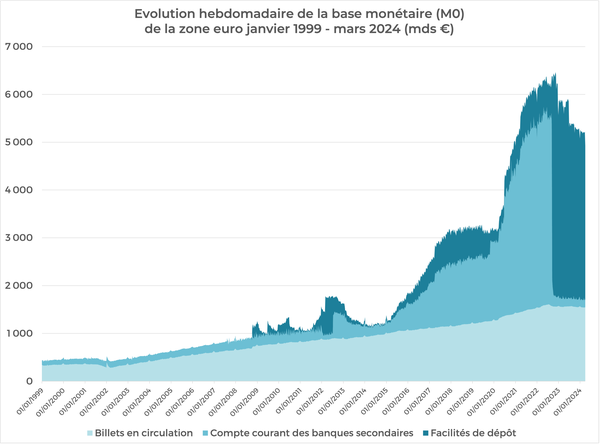
Comme on peut le constater sur ce graphique, la base monétaire n'a cessé d'augmenter depuis 1999 avec des accélérations à la suite des crises (crise financière de 2007-2008, crise de la zone euro dans les années 2010 et crise de la pandémie COVID en 2020).
La masse monétaire désigne la quantité totale de monnaie en circulation dans une économie
Comme on l’a vu dans L'essentiel 1 de ce module, la monnaie est composée de différents instruments : les billets et pièces mais aussi les écritures comptables inscrites sur les comptes courants des acteurs économiques. Au sens strict la monnaie est un moyen qui permet de faire un paiement ou d’éteindre une dette. La monnaie légale ne peut être refusée par un créancier.
Mais les agents économiques disposent aussi d’autres comptes bancaires et de comptes ou livrets d’épargne disponibles plus ou moins facilement et rapidement (plus ou moins liquides). Par exemple, la monnaie placée sur des livrets d’épargne n’est pas directement utilisable pour payer une facture : il faut à minima faire un transfert préalable vers le compte courant, voire demander une autorisation à votre banque (et éventuellement payer des frais de sortie) avant de pouvoir l’utiliser.
C’est pourquoi, la monnaie est parfois considérée comme un continuum d’instruments plus ou moins liquides. Cette vision est liée au point de vue monétariste selon lequel il est essentiel de connaître (pour éventuellement la limiter) la quantité de moyens de paiement en circulation. Un compte sur livret ou un titre de SICAV transférable sans frais et avec un délai nul ou court sont alors vus comme de la quasi-monnaie. Il est d’ailleurs exact que selon le niveau des taux d’intérêt le comportement de placement varie. Il est donc clair qu’il y a un continuum entre les comptes courants et les instruments de placement très liquides.
Dans cette logique, les banques centrales divisent la masse monétaire en agrégats qui s’imbriquent comme des poupées russes et qui vont des instruments les plus liquides vers les moins liquides
La Banque centrale européenne distingue et suit trois agrégats monétaires imbriqués : M1, M2 et M3.
- M1 est l’agrégat le plus étroit : il désigne la monnaie au sens strict c'est-à-dire celle qui est immédiatement disponible pour effectuer des règlements (donc les pièces et billets en circulation et les sommes disponibles sur les comptes courants).
- M3 est l’agrégat le plus large.
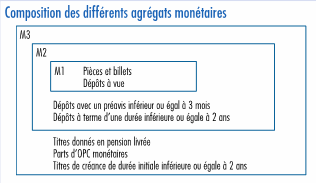
Comme on peut le constater sur le graphique suivant, quels que soient les agrégats considérés, la masse monétaire de la zone euro n’a cessé d’augmenter depuis des décennies. C’est également ce qu’on peut constater pour les autres grandes zones monétaires : Etats-Unis, Japon, Chine etc.
Evolution de la masse monétaire de la zone euro (1980-2022) en milliards d'euros
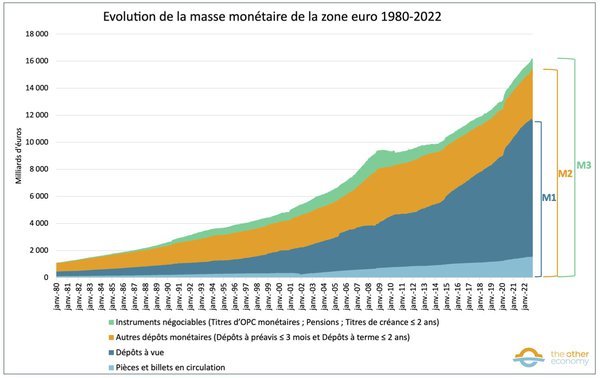
Il y a donc bien eu création monétaire en continu et cette création monétaire est principalement le fait des banques de second rang (voir l'Essentiel 4 dans ce module).
Notons, enfin, que la comparaison entre l’évolution de la base monétaire et de la masse monétaire permet de constater que la relation entre les deux n’est pas constante. Cela vient infirmer dans les faits la théorie du multiplicateur monétaire selon laquelle la monnaie créée est un multiple de la base monétaire.
La monnaie en circulation dans l’économie est créée par les banques secondaires
Comme l’explique un document pédagogique de la Banque de France, les jeux d’écriture sur les comptes bancaires lors des opérations de crédits sont à l’origine de la création monétaire, et plus concrètement de la création de monnaie scripturale.
Les crédits font les dépôts
Toutes les entreprises, y compris les banques, possèdent un bilan comptable et financier qui est une sorte de photographie à un instant précis de ce qu’elles possèdent (c’est l’actif) et de ce qu’elles doivent (c’est le passif).
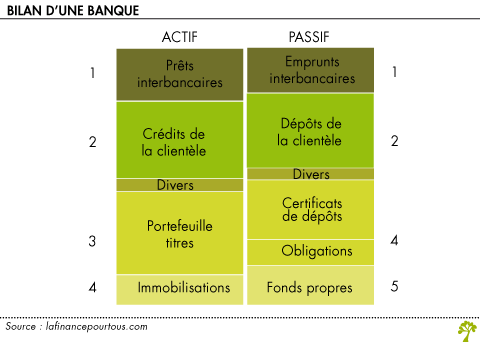
Quand une banque secondaire accorde un crédit de 100k€ à un agent économique (par exemple un particulier ou une entreprise), elle inscrit ces 100k€ simultanément à son actif (c’est un crédit que la banque possède sur son client) et à son passif via un dépôt sur le compte courant de son client. On dit ainsi que « les crédits font les dépôts ».
La monnaie scripturale ainsi créée peut ensuite être convertie en monnaie fiduciaire (en billets de banque) par simple retrait au guichet de la banque.
Cette monnaie est détruite quand le client rembourse son crédit. Pour que la masse monétaire augmente, il faut que le volume des crédits accordés soit supérieur au volume des crédits remboursés. En définitive, ce sont bien les banques secondaires qui, par le biais des crédits accordés à des agents économiques, « créent » la monnaie.
Quid des billets de banque ?
Comme noté dans l’Essentiel 3, la banque centrale a le monopole de l’émission des billets de banques (la monnaie fiduciaire). Cependant, cette « fabrication » des billets n’est pas à l’origine de la création monétaire : elle en est la conséquence.
La quantité de billets en circulation dans une économie dépend de la préférence des agents pour détenir leur argent sous cette forme plutôt que sur leur compte bancaire. Dans la zone euro, les billets représentaient fin 2020 environ 13% de la masse monétaire M1
La monnaie est donc d’abord créée sous forme scripturale puis convertie en billets via les retraits des agents économiques. Ce n’est donc pas une décision de la banque centrale qui motive la mise en circulation de nouveaux billets, mais la demande de crédit et la volonté des agents de disposer de leur argent sous cette forme. Si plus personne ne demandait à disposer de billets, le volume de la masse monétaire ne changerait pas : seule changerait la forme de la monnaie (qui serait alors entièrement sous forme scripturale). C’est le gonflement de la masse monétaire dans son ensemble qui implique le gonflement de la quantité de billets et non l’inverse.
Il existe plusieurs autres cas de création monétaire
Lorsque l’on dépose une devise au guichet d’une banque, la banque crée des euros pour acheter cette devise et symétriquement, lorsqu’un particulier achète une devise, les euros qui servent à cet achat sont détruits.
Plus généralement, comme l’écrit Jean Bayard, toute augmentation de l’actif bancaire concourt à une création monétaire
« La banque monétise ses dépenses (pertes) et démonétise ses recettes (profits) (…). Ainsi, par exemple, elle crée de la monnaie quand elle verse les salaires de son personnel en créditant leurs comptes et elle détruit de la monnaie lorsqu’elle débite les comptes de ses clients des intérêts, agios et autres frais qui lui sont dus. Bref, la banque monétise chaque fois qu'elle achète et qu'elle paie et démonétise chaque fois qu'elle vend et qu'elle encaisse (...).» Ainsi, une banque fait des chèques « sur elle-même » quand elle règle une dépense. Quand elle fait la paie
Ce pouvoir très particulier de création monétaire n’est octroyé qu’aux établissements bancaires au sens strict
L’essentiel est de comprendre que les banques commerciales ne se contentent donc pas de reprêter les dépôts qu’elles collectent (voir l'idée reçue 3 de ce module), ni de transférer de l’argent qu’elles auraient reçu de la banque centrale : elles sont à l’origine de la « production » de la monnaie scripturale, qui constitue l’essentiel de la masse monétaire.
Distinguer le crédit mutuel du crédit créateur de monnaie
Il y a deux types de crédit.
Le crédit mutuel est celui à travers lequel Pierre prête une somme d’argent à Paul. C’est également celui où un établissement financier non bancaire prête à un agent économique de l’argent qui correspond à une épargne préalablement constituée. Ce faisant, il ne crée pas de pouvoir d’achat. Il ne fait que le transférer sous forme de monnaie.
Le crédit créateur de monnaie, donc de pouvoir d’achat, est celui que fait une banque en prêtant un argent créé ex nihilo. Ce crédit est temporaire et l’on pourrait croire que son remboursement (donc la destruction de monnaie) reconduit à la situation initiale. Il n’en est rien. En effet, à vitesse de circulation de la monnaie constante ou croissante, s’il y a plus de crédits nouveaux que de remboursements de crédits anciens, du pouvoir d’achat est créé. C’est généralement le cas quand la conjoncture économique est bonne. C’est l’inverse en période de dépression : il peut y avoir plus de remboursements de crédits que de crédits nouveaux, ralentissement de la vitesse de circulation monétaire et, par conséquent, contraction du pouvoir d’achat.
 Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
Le pouvoir de création monétaire doit être encadré par des dispositifs de régulation publique
Comme on l’a vu dans à l'essentiel 1 de ce module, la création monétaire est structurante pour l’activité économique. L’activité bancaire n’est donc pas une activité économique comme les autres : elle est au service des autres activités, elle doit contribuer aux besoins de la société dans son ensemble. Ce pouvoir relève ainsi de l’intérêt général, du bien public et non d’intérêts privés. En effet, mal utilisée, la création monétaire peut avoir des effets néfastes sur la société et l’économie. Elle confère de plus un pouvoir démesuré aux banques. Pour des raisons démocratiques évidentes, il ne peut être confié sans contrôle au secteur privé. Comme nous le verrons dans l'essentiel 6 de ce module, il existe bien aujourd’hui des modalités de contrôle de la création monétaire privée mais elles sont trop limitées.
Le volume et l’allocation de la création monétaire ont des impacts majeurs sur l’économie et la société
On a déjà vu que le volume de la création monétaire est déterminant pour l’activité économique. Née pour fournir un crédit, donc liée à un besoin de financement, la création monétaire peut avoir un effet sur le volume de l’activité, accrue par ce crédit. A l’inverse, une insuffisance de création monétaire (ou un excès de destruction monétaire) peut conduire à une récession, voire une crise économique, risque majeur qu’il est souhaitable d’endiguer. En résumé la monnaie « endogène » créée via le crédit a un effet procyclique (amplificateur du cycle économique).
L’importance de la création monétaire ne se limite cependant pas à son volume, mais aussi à son allocation. Les crédits sont déterminés par la demande des agents économiques et par les perspectives de profitabilité que les banques en retirent. Cela ne garantit aucunement qu’ils soient dirigés vers les activités les plus socialement utiles, en particulier si ces activités ont une valeur ajoutée sociale ou écologique importante mais un rendement faible
C’est ce qui s’est passé au cours des dernières décennies. Le crédit est ainsi passé au niveau mondial, d’environ 73% du PIB au début des années 80 à près de 130% avant la crise de 2007-2008
L’exemple de l’immobilier
A partir de la fin des années 1970, à la suite du mouvement de dérégulation bancaire, les banques ont concentré leur activité de prêt sur le crédit immobilier notamment parce qu’il présente des caractéristiques attractives : l’analyse du risque de crédit est moins compliquée que dans d’autres secteurs (les prêts aux PME par exemple). Le crédit est en général garanti par une hypothèque sur le bien acquis ce qui rassure le prêteur, car il dispose d’une contrepartie de valeur, en cas de non-remboursement.
Une étude parue en 2014
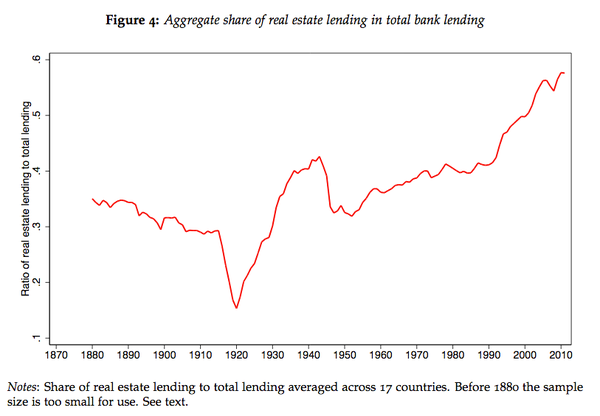
Cette évolution est problématique à plusieurs titres :
D’une part, les crédits à l’immobilier se font au moins en partie au détriment d’autres activités. Par exemple, fin 2019 en France, les crédits immobiliers représentaient environ 51% des crédits à la clientèle non financière résidente en France ; les crédits à l’investissement des entreprises seulement 17%
D’autre part, le crédit immobilier finance, pour l’essentiel
Ce mécanisme repose donc sur une croissance de l’endettement qui en phase haussière du cycle n’apparaît pas problématique : les emprunteurs semblent solvables puisque la valeur des biens acquis par endettement augmente (ils pourraient donc toujours les revendre pour rembourser). Les problèmes surviennent justement lorsque certains emprunteurs ne peuvent plus assurer les remboursements : ils commencent alors à vendre, ce qui provoque une baisse des prix et finit par faire éclater la bulle. Le surendettement devient alors manifeste puisque le prix des biens (ou des actifs) sous-jacents diminue.
Le risque est fort d’entrer alors dans une spirale déflationniste où les efforts de désendettement contribuent au contraire à accroitre la proportion de la dette par rapport au revenu ou au patrimoine. C’est ce qu’on appelle la déflation par la dette, phénomène identifié par Irving Fisher dès les années 1930
C’est ce qui s’est passé au Japon avec l’éclatement de la bulle du crédit immobilier dans les années 1990, qui a plongé le pays dans une déflation dont il n’est toujours pas complètement sorti. Et c’est bien sûr l’éclatement de la bulle des crédits subprimes
Le rythme et l’allocation de la création monétaire sont donc des enjeux d’intérêt général, qui ne concernent pas seulement le secteur financier : quand les bulles spéculatives éclatent, les conséquences affectent un grand nombre d’acteurs économiques et viennent exacerber pauvreté et inégalités.
 Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
Le risque d’effondrement du système financier
La possibilité pour une banque de prêter de l’argent créé ex nihilo fait qu’elle peut se trouver confrontée à une crise de liquidités en deux occasions principalement. D’une part, elle peut subir une « course aux guichets » (bank run en anglais), à l’occasion d’une perte de confiance de ses clients, se traduisant par une panique bancaire. Ses clients vont chercher à retirer des billets de banque (la monnaie légale) mais elle n’en dispose jamais suffisamment pour faire face à toutes ces demandes. Le dernier épisode spectaculaire a été celui de la banque Northern Rock en 2007.
D’autre part, une banque peut se retrouver dans l’incapacité de faire face à ses engagements par rapport à une de ses consœurs ou ne plus lui inspirer confiance, ce qui peut également provoquer une faillite. Une faillite bancaire peut en entraîner d’autres du fait des liens entre banques et entraîner des difficultés pour les entreprises ou les ménages qui en sont les créanciers et peuvent perdre leurs avoirs (les comptes courants et l’épargne déposée). C’est pour cela qu’une garantie publique des dépôts a été mise en place en France
Ces risques, liés strictement à la création monétaire, se trouvent accrus depuis la libéralisation financière initiée à la fin des années 1970. Le système financier international se caractérise notamment par l’existence d’établissements de taille de plus en plus importante ainsi que par une interconnexion croissante entre les différents acteurs. Au sein de ce système, les banques occupent une place déterminante. D’après le Conseil de Stabilité Financière, le total des actifs financiers mondiaux s’élevait fin 2018 à près de 379 000 milliards de dollars (soit l’équivalent de 4,5 années de PIB).
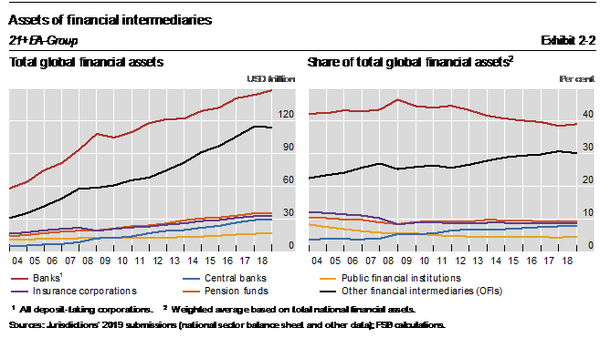
La politique monétaire et ses limites
Comme on l’a vu dans l'essentiel 2 de ce module, le mandat et les outils des banques centrales ont évolué avec le temps et sont différents selon les pays ou les zones monétaires. Nous nous concentrons ici sur les outils que mobilisent aujourd’hui les banques centrales des économies avancées (à l’exception notable de la Chine
Quels sont les outils de politique monétaire à disposition des banques centrales ?
La banque centrale est la « banque des banques » : de la même façon que chaque agent économique a un compte dans une institution bancaire, chaque banque secondaire a un compte à la banque centrale. Celui-ci est alimenté en monnaie créée par la banque centrale (dite monnaie centrale
Pourquoi les banques ont-elles besoin de monnaie centrale ?
Tout d’abord, les banques ont besoin de se procurer des billets pour faire face aux demandes de retraits de leurs clients (voir l'Essentiel 4 dans ce module). Ensuite, certaines banques centrales
Enfin et surtout, les banques ont besoin de monnaie centrale pour régler leurs paiements avec les autres banques, consécutifs aux transactions entre leurs clients. S’il n’y avait qu’une seule banque, les millions de transactions quotidiennes
Quand une banque a besoin de monnaie centrale, elle peut :
- soit en emprunter à une autre banque sur le marché interbancaire
- soit en emprunter directement à la banque centrale.
Les prêts de la banque centrale, appelés opérations de refinancement, sont des prêts de très court terme (24h, une semaine ou quelques mois)
Ce dernier constituait le principal outil de politique monétaire avant la crise de 2007-2008. Il influence, en effet, l’ensemble des autres taux d’intérêts : ceux du marché interbancaires
En contrepartie de leurs emprunts à la banque centrale, les banques doivent également céder temporairement (on dit "mettre en pension") des actifs financiers qui servent de garanties au prêt de la banque centrale (un peu comme une hypothèque sur une maison). Ces actifs, appelés « collatéraux », doivent respecter des critères de qualité (financière) minimum, par exemple une note satisfaisante attribuée par les agences de notation.
La banque centrale peut aussi fournir de la monnaie centrale en achetant des titres de dette détenus par les banques. Ces deux outils (prêts et achats de titres) étaient utilisés différemment par les différentes grandes banques centrales : la BCE privilégiant l’outil prêt, la Fed ou la Bank of Japan ayant davantage recours à l’achat de titres.
La crise financière de 2007-2008 et les outils dits non « conventionnels »
Face à la crise financière de 2008, les banques centrales ont largement utilisé les outils conventionnels. Dans la zone euro, par exemple, le taux de réserves obligatoires est de 1% depuis 2012. La BCE a également régulièrement baissé son taux directeur : de 4,25% en juillet 2008 jusqu’à devenir nul à partir de mars 2016. Il n’est redevenu positif qu’en juillet 2022 à la suite de la hausse de l’inflation (en décembre 2024 il s'élève à 2,9% après avoir culminé à 4,5% en septembre 2023. Source : BdF).
Ces outils se révélant insuffisants pour éviter l’effondrement du système financier, les banques centrales ont dû mettre en œuvre des politiques monétaires dites non conventionnelles qui consistent à fournir davantage de liquidités aux banques via des prêts à plus long terme que précédemment et des achats massifs de titres de dette (le quantitative easing)
Le rôle de « prêteur en dernier ressort »
Pour que le marché interbancaire fonctionne, il faut que les banques acceptent de se prêter, ce qui implique qu’elles aient confiance dans leur solidité réciproque. Quand la méfiance s’établit, il y a un risque d’effondrement de système financier car les banques ne se prêtent plus. Sans la banque centrale, une banque débitrice ne trouverait alors plus de liquidités pour payer ce qu’elle doit et serait en faillite. Les acteurs du système financier étant interconnectés, cette première faillite, si elle concerne une grosse banque (dite systémique)
La principale politique non conventionnelle est le quantitative easing (QE), ou assouplissement quantitatif
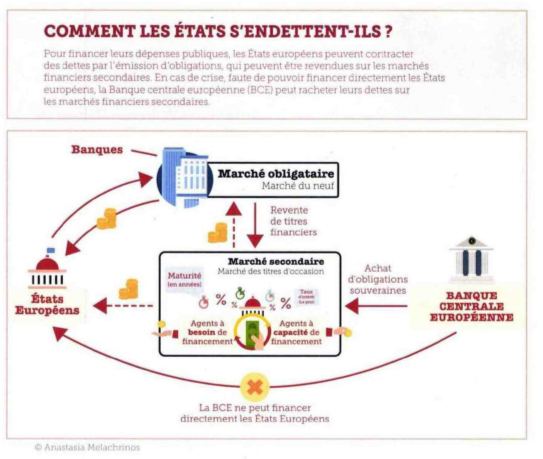
Les opérations de quantitative easing ont plusieurs conséquences :
- Au niveau des banques secondaires, le QE augmente leurs réserves en monnaie centrale ce qui devrait accroître leur capacité à accorder des crédits et permettre ainsi de relancer l’activité économique : les banques ayant moins peur de prêter puisqu’elles disposent de liquidités facilement accessibles auprès de la banque centrale, et les agents économiques étant plus enclins à emprunter du fait de taux d’intérêts très bas. Par ailleurs, il réduit la détention par les banques secondaires de titres de créances sur leur propre Etat ce qui diminue leur exposition au risque de défaut souverain.
- Au niveau des Etats
notemon41 , le QE réduit le coût de la dette. En effet, en annonçant qu’elles vont racheter massivement des titres de dette publique, les banques centrales garantissent (implicitement ou explicitement) qu’il existe un acheteur en dernier ressort de la dette publique. Les banques sont alors assurées qu’elles pourront facilement revendre les titres souverains à la banque centrale et se portent donc plus facilement acquéreuses des titres émis sur le marché primaire. Cela réduit le risque de défaut souverain, fait pression à la baisse sur les taux d’intérêt de la dette publique et limite les ardeurs spéculatives. Par ailleurs, les banques centrales étant le plus souvent à capitaux publics, les intérêts versées par les Etats leur reviennent au moins en partie sous forme de dividendes. Le QE contribue donc améliorer la capacité des États à financer leur déficit budgétaire.
Pour en savoir plus sur le quantitative easing consultez notre fiche sur le sujet
Les limites de la politique monétaire
Un rôle indirect sur le volume de la monnaie qui circule dans l’économie
Quand on se penche sur l’histoire monétaire des 10 dernières années, on ne peut nier que les politiques accommodantes des banques centrales ont eu des effets réels sur l’économie. Elles ont permis d’éviter l’effondrement du système financier et les conséquences dévastatrices que cela aurait eu sur l’activité économique. Elles ont, ensuite, facilité le financement de la dette publique, permettant ainsi aux Etats de continuer à mobiliser le budget pour faire face à la crise économique consécutive à la crise financière de 2008, et encore bien plus aux conséquences de la pandémie de COVID-19.
L’effet de ces politiques reste cependant limité comme le montre la comparaison entre l’évolution de la base monétaire et celle de la masse monétaire (voir l’Essentiel concerné et graphiques ci-après). L’augmentation des liquidités injectées dans le système bancaire par les banques centrales, ne s’est pas traduit par une augmentation du crédit dans les mêmes proportions.
Ceci s’explique par le caractère endogène de la création monétaire : ce sont les agents économiques qui en sont à l’origine, via leur demande de crédits (et non une décision de la banque centrale). Les banques les leur accordent si l’opération est rentable et que le client est solvable. La politique monétaire via le taux d’intérêt directeur et la fourniture de liquidités peut rendre cette opération plus ou moins rentable pour les banques, et plus ou moins coûteuse pour les emprunteurs mais elle ne peut pas forcer ces derniers à emprunter. La demande de crédit des ménages, des entreprises ou des collectivités publiques dépend, en effet, de nombreux facteurs dont la disponibilité de crédits peu chers ne constitue qu’une des dimensions. Leur situation financière (revenu et niveau d’endettement) ainsi que leur confiance dans l’avenir (carnet de commandes des entreprises, état du marché du travail etc.) jouent un rôle majeur.
Quand l’économie est en quasi-déflation et que les perspectives sont mauvaises, les acteurs privés (les ménages et les entreprises) sont attentistes. Même si les taux d’intérêts sont bas, ils cherchent plutôt à se désendetter ou à mettre de l’argent de côté. Ils anticipent, par ailleurs, de futures baisses des prix et attendent avant de se lancer dans des achats ou des investissements. C’est le phénomène de la « trappe à liquidités ».
Aucun rôle dans l’allocation de la masse monétaire
Si les banques centrales jouent un rôle indirect sur le volume de la masse monétaire, elles n’en jouent par contre aucun dans son allocation. Leur action est neutre
Le taux d’intérêt directeur, outil majeur de la politique monétaire avant la crise de 2007-2008, ne peut que rendre les crédits plus ou moins accessibles pour les entreprises ou les ménages. Par contre, il n’influence aucunement l’allocation des crédits : sa hausse ou sa baisse impacte également tous les secteurs de l’économie et toutes les régions. Une hausse renchérira le coût du crédit de l’immobilier, des énergies renouvelables et de tout autre activité économique. Inversement, sa baisse diminue le coût de l’argent pour les investissements productifs mais aussi pour la spéculation et pour des activités polluantes. De même, dans des zones monétaires comme la zone euro, une hausse du taux directeur peut être utile à certaines économies nationales en surchauffe, alors que d’autres, en situation plus déprimée, auraient au contraire besoin d’un assouplissement des conditions de crédit.
Les politiques non conventionnelles n’ont pas non plus d’influence sur l’allocation des crédits. Rappelons, tout d’abord, que ces politiques apportent de la monnaie centrale mais pas de monnaie utilisable par les agents non financiers. Elles ont ainsi conduit en grande partie à une mise en réserve des liquidités ainsi créées sur les comptes des banques à la banque centrale. C’est une des explications de la déconnexion croissante de la base monétaire et de la masse monétaire (voir l’Essentiel concerné).
Ensuite, que les banques centrales achètent des actifs ou les prennent en collatéral, il s’agit en règle générale d’actifs préexistants, acquis sur le marché secondaire. Ce faisant, elles agissent sur le prix des titres, mais seulement indirectement sur leur offre et très indirectement sur le financement des émetteurs originels. En effet, acheter un titre de dette ou une action au moment de son émission n’a pas les mêmes conséquences économiques que l’acheter sur le marché secondaire : seule la première option contribue directement à l’investissement en finançant l’émetteur, tandis que la seconde contribue surtout à améliorer la liquidité de ses actifs et donc à faire baisser les taux pour les obligations. Elle nourrit de plus la spéculation et la formation de bulles car, la demande étant plus importante, les prix des actifs augmentent. Enfin, passer par le marché secondaire conduit à nourrir, via les commissions encaissées au passage, toutes sortes d’intermédiaires financiers, à commencer par les banques.
Cette pauvreté de la politique monétaire n’est pas une fatalité
Ce rôle limité de la politique monétaire dans le volume et l’allocation de la création monétaire n’est pas une fatalité. Elle est le résultat de la doctrine dominante en la matière, héritée des années 1970-80 : la politique monétaire, menée par une banque centrale indépendante des gouvernements, doit se concentrer sur la stabilité des prix. Elle doit être neutre, ne pas favoriser un secteur plutôt qu’une autre (voir l'idée reçue 5 de ce module).
Cette doctrine est en train d’évoluer notamment du fait de l’émergence de la question des risques financiers consécutifs au réchauffement climatique (voir l’Essentiel 7 de ce module). De nombreux travaux de recherche et de think tanks mettent en évidence le fait que les outils déjà mobilisés par les banques centrales pourraient être « verdis », mis au service de la transition écologique. Ils évoquent également la nécessité de réhabiliter d’autres outils et en particulier la monétisation de la dette publique.
 Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
L’approche par les risques ralentit l'action des banquiers centraux dans le domaine climatique
En septembre 2015, dans un discours désormais historique prononcé au siège de la Llyod’s
Il dresse également la typologie de ces risques (plus de détail dans le module finance) :
- les risques physiques (impacts des catastrophes climatiques sur les entreprises, les chaînes de production, le commerce) ;
- les risques de transition (impacts des mutations économiques liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les entreprises carbonées) ;
- et les risques de responsabilité (recours en justice).
Les banques centrales, dont le rôle pour maintenir la stabilité financière a été réaffirmé à la suite de la crise de 2007-2008, se sont saisies de ce sujet. C’est ainsi qu’a été créé en décembre 2017 le NGFS
L’objectif affiché est donc double : contribuer à une meilleure prise en compte des risques climatiques par les acteurs financiers et les mobiliser pour qu’ils financent davantage les projets de transition. C’est ce qu’on appelle la double matérialité : le système financier est menacé par le réchauffement climatique et inversement les activités financières contribuent à aggraver le phénomène.
L’approche des superviseurs et banquiers centraux se concentre sur les risques
Cependant, les travaux des banques centrales se sont pour l’instant concentrés sur la première dimension : l’estimation des risques que le climat fait peser sur les établissements financiers et plus généralement sur le système financier dans son ensemble (le risque systémique).
Cette approche repose sur la logique développée par Mark Carney dans son discours sur la « tragédie des horizons » : les acteurs financiers étant aujourd’hui incapables de prendre en compte les risques financiers climatiques, il faut les rendre visibles pour que la finance puisse en tenir compte et entrainer avec elle le reste de l’économie.
Il s’agit donc d’une approche séquentielle :
- Dans un premier temps, il faut développer la recherche, les méthodologies et les réglementations permettant 1/ d’améliorer la transparence, la qualité et la quantité des informations sur les risques climat portés par les entreprises non financières et 2/ de quantifier précisément l’exposition des acteurs financiers à ces risques.
- Dans un second temps, les acteurs de marché pourront ajuster leur stratégie et, s’ils ne le font toujours pas, les autorités pourront adopter de nouvelles mesures prudentielles et réglementaires.
Cette approche s’inscrit dans la lignée de la gestion traditionnelle des risques par les acteurs financiers, et repose sur deux hypothèses problématiques :
- Une fois les nouvelles informations disponibles, les marchés, devenus efficients sur ce plan, pourraient évaluer correctement (pricer) les actifs verts et les actifs carbonés, et ajuster ainsi leur stratégie d’investissement. Cette hypothèse, qui repose sur la théorie de l’efficience des marchés, est cependant invalidée tant dans les faits (multiplication des crises financières) que dans la théorie.
- Les risques financiers induits par le réchauffement climatique seraient identifiables et mesurables, ce qui est loin d’être le cas comme nous allons le voir.
Les risques financiers induits par le réchauffement climatique ne sont pas mesurables
L’approche traditionnelle de la gestion du risque en finance s’effectue à partir de probabilités établies sur la base de données historiques extrapolées dans le futur. Par exemple, le risque de défaut futur des PME est calculé à partir des données sur les défauts historiques de ce type d’entreprise.
Cette approche est inopérante en matière de risque financier climatique. Les données historiques ne peuvent constituer une base sur laquelle s’appuyer solidement : le changement climatique n’est pas linéaire, il existe des points de bascule, des seuils qui, une fois franchis, pourraient provoquer un emballement du réchauffement planétaire
Comme l’écrivent Hugues Chenet et Wojteck Kalinowski dans une note de l’Institut Veblen, le changement climatique, et plus généralement tous les risques environnementaux nous placent « non pas face à un risque mais face à une incertitude radicale, due à l’immense complexité des mécanismes à l’œuvre mêlant systèmes socioéconomiques et systèmes naturels et à la multiplicité des futurs possibles sur des horizons temporels très longs. (…) L’incertitude radicale caractérise des situations où il n’existe pas de probabilité calculable d’une occurrence future particulière. Le futur est alors inconnu. Autrement dit, si l’incertitude radicale prévaut, le risque financier n’est pas calculable. C’est alors toute la logique de la prise en compte du risque financier qui est ébranlée ».
La focalisation sur l’approche par le risque conduit à l’attentisme des superviseurs et des banquiers centraux
Comme le note Laurence Scialom, l’approche traditionnelle de la gestion des risques se révèle non seulement inadaptée, mais en plus contre-productive.
« Si le caractère radicalement nouveau d’un évènement, ayant un impact potentiellement massif sur le prix des actifs, ne peut être associé à une probabilité faute de données historiques, le risque financier ne peut plus être quantifié. Pire, la perpétuation de l’usage de ces méthodes conduit nécessairement à gravement les sous-estimer et est donc une entrave au calibrage de politique monétaire et macroprudentielle susceptibles de mieux les maîtriser. »
C’est bien ce qu’on constate en se penchant sur les rapports et recommandations du NGFS et plus généralement des banques centrales
Le NGFS développe également des exercices de scénarisation qui consistent à explorer les futurs possibles et semblent ainsi plus adaptés à l’incertitude radicale qui caractérise la problématique du réchauffement climatique. Cependant, ceux-ci sont menés dans une optique quantitative en vue de réaliser des tests de résistance climatique, nouvel outil de supervision des institutions financières. Inspirés des stress tests financiers mis en place à la suite de la crise de 2007-2008, ceux-ci consistent à quantifier l’impact financier (pour un établissement, un portefeuille ou pour le système financier dans son ensemble) de la matérialisation des risques climatiques selon un scénario donné.
Cette approche par les risques se révèle donc nettement insuffisante : elle conduit surtout les régulateurs et superviseurs financiers à l’immobilisme dans l’attente de « plus de recherche ».
Les actifs verts sont-ils moins risqués que les actifs polluants ?
Une réponse positive à cette question, qui occupe une place importante dans les travaux du NGFS, est posée comme un préalable à toute politique prudentielle ou monétaire favorisant les actifs verts ou défavorisant les actifs polluants (les entreprises des énergies fossiles par exemple). Cependant, en l’état actuel de l’économie, il n’y a aucune raison pour qu’une entreprise « verte » soit moins sujette à risque de défaut qu’une entreprise polluante. C’est même parfois le contraire
Si la dynamique peut bel et bien s’inverser à la suite de décisions politiques ou du mouvement majeur d’un acteur significatif, il n’y a pas de raison pour qu’un différentiel de risque soit constaté à l’heure actuelle tant que cette bascule n’est pas perçue par la majorité des acteurs. Là encore, l’approche par le risque ne fait guère avancer. Il serait au contraire souhaitable non pas de justifier une régulation plus stricte parce que les actifs carbonés seraient mesurés comme plus risqués aujourd’hui, mais bel et bien de renforcer la régulation pour les pénaliser car ils sont plus risqués pour le climat. C’est alors qu’ils deviendront financièrement plus risqués.
Quelles alternatives ?
Si les savoirs concernant la quantification des risques financiers sont insuffisants par nature, faut-il attendre une hypothétique perfection pour agir ? Les connaissances sur les impacts matériels du climat, synthétisés dans les rapports du GIEC (voir module Economie, ressources naturelles et pollutions), sont, elles, largement suffisantes. Nous savons avec certitude que l’inaction à court terme provoquera le renforcement des catastrophes climatiques ; que les coûts pour le système économique et donc pour le système financier seront massifs compte tenu des effets de boucles de rétroaction positives qui caractérisent le franchissement des limites planétaires.
Comment alors prévenir les risques financiers qui échappent complètement aux outils traditionnels de gestion de risque ? C’est du côté de la recherche et des think tanks qu’émergent des voies alternatives même si certaines publications et prises de parole des banquiers centraux
- Reconnaître la « double matérialité » du réchauffement climatique
Il ne s’agit pas seulement de calculer les risques financiers consécutifs au changement climatique mais aussi de prendre en compte l’impact de la finance et des activités économiques financées sur le climat. Cela implique donc de reconnaître les critères environnementaux comme des critères de plein droit en plus des critères financiers dans les politiques des régulateurs et des superviseurs.
- Agir par précaution
Ce n’est pas parce que les risques financiers liés au climat sont très difficiles à estimer, qu’ils n’existent pas. Les connaissances scientifiques sur le climat prouvent de manière certaine que le réchauffement climatique aura des impacts massifs sur les conditions de vie sur la planète et sur les ressources accessibles. Cet impact sera aussi massif sur l’économie donc sur le système financier. Cela devrait constituer une base suffisante pour agir et mobiliser les outils existants des banques centrales et des superviseurs financiers.
Hugues Chenet et Wojteck Kalinowski recommandent ainsi, par exemple, de « se contenter à court terme des actions les plus évidentes (…) recourir à des mesures a priori satisfaisantes, des règles de base (ou règles générales, rules of thumb) tirées des connaissances accumulées et de l’expérience de gestion des crises. Un exemple de règle de base serait de commencer par s’attaquer au financement des activités les plus nocives et où un large consensus existe au moins dans certaines juridictions (centrales thermiques à charbon, exploitation de sables bitumineux...), en utilisant l’arsenal d’outils dont disposent les banques centrales, entre rachats d’actifs, éligibilité du collatéral, contrôle du crédit, etc. ». Ils insistent également sur la nécessité de mener des politiques adaptatives, souples et régulièrement revues.
La réaction à la COVID-19 offre en cela un parallèle intéressant : les mesures d’urgence adoptés par les banquiers centraux n’ont pas nécessité de calculs de risques et d’exercices de modélisation aussi complexes que ceux qui dominent aujourd’hui pour faire face au réchauffement climatique. Certes, il s’agissait de réagir dans l’urgence face à une situation avérée, alors que dans le cas du climat (et plus généralement des crises environnementales) il faut agir en amont, par précaution, car une fois que les risques se seront matérialisés il sera largement trop tard. Mais force est constater que ces mesures d’urgence ont concerné un problème de santé publique bien plus limité dans ses conséquences que le réchauffement climatique. On pourrait donc espérer qu’il suscite une réaction encore plus vigoureuse !
 Pour en savoir plus
Pour en savoir plus
La création monétaire privée est procyclique, source d’endettement et d’instabilité financière
Comme on l’a vu dans l’Essentiel concerné, la création monétaire est aujourd’hui faite en contrepartie de l’endettement d’un acteur économique public ou privé.
Du coup, elle contribue mécaniquement à la hausse de l’endettement
La monnaie d’endettement a un deuxième inconvénient. Son émission est fonction de la conjoncture économique et a un effet amplificateur et non régulateur des cycles. Quand l’économie est déprimée, les agents économiques ne veulent ou ne peuvent pas s’endetter et les banquiers prêtent difficilement. Du coup, la monnaie n’est pas créée et peut venir à manquer. A l’inverse, quand l’économie est en surchauffe, la monnaie peut être émise en excès et créer des tensions inflationnistes. Les autorités sont alors amenées à recourir à des actions sur les taux d’intérêt qui, elles, peuvent déclencher des processus récessifs.
Enfin, ce mécanisme n’est pas sans lien avec l’augmentation des crises financières. La « surchauffe » peut ne pas être « calmée » par les autorités, se traduire en bulle financière qui peut exploser (voir l’Essentiel concerné). Dit autrement, les situations d’endettement excessif sont sources d’instabilité : elles conduisent à des risques de récession ou de crises financières
A l’inverse, une monnaie libre, créée et injectée sans dette en contrepartie
- sa création ne génère pas d’endettement ;
- elle est gratuite ;
- elle peut être émise pour relancer l’activité lorsque l’économie est en récession.
Contrairement à une idée reçue, le financement monétaire de l’Etat a été possible et a bien permis d’injecter de la monnaie sans endettement en contrepartie. C’était le cas quand la monnaie était faite de pièces de monnaie ou de billets émis par l’Etat.
Redonner à l’Etat le bénéfice de la création monétaire lui permettrait de réduire son endettement
Le lien entre création monétaire et dette publique est évident en théorie : si l’Etat bénéficie de la création monétaire, il ne s’endette pas à due concurrence. Et c’est le seul acteur à avoir la légitimité de le faire. On parle dans ce cas de « monétisation de la dette publique ».
Il a d’ailleurs été proposé que la création monétaire soit exclusivement d’origine publique. C’est la notion de 100% money introduite par l’économiste Irving Fisher
L’idée de monétisation de la dette publique se heurte en Europe aux traités de l’Union européenne et aux statuts de la Banque centrale européenne qui interdisent formellement l’avance directe de celle-ci aux Etats et administrations publiques. Cette interdiction est légitimée par la doctrine selon laquelle l’Etat doit se soumettre à la discipline de marché (voir L'idée reçue 6 dans ce module) : en étant obligé de s’endetter auprès du marché, il doit justifier de sa bonne gestion. Le recours à la « planche à billets » lui permettrait des facilités anti-économiques. Cette interdiction est relâchée sur le marché secondaire : la BCE peut racheter sur ce marché des obligations souveraines, l’essentiel étant que ces obligations aient d’abord été souscrites sur le marché primaire (voir les explications sur le quantitative easing dans ce module).
Les enjeux sont considérables. En effet, l’effet boule de neige
Dans un article de 2012
Les auteurs décomposent dans la formation de cette dette ce qui est dû aux poids des intérêts et ce qui est dû au déficit primaire (c'est-à-dire avant paiement des intérêts). Ils concluent que « si l’Etat français s’était endetté à taux nul notre dette publique brute, aujourd’hui, eût été de 28,5% du PIB en 2011 (au lieu de 86%) toutes choses égales par ailleurs. » Dit autrement, si les besoins de financement de l’Etat avaient été satisfaits par la création monétaire sans endettement et sans intérêt, alors son taux d’endettement aurait été globalement stable.
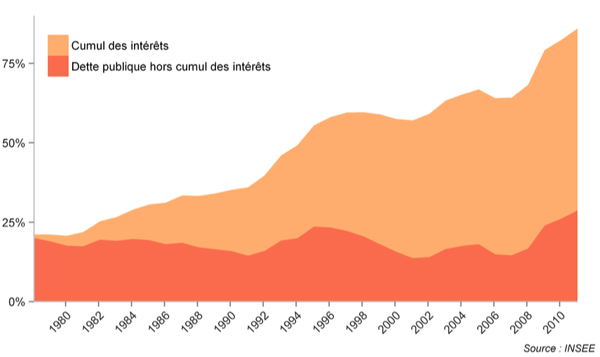
Le financement de l’Etat par l’endettement a donc comme première conséquence négative de faire peser sur ses comptes la charge des intérêts. Plus les taux d’intérêt sont élevés plus cette charge l’est et plus les efforts à faire pour les limiter sont importants et difficiles. On pourrait donc penser que le montant de la dette publique n’est en soi pas un problème (indépendamment des contraintes formelles ou juridiques liées en Europe aux traités européens), si les taux d’intérêt payés sur la dette souveraine sont nuls (voire négatifs) comme aujourd’hui. Dit autrement, la soutenabilité de la dette publique dépendant au premier ordre des taux d’intérêt, le recours à la monétisation ne serait pas utile en période de taux bas.
Cette analyse est peu convaincante. D’une part, il n’est pas forcément souhaitable économiquement que les taux d’intérêt (qui ne servent pas uniquement au financement de la dette publique mais se répercutent dans toute l’économie) soient nuls – cela dépend du contexte. D’autre part, leur niveau peut varier. Rien ne garantit que leur niveau ne va pas se relever. Dans ce cas, les charges d’intérêt pèseront à nouveau. Il s’agit donc d’une épée de Damoclès. Enfin, le montant de la dette publique (rapportée au PIB) est perçu par l’immense majorité des citoyens comme une contrainte économique majeure. Même s’il s’agit d’une croyance plus que d’une vérité, elle doit être prise en considération dans le choix des options.
Les changes flottants sont source de difficultés économiques et sociales
La fin des accords de Bretton-Woods en 1971
Le pays qui se laissera aller au laxisme budgétaire financé par création monétaire aura une monnaie « faible », de sorte que les acteurs économiques lui préféreront d'autres monnaies. À l'inverse, les « vertueux » auront une monnaie forte. C'est ainsi que, dans un cadre de changes flottants, les mécanismes du marché sanctionneront spontanément les mauvaises politiques monétaires.
La fin des accords de Bretton-Woods
Le système mis en place après la conférence de Bretton Woods de 1944 était un système de changes fixes avec étalon de change or basé sur le seul dollar
Ce dispositif donnait au dollar une place particulière. Les déficits de la balance des transactions courantes américaine étant financés par des dollars, les États-Unis choisissaient de ne pas s’en soucier. On appelle cette attitude le benign neglect. Pendant les années 1960, les dépenses militaires américaines ainsi que la course à l'espace conduisirent le gouvernement américain à multiplier les dépenses et à créer une immense liquidité internationale en dollars. Cette licence attira d'abord les remarques du général de Gaulle, qui, dans une conférence célèbre, demanda le retour à l'étalon-or et se mit à exiger des paiements en or, au lieu de dollars.
Ce fut l'Allemagne qui, en 1971, mit fin aux accords de Bretton Woods : agacée d'avoir à acheter des dollars à un taux fixe supérieur au taux naturel du marché – ce qui revenait à payer l'inflation des États-Unis à leur place – la BUBA, la banque centrale allemande, sensibilisée à l'inflation par l'hyperinflation du début des années 1920, cessa de les accepter. Le Président Nixon prit alors la décision de supprimer la convertibilité or du dollar.
Cette vision irénique des changes flottants se heurte à la réalité, comme l’a montré Robert Mundell dans un réquisitoire contre la plupart des arguments en faveur des changes flottants
- qu'il n'y a jamais eu de stabilité des changes mais plutôt, au contraire, une dramatique volatilité ;
- qu’il n'y a pas eu non plus de convergence des taux d'intérêt ;
- que c'est la spéculation qui s'est installée, avec de nombreuses attaques erratiques contre les monnaies, analyse confirmée par d'autres économistes
notemon59 ; - que les chocs n'ont pas été atténués mais aggravés par les changes flottants ;
- que les changes flottants provoquent une instabilité financière endogène.
La majorité des monnaies sont non convertibles
Cette partie s’inspire largement du rapport « La finance aux citoyens – Mettre la finance au service de l’intérêt général » dont nous synthétisons ou reproduisons plusieurs passages issus du chapitre 5
Les monnaies des "pays avancés" sont des monnaies convertibles (parfois appelées "fortes"
La non-convertibilité des devises restreint l’accès aux ressources de la finance internationale
La finance globale mondiale concerne uniquement les transactions en devises convertibles. Il y en a actuellement 18
Il existe bien sûr des degrés divers d’accès aux devises convertibles pour les pays émergents et en développement. Ceux qui exportent beaucoup vers les pays avancés ont des réserves de devises fortes importantes. Même si leur monnaie est techniquement inconvertible, en pratique les prêts et emprunts en devises convertibles sont faciles et abondants. C’est le cas du Chili par exemple, mais surtout de la Chine, qui est le plus gros détenteur de dollars américains du monde. Elle possède deux monnaies, une monnaie interne, le yuan, et une monnaie externe, le renminbi.
Mais pour la plupart des pays émergents et en développement, l’accès restreint aux devises convertibles rend difficiles les investissements d’entreprises non résidentes mais aussi l’expansion d’entreprises locales du fait de surcoûts liés à la méfiance justifiée ou ressentie des partenaires (fournisseurs, banques…).
Les pays qui n’ont pas accès aux devises convertibles sont vulnérables à la spéculation monétaire
Le taux de change de la monnaie d’un pays a des conséquences directes sur la vie des citoyens. Lorsque la monnaie se déprécie par rapport aux autres devises, le prix des produits importés augmente ce qui peut poser des problèmes économiques et sociaux majeurs, par exemple si le pays importe de l’énergie, des produits alimentaires ou des matériaux et machines essentiels à son activité industrielle. Dans le même temps, le prix des produits exportés diminue, ils se vendent donc plus facilement dans les autres pays ce qui favorise les exportations.
Une monnaie peut se déprécier si elle est créée en abondance dans le pays mais également si elle est "attaquée" par des mouvements spéculatifs en provenance de l’extérieur du pays.
La spéculation monétaire peut également toucher les devises convertibles, même si elle est rendue plus difficile par le fait que les pays avancés ont un accès libre au marché des autres devises convertibles : pour contrer une attaque, il leur suffit généralement d’emprunter
Les dépréciations de monnaies des pays émergents et en développement ont été fréquentes et très importantes depuis que le régime de changes flottants est en place (1973). Citons les crises des pays les plus impactés sur la période de 1990 à 2010 : la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Mexique, le Brésil, l’Argentine et la Russie. Ces pays ont connu à partir de la fin des années 1990 des crises bancaires et de change qui leur ont fait perdre jusqu’à près de 15% de leur PIB dans le cas de l’Indonésie
L’arrimage à une monnaie convertible donne accès aux capitaux internationaux mais peut soumettre la population à des contraintes sévères
De nombreux pays ont soit adopté comme monnaie une monnaie forte, soit arrimé
Cet arrimage peut se faire à un taux plus ou moins élevé. Pour la Chine il a été fait à un taux bas
L’arrimage permet au pays d’accéder à des financements internationaux, les investisseurs ne craignant pas le risque de convertibilité et craignant moins celui de risques de pertes de change (le cours de la monnaie non arrimée étant généralement plus fluctuant). Il soutient la compétitivité des biens exportés si le taux de change retenu est bas. De plus, lorsqu'elles rapatrient le fruit de leurs exportations dans leur monnaie locale, les sociétés qui bénéficient alors de ce taux de change avantageux peuvent augmenter considérablement leur profit. L’arrimage permet de protéger sa propre économie des variations de change.
Mais il a aussi des conséquences négatives pour l'économie du pays qui adopte cette politique, puisque l'État abandonne tout ou partie de sa souveraineté monétaire et donc sa capacité à ajuster les fluctuations de l'économie par sa politique monétaire et de taux de change : il ne peut plus recourir à la création monétaire publique afin de réguler son endettement ; il perd la capacité à dévaluer ou à réévaluer sa monnaie ; il doit aussi combattre les « tendances » à une inflation qui serait supérieure à celle de la zone ou du pays de la monnaie de référence, ce qui peut le conduire à comprimer les salaires. C'est aussi une perte économique pour la perception des droits de seigneuriage inhérents à la création de monnaie par une banque centrale. Enfin, l’arrimage doit être défendu : le gouvernement ou la banque centrale doit sans arrêt acheter ou vendre des devises étrangères pour maintenir la parité avec la monnaie d’arrimage, ce qui réclame de larges quantités de réserves de change.
Avoir une monnaie forte n’est pas un gage de bien-être social pour le pays concerné
La création de l’euro a été précédée d’un long plaidoyer en faveur de l’accrochage du franc au mark, une monnaie forte. De gros sacrifices ont été demandés aux citoyens français, espagnols et italiens car, pour soutenir la parité du franc, il a fallu augmenter les taux d’intérêt (ce qui l’a rendu plus attractif et a exercé une pression à la hausse sur son cours) et mener une politique dite de rigueur à partir de 1983 (après plusieurs dévaluations à la suite des attaques du franc au début du premier septennat Mitterrand).
Dans un régime de changes flottants, une monnaie forte est une monnaie qui est « demandée » (par des investisseurs de pays tiers ou des résidents) parce qu’elle est considérée comme ne pouvant perdre de la valeur (par rapport à d’autres monnaies). Une monnaie « faible » est une monnaie dont les investisseurs craignent qu’elle perde de la valeur et dont ils se détournent pour éviter des pertes de change à la revente éventuelle. Au moment de la création de la zone euro, les monnaies faibles (peseta espagnole, lire italienne, drachme grecque et relativement au mark, le franc) avaient connu plusieurs dévaluations.
Dans un régime de changes flottants, la parité d’une monnaie dépend de l’offre et de la demande sur le marché des changes et de l’action de la banque centrale qui peut intervenir sur ce marché (en se coordonnant le cas échéant avec d’autres banques centrales
Techniquement, les économistes font des calculs pour déterminer si une monnaie est sous-évaluée (« faible ») ou surévaluée (« forte ») par rapport à une autre en calculant la parité de pouvoir d’achat de ces deux monnaies (PPA) : le taux de change PPA entre la monnaie du pays et celle du pays étranger est tel qu’une unité de monnaie domestique permet d’obtenir une même quantité de biens et de services, dans le pays et à l’étranger, une fois la conversion faite. Si le taux de change PPA est inférieur au taux de change effectif, la monnaie est surévaluée et inversement.
Les calculs réalisés par les économistes sont complexes, parfois contradictoires, souvent discutables. Pour comprendre la notion, suivons l’exemple fourni par The Economist avec son « Indice Big Mac » qui recense le prix du sandwich de Mac Donald’s tout autour de la planète. Ainsi, le Big Mac coûtait en moyenne 2,94 euros dans la zone euro à la fin janvier 2007, contre 3,22 dollars aux États-Unis, soit une parité de pouvoir d’achat de 1,10 dollar pour un euro. En cotant 1,36 dollar sur le marché, l’euro serait ainsi surévalué de 24 % (par rapport à 1,10 dollar) d’après « l’indice Big Mac ». À l’inverse, le yuan chinois est sous-évalué, selon cet indice, de 56 % face au dollar
Les avantages de disposer d’une monnaie convertible sont clairs, (voir l’Essentiel dans ce module). Mais qu’en est-il d’une monnaie forte ? Les avantages supposés sont les suivants :
- les importations sont moins coûteuses, une monnaie forte limite donc la hausse des prix. Elle contribue, toutes choses égales par ailleurs, à diminuer le coût du crédit, puisque les taux d’intérêt sont d’autant plus faibles que l’inflation l’est aussi, ce qui est favorable aux consommateurs et aux entreprises ;
- l’Etat accède facilement à des financements internationaux car la monnaie est demandée. S’il est internationalement très endetté, son gouvernement n’a pas intérêt à défendre une stratégie d’affaiblissement de la monnaie, car la hausse des taux d’intérêt qui pourrait en résulter renchérirait le coût de la dette publique ;
- le pays dont la monnaie est forte attire plus facilement des investissements étrangers (et éventuellement des sièges sociaux) donc de l’activité, du dynamisme et des emplois. La raison en est toujours la même : ces investisseurs, du fait de la « force de la monnaie », ne craignent pas de perte de change.
Pourtant, il est bien clair que les « dragons asiatiques » et surtout la Chine se sont développés à grande vitesse grâce à une monnaie sous-évaluée
Les inconvénients d’une monnaie forte sont symétriques des avantages :
- une monnaie forte rend les produits exportés moins compétitifs
notemon75 dans les pays ayant une monnaie plus faible ;
Le cas d’Airbus, en compétition avec Boeing est emblématique. En 2014, l’euro valait 1,36 dollar
- la volonté de soutenir les exportations exerce une pression vers le bas sur les salaires pour contrebalancer les effets de la force de la monnaie.
Vouloir maintenir une parité « forte » de sa monnaie peut avoir des inconvénients économiques et sociaux élevés. En effet, cela favorise le partage de la valeur ajoutée en faveur des profits (pour maintenir les salaires le plus bas possible) et des épargnants (en limitant l’inflation), alors qu’une parité faible permet des salaires plus élevés.
Cela peut nécessiter une hausse des taux d’intérêt, un refus du recours à la hausse de l’endettement public, donc au déficit public (voire viser un solde primaire) pour éviter d’exercer une pression à la baisse de la valeur de la monnaie (par hausse de la demande). Bref cet objectif peut venir en contradiction avec des objectifs beaucoup plus souhaitables de politique économique et notamment de justice sociale.
L’arbitrage entre les avantages et les inconvénients dépend évidemment du niveau d’ouverture internationale de l’économie (l’indifférence des Etats-Unis à la parité monétaire du dollar tient largement au faible poids des imports/exports dans le PIB) et de la spécialisation de l’économie. Une économie qui vise à se développer par l’exportation a plutôt intérêt à disposer d’une monnaie sous-évaluée pour prendre des parts de marché à ses concurrents.
Le cas de l’euro est illustratif de ces enjeux. Sa « force » a des effets contrastés selon les pays de la zone et les catégories socio-professionnelles concernés. Elle est plus favorable aux pays européens du Nord (qui ont fait ce choix depuis 50 ans au moins) et défavorable à ceux du Sud qui ont fait le choix inverse.
Idées reçues
Il n’y aurait ni repas gratuit ni argent magique
Face à la possibilité de financer l’économie par la création monétaire publique (par exemple en lieu et place de l’endettement public), et indépendamment de tout débat technique économique ou juridique sur les avantages et inconvénients de cette manière de procéder, deux mantras sont au cœur du discours économique dominant.
Le prix Nobel d’économie Milton Friedman a écrit un ouvrage intitulé There’s no such thing as a free lunch
Quant au deuxième mantra selon lequel la monnaie n’est pas magique, il sous-entend que croire que la création monétaire pourrait solder une dette publique, c’est croire au père Noël. Les gens sérieux savent bien, eux, « qu’il faudra payer », soit par des impôts, soit par l’inflation qui rogne la valeur de l’épargne des épargnants. Le débat politique sous-jacent n’est pas sans conséquences. Les efforts imposés depuis des décennies en Europe pour limiter la dette publique sont en effet très lourds. L’exécutif pourrait avoir du mal à les justifier si la banque centrale, d’une simple écriture informatique, annulait des centaines de milliards d’euros de dette.
Pourtant, la monnaie a bel et bien un caractère « magique » : elle est créée d’un simple jeu d’écritures par les banques, ce qui crée un pouvoir d’achat bien réel (qui se constate de manière dynamique, quand les nouveaux prêts sont supérieurs aux remboursements des anciens). La monnaie n’a rien d’un voile. C’est au contraire un catalyseur des échanges. Son effet sur l’économie « réelle » se démontre, soit en négatif dans les épisodes de crises économiques, soit en positif quand la politique monétaire a été utilisée pour sortir d’une récession (qu’on pense à la reconstruction d’après-guerre ou à la sortie de la crise de 1929). D’autre part, la création monétaire n’est pas par principe inflationniste. En effet, comment expliquer son absence depuis des décennies dans un contexte où les banques commerciales et la banque centrale ne cessent de créer de la monnaie ? (voir Idée reçue 4)
Le contexte économique actuel, où les moyens de production (équipements et force de travail) sont sous-employés et où les besoins d’investissement dans la transition écologique sont massifs, est particulièrement adapté à une politique monétaire active. L’annulation pure et simple de la dette publique détenue par la banque centrale est l’une des méthodes, avec la monétisation ciblée, à recommander aujourd’hui pour éviter les dégâts certains d’une rigueur budgétaire justifiée par un moralisme sans sérieux économique. Mais bien sûr il ne faut recourir à ces méthodes qu’avec discernement et sous un contrôle démocratique renouvelé. Nous ne croyons pas que les billets remplacent l’effort productif, nous ne recommandons pas qu’on les crée ad libitum. L’heure n’est pas aux assignats mais aux dégagements des marges de manœuvre nécessaires pour financer une politique de reconstruction écologique dont nous avons montré l’impérieuse nécessité (voir module Economie, ressources naturelles et pollutions).
Il y aurait plusieurs théories se valant sur la création monétaire
Il peut paraître curieux qu’un phénomène aussi basique et important que la création monétaire fasse l’objet de débats entre économistes professionnels. C’est pourtant le cas, comme le montre Pierre Cailleteau, auteur de La vulnérabilité du système financier mondial, dont nous reproduisons ci-après un extrait qui montre bien qu’une seule de ces théories résiste à l’examen empirique
« La question de la création monétaire reste d’une grande confusion avec des théories qui continuent de s’opposer. L’observateur occasionnel de la finance aura sans doute été étonné pendant la crise du caractère non conclusif de ces controverses, à tel point que la Banque d’Angleterre a cru bon de publier des rapports en 2014
Voir cette vidéo qui détaille les trois théories
Trois thèses concurrentes expliquent la création monétaire privée, i.e. celle des banques, qui représente 97% de la monnaie recensée par les agrégats monétaires :
- La théorie de l’intermédiation voit les banques comme des intermédiaires entre des déposants et des emprunteurs, autrement dit, comme des fonds d’investissement (SICAV…). Les banques, selon cette thèse, ne créent pas la monnaie mais l’allouent. Donc pour pouvoir prêter, les banques doivent d’abord collecter des dépôts. Cette thèse est intuitive, mais erronée. Les partisans de cette théorie contestent de ce fait que les banques aient quoi que ce soit de "spécial". La liste des soutiens de cette thèse est pourtant intimidante : Keynes (même s’il a évolué au cours du temps) ; Tobin, Gurley et Shaw… Une partie des manuels s’inspire de cette approche.
- La théorie de la réserve fractionnaire a pour elle des économistes non moins prestigieux tels que Marshall, Samuelson, Stiglitz. L’idée est que le système bancaire crée de la monnaie, pas les banques prises individuellement : un dépôt dans une banque sera recyclé en prêt, moins un pourcentage gardé en réserve à la banque centrale, la banque jugeant improbable que tous les déposants viennent chercher leur argent en même temps. L’argent ainsi prêté sera ensuite redéposé en partie dans une autre banque qui en reprêtera elle-même une partie, etc. A tout moment, le système aura ainsi créé plus de dépôts que ceux placés initialement dans les livres de chacune. Le corollaire de cette théorie est le multiplicateur monétaire : la banque centrale piloterait par son contrôle de la base monétaire (dont les réserves des banques) la masse monétaire (les crédits). Ceux des manuels qui n’épousent pas la première thèse se reportent en général sur celle-ci.
- La théorie de la création de crédit ("out of nothing" ou "out of thin air") a des partisans dans le secteur académique (Wicksell, Hahn, Schumpeter…) mais surtout fait l’objet aujourd’hui d’un relatif consensus dans le secteur officiel, la Banque d’Angleterre, la Fed, la BCE et le FMI s’étant rangés dans ce camp. La thèse défendue est que les crédits font les dépôts et que les banques seules peuvent prêter des fonds à certains agents, sans en soustraire à d’autres. Paradoxalement, il s’agit de la thèse la plus en vogue à la fin du XIX° siècle et au début du XX° siècle, supplantée pendant quasiment un siècle par les autres théories.
La théorie de la création monétaire d’un trait de plume ("out of thin air") est la seule néanmoins qui résiste à l’expérience.
L’idée que les banques sont des intermédiaires passifs est difficile à réconcilier avec l’explosion du crédit (masse monétaire). D’où viendraient les dépôts pour entretenir cette dynamique ?
L’idée que les banques accordent des prêts en fonction de l’extension ou de la constriction de la base monétaire par la banque centrale ne correspond pas à l’observation
Pour la première fois de l’"histoire" (ce qui est révélateur du faible intérêt porté à la vérification empirique par les économistes monétaires), un économiste a fait une expérience en 2014 : avec un groupe d’observateurs indépendants il a fléché, autant que possible, le processus de prêt d’une petite banque, montrant que le prêt avait été accordé sans vérifier les contraintes de réserve obligatoire ni exiger la constitution d’un dépôt préalable mais bien "out of thin air" sous la seule contrainte des ratios prudentiels, et bien sûr de l’opportunité commerciale
Le fait que la théorie de la création monétaire d’un trait de plume s’impose timidement ouvre un univers d’interrogations : l’idée du multiplicateur monétaire perd en pertinence ; l’idée que la banque centrale contrôle la masse monétaire ou même la base monétaire est erronée ; de nombreux manuels d’économie sont à réécrire. »
Dans l’ensemble de ce module (voir en particulier l’Essentiel 3, 4, 5, 6) nous développons bien sûr les éléments d’explications concernant la théorie de la création monétaire ex nihilo.
Les banques seraient de simples intermédiaires entres épargnants et emprunteurs
Les citoyens croient généralement que les banques sont de simples intermédiaires qui prêtent l’argent qu’elles ont collecté. C’est d’ailleurs souvent ainsi qu’est présenté le métier principal du banquier : l’intermédiation. Il est opposé alors au « financement direct » sur le marché. En faisant un crédit bancaire, une entreprise passerait par l’intermédiaire d’une banque pour obtenir de l’argent. A l’inverse, elle se passerait d’intermédiaire en émettant une obligation souscrite directement par un investisseur.
Cette présentation est parfois un peu nuancée par l’emploi du terme « transformation », comme l’exprimait, par exemple, Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale dans un article de 2012
« Les banques sont des acteurs majeurs dans le circuit de financement de l’économie de la zone euro par leur rôle d’intermédiation directe (crédits bancaires, produits d’épargne bilanciels…) ou indirecte (interventions diverses sur les marchés d’actions ou d’obligations (…). Au-delà de leur rôle d’intermédiaires, les banques assurent un rôle fondamental de transformation qui les différencie des autres institutions financières (tels que les assureurs et les fonds de pension). En effet, les banques transforment des flux d’épargne structurellement de court terme et liquides vers des besoins de financement de long terme et généralement moins liquides. »
Ces formulations font croire au lecteur que les banques collectent de l’épargne qu’elles prêtent ensuite (éventuellement à un horizon plus long que celui de l’épargne collectée, dont font partie les dépôts sur les comptes courants).
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 4, une banque ne fonctionne pas ainsi. L’idée selon laquelle elle prêterait des sommes collectées ne correspond pas du tout à la manière dont sa comptabilité est tenue. Quand elle fait un prêt, elle ne puise pas sur des fonds dont elle disposerait au préalable (et qui serait donc à son actif) : elle crée le prêt à l’actif, et alimente, ex nihilo, le compte bancaire de l’emprunteur (au passif). De la même manière, quand elle collecte de l’épargne ou un simple dépôt (par exemple à l’occasion d’un virement ou d’un chèque déposé par un client), l’épargne ou le dépôt ne se transforme jamais en actif : il reste à son passif, jusqu’à ce qu’il soit retiré par le client.
La notion de transformation telle que présentée habituellement est donc une expression fallacieuse. Certes, il est vrai que la durée moyenne des prêts à l’actif est supérieure à celle des dépôts et de l’épargne au passif, mais ce n’est pas en raison d’une opération de « transformation », mais bien tout simplement du fait du mécanisme de création monétaire où des dépôts (donc de très court terme) sont créés en contreparties d’un crédit (de plus ou moins long terme).
Signalons enfin ici que les banques ne se contentent pas de ce métier de prêteur. Elles ont une activité de finance de marché qui peut être majoritaire comme l’explique le site du ministère de l’Economie. Pour l’ensemble des établissements de crédit français, les prêts « classiques » à l’économie (aux entreprises et aux ménages) représentaient 30% du bilan du secteur en 2013, alors qu‘ils en représentaient 84 % en 1980 ; l’activité de marché, représentée par des titres, compte pour 27%. Comme l’explique le ministère : « C’est la conséquence du financement des banques sur les marchés financiers où elles tiennent un rôle majeur en y intervenant soit pour leur propre compte
La création monétaire publique serait inflationniste
La majorité des étudiants en économie apprennent que la « planche à billets » est inflationniste et ont retenu qu’il ne fallait pas laisser la création monétaire aux mains des gouvernements qui créeraient toujours trop de monnaie, ce qui créerait de l’inflation. On retrouve ce raisonnement inscrit dans de nombreux documents officiels ou pédagogiques.
Qu’est-ce que l’inflation ?
L’INSEE définit l'inflation comme « la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Pour évaluer le taux d'inflation on utilise l'indice des prix à la consommation (IPC). (...) Cette mesure n'est pas complète, le phénomène inflationniste couvrant un champ plus large que celui de la consommation des ménages. ». En effet, l’inflation est évaluée à partir des biens de consommation et des services mais ne concerne pas les actifs (biens immobiliers
En Europe, la lutte contre l’inflation est l’objectif principal du système européen des banques centrales tel que défini dans l’article 127 du traité de Lisbonne. Aux Etats-Unis, par contre, le rôle de la Banque centrale (la FED) est plus large puisqu’elle doit assurer la stabilité monétaire mais aussi le plein emploi.
Les faits montrent pourtant que la création monétaire, qui est aujourd’hui le fait des banques, n’est pas nécessairement inflationniste. Malgré une croissance forte de tous les agrégats monétaires (voir l'Essentiel 3) au cours des dernières décennies, les prix des biens et services courants ont été très stables.
On ne voit pas bien pourquoi la création monétaire serait plus inflationniste si elle était créée de manière publique. La théorie quantitative de la monnaie utilisée pour « démontrer » le lien entre quantité de monnaie et prix ne précise d’ailleurs pas l’origine de la dite monnaie : elle fait jouer un mécanisme de marché. Une offre excessive de monnaie (quelle que soit son origine) par rapport à la demande en ferait baisser le prix.
On ne voit pas bien non plus pourquoi le gouvernement serait amené par principe à créer plus de monnaie que le secteur privé. L’argument qui consiste à dire qu’il en abuserait pour des raisons électoralistes (hausse des dépenses publiques pour plaire à ses électeurs) ne résiste pas à l’analyse. Si son électorat est âgé, il aura au contraire intérêt à privilégier une politique restrictive afin de préserver l’épargne. On a vu à l’inverse qu’en période d’euphorie le crédit bancaire privé peut être excessif et la monnaie créée tout autant (voir l’Essentiel 5).
Si les banques centrales ont été amenées à injecter des quantités considérables de monnaie centrale, alors qu’elles sont publiques (mais indépendantes), ce n’est pas non plus par clientélisme mais pour deux raisons : soutenir les banques et tenter de relancer l’activité en réduisant les taux d’intérêt sur toutes les échéances.
L’idée reçue qui fait de la planche à billets la source de l’inflation provient en fait d’histoires d’hyperinflation, période pendant laquelle la monnaie se déprécie extrêmement vite. On se rappelle en particulier de la planche à billets pendant la Révolution française ou des brouettes de billets de la République de Weimar. D’autres pays ont connu l’hyperinflation : les anciens pays soviétiques, au moment de l’effondrement de l’URSS, le Zimbabwe, les pays d’Amérique du Sud (le Venezuela aujourd’hui). Durant ces épisodes exceptionnels, en effet, le gouvernement avait le pouvoir de création monétaire et semblait alimenter l’inflation en créant les billets à mesure de leur demande.
Pour autant, une analyse objective montre que :
- on ne peut tirer de leçon issue de ces épisodes exceptionnels applicable à la situation d’un pays en état « normal » ;
- l’hyperinflation n’est pas nécessairement créée par l’excès de monnaie en circulation ; dans le cas de la République de Weimar, elle est due aux excessives sanctions extérieures appliquées à l’Allemagne (les réparations de guerre).
La politique monétaire devrait être neutre, menée par une banque centrale indépendante et viser la stabilité des prix
L’Etat devrait se soumettre à une discipline de marché
La construction de l’euro s’est faite sur une base idéologique issue de l’ordolibéralisme allemand selon lequel l’Etat ne doit pas disposer de la planche à billets. Cette idéologie a prévalu également en France à partir des années 1960 avec une charge intense contre le circuit du Trésor et la montée en puissance de Georges Wormser, directeur de la Banque d’Escompte, Jacques Rueff, conseiller économique du général de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing et Jean Yves Haberer.
L’idée est très simple : pour éviter les dépenses publiques, qui seraient « hasardeuses », l’Etat doit agir comme un acteur privé et se procurer ses moyens de paiement auprès de banquiers ou sur le marché. Il sera ainsi obligé de se justifier publiquement (car les investisseurs en obligations souveraines sont aux quatre coins du monde), de mieux gérer ses dépenses et ses recettes, de viser l’équilibre budgétaire ou au moins de prouver sa capacité à rembourser sa dette. La monnaie doit par ailleurs être gérée par une banque centrale indépendante (voir l’Essentiel 1).
C’est ce qu’on appelle soumettre l’Etat à la discipline de marché. Benjamin Lemoine appelle ce processus « l’ordre de la dette »
Toute alternative à ce couple doctrinal (pas de recours de l’Etat à la planche à billets et indépendance de la banque centrale) exposerait la monnaie à un risque d’affaiblissement international donc à des attaques spéculatives, comme celle que George Soros a entreprise contre la livre sterling en 1992. A terme, cela pourrait conduire à une perte de souveraineté. Historiquement, des pays dont la valeur de la monnaie s’est effondrée se sont en effet retrouvés dans l’obligation de demander le soutien du FMI qui les a mis sous tutelle de fait, si ce n’est de droit.
Cette idée simple est pour le moins discutable
- Les politiques budgétaire et monétaire sont les deux leviers économiques les plus puissants dont dispose un Etat. La discipline de marché en prive de fait les Etats, puisqu’elle contraint l’Etat dans ses arbitrages budgétaires. Pourquoi en priver un gouvernement démocratiquement élu ? Pourquoi ce gouvernement serait-il fatalement conduit à faire des choix erronés ?
- Les financiers n’ont jamais discipliné aucun gouvernement ; de tout temps ils ont prêté aux dictateurs les plus féroces et organisé la corruption de l’Etat. Ils ont même participé à des fraudes permettant à certains pays ou collectivités locales de cacher aux citoyens une partie de leur dette. Ils ont également saigné la Grèce
notemon89 . - Pourquoi, d’ailleurs, les marchés financiers (en pratique les acteurs financiers) seraient-ils mieux placés que les Etats pour savoir ce qui est bon pour un pays ? Les financiers anglais ne seraient-ils pas tentés de croire au contraire que ce qui est bon pour la City l’est pour la Grande-Bretagne ?
- Le comportement des « fonds vautours », qui se spécialisent dans la dette souveraine des pays en difficulté est édifiant. En quoi l’action du fonds Elliot Associates et de ses filiales, qui ont récupéré près de 2,5 milliards de dollars sur des obligations de l’Etat argentin qu’ils avaient rachetées pour moins de 200 millions, a eu un effet positif sur l’Argentine ?
Bref, cette doctrine n’est pas fondée empiriquement ni rationnellement. Elle repose pour une large part sur la peur irrationnelle que des gouvernements de pays où les Etats sont fortement structurés se comportent comme ceux de pays complètement désorganisés
L’encouragement de l’épargne serait le meilleur moyen de stimuler l’investissement
L’activité économique repose en partie sur l’investissement, qui permet des progrès de capacité et des progrès de productivité. Concernant les enjeux climatiques, l’investissement est indispensable pour transformer le système socio-technique de sorte qu’il émette moins de gaz à effet de serre. La question de l’investissement est donc centrale au plan économique et écologique.
Vu d’une entreprise (on s’intéresse ici à l’investissement privé), l’investissement ne peut être financé que par :
- l’autofinancement (épargne de l’entreprise) ;
- le crédit ;
- l’augmentation de capital.
Le crédit et l’augmentation de capital proviennent soit du crédit bancaire (l’apporteur de capital pouvant s’endetter pour faire cet apport
La recommandation de politique économique qui en résulte est alors de stimuler l’épargne pour favoriser l’investissement. Ce peut être par exemple par des dispositifs fiscaux (comme le PEA) favorisant la détention d’actions ou l’assurance-vie.
La création monétaire par les banques invalide cette idée et en montre l’absurdité. C’est le crédit et la consommation qui accélèrent l’activité économique. Le crédit n’a pas besoin d’épargne préalable (voir l’Essentiel 4 et Idée reçue 3. En revanche, l’épargne se fait au détriment de la consommation. Favoriser l’épargne a donc un effet plutôt récessif.
Cela étant, il peut être de bonne politique, sur le plan de la transition écologique, d’inciter les citoyens à moins consommer, à plus épargner pour favoriser l’investissement vert.
Mais cette suggestion ne repose pas sur l’idée fausse que l’épargne serait nécessaire à l’investissement.

 MODULE
MODULE

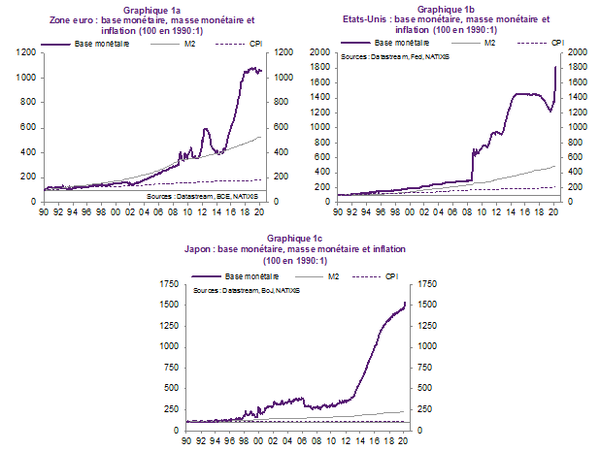
 Livres
Livres
 Commander le livre sur le site de l'éditeur
Commander le livre sur le site de l'éditeur Retour
Retour Fiche en lien
Fiche en lien

