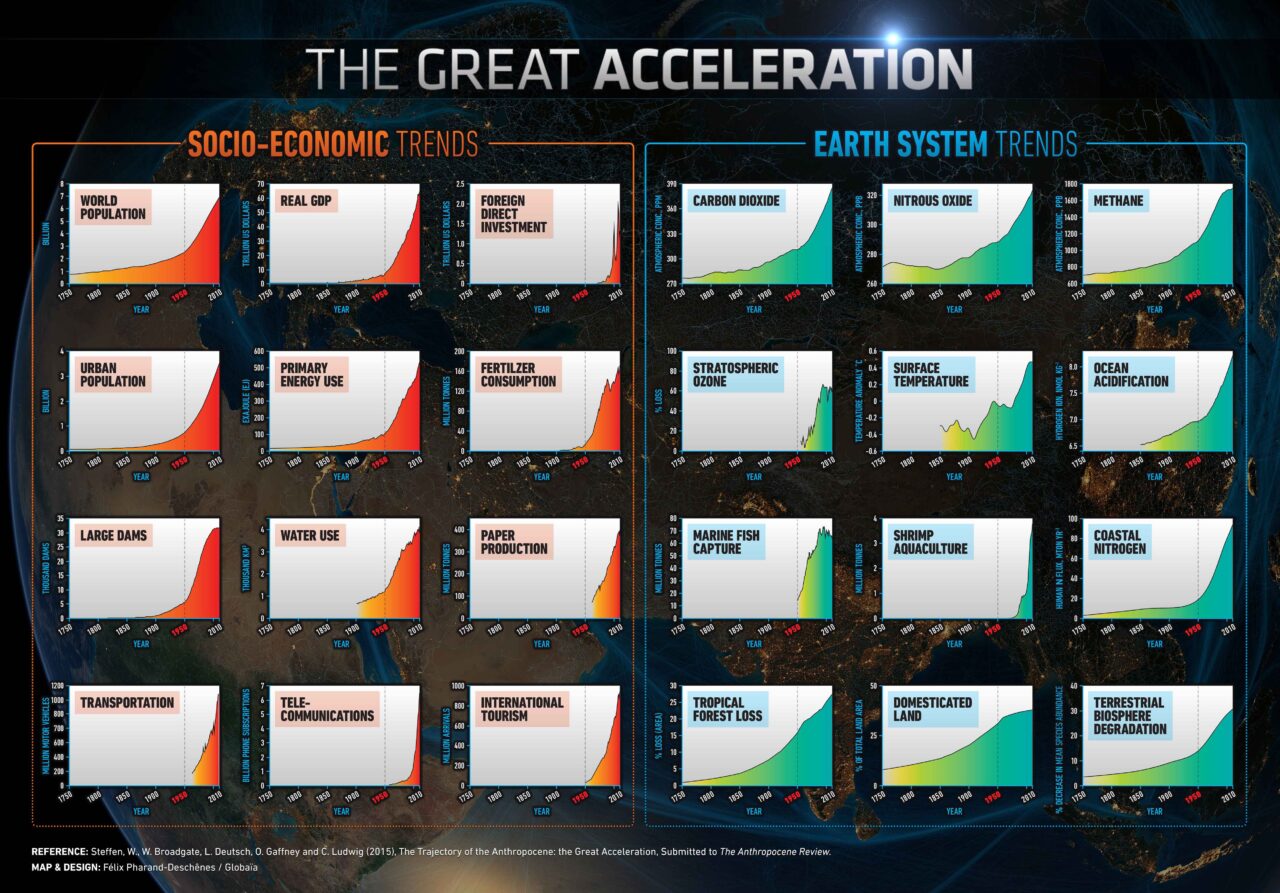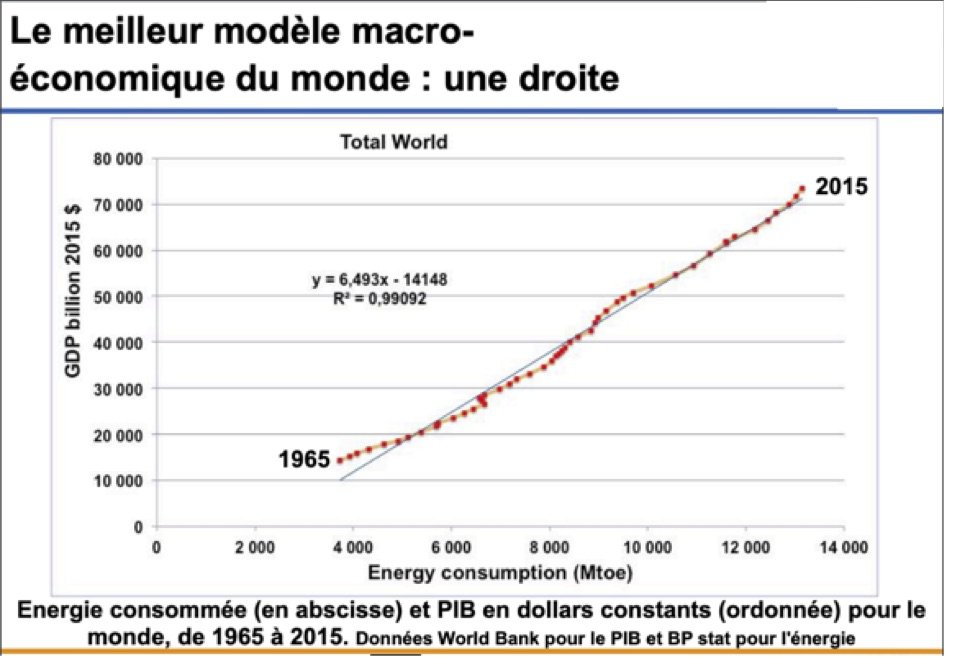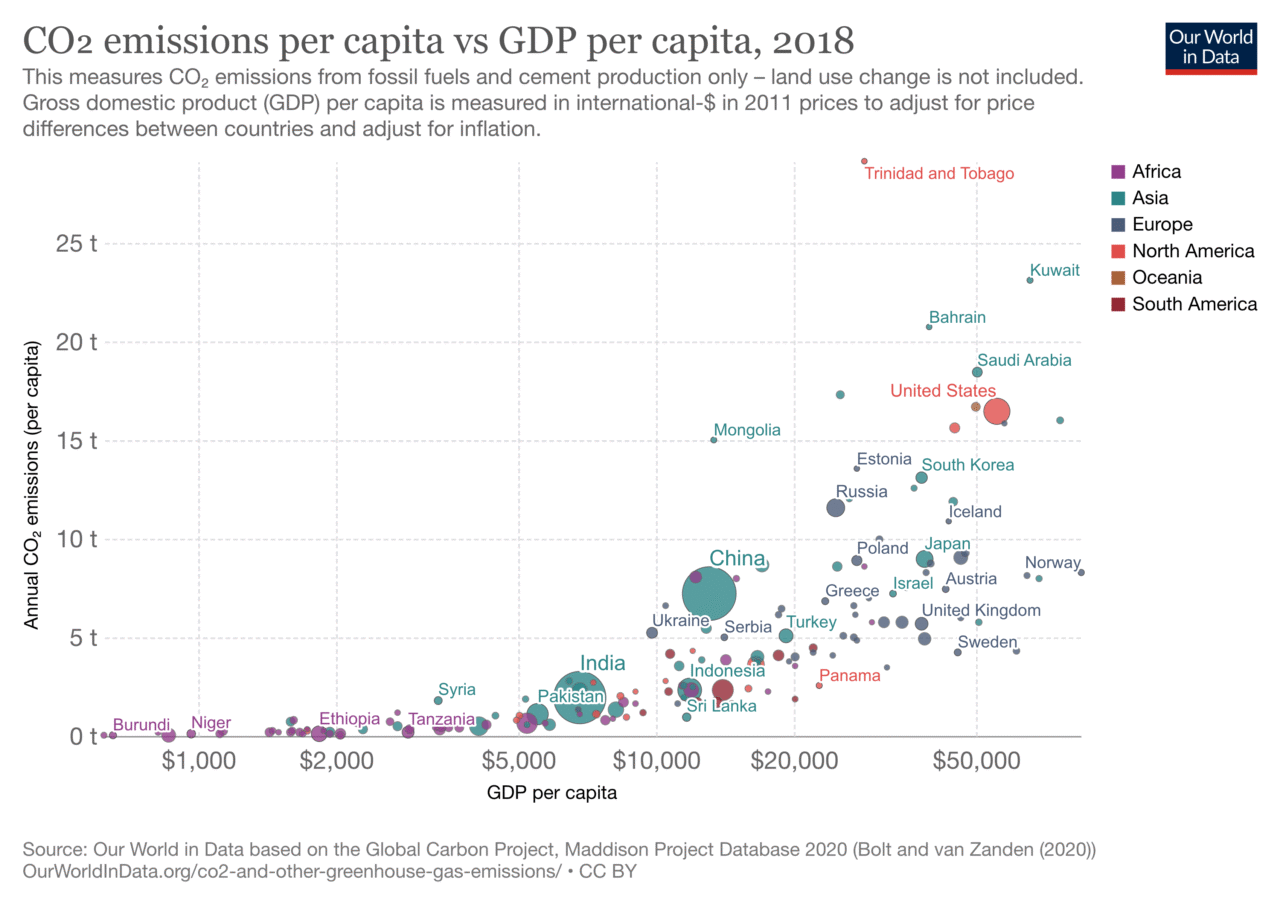Introduction
Depuis des décennies, la croissance du PIB, indicateur phare issu de la comptabilité nationale, est au cœur des discours sur les progrès de nos sociétés et des objectifs de politique économique. Après la crise du Covid en 2020 (comme après toute crise, voire toute guerre), la « reprise » de cette croissance a été célébrée comme le messie.
Pourtant, nous allons voir ici que ni le PIB ni la poursuite de sa croissance ne nous permettent de tenir compte des limites planétaires et de la justice sociale 1. Nous verrons aussi que la construction du PIB pose des questions méthodologiques d’ampleur et d’importance généralement sous-estimées. Nous verrons enfin que les ressorts de la dynamique macroéconomique (même pour les économistes qui considèrent la croissance économique comme un objectif central de la politique économique) ne sont toujours pas bien compris 2.
La question de la croissance se pose en des termes évidemment bien différents selon le stade de développement économique. Il y a assez peu de doutes 3 que pour les pays « pauvres », la croissance économique peut être bénéfique socialement et économiquement. C’est elle qui permet aux enfants et aux femmes de poursuivre un minimum d’études et devenir autonomes. C’est une condition reconnue de la transition démographique. C’est aussi le moyen de disposer d’infrastructures médicales et énergétiques minimales.
Comprendre les ressorts et les limites de la croissance serait utile pour les pays qui vont subir de plein fouet les conséquences des crises écologiques. Ce serait également utile pour l’Union européenne et le Japon qui semblent englués (depuis près de 30 ans pour le Japon et 10 ans pour l’Europe) dans une récession larvée, les rendant incapables de lancer un programme de type « green new deal » vraiment sérieux, tout en anticipant un monde post-croissance où le PIB ne sera plus l’indicateur adapté pour évaluer nos économies.
Définitions
La comptabilité nationale (CN) a pour ambition de représenter de façon globale et chiffrée les principales dimensions de l’économie d’un pays. Le cadre de CN en vigueur donne ainsi des définitions précises des grandes notions économiques et les méthodes permettant de calculer les agrégats 4 caractérisant une économie nationale. Production, consommation, investissement, PIB, chômage, dette publique, dette extérieure, patrimoine national : tous ces chiffres qui alimentent les discours politiques, économiques, médiatiques et le débat public sont issus de la CN. Au niveau international, le cadre comptable aujourd’hui en vigueur est le SCN 2008 (Système de comptabilité nationale). Il est décliné dans les différents pays et régions du monde pour tenir compte des spécificités nationales : en Europe c’est le SEC 2010 (Système européen des comptes) qui s’applique.
Le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur ajoutée agrégée produite au sein de l’économie nationale, c’est-à-dire la valeur totale de la production de biens et services moins les consommations intermédiaires (les biens et services transformés ou entièrement consommés pendant le processus productif). Cet indicateur est donc censé mesurer la valeur nouvellement créée via l’activité productive d’une économie nationale. Nous verrons dans l’Essentiel 3 les modalités détaillées de calcul du PIB ainsi que le fait qu’il peut s’interpréter de plusieurs manières différentes, ce qui en fait aussi son intérêt.
La croissance (ou croissance économique, ou croissance du PIB)
Le PIB est publié en valeur ou à prix courants (c’est le PIB nominal) et en volume ou à prix constants (c’est-à-dire le PIB nominal moins l’inflation). La croissance du PIB désigne la variation du PIB en volume d’une année sur l’autre.
Le PIB par habitant
Pour comparer l’économie de différents pays, on utilise le PIB en valeur (ou en volume) mais aussi le PIB par habitant. En effet, il est évident qu’entre un très grand pays (comme les Etats-Unis) et un petit pays (comme le Luxembourg), le seul niveau du PIB ne dit rien du niveau de vie des habitants. Pour être encore plus exact, on évalue le PIB par habitant en « parité de pouvoir d’achat », c’est-à-dire en tenant compte de ce que les revenus permettent d’acheter.
Ce module a bénéficié de la relecture et des commentaires de Didier Blanchet et de Simon Chazel (ce dernier ayant de plus co-écrit l’Essentiel 8 sur les modèles macroéconomiques). Retrouvez ici la liste de tous les contributeurs de TOE.
L’essentiel
Le PIB et sa croissance sont des indicateurs centraux des discours et politiques économiques
Le PIB est une mesure de la production nouvellement réalisée au sein d’une économie nationale au cours d’une année.
Cet indicateur, qui s’est imposé après la Seconde Guerre mondiale, occupe toujours aujourd’hui une place majeure dans l’orientation et l’évaluation des politiques publiques. Le PIB et sa croissance sont perçus comme la manifestation de la puissance des États, comme la mesure du niveau de vie des habitants et comme une condition sine qua non de l’atteinte de la plupart des objectifs de politiques publiques (lutte contre le chômage, financement des dépenses sociales, transition écologique).
La comptabilité nationale est née des grandes crises de la première moitié du XXème siècle
Si les premières tentatives d’estimation du revenu national remontent à la fin du XVIIème siècle, ce n’est qu’à partir des années 1930 que commence véritablement l’essor de la comptabilité nationale, c’est-à-dire la volonté de représenter de façon globale et chiffrée les principales dimensions (production, revenu, emploi, consommation, capital productif, dette etc.) de l’économie d’un pays.
Les deux guerres mondiales et la crise de 1929 montrèrent, en effet, aux gouvernants l’intérêt de se doter d’outils de mesure de l’économie nationale.
La crise de 1929 constitue un moment important dans l’élaboration du PIB.
D’une part, elle remet en question la conception alors dominante en économie selon laquelle l’offre créant sa propre demande , il faudrait limiter au maximum les interventions publiques pour que l’économie fonctionne au mieux. Non seulement les crises sont possibles mais en plus l’intervention de l’État apparaît nécessaire pour en sortir. Inspiré par les idées de l’économiste J.M. Keynes, le New Deal lancé par le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt en 1933 consiste ainsi à relancer l’économie en accroissant la demande globale par les dépenses publiques (grands travaux, emplois publics, dépenses sociales).
D’autre part, la crise de 1929 met en évidence l’insuffisance de l’appareil statistiques dont dispose les acteurs publics. Si l’intervention de l’État dans l’économie n’est plus taboue, encore faut-il qu’il ait des éléments permettant de guider et d’évaluer son action. C’est pour répondre à ce besoin que Simon Kuznets dirigera à la demande du Sénat américain un rapport sur l’évolution du Revenu national de 1929 à 1932 5 . Ces travaux constituent le premier calcul (sommaire) d’un indicateur approchant du PIB.
La base productive, un élément déterminant de la puissance
Les deux guerres mondiales mettent en évidence l’importance de la mobilisation de la base productive d’un pays pour tenir l’effort de guerre et emporter la victoire. Cela accroit l’intérêt des travaux visant à renforcer les outils statistiques. Au cours du premier conflit mondial, les premiers schémas des comptes nationaux sont élaborés dans différents pays 6. Quant au PIB, il s’impose à la suite de la conférence de Bretton Woods en 1944 comme l’indicateur de référence pour mesurer et comparer la taille des économies.
L’après-guerre voit cette dynamique de production statistique et comptable s’approfondir pour accompagner la reconstruction de l’Europe et, aux États-Unis, la réorientation de la production de guerre vers les biens et services du temps de paix ainsi que leur écoulement. Les Trente Glorieuses, marquées par une forte croissance, le plein emploi et l’élévation des niveaux de vie, valident, dans l’imaginaire collectif, la croissance économique comme instrument de progrès social.
La comptabilité nationale se développe en parallèle dans différents pays avant d’être uniformisée au niveau international avec l’adoption du Système de comptabilité nationale 1993 7 (qui sera mis à jour une fois pour donner le SCN 2008).
Le SCN est une nomenclature très détaillée qui explique l’ensemble des définitions, règles et conventions permettant d’élaborer la comptabilité nationale et les grands agrégats économiques d’un pays. Il s’applique à tous les États du monde même si certains pays et zones peuvent l’adapter aux spécificités locales. Ainsi, dans l’Union européenne c’est le Système européen des comptes (SEC 2010) qui s’applique.
Une des grandes forces du PIB, et plus généralement de la comptabilité nationale, réside d’ailleurs dans cet universalisme des normes et conventions : cela rend possible les comparaisons dans le temps et entre pays.
Ce bref historique montre à quel point l’élaboration de la comptabilité nationale (et de son indicateur central le PIB) est le résultat des événements dramatiques de la première moitié du XXème siècle. Le PIB, en tant qu’indicateur, est né parce qu’il est apparu nécessaire de mesurer finement la production pour sortir de la crise et appuyer l’effort de guerre puis de reconstruction. De telles préoccupations n’ont pas disparu aujourd’hui.
« À côté de la mobilisation des ressources pour l’économie de guerre, ce sont les tentatives de forger une gestion de la demande effective pour sortir du marasme économique provoqué par la crise financière de 1929 qui ont suscité la mise en place de la comptabilité nationale. La focalisation sur le PIB n’est donc pas une simple convention. Elle est certes issue d’une trajectoire historique singulière, combinaison des expériences des guerres du XXe siècle et de la Grande Dépression. Mais ces deux sources dérivent de contraintes toujours actives : d’une part, les rapports de force au sein du « concert des nations » ; d’autre part, le poids électoral d’une politique de soutien à l’emploi. La poursuite de la croissance répond donc en partie à des impératifs structurels. »
Près d’un siècle après sa naissance, le PIB reste au cœur des discours et des politiques économiques
Dans une étude de 2013, le think tank The Shift Project a classé les différents usages du PIB afin d’évaluer dans quelle mesure d’autres indicateurs pourraient le remplacer.
Comme on peut le voir dans l’encadré ci-après, cette classification donne l’impression d’un indicateur « à tout faire » omniprésent quel que soit le sujet traité. Il permet ainsi autant de rendre compte de la puissance d’un Etat (comparaison des pays en fonction de leur PIB en valeur) ou de sa richesse (comparaison du PIB/habitant), que de calibrer les politiques publiques (limiter les dépenses publiques, fixer des objectifs environnementaux, des objectifs en R&D), d’établir les prévisions budgétaires ou encore de calculer les contributions des Etats à divers organismes internationaux.
Le PIB, un indicateur à tout faire
Les usages symboliques
Le PIB est utilisé pour créer et partager une représentation commune d’un concept donné (la richesse, la puissance, le progrès). Ces usages symboliques se manifestent également dans la volonté d’en faire l’étalon de comparaison de toute donnée économique : dépenses d’éducation/PIB, de santé/PIB, d’investissement/PIB.
Les usages opérationnels
Le PIB est utilisé pour déclencher une action concrète. Par exemple : définir la contribution (et souvent les droits de vote) des États à des budgets supranationaux 9 (budget européen, du FMI, de la Banque mondiale) ; distribuer des fonds internationaux (fonds européens de développement régional ou aide au développement distribués en fonction du PIB/habitant) ; établir les prévisions budgétaires (les prévisions d’évolution du PIB sont utilisées pour estimer un niveau de recettes budgétaires et donc une capacité de dépense).
Les usages politiques
Le PIB est utilisé par les gouvernements nationaux ou les institutions supranationales pour légiférer ou réglementer (encadrer la dépense publique 10, fixer les objectifs de politiques particulières 11).
Source Les usages du PIB, The Shift Project, 2013
Cette multiplicité des usages du PIB montre bien la centralité de cet indicateur. La majorité des chefs de gouvernement pose la croissance du PIB comme objectif principal des politiques économiques voire des politiques publiques en général. Elle est perçue non seulement comme une manifestation de la puissance et de la richesse d’un pays mais aussi de sa capacité à répondre aux multiples défis écologiques et sociaux.
Pour résumer, le raisonnement qui appuie cette croyance profondément ancrée est le suivant : la croissance du PIB permettrait d’augmenter l’emploi, le pouvoir d’achat, la capacité d’investissement et d’innovation. Des conditions nécessaires d’une part à une amélioration du bien-être ou du bien-vivre collectif, et, d’autre part, à la résolution des problèmes écologiques, grâce à la science, la technique et l’ingéniosité humaine. Ce sont clairement les arguments invoqués par les économistes quand il s’agit de parler de croissance et d’écologie.
L’impératif de croissance pour mener la transition écologique
Rappelons tout d’abord que la grande majorité des économistes qui travaillent sur la croissance n’incluent pas la question écologique dans leurs travaux (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions).
Les « schumpéteriens » 12 pensent que « l’innovation verte » est la solution au problème que pose le caractère polluant de la croissance du PIB. Ces partisans de la « croissance verte » considèrent celle-ci comme la voie de la transition écologique en permettant le progrès technique nécessaire. Nous y reviendrons dans l’Idée reçue 6.
Pour les « socio-libéraux », la croissance c’est d’abord plus de revenus, et donc davantage de moyens pour améliorer le sort des populations et réduire les inégalités sociales. La lutte contre le changement climatique ne sera pas possible sans croissance permettant de compenser les pertes de revenus des perdants de la transition (qui supprimera des emplois dans les activités dépendantes des énergies fossiles).
Pour les néo-keynésiens, la réduction des émissions de gaz à effet de serre demande beaucoup d’investissements, ce qui génère donc plus de croissance au moins au début.
Malgré une reconnaissance croissante des limites du PIB, il reste au cœur des objectifs affichés par les politiques
Comme on le verra dans l’Essentiel 5 et 6, le PIB et la recherche de sa croissance font l’objet de nombreuses critiques : ils ne constituent pas une garantie d’amélioration des conditions de vie des populations et la croissance s’accompagne de dégradations environnementales massives.
Initialement portées par des chercheurs ou des militants, les constats sur les insuffisances du PIB en tant qu’indicateur de la bonne santé d’une société font désormais l’objet d’une assez large reconnaissance institutionnelle dont témoignent par exemple les initiatives européennes visant à aller au-delà du PIB en mettant d’autres objectifs au cœur des politiques publiques (voir ci-après). Cependant, malgré ces évolutions positives, force est de constater que l’objectif de croissance (désormais qualifiée de verte, durable ou inclusive) reste central.
Le développement d’une stratégie « au-delà du PIB » dans l’Union européenne
La reconnaissance institutionnelle des limites du PIB passe d’abord par des travaux de recherche. C’est ainsi qu’en 2007, la Commission européenne lance l’initiative Beyond GDP (Au-delà du PIB) afin d’élaborer des « indicateurs aussi clairs et attractifs que le PIB, mais tenant davantage compte des aspects environnementaux et sociaux du progrès ». Elle aboutit en 2009 à la publication de la feuille de route Le PIB et au-delà : mesurer le progrès dans un monde en mutation 13.
La même année parait le rapport de la Commission Stiglitz, Sen et Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès social, commandé par le président de la République française. Composée d’économistes éminents dont plusieurs prix Nobel, les travaux de cette commission marquent une étape importante dans la reconnaissance institutionnelle des limites du PIB, car si les critiques sont largement connues, c’est la première fois qu’elles sont émises par des économistes du courant dominant. Les recommandations du rapport sur la mesure du bien-être et de la soutenabilité vont alimenter les travaux divers organismes statistiques européens.
Au niveau politique, le début du XXIème siècle est également marqué par la montée de l’affichage d’objectifs sociaux et écologiques. C’est par exemple le cas de la stratégie UE 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, adoptée en 2010 14.
Dans ses Conclusions du 24 octobre 2019, le Conseil de l’Union européenne invite les États membres et la Commission à « intégrer le souci de l’économie du bien-être de manière horizontale dans les politiques nationales et de l’Union et à placer les personnes et leur bien-être au cœur de l’élaboration des politiques. »
Entrée en fonction fin 2019, la Commission présidée par Ursula Van der Leyen va plus loin en faisant du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) une de ses six priorités stratégiques. A la suite de la pandémie de la COVID-19, la résilience 15 devient « une nouvelle boussole pour les politiques de l’UE. »
Malgré ces avancées, l’objectif de croissance reste prépondérant
Ainsi, la prise en compte de l’économie du bien-être dans toutes les politiques publiques est justifiée par le fait qu’elle « revêt une importance capitale pour la croissance économique, la productivité, la viabilité budgétaire à long terme et la stabilité sociale de l’Union. » L’infographie réalisée par le Conseil européen pour expliquer ce qu’est l’économie du bien-être montre à quel point bien-être des populations et croissance économique restent intrinsèquement liés dans les discours officiels.
Le Pacte vert pour l’Europe est décrit par la Commission comme une « nouvelle stratégie de croissance » qui « vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. »
Voici la trajectoire présentée par la Commission pour atteindre l’objectif de neutralité climatique au cœur du Pacte vert :
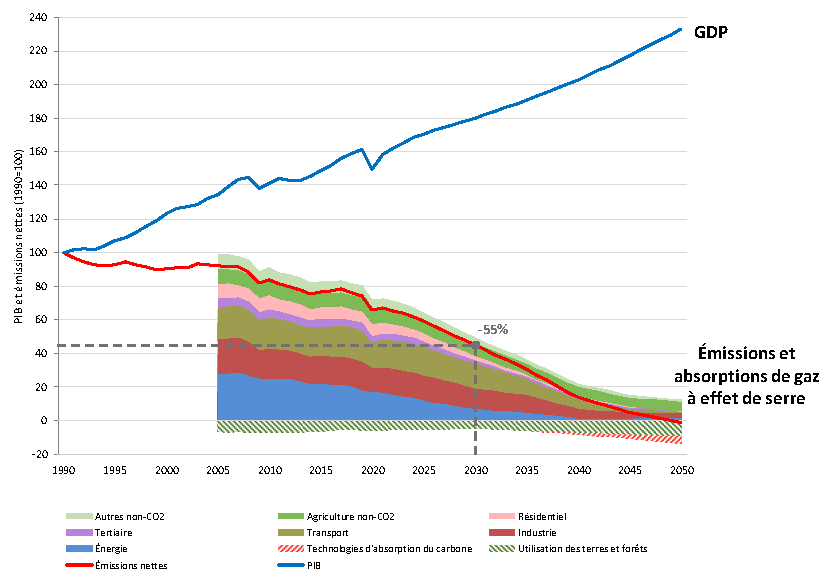
Source Stepping up Europe’s 2030 climate ambition – Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people, Communication de la Commission européenne, COM/2020/562
Comme on peut le constater, la croissance du PIB reste au centre de l’analyse. La présence d’un tel graphique dans un document dédié à la politique climatique illustre combien cet objectif reste perçu comme au moins équivalent à celui de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, voire en constitue la condition.
Dernier exemple, dans la Déclaration de Porto sur les questions sociales adoptée le 8 mai 2021, les chefs d’États réunis au sein du Conseil européen saluent « le fait que les partenaires sociaux européens aient élaboré une proposition conjointe relative à un ensemble alternatif d’indicateurs permettant de mesurer les progrès économiques, sociaux et environnementaux, qui viendrait compléter le PIB en tant que mesure du bien-être au service d’une croissance inclusive et durable. » La légitimité des indicateurs alternatifs est pleinement reconnue mais la croissance reste l’objectif final.
Pour en savoir plus
- Les usages du PIB, The Shift Project, 2013
- Antonin Pottier, « Les nouveaux indicateurs de richesse modifieront-ils la croissance ? Les limites de la critique du PIB », Le Débat, 2018.
- Benjamin Brice, « Pourquoi sommes-nous si attachés à la croissance ? », Blog Un autre cap, 20 octobre 2021.
- François Fourquet (dir.), Les comptes de la puissance : histoire de la comptabilité nationale et du plan, éditions Recherches, 1980.
Les pays de l’Union européenne mènent des politiques d’austérité en croyant être « croissantistes »
Si l’objectif de croissance est commun à la majorité des gouvernements du monde, les politiques destinées à la favoriser peuvent être très différentes d’un pays à l’autre selon les idées économiques dominantes.
Politiques keynésiennes versus réformes structurelles
Pendant les Trente Glorieuses, ce sont les politiques d’inspiration keynésienne qui s’imposent. Elles reposent sur l’importance accordée à la demande globale et au pilotage de l’économie par la puissance publique : strict contrôle du secteur financier, politique de valorisation des salaires et de redistribution, relance via la dépense publique (grands travaux) en cas de ralentissement économique, stratégies industrielles volontaristes etc.
Depuis les années 1970, des politiques d’inspiration néolibérale se sont imposées. Il s’agit de « libérer » la croissance en agissant sur l’offre via l’allégement des réglementations et des contraintes (notamment fiscales) pesant sur les entreprises et les investisseurs, la dérèglementation financière, la mise en place de réformes structurelles portant sur le coût, la durée et l’organisation du travail ainsi qu’à travers la maîtrise des dépenses publiques (qui pèseraient sur les charges des entreprises et nuiraient à leur compétitivité).
L’Union européenne a été le plus loin dans cette voie : les principes économiques relevant de ce type de politiques ont été inscrits au cœur des traités européens, c’est-à-dire tout en haut de la hiérarchie des normes de l’UE. 16
Le PIB potentiel au cœur du logiciel européen
Depuis le traité de Maastricht en 1992, la gouvernance économique européenne est centrée autour de deux règles budgétaires : le déficit public des Etats membres doit être inférieur à 3% du PIB et leur dette publique à 60% du PIB.
Ces règles ont ensuite été précisées pour tenir compte du fait que le solde des comptes publics dépend en partie de la conjoncture : une crise économique peut provoquer une hausse conjoncturelle du déficit (moindre rentrées fiscales, hausse des dépenses sociales, politiques de relance). Dès lors, les instances européennes et nationales se sont attachées à calculer le solde public structurel (c’est-à-dire celui qui aurait été constaté si le PIB était à son potentiel – voir encadré) avec pour objectif qu’il soit à l’équilibre.
Le PIB potentiel
Le PIB potentiel est un indicateur non observable sensé mesurer ce que serait le PIB d’un pays si les capacités de production (le travail et le capital productif) étaient utilisées à leur maximum sans générer d’inflation. Le calcul du PIB potentiel permet de déterminer un autre indicateur non observable : le solde public structurel.
En savoir plus avec notre fiche sur le PIB potentiel et le déficit structurel
Ces considérations ne sont pas que théoriques ou techniques : elles impactent profondément les politiques publiques européennes en vue de faire en sorte que l’économie de chaque pays atteigne son potentiel maximum de production.
Les « bonnes » dépenses publiques, les « bonnes » mesures de politiques économiques sont celles qui font rejoindre le sentier de croissance potentielle. Il s’agit de combler l’« output gap », c’est-à-dire l’écart entre la croissance constatée et la croissance potentielle.
D’un point de vue économique, il est effectivement souhaitable d’utiliser à plein les facteurs de production que sont le travail et le capital physique (les machines, les usines) 17. Cependant, les méthodologies utilisées pour calculer cet écart sont plus que contestables scientifiquement (voir la fiche sur le PIB potentiel et le déficit naturel), de même que les mesures de politiques publiques mises en avant dans les textes européens afin de réduire « l’output gap ».
Il s’agit, en effet, de réformes dites « structurelles », qui concernent essentiellement la baisse des dépenses publiques, la flexibilisation du marché du travail et l’innovation. C’est ainsi que sont justifiées « l’allègement » du droit du travail, la suppression des « rentes de situation », la simplification administrative, la déconstruction des services publics etc. Bref, les mesures qui sont au centre des programmes économiques des dirigeants européens depuis plusieurs décennies.
En pensant mener des politiques de croissance, les gouvernants européens mènent en réalité des politiques d’austérité qui posent évidemment des problèmes majeurs pour investir dans la transition écologique.
Le calcul du PIB repose sur de nombreuses conventions
Nous nous penchons ici sur la façon dont le PIB est calculé, en détaillant notamment la façon dont chacun des grands secteurs institutionnels (voir encadré) contribue à sa formation.
Nous verrons en particulier qu’il résulte de très nombreuses conventions, qui sont elles-mêmes interprétées par les comptables nationaux. Ceci rend les comparaisons internationales bien moins évidentes qu’il n’y parait. Nous verrons également à quel point le PIB est un indicateur riche en informations à partir du moment où on entre dans le détail de sa décomposition.
Le produit intérieur brut est le principal agrégat mesurant l’activité économique d’un pays. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités économiques résidentes de ce pays une année donnée, évaluées au prix du marché.
Il donne une mesure des richesses nouvelles créées chaque année par le système productif du pays et permet des comparaisons internationales.
Comme l’illustre la définition ci-avant, le PIB est traditionnellement présenté comme une mesure de l’activité productive d’un pays. Nous allons voir qu’il existe en réalité trois façons de le calculer : par la production, par les revenus et par les dépenses. C’est assez logique : la production de biens et services permet la distribution de revenus qui servent eux-mêmes à consommer et à investir.
L’économie nationale et les secteurs institutionnels
En comptabilité nationale, l’économie nationale est constituée de l’ensemble des unités institutionnelles résidentes c’est-à-dire les différents agents économiques ayant la capacité de détenir des biens et des actifs, de s’endetter, d’exercer des activités économiques, bref de réaliser des opérations économiques avec d’autres unités.
Une unité est dite résidente à partir du moment où elle exerce des activités économiques sur le territoire du pays pendant un an ou plus. Ce n’est donc pas un critère de nationalité : un travailleur immigré fait partie de l’économie nationale française mais pas un Français travaillant à l’étranger.
Les unités institutionnelles sont regroupées en cinq grands secteurs : les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, les ménages (ce secteur comprend aussi les entreprises individuelles) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (les ISBL).
Les unités institutionnelles résidentes peuvent entretenir des relations avec des unités non résidentes qui sont regroupées dans un 6ème secteur, celui du « reste du monde ».
Le calcul du PIB par la production
Le PIB n’est pas une mesure de la production au sens strict mais de la valeur ajoutée (VA) générée par les différentes unités résidentes d’une économie nationale au cours d’une année.
Comme son nom l’indique, la VA c’est la valeur de la production qui a été ajoutée à l’économie nationale. Pour la calculer, il est donc nécessaire d’éliminer les doubles comptes c’est-à-dire les biens et services vendus par certains producteurs qui entrent dans la production d’autres biens et services.
Pour calculer le PIB il faut donc :
- Additionner la valeur de la production (marchande, non marchande ou pour emploi final propre – voir encadré) réalisée par tous les producteurs sur une année.
- Puis, pour éviter les doubles comptes, retrancher les consommations intermédiaires (c’est-à-dire les biens et services transformés ou entièrement consommés lors du processus productif).
- Enfin, pour obtenir le PIB, il faut passer du prix de base (celui reçu par le producteur) au prix d’acquisition (celui payé par les consommateurs finaux). On ajoute donc les impôts sur les produits (les impôts, telle la TVA, payés par les consommateurs finaux au moment de l’achat) et on retranche les subventions sur les produits (subventions versées au producteur pour réduire les prix payés par les consommateurs finaux).
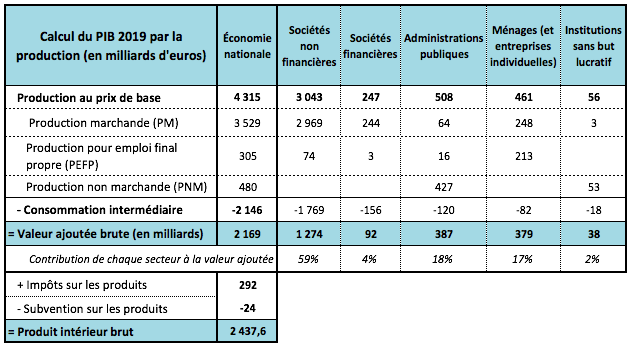
Source Comptes de la Nation 2020, Insee, Tableau économique d’ensemble 2019 (compte de production)
En 2019, le PIB de la France s’élevait à 2437,6 milliards d’euros. La valeur ajoutée était générée à près de 59% par les entreprises non financières, à 18% par les administrations publiques et à 17% par les ménages. Notons au passage que les dépenses publiques représentent bien une contribution au PIB et non un prélèvement sur le PIB comme souvent mis en avant.
Notons qu’il est également possible de décomposer le PIB non pas en fonction des secteurs institutionnels mais en fonction des branches d’activités (agricultures, industries, services etc.)
Les comptables nationaux distinguent trois types de production
La production marchande (PM) est écoulée ou destinée à être écoulée sur un marché. Elle comprend essentiellement les biens et services vendus à un prix « économiquement significatif » (c’est-à-dire couvrant plus de 50% des coûts de production) ou entrant dans les stocks des producteurs 18.
La production non marchande (PNM) est fournie gratuitement (ou à un prix « économiquement non significatif »). Elle regroupe des services qui ne sont pas vendus car ils sont indivisibles (défense, police, éclairage public, entretien des espaces naturels) ou par volonté politique (éducation, santé, accès à la culture etc.). Elle est essentiellement réalisée par les administrations publiques.
La production pour emploi final propre (PEFP) est la production de biens et services destinés à la consommation finale ou à l’investissement du producteur lui-même. Seuls les ménages réalisent une PEFP destinée à leur propre consommation finale (produits agricoles conservés par les agriculteurs, services de logement produits par les propriétaires-occupants, services domestiques résultant de l’emploi de personnels rémunérés). Tous les secteurs peuvent réaliser une PEPF destinée à leur propre investissement : activités de recherche, élaboration de logiciels, fabrication de machines-outils, construction (y compris celle de logements par les ménages) 19.
Comment sont définies les limites de la production ?
Dans le SEC 2010 20, la production est définie comme « une activité exercée sous le contrôle, la responsabilité et la gestion d’une unité institutionnelle qui combine des ressources – main-d’œuvre, capital, biens et services – pour fabriquer des biens ou fournir des services. Ne font pas partie de la production les processus naturels sans intervention ou contrôle humain. » (p.58)
- La croissance spontanée des ressources naturelles (les poissons dans l’océan, les forêts primaires, le renouvellement des nappes phréatiques etc.) est donc exclue de la production. A l’inverse, la croissance des poissons dans les alevinières, des animaux élevés, des arbres cultivés pour leurs fruits ou leur bois font partie de la production. Cela explique pourquoi couper à blanc une forêt primaire ou mettre en culture une réserve naturelle se traduisent par une hausse de la production (et sont donc comptées positivement dans le PIB).
- L’économie non observée 21 fait théoriquement partie de la production. Par exemple, les comptables nationaux doivent essayer d’inclure la production « souterraine » 22, c’est-à-dire non déclarée pour éviter l’impôt (sous-déclaration de chiffre d’affaires) ou les cotisations sociales (travail non déclaré) en faisant des estimations à partir de sources indirectes (comme les redressements fiscaux). Certaines activités illégales sont également incluses dans le périmètre de la production, à partir du moment où elles font l’objet d’un « commun accord » (par exemple : le vol est exclu, mais la vente de biens volés est incluse). De nombreux débats ont eu lieu autour de la question de l’inclusion de la drogue et de la prostitution. 23
- La production comprend également des activités non marchandes ou réalisées pour soi-même (voir encadré ci-avant). Là aussi les limites de ce qui entre ou pas dans le PIB sont fixées conventionnellement. C’est ainsi que la production de biens (alimentaire, construction) par les ménages destinés à leur propre consommation fait partie de la production. Par contre, les services domestiques (cuisine, ménage, garde d’enfant, soins aux malades et aux personnes âgées) ne rentrent pas dans le calcul de la production (à moins d’être réalisés par des employés rémunérés).
Comment la valeur de la production est-elle calculée ?
Si la valeur de la production marchande est déterminée par les prix de vente, ce n’est pas le cas des deux autres types de production.
La PEFP est « estimée sur la base de produits similaires vendus sur le marché. Cette production génère donc un excédent net d’exploitation ou un revenu mixte. » S’il n’existe pas de prix de marché pour des produits similaires, la PEFP « est évaluée aux coûts de production, majorés d’un montant correspondant à l’excédent net d’exploitation ou au revenu mixte escompté ». 24
La PNM est évaluée en faisant la somme des coûts de production. 25 Cette méthode a fait l’objet de nombreux débats entre comptables nationaux. 26 Si elle a l’avantage de reposer sur des grandeurs mesurables, elle n’en reste pas moins largement conventionnelle, et il pourrait y avoir d’autres façons de l’évaluer. Par exemple, si la PNM intégrait comme la PEFP une marge du producteur (excédent d’exploitation ou revenu mixte), son montant serait plus élevé ce qui conduirait à augmenter le PIB des pays dans lesquels les services publics occupent une place importante.
Le calcul du PIB par la demande (ou par les dépenses)
Le PIB peut également être calculé en faisant la somme de toutes les dépenses finales (donc hors consommations intermédiaires) effectuées par les unités résidentes, à laquelle on ajoute le solde des échanges de biens et services avec le reste du monde.
Cette approche permet de comprendre si le PIB est plutôt tiré par la consommation finale ou par l’investissement. Le solde des échanges permet de voir dans quelle mesure la demande intérieure dépend des importations (si ce solde est négatif) ou dans quelle mesure la demande extérieure contribue au PIB (si ce solde est positif).
Par exemple, en 2019, la consommation finale représentait environ 77% du PIB de la France et l’investissement (la FBCF – voir encadré), près de 23%.
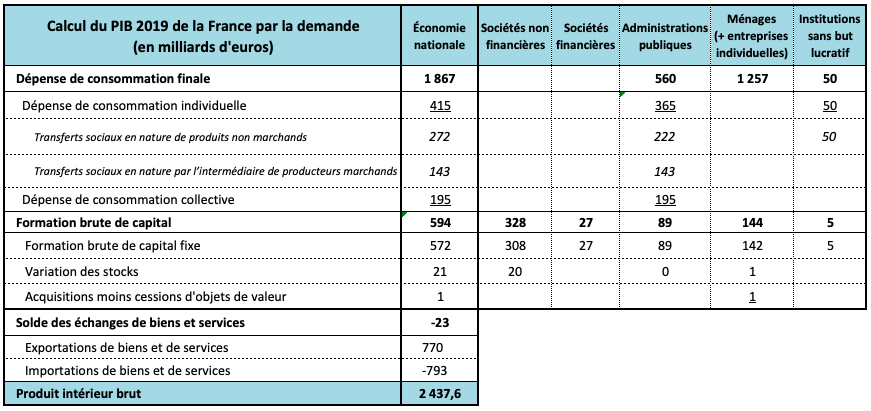
Source Comptes de la Nation 2020, Insee, Tableau économique d’ensemble 2019 (compte de d’utilisation du revenu et compte de capital)
La dépense de consommation finale
Elle recouvre « les dépenses consacrées par les unités institutionnelles résidentes à l’acquisition de biens ou de services qui sont utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs des membres de la communauté. » 27
Elle est essentiellement le fait des ménages et comprend tous les biens et services achetés (hors logement, considéré comme un investissement) ainsi que ceux qui relèvent de la production pour emploi final propre.
Cette façon d’envisager la consommation finale des ménages est assez restrictive car elle écarte les dépenses qui bénéficient aux ménages mais qui sont à la charge des administrations publiques (éducation, santé, culture etc.) ou des institutions sans but lucratif (voir encadré).
Les sociétés (financières et non financières) n’ont aucune dépense de consommation finale. Leurs achats de biens et services servent soit à leur consommation intermédiaire (et sont alors exclus du PIB), soit à la rémunération des salariés en nature (ils sont alors imputés à la consommation finale des ménages), soit à l’investissement (voir ci-après).
Le calcul de la dépense de consommation finale des administrations publiques
Comme on l’a vu, les administrations publiques (APU) produisent des services non marchands pour le reste de la société. Ceux-ci n’étant pas vendus et donc n’étant pas acquis directement par les autres unités institutionnelles, les comptables nationaux considèrent en première analyse que cette production non marchande (PNM) est consommée par les APU elles-mêmes.
On obtient alors leur dépense de consommation finale en additionnant : i/ la valeur de la PNM 28 et ii/ les dépenses que les APU effectuent auprès de producteurs marchands pour payer des biens et des services fournis aux ménages (remboursements de médicaments, d’appareils médicaux, de consultations médicales, aides au logement etc.)
Elle est ensuite scindée en deux grandes catégories :
– la dépense de consommation individuelle recouvre les dépenses dont les bénéficiaires peuvent être identifiés. Il s’agit principalement de la PNM de services de santé et d’éducation ainsi que des paiements réalisés aux producteurs marchands.
– la consommation collective comprend la PNM qui bénéficie à l’ensemble de la collectivité (défense, police, justice, administration générale etc.) et n’est donc pas individualisable.
L’approche est la même pour les Institutions sans but lucratif : leur PNM est affectée à leur dépense de consommation individuelle.
La formation brute de capital (FBC)
La FBC est obtenue en additionnant la formation brute de capital fixe (FBCF), la variation des stocks et les acquisitions moins les cessions d’objets de valeurs (bijoux, objets d’arts, pierres et métaux précieux détenus à titre de réserve de valeur).
La formation brute de capital fixe (FBCF) est le nom donné à l’investissement productif réalisé au cours d’une année par les différents acteurs économiques. Elle est constituée des acquisitions 29 moins les cessions d’actifs fixes (voir encadré) effectuées par les producteurs.
Les différentes catégories d’actifs fixes
Les actifs fixes sont les biens et services produits pour être utilisés dans les processus de production sur le long terme (plus d’un an).
Ils peuvent être corporels (bâtiments, matériel de transport, ouvrages de génie civil, machines, équipements des technologies de l’information et de la communication (TIC), ressources biologiques cultivées animales ou végétales) ou incorporels (logiciels, recherche et développement, droits de propriété intellectuelle, acquisition d’œuvres récréatives, artistiques ou culturelles originales). Les biens durables acquis par les ménages pour leur consommation (électroménager, voitures, TV, matériel informatique) ne sont pas comptés dans la FBCF mais dans la consommation finale. Par contre, l’acquisition de logements est comptée dans la FBCF car elle permet aux ménages de produire des « services de logement » (via la location ou l’emploi final propre).
Source La liste des actifs fixes (ainsi que leur évolution) peut être consultée sur le site de l’Insee.
La délimitation entre investissement (FBCF) et consommation intermédiaire n’est pas figée
Les notions de consommation intermédiaire et d’investissement désignent toutes deux des biens et services utilisés lors du processus productif.
Elles se différencient par le temps d’utilisation : dans le premier cas, les biens et services sont entièrement transformés ou consommés pendant la production ; dans le second cas, ils servent sur le long terme.
Concernant le PIB, cette distinction a une importance fondamentale puisque la valeur des consommations intermédiaires est déduite de la production alors que ce n’est pas le cas pour les investissements. Or, la délimitation du périmètre de ces deux notions a évolué dans le temps.
Par exemple, l’acquisition de matériels militaires 30, de services de recherche & développement ou de logiciels et bases de données était classée dans les consommations intermédiaires jusqu’en 2014 (date à laquelle le nouveau système européen des comptes, le SEC 2010, a été mis en œuvre par les comptables nationaux des pays européens). Ensuite, ces différents postes ont été classés dans l’investissement. Cela a, par exemple, engendré une hausse du PIB de la France d’environ 46 milliards d’euros en 2010. 31
Le PIB n’intègre pas la consommation de capital fixe (usure des machines, des bâtiments, des infrastructures)
Le PIB est censé mesurer la valeur ajoutée, c’est-à-dire la valeur nouvellement créée par la production dans un pays. C’est pour cela qu’on déduit la valeur des consommations intermédiaires.
Dans la même logique, il faudrait également déduire l’usure du stock de capital fixe (appelée consommation de capital fixe – CCF). En effet, les machines, les bâtiments, les infrastructures se détériorent au fur et à mesure du temps. Certains équipements (en particulier les TIC, les logiciels et bases de données) peuvent devenir obsolètes. Tout cela représente une réduction de la valeur ajoutée.
La consommation de capital fixe est toutefois difficile à évaluer. Tous les pays ne réalisent pas ce type de calcul et ceux qui le font peuvent utiliser des méthodes différentes. 32
L’usage est donc de retenir comme indicateur clef le PIB et non le PIN (produit intérieur net), même si celui-ci est également calculé par les comptables nationaux. 33 Cela ne permet donc pas de percevoir la dégradation du capital fixe, ce qui est un problème, par exemple, quand la part des achats de logiciels et de matériel informatique est importante dans la FBCF car les durées de vie de ces investissements sont courtes. Le PIB (qui inclut la CCF) peut donc augmenter plus vite que le PIN et ainsi cacher l’obsolescence du capital productif.
Le calcul du PIB par le revenu
Enfin, le PIB peut également être calculé comme la somme des revenus distribués par les producteurs lors du processus de production.
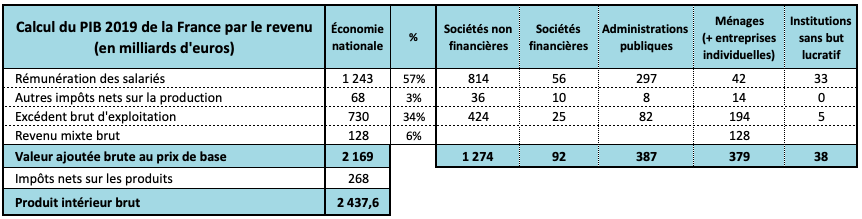
Source Comptes de la Nation 2020, Insee, Tableau économique d’ensemble 2019 (compte d’exploitation)
On voit sur le tableau ci-dessus que les revenus provenant de la rémunération des salariés représentaient 1243 milliards d’euros en 2019, soit 57% de la valeur ajoutée. Ils étaient principalement versés aux salariés par les sociétés non financières (814 milliards), puis par les administrations publiques (297 milliards).
Le PIB se calcule en additionnant :
- La rémunération versée par les producteurs aux salariés (qui inclut les cotisations sociales salariales et patronales) ;
- Les « autres impôts nets sur la production » 34, versés par les producteurs aux administrations publiques ;
- L’excédent brut d’exploitation (EBE), qui correspond à ce qui reste au producteur une fois que les charges directes liées à la production ont été payées (les salaires, les impôts nets liés à la production et les consommations intermédiaires). C’est un indicateur du profit que les producteurs ont retiré de leur activité. Il est évidemment particulièrement important pour les sociétés non financières (SNF) puisque l’EBE constitue leur principale source de revenus primaires à la différence des ménages (la principale source étant la rémunération du travail) ou des administrations publiques (la principale source étant les prélèvements obligatoires). L’EBE permet aux SNF de faire face aux obligations qui ne découlent pas directement de la production (payer les intérêts de leurs emprunts, payer l’impôt sur les sociétés), d’investir et de verser des dividendes à leurs actionnaires ;
- Le « revenu mixte », qui correspond aux revenus des entreprises individuelles 35. Il est dit mixte car il comprend d’une part (et en majorité) la rémunération du travail non salarié des dirigeants d’entreprises individuelles et d’autre part le profit « normal » (l’EBE).
Ne pas confondre le PIB et le Revenu national
Le PIB permet de voir quels acteurs sont à l’origine de la distribution de revenus issus de la production. Par contre, il ne permet pas de savoir quels sont les revenus réellement perçus par les différents secteurs institutionnels. Pour cela, il faut regarder le revenu national brut. Celui-ci mesure la somme des revenus primaires (issus de la production et de la propriété) reçus par les résidents, que ces revenus soient générés par l’économie nationale ou par le reste du monde.
Pour le calculer, il faut :
- ajouter au PIB les revenus reçus du reste du monde : il s’agit surtout des rémunérations versées aux salariés résidents par des unités non résidentes et des revenus de la propriété (intérêts, dividendes etc.) versés à des résidents par des unités non résidentes ;
- soustraire du PIB les revenus versés au reste du monde (rémunérations et revenus de la propriété versés à des non-résidents).
Pour en savoir plus
- Faut-il croire les statistiques ? très bonne vidéo d’olivier Passet montrant la dimension conventionnelle du PIB.
- La comptabilité nationale, Jean-Paul Piriou, La Découverte, 2019
- Les statistiques détaillées des composants du PIB Français se trouvent dans le Tableau économique d’ensemble (TEE) disponible chaque année dans les Comptes de la Nation publiée par l’Insee
- Les statistiques des principaux composants du PIB sur Eurostat
L’assimilation du PIB à la puissance ou à la richesse d’un pays est trompeuse
Que dit le PIB de la puissance d’un pays ?
Comme on l’a dit dans l’Essentiel 1, les guerres ont constitué un puissant accélérateur dans la création du PIB et dans son affirmation en tant qu’indicateur de la puissance d’un État ou tout du moins de sa capacité à mobiliser ses ressources productives pour s’imposer dans le « concert des nations ». Qu’en est-il aujourd’hui ?
Une simple analyse du classement des États par leur PIB montre que cet indicateur est insuffisant pour traduire la puissance politique.
Classement des 20 premiers pays du monde (+ l’Union européenne) en fonction de leur PIB 2020.

Source Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale
Que l’on songe au paradoxe d’une Russie surpuissante géopolitiquement au point de pouvoir prendre ces dernières années sa revanche de la guerre froide sur les États-Unis mais dont le PIB est inférieur de 50 % à celui de la France (et le PIB par habitant quatre fois moindre) ou, à l’inverse, à une Union européenne qui ne parvient toujours pas à peser sur le cours du monde alors que son PIB est équivalent à celui des États-Unis et de la Chine.
Le PIB ne dit rien non plus de la dépendance des États en termes d’approvisionnement vis-à-vis du reste du monde. Cet élément a été particulièrement mis en valeur lors de la crise de la COVID-19 qui a vu le bouleversement, voire la mise à l’arrêt des chaines de production mondialisées provoquant des ruptures d’approvisionnement en biens essentiels pour répondre à la pandémie (masques, paracétamol, réactifs pour les tests, matériel respiratoire, production alimentaire) ou pour le fonctionnement global de l’économie (puces électroniques).
Il en va de même pour l’indépendance énergétique. Elle est invisible dans le PIB alors qu’on sait au moins depuis les crises pétrolières des années 1970 à quel point l’énergie est déterminante dans la production globale.
Enfin, il est important de ne pas confondre puissance économique d’un pays et la richesse de ses habitants (mesurée par le PIB dont on verra plus loin que c’est une mesure très sommaire). L’exemple de la Chine est à cet égard particulièrement éclairant. Deuxième économie mondiale par la taille de son PIB, la Chine connaît depuis des décennies des taux de croissance qui font rêver les dirigeants occidentaux. Est-ce à dire que ses habitants sont parmi les plus riches de la planète ? Certainement pas. Si l’on regarde le PIB par habitant, la Chine se situait en 2019 à la 79ème place si l’on mesure en dollars constant (voir ici) et à la 83ème place en parité de pouvoir d’achat (voir ici).
La richesse d’un pays, c’est son patrimoine
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 3, le PIB est une mesure de la valeur ajoutée générée sur un territoire une année donnée.
C’est donc avant tout un indicateur qui mesure un flux et non un stock de richesse.
Il est tout à fait possible que le PIB d’un pays s’accroisse année après année puis s’effondre brusquement parce que cette croissance reposait sur l’exploitation de ressources naturelles dont les stocks se sont taris. C’est l’exemple bien connu de l’île de Nauru après l’épuisement des mines de phosphate.
La richesse d’un individu ce n’est pas simplement son revenu mais aussi son patrimoine (immobilier et financier) ainsi que sa santé, ses connaissances, ses savoir-faire, sa culture, les liens qu’il développe avec les autres.
Dans le cas d’un pays, le patrimoine comprend de nombreuses dimensions
Le patrimoine public composé d’actifs financiers et surtout d’actifs physiques : infrastructures (réseaux d’eau, d’électricité, de téléphonie, routes et rails, ports et aéroports…), équipements collectifs, bâtiments qui hébergent les services publics (écoles, hôpitaux, musés, casernes, etc.). Certains de ces actifs, tels les monuments ou les œuvres d’arts, ne sont pas valorisés monétairement. La cathédrale Notre-Dame de Paris ne vaut rien, pas plus que la Joconde tant qu’elles ne sont pas mises en vente (pour rembourser la dette publique par exemple !).
Le patrimoine d’un pays, c’est aussi son système productif privé : des industries, un système agricole, des services. Dans quelle mesure une économie produit-elle l’alimentation, les vêtements, les matériaux des bases (papier, acier, ciment, etc.), les médicaments, l’énergie, les machines, les meubles, les équipements informatiques consommés par ses habitants ? Dans quelle mesure dépend-elle des chaines d’approvisionnement mondiales ? Notre système productif est-il capable de produire des biens et services qui intéressent d’autres pays et nous donne-t-il donc les moyens financiers d’acquérir ce que nous ne produisons pas ?
Le patrimoine comprend également les institutions qui permettent le fonctionnement de l’économie et plus généralement de la vie en société : un système judicaire, une police, une armée, un système de santé, un système éducatif etc.
Enfin, la richesse d’un pays repose sur le patrimoine naturel (public et privé) qui permettra la production future. Un territoire national plus ou moins artificialisé, une biodiversité terrestre et marine plus ou moins riche, des forêts, des nappes phréatiques, des ressources minières et énergétiques, des sols agricoles vivants ou morts, des réserves naturelles, des espaces côtiers.
Bref, nous léguons un potentiel de ressources naturelles plus ou moins important.
Point trace de tout cela dans le PIB : notre système économique a réduit la notion de richesse à une dimension bien étroite !
Le PIB n’est pas un bon indicateur de santé économique et sociale
Omniprésent dans le débat public, le PIB et sa croissance sont souvent assimilés à une mesure de la santé économique et sociale d’une économie.
Pourtant, déjà en 1934, Simon Kuznets, l’architecte de la comptabilité nationale américaine et l’inventeur du PIB, alertait contre son utilisation en tant qu’indicateur de bien-être 37. Les limites du PIB comme outil de diagnostic de l’état d’une société ont depuis fait l’objet de très nombreux travaux.
Comme le résume très bien l’économiste Eloi Laurent, « le PIB est trompeur quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain et muet sur la soutenabilité écologique. La croyance dans la croissance est soit une illusion soit une mystification. » Nous abordons ici les grandes lignes des critiques concernant l’économie et les aspects sociaux et dans l’Essentiel 6 les critiques en matière d’écologie.
Que nous dit le PIB de la structure productive d’un pays ?
En tant qu’indicateur agrégé, le PIB donne peu d’informations sur la structure de la production. Par contre, rentrer plus dans le détail des données employées pour calculer le PIB permet d’accéder à de nombreuses informations.
Il est par exemple possible d’analyser la formation de la valeur ajoutée par branche 38 (agriculture, industrie, construction, services marchands et non marchands) ou par secteurs institutionnels (ménages, société financières et non financières, administrations publiques etc.).
Cette plongée dans les détails du PIB permet-elle de rendre compte des rapports de force au sein de l’économie et de l’évolution de la structure productive ? Rien n’est moins sûr. Comme nous allons le voir avec les trois exemples ci-après le PIB semble de moins en moins bien adapté pour rendre compte de l’évolution de l’économie d’un pays.
Les sociétés financières
Le graphique suivant permet par exemple de constater à quel point le PIB rend peu compte de la montée en puissance de l’industrie financière depuis les années 1970. En France, la contribution du secteur des sociétés financières à la valeur ajoutée de l’économie française oscille autour de 5% depuis 50 ans, à peine plus du double des associations. 39
Le PIB ne rend donc absolument pas compte de la croissance vertigineuse de la sphère bancaire et financière depuis les années 1970 (voir le module Rôle et limites de la finance) et du pouvoir croissant de ces acteurs sur la sphère productive (voir le module Rôle et limites de la finance) et sur les politiques publiques (voir le module Dette et déficit publics).
Cette situation est liée au fait que la puissance de l’industrie financière est la conséquence du poids des patrimoine financier dont le PIB ne rend pas compte.
Part des secteurs institutionnels dans la valeur ajoutée en France de 1949 à 2020 (en %)
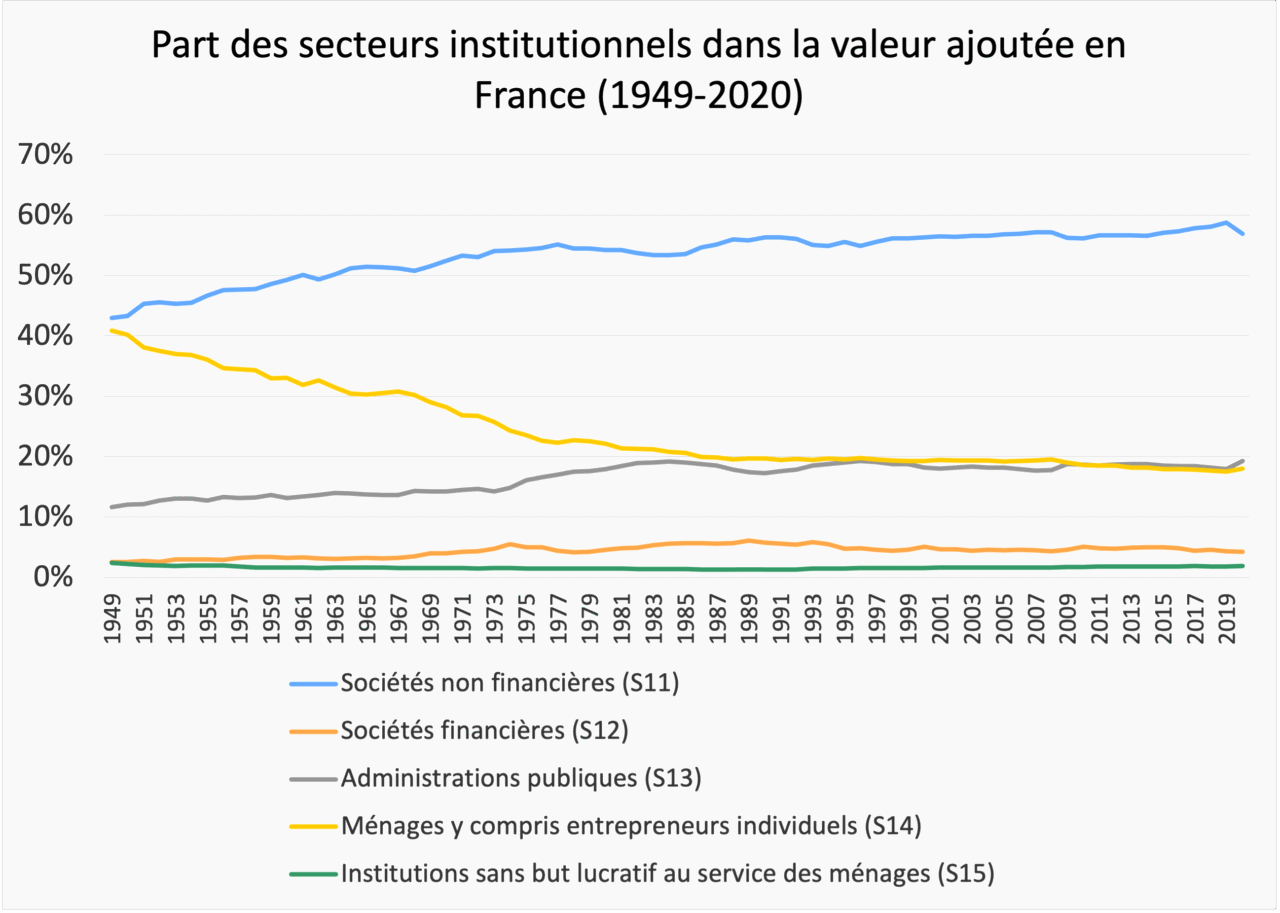
Source INSEE – Comptes de la Nation 2020 (Série 1.106)
L’économie numérique
La dernière décennie a été marquée par l’émergence de l’économie numérique et de ses champions les GAFAM 40.
A ce jour, la décomposition du PIB ne permet pas de rendre compte de cette dynamique puisqu’il n’y a pas de branche « économie numérique » dans les classifications de la comptabilité nationale. Les entreprises concernées sont donc classées dans différentes autres branches en fonction de leur activité principale.
Cette situation est normale : les nomenclatures statistiques s’adaptent avec un certain décalage à l’évolution de la structure productive 41. La version du Système des comptes nationaux aujourd’hui en vigueur date de 2008, année de la sortie du premier smartphone !
Il existe cependant des travaux cherchant à évaluer la contribution de l’économie numérique au PIB. C’est ce que fait, par exemple, le Bureau of Economic Analysis aux États-Unis.
Croissance du PIB, croissance de l’économie numérique et part de l’économie numérique dans le PIB
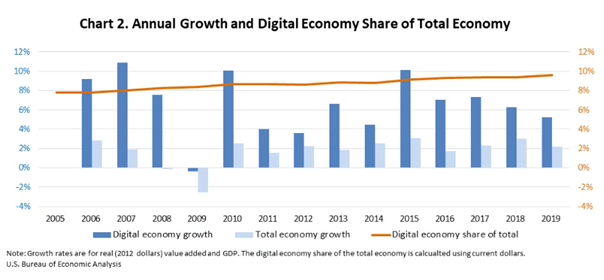
Source Updated Digital Economy Estimates, Bureau of Economic Analysis (juin 2021)
D’après les calculs du Bureau of Economic Analysis, la part de l’économie numérique dans le PIB américain serait passée d’un peu moins de 8% en 2005 à environ 10% en 2019.
Ces travaux posent de très nombreuses questions méthodologiques 42 qui sont loin d’être résolues. Ils butent notamment sur le fait que la puissance des entreprises du numérique et en particulier des GAFAM tient à un modèle économique particulier : elles fournissent des services « gratuits » et en contrepartie captent et exploitent les données des utilisateurs de ces services. La première source de revenu de Google ou de Facebook par exemple est la publicité alors que la vraie source de leur puissance tient à leur formidable capacité de captation de données. Cela pose de nombreuses questions que ni la comptabilité, ni le PIB ne sont aujourd’hui en mesure d’éclairer.
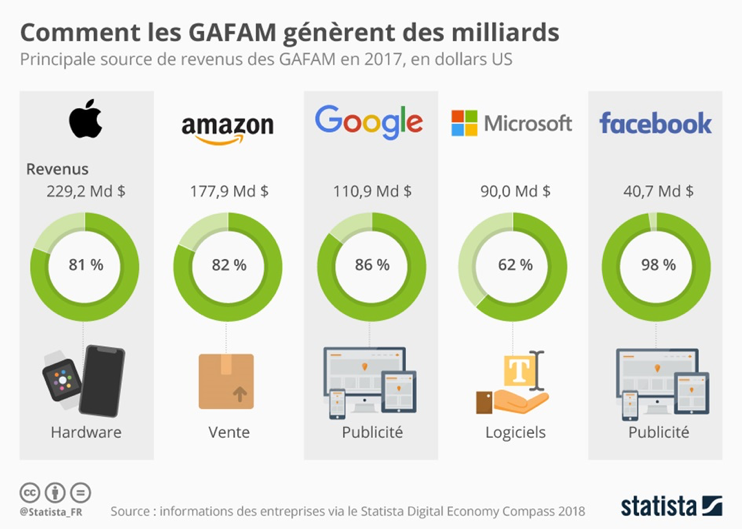
Source Les GAFAM, ces champions du numérique parfois compliqués à dompter, Cité de l’Economie (NB : dans le graphique ci-dessus le terme de revenu désigne le chiffre d’affaires).
Le poids des multinationales
Enfin, les dernières décennies ont été caractérisées par l’émergence des multinationales. Or, la comptabilité nationale qui s’est développée depuis le milieu du XXème siècle vise à suivre l’activité économique pays par pays, le PIB mesurant la production réalisée par les unités résidentes 43 dans chaque pays.
Comme l’explique très clairement l’économiste Jean-Paul Piriou, ce concept de résidence « conduit à négliger le contrôle exercé sur certaines unités résidentes par des unités résidentes d’autres économies nationales. Pour la comptabilité nationale, la filiale française d’IBM fait partie de l’économie nationale (elle est la propriété d’IBM-USA mais son siège social est en France) et la filiale espagnole de Renault appartient à l’économie nationale espagnole. Le critère de la résidence n’est alors que partiellement réaliste car il ne permet pas d’intégrer certaines relations de pouvoir. Représenter une économie nationale rend d’emblée impossible la prise en considération de la structuration de l’économie mondiale par les firmes transnationales. » 44
Enfin, le développement des chaines de valeur mondialisées et la part importante des actifs immatériels (logiciels, R&D, bases de données, marques) dans la production rend de plus en plus problématique l’attribution d’une production à un territoire donné. L’exemple du PIB irlandais est particulièrement éclairant sur ce point (voir encadré ci-dessous).
Quand le PIB irlandais bondit, sans production associée
« En juillet 2016, l’institut statistique irlandais (Central Statistics Office, CSO) a revu fortement à la hausse le taux de croissance du PIB pour 2015, le faisant passer de 7 % à 25,6 % (CSO, 2016a). Cette révision à la hausse ne s’est traduite ni par une révision similaire de l’emploi ni par une accumulation de capital physique. Elle s’explique en grande partie par la relocalisation, opérée par un petit nombre de grandes multinationales au sein de leurs unités légales irlandaises, d’actifs immatériels existants (recherche et développement, logiciels, etc.), pour un montant de 300 milliards d’euros, plutôt que par la mise en place de nouvelles capacités de production. » Cette relocalisation a été motivée par les conditions fiscales particulièrement attractives qui prévalent en Irlande.
En 2020, le problème perdure. C’est le même type de phénomène qui donne l’impression que l’Irlande a échappé à la récession, alors que l’activité n’y a pas été plus épargnée qu’ailleurs en Europe. Voir la vidéo de Xerfi canal très claire sur le sujet.
Source Citation issue de L’énigme de la croissance du PIB irlandais en 2015 : tentatives de réponse, Économie et Statistiques, Insee, 2020
Ces différents exemples montrent à quel point le PIB semble de moins en moins adapté pour répondre à son objet initial : être la mesure du volume global de la production d’un pays et refléter la structure de la production (via l’analyse de ses composantes en termes de branches ou de secteurs institutionnels).
C’est pourquoi, certains comptables nationaux 45 recommandent de ne plus communiquer sur le PIB en tant qu’indicateur relatif à la production mais plutôt sur le PIB en tant que source de revenu (voir l’Essentiel 3). Cela permettrait d’avoir une approche plus claire de ce que mesure le PIB, à savoir des flux de revenus qui incluent des revenus pouvant être extrêmement volatils (tels ceux liés à la localisation des actifs immatériels, brevets, logiciels, marques, des multinationales). Cette approche ne résout cependant en rien la question de la puissance et des rapports de force au sein de la sphère économique.
PIB et bien-être des populations
Il est indéniable que dans les pays pauvres, la hausse du bien-être de la population passe par l’accroissement de certaines productions essentielles (agricoles, industrielles, de santé, d’éducation). Plus généralement, la croissance économique véhicule l’idée d’une augmentation des moyens collectifs et donc des marges de manœuvre politiques et sociales notamment pour améliorer les conditions de vie des populations. Comme nous allons le voir, la relation entre hausse du PIB et amélioration du bien-être est, cependant, loin d’être toujours avérée.
Le PIB ne fait pas le bonheur : le paradoxe d’Easterlin
On doit à l’économiste Richard Easterlin la mise en évidence du paradoxe qui porte son nom. Dans une étude de 1974 46, il compare l’évolution du revenu réel 47 par habitant et celle de leur « bonheur » mesuré par des enquêtes déclaratives dans 19 pays pour la période 1946 et 1970 (voir encadré).
Ses résultats montrent que si à l’intérieur d’un même pays les habitants riches se déclarent plus heureux que les pauvres, ce n’est pas nécessairement reflété par les différences de niveau de revenu entre les pays.
Par ailleurs, aux États-Unis, la hausse de plus de 60 % du revenu réel ne s’est pas accompagnée d’une hausse dans les mêmes proportions de la part des Américains s’estimant « très heureux ».
L’évaluation subjective du bien-être
Pour certains chercheurs, les concepts de qualité de vie ou de bien-être sont trop subjectifs pour que des indicateurs objectifs (c’est-à-dire basés sur des données physiques telles les inégalités, le niveau d’éducation ou l’espérance de vie) puissent faire l’objet d’un consensus. Ils jugent donc préférable de se fonder sur des indicateurs subjectifs, construits à partir de l’opinion que les individus eux-mêmes ont de leur bien-être.
Ces indicateurs sont élaborés à partir d’enquêtes réalisées auprès d’un échantillon d’individus représentatifs auxquels on demande d’évaluer sur une échelle de 0 à 10 leur niveau de satisfaction dans la vie (de façon globale ou dans des domaines précis telles la situation financière ou les relations personnelles). Réalisées régulièrement, ces enquêtes permettent ensuite de comparer les réponses dans le temps (les gens s’estiment-ils plus heureux qu’avant ?) et selon les pays (où obtient-on les meilleurs scores ?).
Voir par exemple les résultats des enquêtes sur le bien être sur le site d’Eurostat pour l’Union européenne, sur le site de l’Insee pour la France, sur le site de l’Office of national statistics pour la Grande Bretagne. Le Better Life Index, indicateur développé par l’OCDE, est notamment composé de plusieurs indicateurs subjectifs.
Cette première étude a donné lieu à de nombreuses autres qui vont dans le même sens.
Au-delà d’un certain niveau, « plus de revenu » n’entraîne pas « plus de satisfaction » ou plus de « bien-être ». Une étude de l’Insee réalisée dans 26 pays européens montre par exemple que « la hausse des niveaux de vie a un impact marqué sur la satisfaction dans la vie jusqu’à 20 000 euros par an, qui s’estompe peu à peu entre 20 000 et 40 000 euros. Au-delà, la variation du niveau de vie influe marginalement la satisfaction dans la vie. » 48
PIB et indicateurs sociaux
Les Trente Glorieuses ont installé la croyance selon laquelle la croissance du PIB allait de pair avec l’amélioration de nombres d’indicateurs sociaux : création d’emploi, baisse de la pauvreté et des inégalités, amélioration généralisée du pouvoir d’achat, hausse de l’espérance de vie. Les dernières décennies ont cependant montré que cette croissance ne constituait en rien une condition suffisante pour l’atteinte de ces objectifs.
Il suffit, par exemple, de constater que la croissance des dernières décennies n’a pas empêché le maintien d’un chômage de masse dans de très nombreux pays, en particulier si on considère le « halo du chômage » 49 et non pas seulement le chômage au sens strict.
La croissance du PIB peut s’accompagner de la hausse des inégalités comme le montre l’évolution de l’indice de Gini des États-Unis, première économie mondiale (voir les données sur le site de la Banque Mondiale) 50.
Selon l’OCDE, « au cours des trente dernières années, le fossé entre riches et pauvres s’est creusé dans la plupart des pays de l’OCDE tandis que le coefficient de Gini progressait de trois points, pour atteindre une valeur moyenne de 0,32 »« . » 51
Un haut niveau de PIB par habitant ne se traduit pas nécessairement pas de meilleures performances des indicateurs sociaux (niveau d’éducation, de santé, de lien social etc.). Les résultats des travaux portant sur les régions françaises ont ainsi montré qu’il n’existe aucune corrélation entre le niveau de PIB par habitant et l’indice de santé sociale (voir encadré). L’île de France, région la plus riche, est également parmi les plus mal notées par cet indicateur.
L’indice de santé sociale (ISS) des régions de France
L’ISS est indicateur synthétique qui intègre six dimensions (logement, santé, éducation, lien social et sécurité, travail et emploi, revenus) à travers une vingtaine de variables. Par exemple, pour l’éducation, les variables retenues sont le taux de non diplômés et le taux de jeunes de 18 à 24 ans qui ne sont ni en études, ni en formation, ni en situation d’emploi.
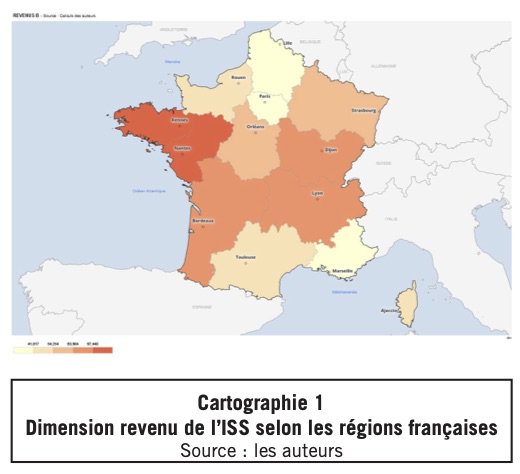
Source Florence Jany-Catrice, Grégory Marlier La santé sociale des nouvelles régions françaises et son évolution (2008-2016), 2020. Lecture de la carte : plus la couleur est foncée, plus l’indice de santé sociale est élevé.
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 3, il a été décidé de ne pas retenir dans le périmètre de la production certaines des activités que l’on fait soi-même ou pour les autres sans échanges monétaires. Certaines activités essentielles à la qualité du lien social tels le bénévolat et les services domestiques ne sont donc pas comptabilisées dans le PIB.
Ainsi, pour accroître le PIB, mieux vaudrait remplacer les bénévoles des associations par des salariés ; mettre les enfants à la crèche et les grands-parents en maison de retraite que de faire garder les premiers par les seconds ; acheter des repas tout prêts plutôt que de les préparer soi-même ; payer des cours particuliers à ses enfants plutôt que de les aider à réviser le soir. Serait-ce préférable sur le plan de la santé sociale ?
Enfin, comme nous allons le voir dans l’Essentiel suivant, l’exploitation à outrance des ressources naturelles et les pollutions n’impactent pas négativement le PIB (au contraire !) alors que les conséquences des dégradations environnementales peuvent être importantes localement et globalement (via le dérèglement climatique par exemple).
La croissance du PIB s’accompagne de celle de l’exploitation et de la dégradation de la nature
L’une des principales critiques du PIB porte sur les impacts environnementaux. En effet, non seulement le PIB est aveugle à la destruction des ressources naturelles et aux grands déséquilibres écologiques, mais en plus la recherche de sa croissance contribue à les augmenter.
Les théories dominantes de la croissance ont en général recours à deux facteurs de production : le capital (autrement dit l’ensemble des équipements et infrastructures utilisés par le système économique) et le travail. Elles font intervenir de plus en plus le « capital immatériel » (les inventions, les brevets, les savoir-faire) mais « oublient » les ressources naturelles (voir l’Essentiel 8 sur les modèles macroéconomiques).
Le raisonnement implicite derrière cette façon d’envisager la croissance repose sur l’idée que le capital artificiel (les machines) pourrait indéfiniment remplacer le capital naturel. Cette approche, dite de la soutenabilité faible 52, est pourtant clairement fausse : on ne remplacera pas la régulation naturelle du climat par des techniques de géo-ingénierie 53, ni les abeilles et autres pollinisateurs par des drones.
Le PIB est aveugle à la surexploitation des ressources naturelles
Il est évident que les ressources naturelles constituent le socle matériel et vivant de toute activité économique. Nous avons besoin d’eau et de terres arables pour l’élevage et les cultures alimentaires et textiles ; de bois et de minerais pour construire les bâtiments, les infrastructures et les machines ; d’énergie pour nous chauffer, cuire les aliments, déplacer humains et marchandises, extraire et transformer la matière etc.
Si le processus productif et la consommation se nourrissent de ressources naturelles, il les transforme en grande partie en déchets et pollutions (solides, liquides ou gazeux) rejetés dans les milieux naturels, perturbant et polluant les écosystèmes, transformant l’océan en vaste poubelle, déstabilisant le climat planétaire.
Depuis le début de la révolution industrielle, nous puisons dans le stock de ressources naturelles sans que le PIB nous permette d’en percevoir les limites. Il n’est tout simplement pas fait pour cela : il ne mesure, en effet, que les flux monétaires générés par la production et l’échange de biens et services.
Nous utilisons de l’eau, des sols, des métaux, de l’énergie mais le prix de la constitution de ces ressources n’apparaît jamais sur nos factures. Nous payons uniquement le travail et les rentes liées à leur extraction, leur transport, leur transformation, leur commercialisation, au marketing, à la publicité, mais jamais le prix de la quantité de ressources naturelles elles-mêmes utilisées car la Nature ne se fait pas payer…
Nous bénéficions, par ailleurs, de nombreux services du fait même du fonctionnement des écosystèmes (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions) qui n’ont pas de prix en soi. Ainsi, nous ne payons rien pour le cycle de l’eau, la stabilité du climat, l’existence d’un océan propice à la vie, la photosynthèse ou pour l’action des abeilles et autres pollinisateurs. Leur disparition, en revanche, aurait un « coût » économique , mais surtout humain et écosystémique très élevé dont nous ne prendrions conscience que trop tard.
Le PIB est le moteur de la destruction de la nature
En plus d’être aveugle à la dilapidation du patrimoine naturel, le PIB et la recherche de sa croissance ont constitué jusqu’à présent le moteur de ces destructions. Quand une forêt primaire est coupée à blanc, quand une mine est mise en exploitation, quand les flottes de pêche industrielle vident les océans (tout en détruisant les fonds marins), cela génère des emplois, des biens et services vendus, bref du PIB.
Ainsi, malgré les alertes maintes fois renouvelées, la croissance reste au niveau planétaire extrêmement bien corrélée à la consommation de matières et d’énergie, aux émissions de gaz à effet de serre et plus généralement à la pollution et à la destruction de la nature (au point que c’est probablement le meilleur indicateur de cette destruction !
Or, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables que ce soit parce qu’elles sont en quantité finie sur la planète (comme les énergies fossiles ou les minerais) ou parce qu’elles se renouvellent trop lentement par rapport à nos prélèvements (ressources halieutiques, sols, eau douce, forêts etc.) (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions). C’est ce qu’ont appris à leur dépend les habitants de l’île de Nauru ou les pêcheurs de morue à Terre neuve .
Par ailleurs, les activités nécessaires pour réparer les problèmes générés par l’activité économique (appelées « dépenses défensives »), loin de peser sur le PIB, le font croître : dépolluer les plages après une marée noire, les sols à la suite de pollutions chimiques, construire des stations d’épuration, construire des digues pour se protéger des eaux après la destruction des écosystèmes côtiers (mangroves, coraux), dispenser des soins pour réparer les conséquences de la pollution sur la santé… tout cela génère des activités économiques et donc du PIB.
Encore faut-il avoir les moyens de payer pour la réparation des dégâts, sinon il ne reste plus qu’à les subir comme cela se passe pour de nombreuses populations dans le monde. Ajoutons que tout n’est pas réparable. Si certains services que nous tirons des écosystèmes peuvent être reconstitués artificiellement (l’épuration de l’eau par exemple), ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre eux. Impossible, par exemple, de remplacer la stabilité du climat pourtant essentielle à la survie humaine.
Quand viendra le jour où les coûts engendrés par la réparation des désordres écologiques seront trop importants pour l’économie des hommes, le PIB se mettra alors inéluctablement à décroître.
Quelques exemples de la très bonne corrélation entre croissance du PIB, consommation de ressources naturelles et pollutions
De nombreux travaux issus de raisonnement physique ont montré les fortes corrélations entre croissance du PIB, consommation de ressources naturelles et dégradations de l’environnement.
Des chercheurs ont ainsi mis en évidence la « grande accélération » 54, c’est-à-dire la croissance exponentielle, à partir des années 1950, d’indicateurs socio-économiques, au premier rang desquels le PIB, et d’indicateurs portant sur les consommations de ressources (eau, énergie, poissons) ainsi que sur les dégradations environnementales (émissions de gaz à effet de serre, déforestation, eutrophisation des zones côtières).
PIB et consommation de ressources naturelles : l’exemple de l’énergie
Il est assez facile d’expliquer la corrélation entre croissance économique et consommation d’énergie. L’activité économique consiste principalement en l’extraction et la transformation de matières pour fabriquer des biens et services consommés par les êtres humains.
Parmi ces matières, l’énergie occupe une place majeure. Non seulement, nous la consommons directement (pour chauffer les bâtiments, déplacer humains et marchandises, cuire les aliments, faire fonctionner les équipements électriques et électroniques) mais en plus elle est le moteur de transformation des autres ressources naturelles : toute activité d’extraction et de transformation nécessite des machines, donc de l’énergie.
Symétriquement, les tensions sur l’approvisionnement énergétique observées à certaines périodes (la crise pétrolière de 1973 en Occident étant le cas le plus spectaculaire) ont conduit à des baisses de taux de croissance.
Les liens entre l’énergie et le PIB ne relèvent donc pas d’une simple corrélation fortuite : il existe bien une relation de causalité entre PIB et énergie. Cependant, celle-ci n’est pas absolue. La hausse de la consommation d’énergie ne suffit pas à elle-seule à expliquer la croissance du PIB.
Sur le plan théorique, si l’accès à l’énergie est clef pour « faire tourner nos machines », donc l’économie, il n’est pas suffisant. Il faut en plus des institutions, des entreprises, des connaissances, du personnel qualifié et motivé… pour utiliser et transformer cette énergie.
Sur le plan empirique, des pays ont (ou ont eu) un accès facile à des ressources énergétiques et n’ont pas vu leur PIB croître. C’est ce qu’on appelle la « malédiction du pétrole » ou plus généralement des ressources naturelles 55 : des pays ayant d’importantes ressources pétrolières peuvent ne pas se développer, soit par incapacité technique (c’était le cas de tous les pays du monde avant la révolution industrielle), soit du fait de la captation de la rente pétrolière par une oligarchie.
PIB et pollutions : l’exemple des émissions de GES
Comme le montre le graphique ci-après, PIB par habitant et émissions de CO2 par habitant sont assez bien corrélées. Cette corrélation est évidemment liée à la précédente (énergie/PIB) dans la mesure où l’énergie primaire est très majoritairement d’origine fossile. Charbon, pétrole et gaz continuent à représenter aujourd’hui 80 % des sources d’énergie primaire au niveau mondial.
Si on peut constater dans certains pays développés un découplage entre émissions de CO2 et PIB (voir l’Essentiel 9), les ordres de grandeur sont cependant loin d’être au rendez-vous.
Pour en savoir plus
- Eloi Laurent, Sortir de la croissance, mode d’emploi, éditions Les liens qui libèrent, 2021.
- Tim Jackson, Prosperity Without Growth, Routledge, 2017.
- J. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, « Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social », 2009.
- Dominique Méda, Florence Jany-Catrice, Faut-il attendre la croissance ?, La Documentation française, 2016.
- « Vers une société post-croissance ? », conférence de Dominique Méda, 19 mars 2018.
- Vaclav Smil, Growth: From Microorganisms to Megacities, MIT Press, 2019.
Les limites du PIB sont bien comprises mais il est encore loin d’être remplacé
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 4 et 5, les limites du PIB et de l’objectif de croissance sont désormais bien établies. Confrontés à ces critiques, les comptables nationaux et les économistes apportent une réponse simple : le PIB n’a pas vocation à mesurer le bien-être, le progrès et encore moins la soutenabilité environnementale d’une économie. L’indicateur n’est pas coupable des dérives médiatiques et de la vénération politique dont il est l’objet.
C’est pourquoi, de multiples travaux ont porté sur l’élaboration d’indicateurs permettant de compléter le PIB, d’en relativiser fortement l’usage dans le débat public et dans la conduite des politiques publiques, voire de le remplacer. L’objectif in fine n’est pas seulement de disposer d’autres mesures de l’économie, mais aussi de contribuer à forger d’autres trajectoires de l’économie.
Les indicateurs alternatifs au PIB
Un des débats fondamentaux au cœur des réflexions sur les indicateurs alternatifs porte sur la question de savoir s’il faut mettre en avant :
- quelques indicateurs synthétiques (voir ci-après) ayant une puissance communicante suffisante pour contrebalancer le PIB ;
- ou un tableau d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux afin de disposer de mesures fines de l’évolution de la société dans ses diverses dimensions.
Les indicateurs synthétiques (ou composites)
Ils ont pour objet de résumer en un chiffre unique différentes variables normalisées 56, qui sont ensuite pondérées et agrégées.
Au-delà de la dimension économique souvent présente, ces indicateurs peuvent insister plutôt sur les dimensions sociales (les variables porteront par exemple sur les inégalités, la pauvreté et l’exclusion, l’insécurité sociale etc.), ou sur les dimensions environnementales (les variables porteront par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations de matières et d’énergie, l’utilisation des terres etc.) Certains indicateurs ambitionnent de couvrir toutes ces dimensions.
Les principales critiques portent sur le fait que les choix des différentes variables et surtout leur pondération sont nécessairement arbitraires et que ces indicateurs ne peuvent bien sûr couvrir toutes les dimensions du bien-être et de la soutenabilité. Leurs promoteurs reconnaissent ces limites inhérentes à toute procédure d’agrégation mais insistent également sur le fait qu’ils ont un fort pouvoir de communication et constituent ainsi de bons candidats pour contrebalancer la prédominance du PIB.
Quelques exemples d’indicateurs synthétiques
L’indice de développement humain (IDH) 57 est le plus ancien indicateur synthétique. Il se base sur trois critères (le revenu/habitant, l’espérance de vie et le niveau d’éducation) qui sont ensuite pondérés pour donner une note globale à chaque pays. Publié depuis 1990, le classement ainsi obtenu diffère assez largement de celui du PIB par habitant même si les pays à haut revenu restent en tête de liste.
Le Better Life Index, développé par l’OCDE dans le cadre de son Initiative Better Life, se focalise sur les conditions et la qualité de vie actuelle. Il a surtout une vocation pédagogique. Il est fondé sur 11 critères 58 qui sont par défaut pondérés à 1. L’utilisateur de l’outil en ligne peut, ensuite, faire varier ces pondérations et voir comment évolue le classement des pays.
Le Sustainable Development Index (SDI), développé par Jason Hickel, a pour ambition de mesurer la soutenabilité écologique du développement humain. Le SDI part de l’IDH (légèrement remanié) et le divise par un indicateur de dépassement écologique (lui-même calculé à partir de l’empreinte CO2 et de l’empreinte matière par habitant). Le classement est cette fois très différent de celui du PIB/habitant, les pays développés étant parmi les plus mal notés du fait d’un trop fort dépassement écologique.
Les indicateurs d’empreinte visent à mesurer les impacts environnementaux liés à la consommation d’un individu, d’un pays, d’une région (donc en tenant compte des importations et non de la seule production nationale). L’empreinte carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre, l’empreinte matière la quantité de matières extraites (biomasse, énergies fossiles, métaux et minéraux non métalliques), l’empreinte eau la quantité d’eau utilisée pour satisfaire la demande de biens et service d’une population. L’empreinte écologique mesure la surface productive utilisée pour produire les ressources naturelles consommées 59 par une population et pour absorber ses déchets (en particulier les émissions de CO2). Ces différents indicateurs sont ensuite comparés aux limites planétaires les concernant (par exemple, pour l’empreinte carbone, le niveau d’émissions de gaz à effet serre maximal par habitant pour limiter le réchauffement climatique à +2°C).
Le rapport Classement internationaux sur l’environnement, Ministère de la transition écologique (2022) donne des informations détaillées sur 10 indicateurs synthétiques.
Les « PIB ajustés » ou « PIB verts » constituent une forme particulière d’indicateurs synthétiques
Ils ont pour objet de corriger le PIB en y ajoutant des estimations monétaires d’activités qui contribuent positivement au « bien-être économique présent » (les loisirs, le travail domestique) et en y retranchant les activités qui le réduisent (trajets domicile-travail, activités de dépollution, destruction de forêts primaires etc.)
Ces démarches ont l’avantage de pouvoir être directement confrontées au PIB et de s’inscrire dans un espace de mesure familier : celui des comptes nationaux et de l’expression des valeurs en unités monétaires.
Par contre, elles posent de nombreux problèmes : i/ elles ne prennent pas en compte les inégalités ii/ elles impliquent de donner une valeur monétaire à des biens et services qui n’en ont pas, avec tous les questions méthodologiques et éthiques que cela pose, et, en particulier, de donner un prix la nature iii/ elles relèvent d’une logique de soutenabilité faible : la destruction de ressources naturelles peut être compensée par le développement du capital artificiel (les machines).
Ces démarches trouvent leur origine dans un article de 1973 de Nordhaus et Tobin 60 qui intégraient très peu les questions environnementales. On peut également citer l’indicateur de progrès véritable ou l’indice de bien-être durable.
Les tableaux de bord multidimensionnels
La voie majoritairement suivie au niveau institutionnel consiste à mettre en place des tableaux de bord regroupant divers indicateurs non pondérés, soit dans une optique de vision globale des différentes dimensions (économique, sociale, écologique) de la société, soit en vue d’éclairer des politiques publiques spécifiques (éducation, transport, énergie etc.)
Les multiples tableaux de bord
La communauté internationale a adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies de 2015. Celui-ci se décline en 17 Objectifs de développement durable (ODD), évalués au moyen de plus de 230 indicateurs. Les ODD sont suivis dans la plupart des pays du monde (du moins ceux qui disposent d’un appareil statistique) : voir ici pour la France, ici pour l’UE et ici pour les Etats-Unis.
L’OCDE présente dans l’édition 2020 de son rapport annuel Comment va la vie ? un tableau de bord élargi de plus de 80 indicateurs du bien-être (actuel et futur). Afin de rendre la communication plus concise, ils ont mis en évidence 36 indicateurs phares 61. On peut également citer les tableaux de bord des indicateurs de la croissance verte.
Dans un rapport paru en 2021, les chercheurs du Zoe Institute ont passé en revue les multiples tableaux de bord de l’Union européenne afin d’analyser la couverture des indicateurs sociaux et environnementaux. Ils ont ainsi dénombré plus de 450 indicateurs issus de 18 processus politiques différents 62. Leurs résultats montrent que les aspects sociaux et environnementaux sont rarement présentés ensemble. Surtout, si ces tableaux de bord peuvent être intéressants pour des politiques spécifiques, ils souffrent d’une très grande fragmentation. Ils contribuent à une lecture en silo des différentes politiques publiques et sont loin de présenter une synthèse accessible, une vision d’ensemble, réduisant la complexité pour les décideurs et pour la société civile.
L’intérêt des tableaux de bord réside dans la capacité pour les gouvernements et les experts à suivre et analyser finement les différentes évolutions de la société. Par ailleurs, en retenant des variables environnementales physiques, ils permettent de disposer d’indicateurs d’alerte sur la non-soutenabilité du développement.
Cependant, ces tableaux souffrent d’une très grande hétérogénéité, de la difficulté à choisir et hiérarchiser les indicateurs qui les composent. Surtout, ce sont de piètres instruments de communication.
« Le débat public, politique et médiatique est largement dominé par les critères économiques et financiers : PIB, croissance et indices boursiers tiennent le haut du pavé et détiennent les records d’audience. Ce sont eux qui symbolisent la réussite. Organiser des débats publics sur la façon dont la croissance s’accompagne ou non de progrès social et environnemental avec, d’un côté, un indicateur de croissance puissant, connu et très médiatisé, et, de l’autre, un tableau de plusieurs dizaines de variables, c’est se mettre d’emblée en situation de concurrence déloyale. »
Un donut pour remplacer les tableaux de bord ?
C’est à Kate Raworth qu’on doit l’idée de représenter les objectifs à long terme de l’humanité sous la forme d’un donut. « En deçà de l’anneau interne – le fondement social – se trouvent les privations humaines critiques, comme la faim et l’illettrisme. Au-delà de l’anneau externe – le plafond écologique – se trouve la dégradation critique de la planète, comme le changement climatique et la perte de biodiversité. Entre ces deux cercles se situe le donut proprement dit, l’espace dans lequel nous pouvons satisfaire les besoins de tous, dans la limite des moyens de la planète. » 64 Cette représentation fournit un cadre général qui souligne la nécessité d’équilibrer la durabilité environnementale et la cohésion sociale par le biais d’une économie résiliente.
Le Zoe Institute s’est fondé sur ces travaux pour représenter visuellement les priorités de l’Union européenne d’ici 2030.
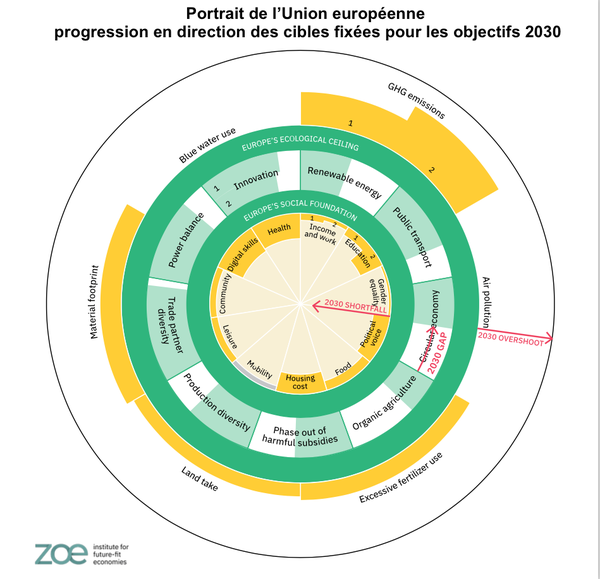
Source Towards a thriving Europe beyond economic growth, 2021 Les surfaces jaunes au-dessus du plafond écologique indiquent une transgression des objectifs écologiques pour 2030. Les surfaces jaunes en-deçà des fondations sociales indiquent les écarts par rapport aux objectifs sociaux de l’UE pour 2030. Les surfaces vertes à l’intérieur du « donut » représentent les leviers politiques et les outils économiques.
Comment faire émerger les indicateurs alternatifs au PIB dans le débat public ?
Malgré les nombreux travaux sur les indicateurs alternatifs, on a vu dans l’Essentiel 1 que le PIB et sa croissance restent au cœur des discours et des objectifs affichés de politiques économiques.
En effet, il ne suffit ni de mesurer les indicateurs alternatifs, ni de les proclamer pour enclencher une transformation sociale profonde. Encore faut-il les rendre effectifs, c’est-à-dire en faire de véritables outils de mesure et d’orientation de l’action publique.
Donner une légitimité aux indicateurs alternatifs
Une revendication récurrente des promoteurs des indicateurs alternatifs au PIB porte sur les modalités de leur adoption. Étant censés traduire les objectifs dont se dote une société, il est nécessaire de leur donner une légitimité en engageant un débat public sur ce qui fait sens et sur la direction à prendre.
En faire de véritables outils d’orientation des politiques publiques
Les pouvoirs publics doivent se saisir véritablement de ces indicateurs et les rendre opérationnels. Le principe général serait de justifier les différentes mesures de politiques publiques non parce qu’elles sont bonnes pour la croissance (ou considérées comme telle – voir l’Essentiel 2), mais parce qu’elles sont bénéfiques à la transition écologique, à la réduction des inégalités etc.
L’exemple de la loi SAS en France est à cet égard éclairant (voir encadré) : les nouveaux indicateurs de richesse sont publiés régulièrement mais ne font l’objet d’aucune communication spécifique et n’ont aucun impact sur les politiques publiques.
L’échec de la loi française sur les nouveaux indicateurs de richesse
Votée en 2015, la loi SAS prévoit que le gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de nouveaux indicateurs de richesse ainsi qu’une évaluation de l’impact des principales réformes engagées au regard de ces indicateurs. A la suite de ce vote, des travaux ont été engagés afin d’identifier 10 indicateurs de richesse.
Cette loi est malheureusement restée sans portée politique : les rapports annuels sont publiés 65 mais ils ne servent pas à éclairer et évaluer les politiques publiques, à commencer par la mobilisation des finances publiques.
C’est ce que note l’économiste Eloi Laurent dans une note qui se penche sur la mise en œuvre de la loi SAS. « Le débat budgétaire français se trouve actuellement sous la tutelle de l’objectif de croissance du PIB, lui-même déterminant dans l’application et le respect des règles européennes en matière de finances publiques (calculées en pourcentage du PIB). En dehors de la décomposition du PIB et de quelques indicateurs macroéconomiques relatifs au marché du travail, l’information transmise à la représentation nationale au moment de procéder à la répartition des dépenses et des charges publiques se révèle très insuffisante pour saisir l’état social du pays et ses défis pour l’avenir, notamment écologiques. » 66
La réaction des autorités publiques lors de la crise économique de 2020 constitue également un bon exemple du peu d’impact qu’ont à ce jour les indicateurs alternatifs sur les politiques publiques. Face à l’impératif d’éviter l’effondrement du système productif du fait de son arrêt prolongé lors des confinements, les pouvoirs publics des pays riches ont dépensé sans compter pour soutenir les revenus des salariés et des entreprises. Ces financements ont rarement été conditionnés à des objectifs écologiques ou sociaux. S’ils ont financé les énergies bas carbone, ils ont aussi largement alimenté l’économie fossile. 67
Loin d’enclencher une bifurcation vers un modèle moins consommateur de ressources et plus résilient, la réaction économique à la pandémie de COVID-19 s’est manifestée par la volonté de revenir à la « normale », donc de maintenir le système économique en l’état.
Il existe par contre des initiatives montrant qu’il est possible de mobiliser les indicateurs de façon opérationnelle. C’est ainsi que le Well-being budget mis en place en Nouvelle Zélande depuis 2019 oriente concrètement l’utilisation de l’outil budgétaire en priorisant certaines dépenses publiques (santé mentale, allocations pour les populations indigènes, lutte contre la pauvreté infantile et les violences familiales, investissement pour le climat) sur le fondement d’indicateurs écologiques et sociaux.
Les indicateurs ne peuvent pas tout : redonner aux États les moyens de piloter l’économie
Comme noté dans l’Essentiel 1, le PIB et la comptabilité nationale sont nés de la crise de 1929, des guerres mondiales et de la reconstruction, donc d’une configuration historique pendant laquelle les États disposaient de leviers bien plus importants qu’aujourd’hui sur l’économie (planification plus ou moins importante, encadrement de la finance et du crédit bancaire, échanges limités avec l’extérieur, bouclage macro-économique par la dépense publique).
Comme l’explique Antonin Pottier, ces conditions ne sont plus réunies.
« Les institutions qui permettaient à la comptabilité nationale d’éclairer les décisions relatives au pilotage de l’économie ont été démantelées, les conditions socio-économiques adéquates au pilotage ont disparu, les dispositifs de supervision de l’économie ont été abandonnés. Dans cette ère néolibérale, où sont entrées toutes les économies occidentales à partir des années 1980, l’État a perdu beaucoup de ses capacités d’intervention directe. (…) Avec le retour du laisser-faire, sans institutions adéquates de régulation, sans capacité de l’État à contraindre ou à convaincre les acteurs économiques, la croissance de la production est surtout le résultat d’une myriade d’actions des agents de l’économie. Ces actions ne sont pas guidées par des indicateurs agrégés comme le PIB, mais par les perspectives de profit de ces agents. »
Adopter de nouveaux indicateurs et les placer au cœur des discours de politiques publiques ne peut donc suffire. Il est également nécessaire de revoir les conditions institutionnelles dans lesquelles se construisent les politiques publiques.
Remettre en cause le totem de la croissance passe aussi par un questionnement sur la toute-puissance de la finance et sa capacité à déstabiliser l’économie productive (voir le module Rôle et limites de la finance), sur les modalités de financement des dépenses publiques (voir le module Dette et déficit publics), sur la capacité des acteurs les plus fortunés (qu’il s’agisse des ménages ou des entreprises) à éviter l’impôt, sur la primauté du libre-échange sur toute forme de protection sociale et environnementale. Il s’agit, également, de changer les incitations, les manières de faire et de calculer des agents privés par exemple en réformant profondément la comptabilité pour qu’il ne soit plus possible de faire des bénéfices tout en détruisant la nature. La recherche doit donc désormais porter sur les obstacles institutionnels, ainsi que les mécanismes qui pourraient faire de ces indicateurs une force d’action.
Pour en savoir plus
- Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte, 2016.
- Eloi Laurent, Et si la santé guidait le monde ?, éditions Les liens qui libèrent, 2020.
- La Well-Being Alliance (WeALL), qui met notamment en évidence et accompagne des initiatives sur les indicateurs alternatifs au PIB.
- Conférence « Putting Well-being Metrics into Policy Action », organisée par l’OCDE en 2019, lors de laquelle de nombreuses initiatives concrètes ont été présentées.
- « Beyond GDP Measuring What Counts for Economic and Social Performance », rapport de l’OCDE, 2018
- J.P. Fitoussi, M. Durand, Measuring What Counts, The New Press, 2019.
La croissance du PIB n’est pas expliquée par les modèles macroéconomiques les plus utilisés
Nous avons vu dans la section précédente que la croissance du PIB reste l’objectif des politiques macroéconomiques. Nous allons tenter ici de faire le point sur les facteurs explicatifs de cette croissance en économie, et de voir comment elle est intégrée dans les principaux modèles macroéconomiques utilisés dans les grandes institutions publiques 68.
Ces modèles sont des repères majeurs dans la conduite des politiques économiques publiques 69. Or ils ne sont pas neutres : ils traduisent les choix théoriques qui ont présidé à leur élaboration. Aujourd’hui, les modèles macroéconomiques majoritairement utilisés par les grandes institutions publiques sont fondées sur les postulats suivants : les marchés s’équilibrent automatiquement (via les prix pour le marché des biens et services, via le salaire pour le marché du travail, via le taux d’intérêt pour le capital) même si parfois des rigidités sont introduites par les modélisateurs ; la croissance de la production est déterminée par la hausse de l’offre (qui rencontre automatiquement sa propre demande) ; la monnaie et le crédit sont neutres ; les ressources naturelles et les pollutions ne sont pas des facteurs limitants.
Qu’est-ce qu’un modèle macroéconomique ?
Un modèle est un système d’équations mathématiques (et de procédures pour les résoudre) ayant des fondements théoriques ou empiriques, conçues pour simuler le fonctionnement d’un système du monde réel : l’atmosphère terrestre, un marché financier, un écosystème naturel, etc.
Un modèle macroéconomique a pour objet de simuler le fonctionnement de l’économie dans son ensemble pour un pays, une zone régionale, voire le monde entier. Ces modèles sont utilisés par les institutions économiques (Banques centrales, OCDE, FMI, ministères des finances) pour faire des prévisions sur la conjoncture économique de court terme (notamment en vue d’éclairer les décisions budgétaires) ou pour évaluer les conséquences de décisions de politiques économiques.
Par exemple, la Direction Générale du Trésor en France utilise les modèles Mésange, Opale et Nigem ; la Banque de France utilise le modèle FR-BDFb ; la Commission européenne le modèle Quest et la BCE le modèle NAWM.
Les éléments d’analyse présents dans ce chapitre font référence à ces modèles.
Soulignons, avant d’aller plus loin, que les « causes » ou les « facteurs » économiques de la croissance du PIB évoqué par la suite ne peuvent être appréhendés hors « contexte » institutionnel, politique, culturel, ou juridique. Ce contexte doit être favorable pour permettre la croissance, comme le montrent l’histoire et la situation actuelle des pays les moins avancés.
La croissance de la production dépend du capital productif, du travail et de la disponibilité des ressources naturelles
Considérons d’abord le PIB sous l’angle de la production, sans tenir compte de l’aspect « demande » et des questions de répartition des revenus et de crédit qui y sont associées. La production d’un territoire doit être en mesure de croître afin de permettre la croissance du PIB (voir l’Essentiel 3 sur la façon dont est calculé le PIB). Elle repose sur la mobilisation de « facteurs de production », que l’on recense dans les paragraphes suivants (la capacité à mobiliser ces facteurs de production étant une condition nécessaire à la croissance).
Capital et travail sont les deux facteurs de productions généralement considérés dans les théories économiques
La production d’un territoire dépend tout d’abord des capacités de productions dont dispose ce territoire : usines, machines, main d’œuvre… En termes économiques, on parle des facteurs de production : « capital productif » (les machines et infrastructures impliquées dans la production) et « travail ».
Une hausse de la production est permise par :
- A court terme, une hausse du taux d’emploi de la main d’œuvre ou du taux d’utilisation du capital productif ;
- A plus long terme (lorsque les capacités de production sont déjà pleinement employées), une hausse de la valeur absolue d’heures travaillées ou de capital productif ;
- Ou (toujours à long terme) des progrès de productivité du travail (valeur produite par quantité de travail investie) 70 ou du capital productif – qui sont intimement liés.
Pour illustrer, décomposons la production par habitant (PIB/Habt) de la manière suivante 71 :
PIB/Habt = PIB/ H * H/ Popa * Popa/ Habt
Avec H les heures travaillées, Popa la population active et Habt la population totale. La production par habitant peut croître :
- par l’augmentation du taux d’activité (Popa/Habt),
- par celle du nombre d’heures travaillées par actif (H/Popa),
- ou par celle de la productivité du travail (PIB/H).
A noter que les progrès de productivité peuvent se traduire par une hausse de la production si les autres paramètres sont constants mais peuvent tout aussi bien ne pas se traduire en cas de baisse de l’emploi ou du temps de travail.
On peut faire le même raisonnement en décomposant la production en fonction de la quantité totale de capital productif, du taux d’utilisation de ce capital et de la productivité de ce capital.
Le « capital naturel », un facteur de production généralement oublié par la théorie économique
En plus du capital productif et du travail, la production de biens et services requière de l’énergie et des ressources naturelles. Elle dépend également de la stabilité du climat et de la bonne santé des écosystèmes (notamment du fait des services écosystémiques dont les hommes bénéficient gratuitement : épuration de l’eau et de l’air, pollinisation pour l’agriculture, espaces naturels et tourisme, etc.). L’ensemble de ces éléments est souvent appelé « capital naturel ».
La croissance et même le simple maintien de la production peuvent être rendus impossibles du fait de limitations sur l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles, ou lorsqu’un service écosystémique n’est plus assuré (air pollué, absence de pollinisation, espace naturel endommagé rendant impossible une activité touristique…). Le capital naturel est donc un autre facteur de production.
En résumé, l’activité économique repose sur trois principaux facteurs de production : le travail, le capital productif, et le capital naturel. Certaines activités requièrent plus de capital productif, d’autres plus de travail, d’autres davantage de capital naturel. Pour la majorité des économistes, ces trois capitaux sont entièrement substituables entre eux : il est toujours possible de remplacer des ressources naturelles par des machines ou par du travail ; pour d’autres, les possibilités de substitutions entre ces différents facteurs de production (par exemple, utiliser moins de travail et davantage de machines) sont limitées. Cette question de la substituabilité est au cœur du débat qui anime les économistes sur la soutenabilité forte ou faible du développement (que nous présentons dans le module Economie, ressources naturelles et pollutions).
Soulignons ici que toute activité économique requiert un apport d’énergie, et que celui-ci ne peut pas être réduit au-delà de certaines limites (limites thermodynamiques), ce qui est bien une certitude « physique » et non un débat d’économistes.
Et dans les modèles macroéconomiques les plus utilisés au niveau institutionnel ?
Ces modèles incluent le « capital productif » et « travail », mais ignorent généralement le facteur de production « capital naturel ». La raison en est simple : les transactions n’étant faites qu’entre des hommes (et pas avec la nature), aucun flux monétaire ne vient marquer l’extraction d’une ressource de l’environnement (autre que les coûts de cette extraction) ou rétribuer un service écosystémique : le capital naturel est gratuit. Cette omission est, de plus, justifiée par l’hypothèse implicite que, grâce au progrès technique, il serait toujours possible de trouver une solution si une ressource venait à manquer (en changeant de procédé, en la remplaçant par une autre ressource ou par des machines etc.) 72 De fait, cela revient à considérer dans ces modèles que le capital naturel nécessaire à l’activité économique n’est et ne sera jamais limitant : les ressources naturelles sont considérées comme infinies, toujours disponibles, sans délai, et en tout lieu ; les services écosystémiques comme toujours rendus.
Cette vision est évidemment en contradiction avec la réalité. On peut penser aux crises d’approvisionnement à court terme liées à des inerties de développement de filières (compétences et infrastructures), aux catastrophes naturelles ou à des enjeux géopolitiques. On peut surtout citer les risques d’approvisionnement de long terme lié à l’atteinte des limites planétaires.
L’absence de prise en compte des rétroactions environnementales
L’activité économique génère des pressions sur l’environnement (surexploitation des stocks de ressources naturelles, destructions d’habitats naturels, émissions de gaz à effet de serre, de déchets solides et liquides…).
Ces dégradations peuvent impacter négativement la production ultérieure en affectant les trois facteurs de production (capital productif, travail, capital naturel) cités précédemment : on parle de boucle de rétroaction environnementale. Par exemple, le changement climatique peut détruire ou rendre inopérable le capital productif (destruction d’usines et d’infrastructures à la suite de tempêtes ou d’inondations), rendre le travail moins efficient ou impossible lors de vagues de chaleur, et surtout endommager le capital naturel (feux de forêts, incendies, perte de biodiversité, sécheresse endommageant les cultures)…
Ainsi, la croissance du PIB doit être analysée non seulement au regard de ces trois facteurs de production, mais aussi en tenant compte des rétroactions liées aux pressions sur l’environnement.
Et dans les modèles macroéconomiques les plus utilisés au niveau institutionnel ?
De façon générale, les modèles macroéconomiques utilisés par les institutions publiques n’intègrent pas de boucle de rétroaction du climat sur l’économie. Si certains d’entre eux permettent (ou pourraient permettre) de déterminer les émissions de gaz à effet de serre induites par une trajectoire macroéconomique simulée, ils ne tiennent pas compte des effets du dérèglement climatique sur l’économie.
Les banques centrales commencent, cependant, à mener des travaux sur les risques financiers liés au réchauffement climatique (voir le module sur la monnaie). Elles se basent pour cela notamment sur les travaux théoriques des économistes tels William Nordhaus qui ont tenté de modéliser les impacts sur le PIB de différents niveaux de réchauffement climatique d’ici la fin du siècle. Comme nous le verrons dans l’Idée reçue 6, ces travaux sont largement défectueux et conduisent à minorer systématiquement les impacts du changement climatique. Il est particulièrement problématique que les banques centrales s’en inspirent.
Les autres boucles de rétroaction environnementale (érosion de la biodiversité, pollutions chimiques massives…) sont absentes de tous les modèles macroéconomiques les plus utilisés. Ces boucles de rétroaction sont extrêmement complexes, et les travaux de recherche visant à en proposer une modélisation ne sont pas encore satisfaisants.
La croissance du PIB dépend également de la répartition des revenus et du crédit
Au début du XIXe siècle Jean-Baptiste Say a formulé une « loi économique » selon laquelle l’offre crée sa propre demande : les biens (d’investissement ou de consommation) produits sont nécessairement vendus car le pouvoir d’achat engendré à l’occasion de leur production permet de les acheter. Dans cette conception, le crédit et la monnaie ne jouent pas de rôle si ce n’est éventuellement d’ajustement à court terme. La croissance ne dépend donc que de la production. Reprise par les économistes de l’école néoclassiques à la fin du XIXème siècle, cette conception qui postule l’équilibre automatique entre offre et demande est encore aujourd’hui largement dominante et structurante pour la construction des modèles macroéconomiques.
Pourtant, la crise de 1929, les travaux de John Maynard Keynes sur l’importance de la demande dans la dynamique économique et ceux de Roy Forbes Harrod et Evsey Domar 73, avaient permis de remettre largement en cause cette conception.
Ils ont mis en évidence la possibilité de déséquilibres structurels (ex : entre l’offre et la demande de biens et services, entre les gains « réels » de productivité et la répartition de leur traduction monétaire, les déséquilibres sur les marchés financiers ou sur le marché du travail etc.). Cela conduit à intégrer au raisonnement sur la croissance la question de la répartition des revenus et celle de la création monétaire, via le crédit.
Une hausse de la production n’implique pas forcément une hausse de la demande
Si la hausse de la productivité, de la quantité totale, ou du taux d’utilisation d’un facteur de production permet de « faire plus », cela ne se transforme pas automatiquement en croissance du PIB.
Le PIB ne croit, en effet, que si les producteurs anticipent qu’un surcroît de production sera acheté et que leurs produits sont effectivement achetés. Cela suppose un pouvoir d’achat et un « vouloir d’achat » 74 au rendez-vous. Cela n’est pas automatique sauf précisément à croire à l’équilibre spontané des marchés (donc à croire à la loi de Say présentée ci-avant). Il est, en effet, tout à fait possible que le surcroit de revenus générés par la production ne serve pas à acquérir la production supplémentaire (parce qu’il est mal réparti, parce qu’il est épargné). 75
L’économiste Patrick Artus montre, dans son livre 40 ans d’austérité salariale comment en sortir ? (Odile Jacob, 2020), qu’au sein des pays de l’OCDE, la productivité par salarié a cru dans les 30 dernières années d’un facteur 1,5, tandis que les salaires ne croissaient que de 1,25. En parallèle, les prix ont été globalement stables. La production, elle, a crû lentement. Le crédit à la consommation a permis aux salariés, dont le revenu croissait moins vite que la production, d’acheter le surcroit de production. Il a donc joué un rôle compensateur, et ce, sur la longue durée.
Le rôle fondamental de la création monétaire via le crédit pour l’activité économique
Dans la conception néoclassique de l’économie, la monnaie est neutre : c’est le « lubrifiant » de l’économie, un simple instrument facilitant les transactions et évitant le troc. Injecter plus de monnaie dans l’économie n’a pas d’autre effet que d’augmenter le niveau général des prix. Dans le modèle néoclassique, il n’y a donc pas de monnaie, pas de crédit, pas de secteur financier. Les ménages choisissent de dépenser les revenus gagnés lors du processus de production soit en consommant, soit en épargnant (l’arbitrage entre les deux étant fonction du taux d’intérêt). L’épargne permet de financer la demande d’investissement des entreprises. C’est le taux d’intérêt qui permet d’équilibrer l’épargne et l’investissement. La monnaie et le crédit ne jouent aucun rôle dans cette dynamique.
Cette conception est clairement infirmée dans les faits.
Comme on l’a vu ci-avant, le crédit permet, tout d’abord, de soutenir (au moins pour un temps) la consommation des classes moyennes ou basses quand les revenus gagnés au cours du processus de production sont insuffisants pour qu’ils achètent les biens produits. Il permet donc d’éviter (retarder) une crise de surproduction (mais peu aboutir à une crise de surendettement ).
Par ailleurs, les entreprises, l’Etat et une partie des ménages s’endettent pour investir. Cet endettement ne repose pas que sur le recyclage de l’épargne mais également sur la création monétaire réalisée par les banques à l’occasion des crédits qu’elles accordent (voir le module sur la monnaie). Cette création monétaire est de fait permanente : le flux de nouveaux crédits étant supérieur à celui des remboursements (sauf pendant les crises financières qui sont des périodes de destruction monétaire). La nouvelle monnaie mise en circulation permet donc la réalisation de projets qui n’auraient pas vu le jour sans cela.
Enfin, le crédit et la création monétaire peuvent alimenter le surendettement et des bulles spéculatives génératrices de crises financières dont il est difficile de nier l’impact sur l’économie.
L’économiste Richard Werner a élaboré une théorie quantitative du crédit 76 et l’a confrontée notamment au cas japonais. Les deux idées clefs de son travail sont de s’intéresser au rôle de la quantité de crédit plus qu’à celui des taux d’intérêt et de bien distinguer les crédits à l’économie « réelle » des crédits aux activités « spéculatives ». Citons par exemple cet extrait d’un article paru en 2018 dans Ecological economics « Cela suggère que les marchés ne sont pas en équilibre et que le troisième facteur de croissance du PIB est une quantité (…) (à savoir, la quantité de création de crédit bancaire pour l’économie réelle, c’est-à-dire pour les transactions du PIB, comme le postule la théorie quantitative du crédit) ».
Et dans les modèles macroéconomiques les plus utilisés au niveau institutionnel ?
La majorité des modèles macroéconomiques aujourd’hui utilisés sont d’inspiration néoclassique et s’inscrivent dans la lignée de la loi de Say : ils supposent que la demande s’ajuste toujours à l’offre, dans tous les secteurs de l’économie : lorsque la production augmente, la demande est supposée augmenter dans les mêmes proportions. On dit que les marchés des biens et services, est « à l’équilibre », et l’on parle de modèles d’équilibre général. 77
Dans ces modèles, le rôle de la répartition des revenus et du crédit dans la croissance du PIB sont donc éludés.
Comment les modèles macroéconomiques les plus utilisés institutionnellement expliquent-ils la croissance économique ?
Des modèles macroéconomiques sans ressources naturelles, sans courbe de rétroaction environnementale, sans monnaie et sans répartition des revenus
Comme nous l’avons vu, les modèles macroéconomiques les plus utilisés aujourd’hui par les institutions publiques retiennent essentiellement deux facteurs de production : le capital et le travail. Ils sont reliés au PIB par le biais d’une fonction de production agrégée 78. Ils n’intègrent donc ni les ressources naturelles, ni des boucles de rétroactions environnementales : dans cette manière de modéliser l’économie, ce qui entre dans le système économique et ce qui en sort … n’est pas de son ressort ! 79
Par ailleurs, la répartition des revenus, la monnaie et le crédit ne sont généralement pas non plus représentés dans ce type de modèle : tous les biens produits sont supposés être consommés et le pouvoir d’achat distribué dans le processus de production est supposé suffire pour acheter ces biens.
Dans ces modèles, la croissance du stock de capital et l’augmentation de la mobilisation de la main d’œuvre (notamment via la réduction du chômage) permettent au PIB de croitre, dans une boucle de rétroaction positive (la croissance permettant, via l’épargne de financer l’investissement donc la hausse du stock de capital qui permet en retour la hausse de la production etc.).
Dans ces modèles, la croissance économique est principalement déterminée par une variable exogène, appelée productivité globale des facteurs
Au cœur de ces modèles, se trouve la fonction de production agrégée, qui relie le PIB aux facteurs de production, travail et capital.
Seulement, la confrontation aux données passées, via la technique de « comptabilité de la croissance » 80 introduite par Robert Solow en 1957 (voir encadré), a montré que seule une part secondaire de la croissance pouvait être expliquée par les facteurs de production capital et travail (via la boucle de rétroaction positive décrite plus haut).
La partie restante a alors été attribuée à un « facteur de production résiduel » appelé productivité globale des facteurs (PGF) ou « résidu de Solow » (voir encadré). C’est bien plus cette PGF que les autres facteurs de production qui explique la croissance dans les différentes analyses (voir encadré).
Le résidu de Solow et la théorie de la croissance exogène
Dans son article « Technical Change and the Aggregate Production Function », paru en 1957, l’économiste Robert Solow cherche à étudier dans quelle mesure la croissance économique des Etats-Unis sur la période 1909-1949 est liée aux différents facteurs de production. Il décompose les sources de la croissance entre le facteur capital, le facteur travail et se rend compte qu’ils ne suffisent pas à expliquer la croissance : il reste un « résidu » qui représente près de 87% du PIB/habitant des Etats-Unis sur cette période !
Solow attribue ce « facteur de production résiduel » au progrès technique qu’il considère comme exogène, c’est-à-dire extérieur à la dynamique économique, non déterminé par les décisions des agents. C’est une « manne tombée du ciel ». C’est pourquoi, la théorie de la croissance développée par Solow est qualifiée de croissance exogène.
En savoir plus : voir la fiche sur le résidu de Solow sur le site Partageons l’Eco
Ainsi, dans de nombreux modèles macroéconomiques aujourd’hui utilisés pour éclairer les politiques publiques, la croissance du PIB est déterminée en premier lieu par la PGF qui, comme on l’a vu, est un élément résiduel. C’est, par définition, la part de la croissance de la production qui n’est explicable ni par l’augmentation du facteur capital ni par celle du facteur travail. C’est donc un terme « ad hoc », exogène au modèle : c’est-à-dire qu’il n’est pas expliqué par les relations avec les autres variables du modèle. Il est fixé de façon conventionnelle par le modélisateur sans reposer sur l’observation de données.
En se basant sur les théories de la croissance endogène (voir encadré), certains modélisateurs tentent « d’endogénéiser » la PGF (c’est-à-dire en faire une variable qui découle du modèle) mais cela reste partiel et c’est loin d’être le cas de la majorité des modèles. Parmi tous les modèles institutionnels étudiés dans ce chapitre, seule une variante du modèle Quest utilisé par la Commission Européenne propose une endogénéisation – partielle – de la PGF. Dans ce modèle, la PGF croit pour partie, grâce à des investissements dans la R&D, et pour partie de manière exogène.
Expliquer la PGF : les théories de la croissance endogène
Dans le dernier quart du XXème siècle, de nombreux travaux théoriques 81 ont eu pour objet d’analyser la PGF, ce « résidu » censé représenter le progrès technique. Ils sont regroupés sous l’appellation « théories de la croissance endogène » car ils cherchent à montrer que la productivité globale des facteurs n’est pas une « manne tombée du ciel » comme dans le modèle de Solow mais provient bien de la croissance elle-même tout en la nourrissant (provoquant ainsi un cercle vertueux).
Ainsi, pour Robert Lucas la croissance permet aux travailleurs d’accumuler du « capital humain » (stock de connaissances et de compétences, état de santé etc.) qui les rendent plus productifs. Pour Romer, c’est la Recherche & Développement, c’est-à-dire l’accumulation de « capital technologique » qui permet d’accroître la productivité non seulement des acteurs à l’origine de cette R&D mais aussi à tous les autres. Enfin, Robert Barro a souligné le rôle de l’investissement public (donc l’accumulation de capital public) : les infrastructures sont sources de multiples externalités positives pour ceux qui en bénéficient et stimulent leur productivité. La croissance qui en résulte génère une hausse des rentrées fiscale qui alimentent à leur tour l’investissement public.
En conclusion, dans les modèles que nous avons évoqués en début de chapitre (qui sont représentatifs de la majorité des modèles utilisés par les institutions publiques), la croissance s’explique pour plus grande partie par la croissance exogène (donc inexpliquée) de la productivité des facteurs de production, et pour le reste par les équations qui relient l’investissement à l’accroissement du stock de capital. Le PIB croit donc par hypothèse, sans que l’on explique comment.
Le rôle du crédit et de la répartition des revenus n’est pas pris en compte dans ces modèles, tout comme le rôle joué par le capital naturel. Enfin, les effets de rétroaction de la dérive climatique et de la destruction de la nature sur la croissance qui en est la cause sont un point aveugle du raisonnement et ne sont pas représentés par ces modèles actuels.
Ces modèles sont donc porteurs d’une vision non seulement sans fondement solide mais dangereuse. Elle nous conduit à sous-estimer (voir à nier) les impacts de la crise écologique, à surestimer nos moyens pour y faire face et à se tromper sur les politiques publiques à adopter en mettant la croissance en priorité alors qu’elle ne peut être qu’une résultante (ou pas) de nos choix sociaux et économiques.
Pour en savoir plus
- Franck-Dominique Vivien, « Les modèles économiques de soutenabilité et le changement climatique », Regards croisés sur l’économie, vol.2, n°6, 2009, pp. 75-83
- Martin Anota, « Les théories de la croissance économique », blog Annotations, 1er septembre 2012
- Gaël Giraud, « Crise de la « science économique » » (partie 1), blog de Mediapart, 29 novembre 2015
- Gaël Giraud, « Crise de la « science économique » » (partie 2), blog de Mediapart, 1er décembre 2015
La question du découplage occupe le centre des débats sur les liens entre croissance et écologie
L’objectif de découplage entre la croissance économique et les pressions sur la nature est régulièrement invoqué dans les politiques publiques depuis le début des années 2000. Nous nous penchons ici sur ce que signifie concrètement le découplage, sur les arguments de ceux qui l’invoquent et de ceux qui le disent impossible, pour ensuite nous poser la question de la pertinence de ce débat.
Que signifie découpler la croissance du PIB des pressions sur la nature ?
La notion de découplage signifie que la croissance économique pourrait s’accompagner de la décroissance des pressions sur la nature (mesurée par différents indicateurs). Concrètement, le lien constaté jusqu’à présent entre croissance du PIB et impacts environnementaux (voir l’Essentiel 6) serait rompu.
Cette première approche doit cependant être précisée. En effet, il ne suffit pas de découpler un peu : il faut découpler suffisamment pour préserver l’habitabilité de notre planète.
Dans une publication de la société Carbone 4, ses auteurs détaillent les conditions qu’une telle ambition implique.
- Le découplage doit concerner l’ensemble des enjeux écologiques.
Il doit concerner l’amont et l’aval du système économique, c’est-à-dire l’ensemble des ressources naturelles 82 utilisées dans le système productif et l’ensemble des déchets et pollutions générés (y compris les gaz à effet de serre) lors la production et au moment de la consommation. Il ne s’agit donc pas seulement de découpler croissance économique et énergie ou émissions de gaz à effet de serre comme souvent présenté dans les analyses.
- Le découplage doit être global et non local
La réduction des pressions sur la nature doit être envisagée à l’échelle de la planète et non à la seule échelle d’un pays ou d’une région du monde. C’est particulièrement évident pour les enjeux globaux tel le réchauffement climatique, le trou de la couche d’ozone ou la préservation des ressources maritimes.
- Le découplage doit être absolu et non relatif
Le découplage relatif signifie que chaque unité de PIB supplémentaire est obtenue grâce à moins de ressources naturelles ou génère moins de pollutions que l’unité précédente.
L’objectif est d’obtenir un découplage absolu : les prélèvements sur la nature et les pollutions doivent baisser.
Par exemple, au niveau mondial les émissions de gaz à effet de serre (GES) par unité de PIB (en PPA) sont passées de 613 g de CO2eq en 1990 à 423 g en 2015. Malheureusement, ce découplage relatif ne s’est pas traduit en découplage absolu : sur la même période, les émissions mondiales de GES sont passées de près de 33 à 49 Gt de CO2eq. 83
- Enfin, ce découplage doit être pérenne dans le temps et suffisamment rapide pour éviter des dommages environnementaux irréversibles.
Par exemple, le dernier rapport du GIEC 84 indique que pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5°C, les émissions de CO2 doivent baisser jusqu’à devenir nulles en 2050 puis négatives ensuite ! Cela implique une baisse moyenne de près de 3,5 milliards de GT de CO2 par an.
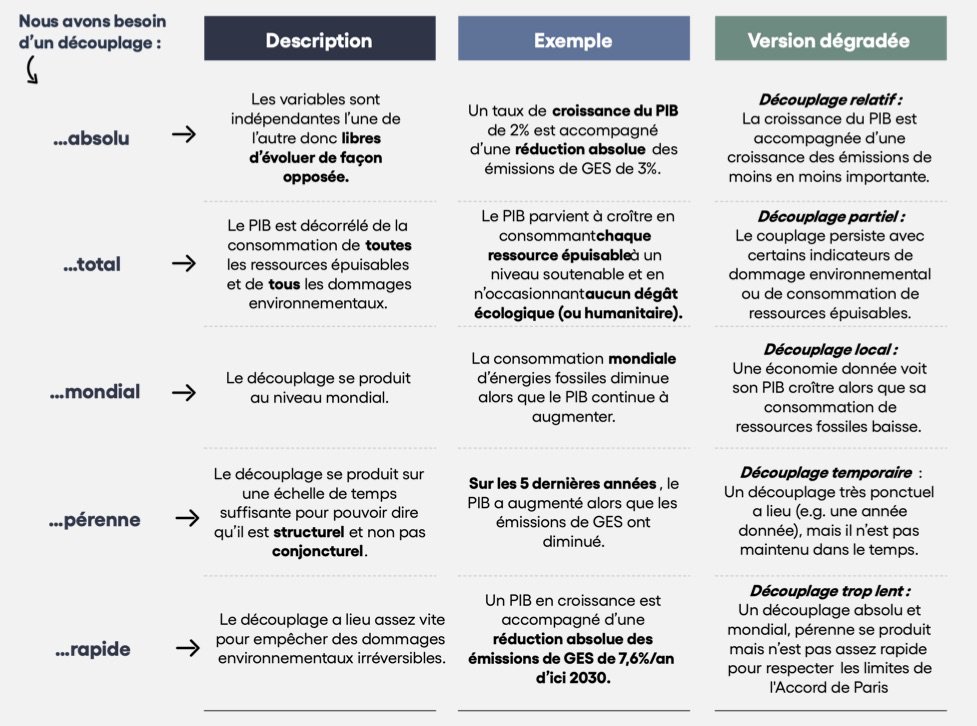
Source Découplage et croissance verte, Carbone 4, 2021
Les arguments de ceux qui croient le découplage possible
Le principal argument mobilisé en faveur du découplage repose sur l’observation du passé.
Dans certaines régions du monde parmi les plus développées, un découplage absolu a en effet été constaté pour certains impacts. C’est en particulier le cas de l’Union européenne en matière de réchauffement climatique. Les émissions de GES de l’Union européenne ont atteint un pic à plus de 6 Gt eq CO2 à la fin des années 1970 pour ensuite descendre à environ 4,5 Gt eq CO2 en 2015.
Évolution des émissions de GES de l’Union européenne (à 28) 2015 – 2020
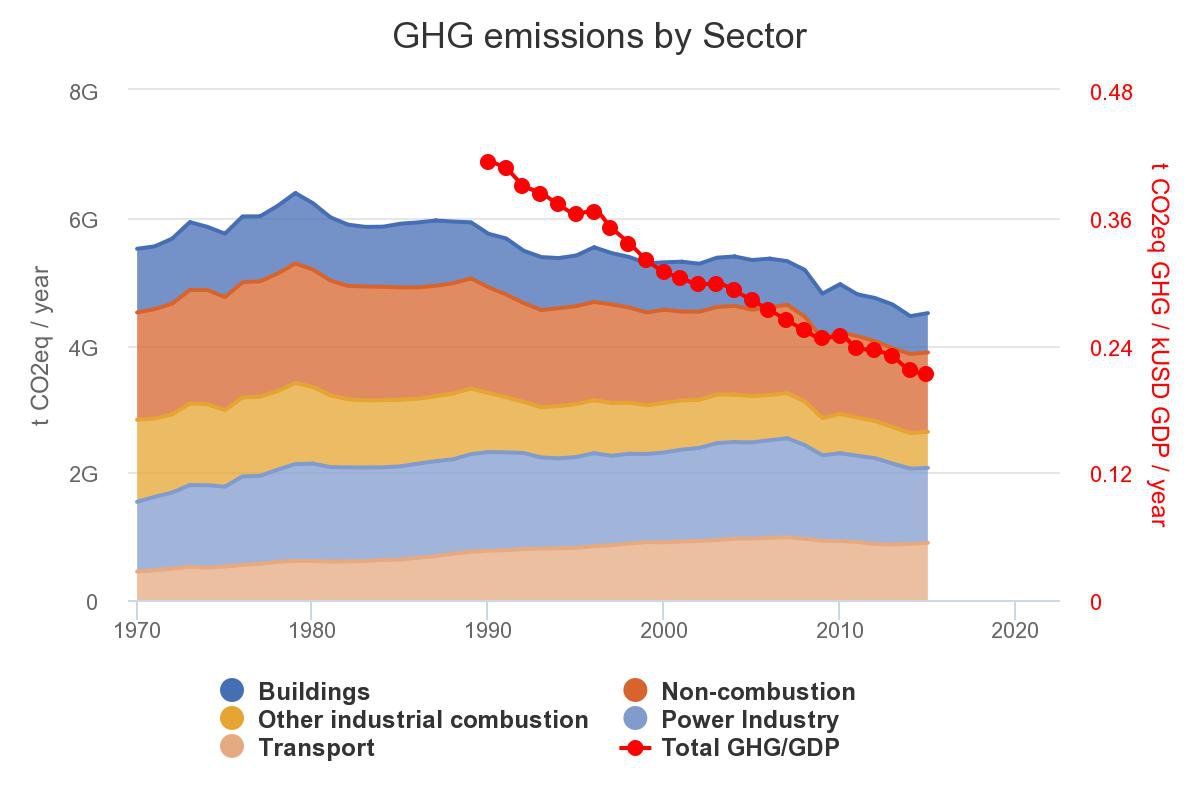
Source Base de données EDGAR
Une étude de la revue Climate Policy parue en 2020 permet d’entrer plus dans le détail. Elle analyse l’évolution de 24 pays (22 pays européens, les Etats Unis et la Jamaïque) qui ont réduit en valeur absolue leurs émissions territoriales de CO2 ainsi que leurs émissions globales de GES (même si dans une moindre mesure) entre 1970 et 2018 (l’atteinte du pic d’émission étant différent selon les pays). Dans ces 24 pays, les émissions de CO2 liées à la consommation (l’empreinte CO2) sont également en baisse depuis au moins 2008. Cette précision est importante car les pays concernés ont délocalisé une partie de leur production (et donc de leurs émissions de GES) dans d’autres pays du monde. 85
Pour certains économistes, cette évolution confirme la théorie de la « courbe environnementale de Kuznets » : au-delà d’un certain niveau de revenu, tout enrichissement supplémentaire favorise aussi la qualité de l’environnement et la baisse de la pollution (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions).
Si l’Union européenne a pu maintenir la croissance économique tout en réduisant son impact sur le réchauffement climatique, cela signifie que le monde dans son ensemble pourrait également y parvenir.
Deux leviers majeurs doivent être mobilisés pour atteindre le découplage :
- l’efficacité de l’utilisation des ressources permises par le progrès technique
- la substitution de ressources polluantes par d’autres
La façon dont est envisagé le découplage entre émissions de gaz à effet serre et croissance économique est exemplaire de cette vision. Rappelons encore une fois que le climat n’est pas le seul défi écologique. Cependant, étant placé en haut de l’agenda des politiques écologiques, c’est le plus étudié.
Le think tank The Shift Project a analysé 17 scénarios de transition énergétique 86 provenant tant d’organisations internationales, d’agences de recherche, d’ONG ou d’entreprises. Cette publication permet de dresser plusieurs constats :
Tout d’abord, dans de nombreux scénarios, la croissance du PIB est une donnée exogène, c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas des autres paramètres étudiés. Ainsi, la disponibilité des ressources naturelles ou les dommages du réchauffement climatique n’ont par construction aucun impact sur le PIB : leur lien n’est tout simplement pas étudié (voir l’Essentiel 8 sur les modèles macroéconomiques).
Ensuite, les scénarios postulent 1/ une croissance de l’efficacité énergétique 87 sans précédent et 2/ la baisse drastique du contenu carbone de l’énergie (les énergies fossiles sont remplacées par des énergies bas carbone) et 3/ dans une moindre mesure la sobriété énergétique (le fait de moins consommer d’énergie).
Enfin, certains de ces scénarios impliquent également une mobilisation importante des techniques de captage du CO2, qu’elles reposent sur la reforestation ou sur les techniques industrielles de captage au moment des émissions ou directement dans l’atmosphère, puis de stockage dans des réservoirs géologiques.
Toutes ces évolutions sont rendues possibles par le progrès technique, lui-même stimulé par la hausse du prix du carbone et les soutiens publics à l’investissement et à l’innovation. En bref, le pari du découplage repose souvent sur un fort optimisme technologique.
Les arguments de ceux qui pensent le découplage impossible
Là encore, ces arguments s’appuient sur l’observation du passé.
Si l’on considère l’ensemble des conditions présentées au point 9.1 ci-dessus, il est clair qu’à ce jour le découplage reste un objectif mais pas une réalité.
L’analyse du seul sujet du réchauffement climatique (le plus étudié) suffit à s’en convaincre.
Si un découplage entre croissance et émissions de gaz à effet de serre a bien été constaté en termes relatifs à l’échelle de la planète ou en termes absolus pour certaines régions du monde, au niveau mondial les émissions de CO2 et plus généralement de GES continuent à croitre en valeur absolue. Par ailleurs, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 comme le recommande le GIEC, il faudrait atteindre un rythme de découplage nettement plus rapide que celui constaté à ce jour.
Ainsi, selon l’édition 2019 de l’Emissions Gap Report du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer de 7,6 % par an entre 2020 et 2030 pour limiter le réchauffement climatique à +1,5°C.
Dans l’étude citée en 9.2, les auteurs distinguent trois profils de pays sur les 24 ayant réduit leurs émissions dans la période 1970-2018 :
- « Long terme decline » : six pays ont réduit régulièrement leurs émissions de CO2 depuis les années 1970 (France, Allemagne, Royaume Uni, Suède, Belgique et Macédoine) avec des rythmes moyens compris entre -1,5% (pour la Suède) et -0,4% (pour la Belgique) ;
- « Former eastern bloc » : six pays de l’ancien bloc de l’Est ont connu une réduction rapide des émissions de CO2 au moment de la dissolution de l’Union soviétique puis une très légère diminution (rythmes annuels moyens compris entre -4% pour l’Ukraine et -1,6% pour la Slovaquie) ;
- « Recent peak » : douze pays (dont les États-Unis, l’Italie, l’Espagne) ont connu un pic d’émissions au milieu des années 2000 puis des réductions à un rythme parfois élevé (entre -4,1% pour la Grèce et -0,5% pour les Pays-Bas).
Ces chiffres ne concernent que les émissions de CO2 : les auteurs de l’étude précisent que pour la majorité des pays les rythmes de réduction des émissions de GES sont un peu plus faibles. On est donc loin des niveaux requis par l’ambition climatique internationale.
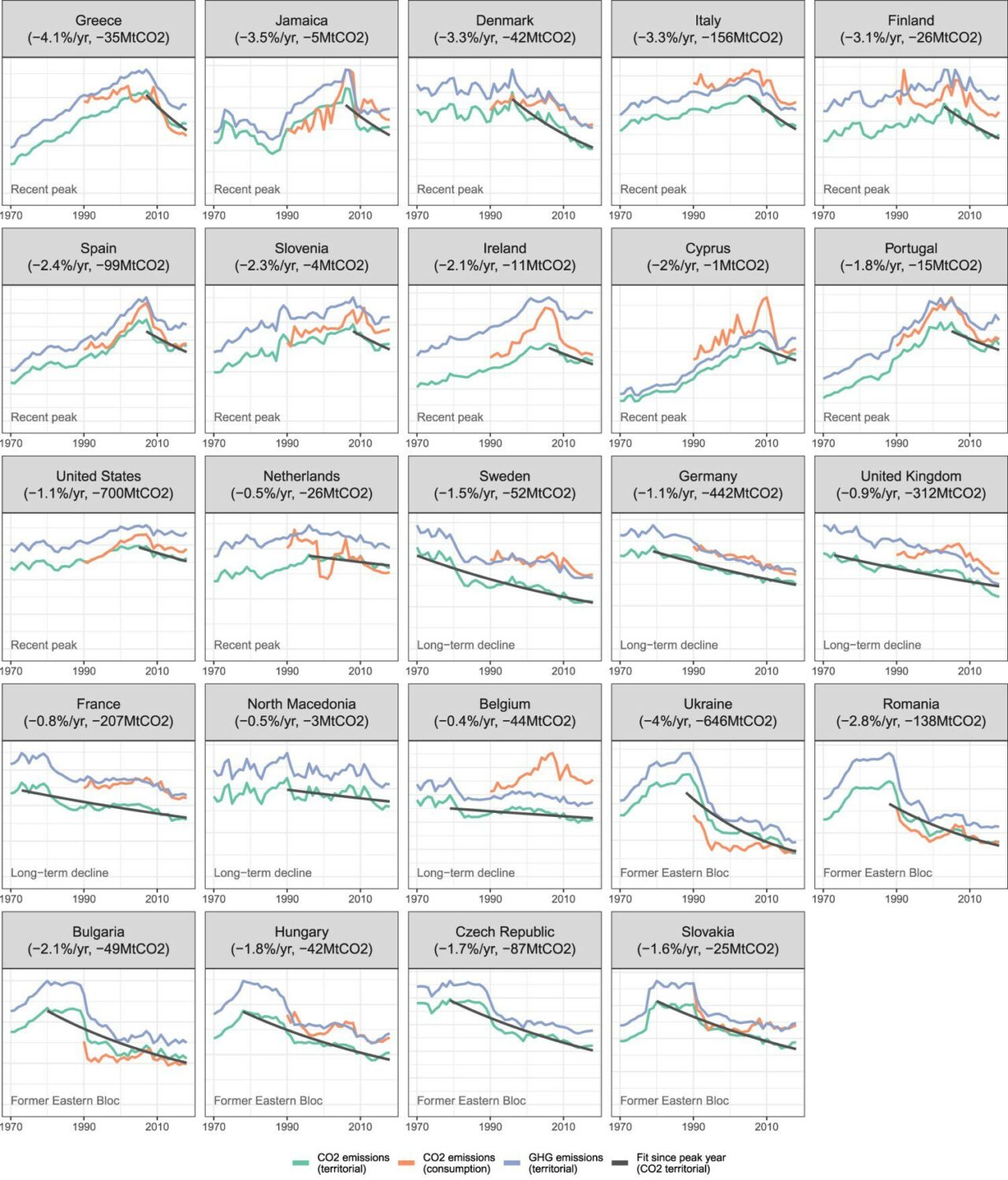
Source William F. Lamb et al. Countries with sustained greenhouse gas emissions reductions: an analysis of trends and progress by sector, Climate policy, 2021.
Ce qui vaut pour les GES est également valable pour nombre d’autres impacts environnementaux. Des chercheurs ont réalisé une méta-analyse 88 portant sur 179 publications étudiant le découplage, réalisées entre 1990 et 2019. Leur conclusion est sans appel :
« Les 179 articles examinés contiennent des preuves d’un découplage absolu entre les impacts, notamment les émissions de CO2 (et de SOX), ainsi que l’utilisation des terres et de l’eau dans des cas géographiquement limités (au niveau national) par rapport au PIB, mais pas de découplage des ressources pour l’économie dans son ensemble, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale. Il n’y a pas de preuves d’un découplage absolu suffisamment rapide au niveau mondial. »
Source : Decoupling for ecological sustainability (2020)
La croyance dans le découplage repose sur la foi dans le progrès technique
L’European Environment Bureau a, dans une étude de 2019, mis en évidence les arguments principaux opposés à la possibilité du découplage qui relèvent surtout de la trop grande croyance dans l’efficacité du progrès technique.
Voici quelques-uns de ces arguments :
- L’effet rebond. Les améliorations de l’efficacité énergétique sont souvent partiellement ou totalement compensées par une réaffectation de l’argent économisé à la même consommation (par exemple, en utilisant plus souvent une voiture économe en carburant), ou à d’autres consommations ayant un impact (par exemple, en achetant des billets d’avion pour des vacances lointaines avec l’argent économisé grâce aux économies de carburant). Elles peuvent également générer des changements structurels dans l’économie qui induisent une consommation plus élevée (par exemple, des voitures plus économes en carburant renforcent un système de transport basé sur la voiture au détriment d’alternatives plus écologiques telles que les transports publics et le vélo).
- Les solutions technologiques à un problème environnemental peuvent en créer de nouveaux et/ou en exacerber d’autres. Par exemple, la production de véhicules électriques exerce une pression sur les ressources en lithium, en cuivre et en cobalt qui ne sont pas en quantités illimitées sur notre planète 89 ; la production de biocarburants suscite des inquiétudes quant à l’utilisation des sols, notamment pour la production alimentaire ; les centrales nucléaires posent des problèmes en termes de gestion des déchets, de ressources en eau et de risques d’accidents.
- Les gains d’efficacité-matière ne peuvent être soutenus indéfiniment : ils atteignent nécessairement un plafond. Pour fabriquer une voiture, il faut une épaisseur minimale d’acier, donc, passés les premiers gains, il faudra toujours plus d’acier pour fabriquer toujours plus de voitures. Autre exemple, les gains d’efficacité énergétique diminuent au fur et à mesure que l’efficacité des processus se rapproche de la limite thermodynamique. Ainsi, « la production d’acier consommait environ 50 MJ/kg dans les années 50 et elle a été divisée par deux entre les années 50 et 2000. Elle ne pourra très probablement pas être divisée par deux d’ici 2050, car l’investissement nécessaire pour gagner quelques MJ quand on se rapproche de la limite thermodynamique (10 MJ/kg) devient prohibitif. » 90
- Le progrès technologique est indifférencié : il ne cible pas nécessairement les facteurs de production importants pour la durabilité écologique. Il peut conduire dans le même temps au développement des innovations qui réduisent les pressions sur l’environnement et à celui des innovations qui augmentent l’impact des humains sur la planète.
Le respect des limites planétaires implique nécessairement de mobiliser dans une proportion bien plus importante le levier de la sobriété afin de faire décroitre en valeur absolue les consommations matérielles et les pollutions.
Au-delà du débat sur le découplage
Il est clair qu’un monde dans lequel la transition écologique a permis de préserver l’habitabilité de notre planète est un monde dans lequel la consommation de ressources naturelles a été drastiquement réduite, de même que les pollutions générées par le système productif.
Y parvenir nécessite à la fois de réduire les consommations de biens et services et d’augmenter l’investissement. Cela se manifestera également par des évolutions dans le poids respectif des différents secteurs de l’économie. Certains sont amenés à disparaître (les énergies fossiles, l’industrie et le commerce du tout jetable), d’autres à gagner en importance (l’agriculture, les énergies bas carbone, la rénovation énergétique, le recyclage, la réparation), d’autres encore à se transformer radicalement (le transport, la chimie, le numérique etc.)
L’impact sur le PIB de ces évolutions n’est pas prévisible. A court et moyen terme, la balance entre les « gains » économiques (liés aux investissements et au développement d’activités sobres et bas-carbone) et les pertes (arrêts d’activités polluantes ou trop gourmandes en ressources naturelles) n’est pas évidente a priori.
Par ailleurs, on a vu dans l’Essentiel 3 que le PIB était un indicateur reposant largement sur des conventions, y compris pour la valorisation d’échanges non marchands. Les ajustements méthodologiques comptables pourraient donc également avoir un impact sur le niveau du PIB et donc sur la perception du découplage. C’est exactement ce qui s’est passé depuis la création de l’indicateur (voir encadré).
Se projeter dans un monde qui se conforme aux objectifs écologiques adoptés par la communauté internationale, c’est se projeter dans un monde où les « règles du jeu » économiques ont fortement changé. Pour ne prendre qu’un exemple, si l’énergie a été pendant un siècle facile d’accès et peu chère, il ne faut pas s’étonner qu’elle ait été gaspillée ; à l’inverse un monde qui lutte contre le changement climatique est un monde qui décide de contraindre (par divers moyens) l’usage des énergies fossiles, alors que les énergies bas-carbone butent sur de nombreuses limites (espace, matières premières etc.).
Induire du monde passé des conclusions sur son évolution future alors qu’on suppose de forts changements n’est donc pas très pertinent.
Symétriquement, si nous ne parvenons pas à réduire drastiquement nos impacts sur la nature alors les habitants de la planète vont de plus en plus être confrontés aux limites planétaires ce qui ne peut conduire qu’à des tensions, des conflits voire des guerres pour des ressources et espaces humainement habitables devenus rares.
Imaginer le monde à venir sur une conception « business as usual », comme c’est le cas des réflexions autour du découplage, constitue donc une erreur de raisonnement.
Quand l’estimation du découplage dépend de la définition du PIB
Dans un article paru début 2024, Gregor Semieniuk analyse l’impact de l’évolution des définitions du PIB élaborées au fil du temps par les organismes statistiques sur les résultats de découplage. En effet, comme nous l’expliquons dans l’essentiel 3, le calcul du PIB dépend de nombreuses conventions et a beaucoup évolué au cours du temps. Par exemple, ce n’est qu’à partir de 1977 que la production non marchande des administrations publiques est incluse dans le PIB.
Les travaux de Gregor Semieniuk permettent de montrer que le découplage n’est pas le même selon la définition retenue pour représenter notre histoire économique. Par exemple, aux Etats-Unis avec la définition en vigueur en 2018, les statistiques renvoient l’image d’une économie nécessitant 50 % de moins d’énergie entre 1930 et 1980 pour produire une unité de PIB. Si on retient la définition de 1984, le progrès n’a été que de 30 %. Pour certains pays, les changements sont encore plus importants : des découplages constatés avec la mesure actuelle du PIB sont transformés en recouplage avec des définitions passées (et inversement).
Source G. Semieniuk, Inconsistent definitions of GDP: Implications for estimates of decoupling, Ecological Economics (2024). Les résultats de cet article sont présentés de façon très claire dans Une croissance moins polluante ? Encore faut-il savoir ce que l’on entend par croissance, The Conversation (2024)
Pour en savoir plus
- « Découplage et croissance verte », Carbone 4, 2021
- Une croissance moins polluante ? Encore faut-il savoir ce que l’on entend par croissance, The Conversation (2024)
- Clément Jeanneau, « Des nouvelles de la croissance verte », blog Nourritures terrestres, 17 novembre 2020
- European Environmental Bureau, « Decoupling debunked – Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability », 2019
- Helmut Haberl et al, « A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights », Environmental Research Letters, vol.15, n°6, juin 2020
- T.Vadén et al., « Decoupling for ecological sustainability: A categorisation and review of research literature », Environmental Science & Policy, vol.112, octobre 2020, pp.236-244
- K.Lenaerts et al., « Can climate change be tackled without ditching economic growth ? », 27 septembre 2021
L’économie d’un pays doit faire l’objet d’un pilotage macroéconomique qui ne peut pas être focalisé sur le PIB
Les agents économiques ne peuvent être laissés à eux-mêmes. Dit autrement, le libre marché ne peut conduire à l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux désirables. La puissance publique a une responsabilité de pilotage. Mais aujourd’hui, en Europe et dans la majorité des pays dans le monde, elle l’exerce en privilégiant un objectif macroéconomique central : la maximisation de la croissance du PIB, qui s’accompagne de dégradations environnementales insoutenables (voir l’Essentiel 6). Comment faire autrement ?
La décroissance du PIB, un objectif repoussoir
Comme développé dans l’Essentiel 1 et dans l’Idée reçue 6, la croissance verte est régulièrement invoquée comme horizon des politiques publiques pour respecter les limites planétaires.
A l’opposé, le mouvement pour la décroissance est souvent caricaturé dans le débat public comme se focalisant sur un objectif volontaire de décroissance du PIB, donc de récession économique. Il fait alors figure de repoussoir.
« Pour bon nombre de personnes, la référence à la décroissance agit comme un repoussoir, véhiculant un imaginaire de privation. Ses détracteurs ne manquent d’ailleurs pas de la caricaturer comme un retour forcé à la bougie. Un discours particulièrement efficace, car nous avons été collectivement conditionnés par l’importance de la croissance et par la peur de sa disparition. »
Dans le monde de l’entreprise, les dirigeants recherchent pratiquement toujours à faire croitre leur organisation : il est très difficile de gérer la réduction du chiffre d’affaires d’une entreprise, ce qui suppose baisse des salaires, temps partiel, licenciements… Dès lors, les chefs d’entreprises sont favorables à la croissance du PIB, en généralisant le raisonnement à toutes les sociétés, et sans prendre en considération les limites que nous évoquons dans ce module.
Plus généralement, les détracteurs de la décroissance invoquent, d’une part, le besoin de croissance des pays en développement pour atteindre des objectifs sociaux et humains essentiels et, d’autre part, les problèmes majeurs dans les pays riches que poserait une récession programmée pour la soutenabilité de la dette, le financement des retraites ou de la sécurité sociale etc.
Enfin, en matière de transition écologique, l’objectif de décroissance du PIB réduirait les marges de manœuvre nécessaires, enlèverait la motivation des agents économiques à prendre des risques et innover et serait favorable au statu quo, c’est-à-dire à une économie insoutenable.
Des mouvements riches qui veulent voir au-delà de la croissance
En réalité, les mouvements et les recherches sur la décroissance sont bien plus riches et divers que le seul objectif de décroissance du PIB.
La décroissance est une réduction planifiée de l’utilisation de l’énergie et des ressources visant à rééquilibrer l’économie avec le monde vivant de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être humain.
Si le terme décroissance est apparu dans les années 1970 91 dans la lignée du rapport The Limits to Growth et donc du débat sur les limites écologiques de la croissance de la production, les mouvements se revendiquant de la décroissance trouvent leurs racines dans différents courants de pensée et philosophies qui s’entrecroisent.
L’argument écologique et l’appel à un renouvellement du paradigme économique dominant pour intégrer ressources naturelles et pollutions sont bien évidemment très présents. Mais la décroissance se nourrit également de la critique des politiques de développement menées dans les pays du Sud et de l’anti-utilitarisme, des réflexions sur le sens de la vie dans les sociétés modernes (centrées sur l’idée de travailler plus pour gagner plus et consommer plus), de l’appel à un renouveau du débat démocratique et à plus de justice sociale via la réduction des inégalités.
Les stratégies sont également très variées : elles vont du militantisme activiste s’opposant à des projets d’expansion d’aéroports, d’autoroutes ou de centres commerciaux, à la construction d’alternatives locales montrant que des modes de vie frugaux et peu impactants sont possibles, en passant par les chercheurs et think tank qui cherchent à réformer les institutions existantes ou à construire un nouveau paradigme macroéconomique écologique.
Depuis le début du XXIe siècle, une littérature foisonnante est ainsi apparue avec des auteurs comme Giorgos Kallis, Jason Hickel, Tim Jackson, Kate Raworth, Timothée Parrique, Eloi Laurent, Dominique Meda etc.
La très grande variété de ceux qui agissent et réfléchissent pour mettre en œuvre la profonde transformation écologique et sociale de notre mode de développement se traduit par la grande diversité des terminologies employées pour désigner le modèle : « économie du bien-être », « économie stationnaire », « économie de la post-croissance », « donut économie »…
Début 2021, l’agence européenne de l’environnement a publié la note Growth without economic growth, qui effectue une bonne synthèse du questionnement central posé par ces mouvements.
La croissance économique est étroitement liée à l’augmentation de la production, de la consommation et de l’utilisation des ressources et a des effets néfastes sur l’environnement naturel et la santé humaine. Il est peu probable qu’un découplage durable et absolu entre la croissance économique et les pressions et impacts environnementaux puisse être réalisé à l’échelle mondiale ; les sociétés doivent donc repenser ce que l’on entend par croissance et progrès et leur signification pour la durabilité mondiale.
Pour en savoir plus
- De nombreuses ressources sur le site de Timothée Parrique
- Demaria et al., What is Degrowth ? From an activist slogan to a social movement, Environmental Values, vol. 22, 2013, pp. 191–215
- Jason Hickel, What Does Degrowth Mean? A Few Points of Clarification, Globalizations, vol.18, septembre 2020, pp.1-7
- Agence européenne de l’environnement, Growth without economic growth, 2021
Se fixer de nouveaux horizons collectifs
Se détacher de la croissance du PIB implique une redéfinition des horizons collectifs de notre société.
Trois horizons collectifs doivent être remis au cœur du gouvernement de l’économie, qui n’est qu’une facette de la coopération sociale : le bien-être, la résilience et la soutenabilité.
Viser le bien-être consiste à valoriser les véritables déterminants de la prospérité humaine, au-delà des seules conditions matérielles et du bien-être économique (se soucier de la « qualité de vie » et du développement humain).
Construire la résilience, c’est s’assurer que ce bien-être humain puisse supporter les chocs à venir (notamment environnementaux), comme l’illustre la question majeure de l’adaptation de nos territoires au changement climatique.
Enfin, rendre nos sociétés soutenables, c’est comprendre à quelles conditions le bien-être humain peut se projeter et se maintenir durablement dans le temps, sous une contrainte écologique de plus en plus forte, afin d’en tirer toutes les conséquences ici et maintenant, au plan local comme au niveau global.
Les marchés ne s’autorégulant pas, ces horizons ne pourront être atteints sans un véritable pilotage de l’économie que seule la puissance publique à légitimité à mener. Il s’agit en particulier de surveiller et de corriger les grands déséquilibres :
- la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales ;
- l’insuffisance d’utilisation des moyens de production (que ce soit les usines ou les travailleurs) ;
- l’excès d’endettement des agents privés et les déséquilibres financiers, source potentielle de récession voire de déflation ;
- le déséquilibre de la balance commerciale ;
- la pression excessive sur les ressources naturelles (eau, sols, forêts, poissons etc.) et les pollutions massives (de l’eau, de l’air, des sols) pouvant mener à des déséquilibre globaux (réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité – voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions).
C’est à la puissance publique de corriger les déséquilibres (du moins les plus significatifs et à l’intérieur de marges d’appréciation à définir) et de tenter d’empêcher qu’ils arrivent.
Il ne s’agit pas de viser la perfection et une précision d’horloger mais de raisonner en ordres de grandeur pour changer de cap et éviter les spirales négatives.
Pour cela, se détacher du PIB et de l’objectif de croissance en adoptant des indicateurs alternatifs est un élément essentiel mais, comme on l’a vu dans l’Essentiel 7, ce n’est pas suffisant.
Un indicateur est fait pour signaler si les politiques publiques vont dans le bon sens. Il ne suffit pas à piloter une économie.
Comme l’écrit Aurore Lalucq, il nous faut « étudier les conséquences pratiques d’un changement de modèle : par quoi remplacer le PIB dans les négociations collectives et le vote du budget ? Comment financer notre modèle social ? Et quid des marchés financiers, dont l’existence même est intrinsèquement liée à une croissance perpétuelle ? ».
Plus généralement, il s’agit de revenir sur le mouvement de dérégulation et de dérèglementation des dernières décennies et de redonner à la puissance publique la pleine maitrise des outils de politiques économiques (budget, monnaie, normes et règlements, encadrement de la finance etc.).
Cela implique de restructurer les places respectives du marché, de l’Etat (dont le niveau européen) et des communautés territoriales. Il appartient aux Etats de planter le cadre, les règles du jeu nationales et internationales, de fixer aux entreprises privées les limites nécessaires sur le plan social et écologique et de donner les espaces de liberté aux communautés territoriales. La gestion des biens communs, qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux, ne peut se réduire à la mise sur le marché de droits d’accès ou d’usage et encore moins à leur privatisation.
Idées reçues
La hausse de la productivité serait la source principale de la croissance du PIB
Dans leur majorité, les économistes sont convaincus que la croissance du PIB est due en premier lieu à celle de la productivité du travail. 92
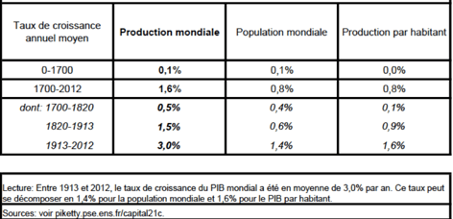
Source Site de l’économiste Thomas Piketty – Pour des chiffres détaillés sur la France, voir le module Travail et chômage.
Il saute aux yeux que la croissance de la productivité des êtres humains s’est améliorée substantiellement depuis la révolution industrielle et les processus successifs de mécanisation, industrialisation, automatisation et robotisation qu’elle a permis.
L’agriculture : un cas particulièrement frappant
En France, nous sommes passés « de 4 millions d’exploitations agricoles en 1929, à 2,3 millions en 1955 et moins de 400 000 aujourd’hui. Si la tendance de ces deux dernières décennies se poursuivait, on devrait compter 250 000 exploitations agricoles à l’horizon 2030. » 93
Les chiffres relatifs aux actifs agricoles sont encore plus parlants, les fermes ne faisant quasiment plus vivre aujourd’hui que le chef d’exploitation. Dans les années 1930, il y avait environ 7 millions d’actifs agricoles. Ils sont moins de 760 000 en 2020 (dont 70% d’exploitants) 94. A noter que la politique agricole en Europe et en France, à partir des années 1950, a été conçue pour encourager cette productivité via des aides à l’augmentation des surfaces, la mécanisation, la sélection variétale et le développement des pesticides. En parallèle, le nombre de tracteurs est passé de 20 000 en 1929 (soit 1 tracteur pour 200 exploitations) à 230 000 en 1954 et à plus de 800 000 aujourd’hui (soit 2,2 tracteurs par exploitation) 95, beaucoup plus puissants 96, et ce sans compter les autres machines.
Voir d’autres exemples dans le module Travail et chômage
Le raisonnement des économistes qui font de la productivité un moteur de croissance et d’emploi
Alors que le bon sens fait du remplacement de l’homme par la machine une cause de chômage et que l’histoire des luttes sociales rappelle combien la mécanisation s’est heurtée aux légitimes oppositions des travailleurs, les économistes font au contraire de la productivité le moteur de la croissance et pour finir de l’emploi. Quel est leur raisonnement ?
Les gains de productivité (issus du progrès technique) se traduisent directement en baisse de quantité de travail à production donnée. C’est leur définition même.
Ils libèrent ainsi des forces de travail qui peuvent être employées à produire davantage du même produits ou d’autres marchandises et devenir ainsi source de croissance économique. C’est d’ailleurs ce qu’on a constaté pendant la majeure partie de l’ère industrielle comme le montrent les chiffres ci-dessus.
Mais ce processus n’a rien d’automatique. Pour qu’il y ait croissance de la production, il est nécessaire qu’au niveau macroéconomique :
- les entreprises décident d’augmenter la production via des investissements de capacité supérieurs à ceux existants 97 ou en créant de nouvelles activités ;
- la production supplémentaire puisse se vendre. Il faut donc que le pouvoir d’achat, potentiellement libéré grâce aux gains de productivité, soit effectivement distribué aux futurs acheteurs (via les hausses de salaire ou les baisses de prix) de façon suffisante.
Le schéma ci-après illustre trois voies par lesquelles la redistribution des gains de productivité permet une hausse de la production.
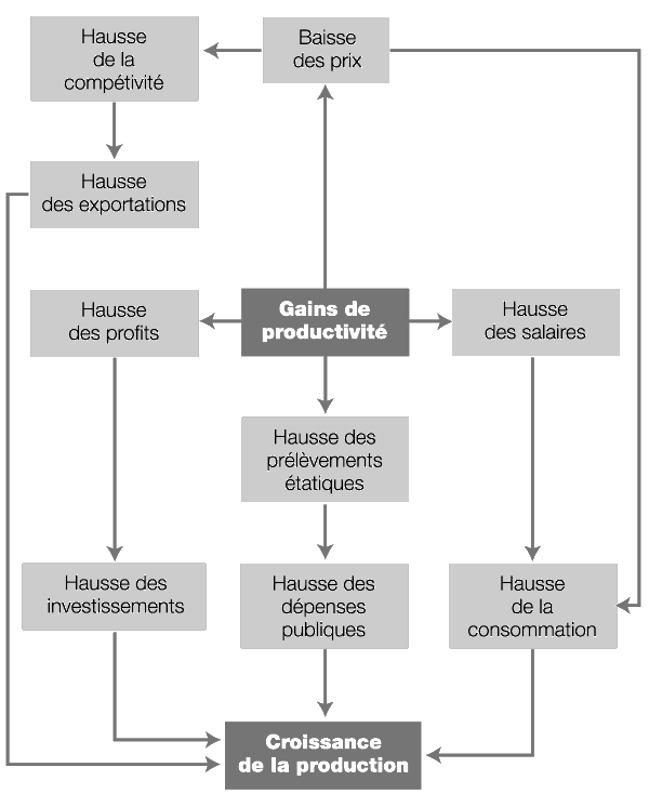
Source J.M. Albertini, E. Coiffier, M. Guiot, Pourquoi le chômage ?, Scodel, 1987 – schéma en ligne ici
Cependant, ces voies ne sont pas automatiques : de nombreux biais peuvent empêcher la redistribution des gains de productivité d’être suffisante pour permettre d’écouler la production. Par exemple, la hausse des profits des entreprises ne se transforme pas nécessairement en investissement (voir Idée reçue 2). De son côté, l’État peut augmenter les prélèvements obligatoires pour rembourser une partie de la dette publique. Enfin, les salariés peuvent recevoir « moins que leur juste part » et ne pas pouvoir augmenter leur consommation.
Prenons l’exemple d’une organisation sociale (imaginaire) dans laquelle tous les salariés « remplacés ou aidés par » des machines restent payés autant par heure travaillée 98. Comme les machines se substituent à eux en partie, les salariés travaillent moins d’heures, et les revenus distribués sont plus faibles. Dès lors, comment peuvent-ils avoir assez de revenus pour acheter les produits fabriqués ?
La seule réponse possible est : par la baisse des prix. Mais supposons que dans notre monde imaginaire, ceci ne se produise pas. Ces produits seront donc invendus. Les entrepreneurs n’étant pas aveugles, ils anticiperont ce risque et ne feront pas réaliser les produits. Dans cette économie imaginaire les gains de productivité s’accompagnent de décroissance et de pertes de pouvoir d’achat pour l’immense majorité des salariés.
Imaginaire ? Pas tant que cela. Dans son livre 40 ans d’austérité salariale : comment en sortir ?, l’économiste Patrick Artus montre qu’au sein des pays de l’OCDE, la productivité par salarié a augmenté de 50% dans les 30 dernières années alors que les salaires n’augmentaient que de 25%. En parallèle, les prix ont été globalement stables. La production elle, a cru lentement… L’insuffisante hausse du pouvoir d’achat a été en partie compensée par l’endettement des ménages. Mais on voit bien que cette compensation a des limites : les prêteurs finissent par vouloir être remboursés.
Le premier effet du progrès technique est donc bien de priver de travail celui qui est remplacé partiellement ou totalement par une machine. Pour que cette privation d’emploi soit compensée au niveau collectif, il faut donc bien de la croissance.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la croissance de la production est encore très majoritairement considérée comme vitale malgré les nombreux travaux dénonçant ses effets négatifs (voir l’Essentiel 5 et 6). Mais, d’une part, cette croissance ne découle pas naturellement des gains de productivité comme nous venons de le voir. D’autre part, cette croissance n’est pas une condition suffisante : on peut assister à une croissance du PIB sans création d’emplois 99.
Que faire ? Dans un monde de croissance faible, voire de stagnation comme c’est le cas actuellement, force est de constater que si la productivité continue à croître (par l’effet de l’informatisation ou de la robotisation de tâches de plus en plus nombreuses), le chômage et la précarité (temps partiel subi et autres activités précaires) ne pourront qu’augmenter sauf à organiser la baisse du temps de travail.
L’autre voie est de proposer des emplois publics dans des domaines dits peu « productifs » (l’environnement et le soin aux personnes en priorité), en mettant évidemment l’accent sur la formation. Ce sont par exemple les propositions de garantie de l’emploi vert.
Dans une économie mondialisée, la politique macroéconomique devrait se limiter à faciliter une offre compétitive
Que signifie favoriser une offre compétitive ?
Depuis des décennies, la politique économique dite de l’offre, appliquée en Europe et en France, vise à favoriser une « offre compétitive », c’est-à-dire telle que les entreprises du pays concerné gagnent des parts de marché à l’export, soit en raison de prix plus bas que ses concurrents, soit pour des raisons de « qualité ».
Pour ce faire, les mesures mises en place (appelées mesures structurelles) cherchent à réduire les charges qui « pèsent » sur les entreprises (les charges sociales, les impôts, les réglementations) et à favoriser la recherche et le développement (via par exemple des mesures fiscales favorables tel le crédit d’impôt recherche 100.
Au niveau européen, ces politiques sont majoritaires et sont supposées favoriser la croissance et réduire l’écart entre la croissance potentielle et la croissance observée (voir l’Essentiel 2). Ces politiques justifient aussi la « maîtrise » des dépenses publiques et le refus du déficit budgétaire : il s’agit de ne pas faire peser des prélèvements « excessifs » sur les entreprises.
On doit au chancelier Helmut Schmidt d’avoir formulé en 1974 un slogan aujourd’hui très célèbre. Il résume de façon assez facile à mémoriser la présente idée reçue : « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain ». Dans les années 1980, ce « théorème » est devenu le principal support des politiques économiques de « désinflation compétitive », visant à « restaurer les marges des entreprises ». Il s’agit de promouvoir, via la modération salariale et fiscale, la compétitivité des entreprises. D’abord motivées par l’impact des deux chocs pétroliers (hausse de l’inflation et déficits publics et privés croissants), ces politiques économiques vont devenir la norme.
Sans rentrer dans un débat académique, nous allons ici montrer les limites et erreurs de cette « doctrine ».
Tout d’abord, comme on l’a vu dans l’Essentiel 5 et 6, la croissance du PIB n’est, pour nos pays, ni un bon indicateur ni un bon objectif. D’autre part cette doctrine repose sur l’idée que le développement du commerce international bénéficie à toutes les parties prenantes des échanges ; nous montrons dans le module commerce (en cours de de rédaction) que cette idée reçue est fausse dans sa généralité.
Mais même à l’intérieur de ce « cadre de raisonnement » (le pilotage par le PIB et un commerce international bénéfique par principe), cette doctrine repose sur trois erreurs :
- L’économie d’un pays comme la France ne repose pas que sur la demande extérieure mais aussi sur la demande intérieure. Calibrer une politique pour les seules entreprises exportatrices laisse de côté un pan entier de l’économie.
- Il est évident par ailleurs que tous les pays du monde ne peuvent ni être exportateurs ni être compétitifs en même temps. Au sein de l’Europe, on observe des déséquilibres d’ampleur, illustration de cette remarque de bon sens, entre les « pays du Nord » (dont l’Allemagne) et les « pays du Sud ».
- Contrairement à ce qu’affirme la « loi » énoncée par Jean-Baptiste Say, une politique de l’offre ne génère pas nécessairement de la demande pour acheter les produits et services offerts, même s’ils sont compétitifs.
Cette doctrine n’a d’ailleurs pas fait la preuve de son efficacité (toujours en raisonnant dans le cadre posé implicitement, comme rappelé ci-dessus). Depuis qu’elle est appliquée en France, le chômage ne s’est pas substantiellement réduit, la croissance n’est pas au rendez-vous et la compétitivité des entreprises françaises ne s’est pas améliorée. Les demandes faites, dans le cadre du plan de relance 2021, par les entreprises de réduire les impôts de production en sont une preuve indirecte.
Plus précisément, force est de constater que la hausse des profits des entreprises ne conduit pas nécessairement à une hausse de l’investissement.
Dans une note d’analyse de 2017 101, l’économiste Patrick Artus met en évidence la hausse des profits des entreprises non financières des Etats-Unis, du Japon et de la zone euro sur la période 1996-2017. Se posant ensuite la question de l’utilisation de ces profits, il observe qu’ils ont :
- conduit à la hausse du taux d’autofinancement donc à la limitation de l’endettement des entreprises ;
- parfois financé la hausse des dividendes distribués et les rachats d’actions (voir Idée reçue 5) ;
- partout financé l’accumulation de « cash » par les entreprises et leur croissance externe (via l’achat d’actions d’autres entreprises).
Dans un ouvrage plus récent 102, Patrick Artus montre que cette politique s’est traduite par une rémunération trop basse des travailleurs. Elle a conduit à financer la consommation courante par le crédit, donc par l’endettement, sans création de valeur permettant de rembourser la dette (voir le module Rôle et limites de la finance). Les conséquences en ont été politiquement délétères, en faisant le lit des partis populistes.
En conclusion, cette idée reçue ne résiste pas à l’analyse. Des politiques macroéconomiques n’ont pas à faire de la compétitivité leur priorité. Elles ont maintenant, comme nous l’avons vu dans l’Essentiel 10, à mettre en priorité les investissements et l’orientation des leviers publics au service de la transition écologique. La compétitivité de l’offre est une question importante certes, mais de second plan.
L’épargne serait un préalable nécessaire à l’investissement et favorable à la croissance économique
Pour certains économistes, comme Friedrich Hayek, la constitution d’une épargne serait une condition préalable à l’investissement, lequel serait nécessaire à la croissance économique, en permettant des gains de productivité.
Cette idée d’épargne préalable est conforme à l’intuition qu’on peut se faire d’un monde de subsistance : il faut se priver de consommer aujourd’hui pour préparer l’avenir (par exemple de graines de blé, qu’il faut conserver pour les plantations futures).
Comptablement, on a vu par ailleurs que le PIB se décomposait, sous l’angle des dépenses, en consommation, investissement et solde extérieur (voir l’Essentiel 3). Il est donc tentant de considérer que, toutes choses égales par ailleurs, moins de consommation c’est plus d’investissement. Les entreprises investissant pour croitre, plus d’épargne permettrait plus de croissance.
Cependant, un raisonnement plus global permet de mettre en évidence les points suivants, qui mettent en doute cette idée reçue :
- La variation de l’épargne financière entre deux moments résulte, d’une part, du flux d’épargne entre ces deux moments (épargne utilisée pour consommer ou investir et épargne nouvellement constituée) et, d’autre part, du flux de crédit. En effet, les banques créant de la monnaie, un crédit est à l’origine d’une nouvelle liquidité qui est comptée dans l’épargne financière (voir le module sur la monnaie). Si on isole la monnaie au sens strict de l’épargne financière, on voit alors que le flux d’investissement est égal au flux d’épargne net (épargne constituée dans la période moins désépargne de la période), accrue du flux de création monétaire sur la période.
- Le comportement d’investissement d’une entreprise ou d’un ménage est peu dépendant de l’épargne accumulée dans l’économie nationale, et relativement indépendant de l’épargne que l’entreprise ou le ménage considéré a constitué. Un ménage investira dans un logement ou une voiture, non seulement car il dispose d’un apport personnel (éventuellement fruit d’un héritage) mais aussi et surtout parce qu’il peut s’endetter pour le faire (une banque est prête à lui accorder un crédit), ce qui dépend de ses perspectives de revenus. Une entreprise investit non pas seulement en fonction de sa capacité d’autofinancement passée mais en vue de réaliser des profits et en fonction de sa capacité à convaincre des tiers à la financer.
- L’épargne peut être mobilisée pour refinancer des actifs existants (par exemple l’achat de logement anciens, ou l’achat de titres financiers telles les actions ou les obligations déjà émises). Dans ce cas, l’épargne ne finance pas l’investissement productif.
- Les entreprises investissent soit pour croître soit pour faire des gains de productivité, dont on a vu que l’effet sur la croissance est discutable (voir Idée reçue 1).
Concrètement, les politiques encourageant l’épargne (par exemple par des dispositifs fiscaux réduisant l’imposition de l’assurance-vie en France) ne sont donc probablement pas les plus efficaces si leur objectif est de favoriser la croissance. Elles peuvent par contre poursuivre d’autres objectifs (comme pour l’assurance-vie de faciliter les successions) et c’est alors un autre débat.
Les politiques de relance budgétaire seraient inefficaces
Quand l’économie est en crise, ou en simple récession, l’augmentation des dépenses publiques est souvent mobilisée pour « en sortir ». C’est la préconisation dite « keynésienne » car elle a été théorisée par Keynes entre les deux guerres mondiales (voir la fiche sur le multiplicateur budgétaire) .
Elle a été fortement contestée dans les années 70 par les économistes néolibéraux en utilisant deux arguments.
- Les dépenses publiques évinceraient les dépenses publiques en mobilisant une épargne limitée. On retrouve l’idée reçue précédente qui fait de l’épargne un préalable à l’investissement.
- Les agents économiques anticiperaient que toute relance budgétaire causant un déficit serait ultérieurement financée par un surcroit d’impôts. Ils seraient donc amenés à épargner, annihilant ainsi l’effet de la dépense publique.
Si l’on en croit ces deux affirmations, les politiques de relance budgétaire seraient inefficaces, voire néfastes. Il serait donc essentiel de gérer sainement les finances publiques et de revenir rapidement à l’équilibre budgétaire après un déficit causé par une crise, voire de dégager des excédents si la dette publique est trop élevée. Cette doctrine sous-tend les politiques d’austérité budgétaire. Elle est au cœur des programmes dits d’ajustement structurel du FMI, de la politique budgétaire européenne, et notamment du semestre européen . Elle a été mise en œuvre de manière spectaculaire, et désastreuse pour le peuple, dans le cas de la Grèce.
Les dégâts générés par l’application de ces programmes devraient en soit suffire à en montrer l’inanité. Mais il est nécessaire de revenir sur les erreurs de raisonnement qui la sous-tendent.
- Rien ne prouve, comme l’ont montré les travaux d’économie expérimentale, que les agents économiques se comportent de manière dite rationnelle par les économistes qui prônent ces politiques, bien au contraire. Les agents économiques n’anticipent pas nécessairement une hausse des impôts et ce d’autant moins que, si elle devait arriver, rien ne prouve à leurs yeux qu’elle concernerait leurs propres impôts.
- L’épargne et la main d’œuvre sont aujourd’hui abondantes : l’investissement public n’évince donc pas les investissements privés mais mobilise des ressources inutilisées, oisives.
- Les faits montrent que la dette publique peut croître longtemps et les déficits perdurer sans impact majeur sur l’économie du pays (voir le module Dette et déficit publics ).
- L’effet multiplicateur d’une dépense publique est bien établi. L’analyse des réactions publiques à la crise de 2008 est révélatrice : les États-Unis, qui ont accepté un déficit public plus important que l’Europe, sont sortis plus vite de la crise.
- Enfin et surtout, ce raisonnement suppose qu’est définitivement établi « l’ordre de la dette », selon l’expression de Benjamin Lemoine, à savoir l’obligation pour les États de financer leur déficit exclusivement sur les marchés financiers. Un État qui retrouverait le bénéfice de la création monétaire pourrait utiliser un pouvoir d’achat créé ex nihilo, qui n’a donc nul besoin d’être remboursé. (voir le module Dette et déficit publics)
Conclusion : une politique de relance budgétaire ne se heurtera pas nécessairement au double mur de l’effet d’éviction et de la hausse de l’épargne privée par précaution. Cette conclusion est importante dans la période actuelle où le besoin d’investissements publics (et d’aides publiques à l’investissement privé) dans la transition écologique ne doit pas être bloqué par des raisonnements inappropriés.
Les indices boursiers seraient de bons indicateurs de la santé économique d’un pays
Les cours des indices boursiers (Dow Jones, Nasdaq, MSCI World, Eurostoxx 600, CAC 40) font partie des indicateurs économiques omniprésents dans le débat public et médiatique, comme si leur hausse était synonyme de la bonne santé économique d’un pays et leur baisse, d’une catastrophe économique. Nous allons voir pourtant qu’indice boursier et santé économique sont largement indépendants.
Qu’est-ce qu’une bourse ?
Lors de la création d’une entreprise, le ou les fondateurs apportent des ressources pour constituer le capital social de l’entreprise. Celui-ci est divisé en actions (ou parts sociales), attribuées aux fondateurs (dès lors, dénommés actionnaires) en proportion de leur contribution. La détention de ces actions donne des droits de participation aux décisions de l’assemblée générale de la société et des droits financiers (via le versement de dividendes).
Une fois émises, les actions peuvent être vendues soit lors d’échanges bilatéraux (de gré à gré), soit publiquement sur des marchés organisés appelés bourses (ex : le New York Stock Exchange ou Euronext). Dans ce dernier cas, la valeur des actions est affichée régulièrement (voire en continu) et varie en fonction de l’offre et de la demande.
Si l’entreprise a besoin de nouveaux financements pour investir et se développer, elle peut émettre de nouvelles actions 103 et les vendre aux actionnaires existants ou à d’autres investisseurs de gré à gré ou publiquement, sur une bourse. Les bourses supposées être le moyen principal du capitalisme pour financer les entreprises ne le font pas toujours. D’après un récent rapport, « les Bourses ne financent plus, en flux nets (c’est-à-dire introductions et augmentations de capital moins rachats d’actions), les économies américaine et européenne depuis déjà une vingtaine d’années. » 104
La cotation boursière ne traduit pas la valeur des entreprises
Un indice boursier mesure l’évolution du cours des actions de toutes les entreprises cotées sur une bourse (ou d’une partie d’entre elles). Par exemple, le CAC 40 concerne les 40 plus grosses entreprises françaises cotées à la bourse de Paris (elle-même intégrée à la bourse Euronext).
Un indice boursier caractérise donc la valeur financière, à un instant donné, des entreprises incluses dans l’indice. Cette valeur fluctue sans que cela ait nécessairement un rapport avec les « fondamentaux » ou la santé économique ou financière des dites entreprises.
La valeur fondamentale d’une entreprise
Elle est censée représenter ce que vaut une entreprise. Les « experts » chargés d’évaluer les entreprises ont recours à de nombreuses méthodes qui donnent des résultats très différents. Au total, la référence qui compte, au cas où ces évaluations servent de base à des transactions effectives, c’est la comparaison avec d’autres entreprises similaires, ayant fait l’objet de transactions de même nature… Cela revient à dire que la seule valeur observable et objective, c’est le prix.
Or, ce prix ne varie pas uniquement en fonction de qualités intrinsèques liées à l’entreprise ou à son « environnement » (son positionnement sur le marché, sa réputation, la dynamique du marché, la qualité du management, sa performance financière passée, présente et espérée…).
Il dépend aussi de mécanismes propres au fonctionnement des marchés boursiers.
La valeur d’une entreprise cotée en bourse peut fluctuer en fonction des « humeurs des marchés », les opérateurs sur ces marchés étant sensibles à de multiples informations plus ou moins fondées et surtout aux décisions des autres.
Une stratégie possible pour un investisseur consiste à deviner ce que les autres pensent. Le prix d’un titre est ainsi déterminé par un mécanisme auto-référent fondé sur ce que chacun pense que les autres pensent que les autres pensent ad infinitum. L’économie comportementale a bien étayé ce point, que Keynes avait le premier mis en évidence, par son analogie avec un concours de beauté, consistant à élire les plus belles jeunes femmes parmi une centaine de photographies publiées. Le gagnant est le lecteur dont la sélection se rapproche au mieux des six photographies les plus choisies. En d’autres termes, le gagnant est celui s’approchant au mieux du consensus global. Keynes fait remarquer que pour remporter ce jeu, il n’est pas logique de raisonner uniquement selon ses goûts personnels. Il faut en effet déterminer le consensus de tous les autres lecteurs : en déroulant le raisonnement, on comprend que le choix des lecteurs se porte uniquement sur les candidates qu’ils pensent que les autres éliront, ceux-ci choisissant celles qu’ils pensent que les autres éliront, et ce à l’infini.
Les fluctuations de la valeur d’une entreprise peuvent également résulter de manipulations de cours, quand par exemple une entreprise achète ses propres actions 105. En 2019, ces rachats, aux États-Unis, s’élevaient à environ 750 milliards de dollars alors que les introductions en bourse atteignaient 62 milliards de dollars. En 2021, ces rachats sont toujours massifs. 106
Les indices boursiers donnent peu d’information sur la santé économique d’un pays
Même à supposer que les indices caractériseraient la santé des grandes entreprises, ceci n’a qu’un lointain rapport avec la santé économique d’un pays dans son ensemble. Par exemple, à la suite de la pandémie COVID-19, la première vague de confinement s’est manifestée par un brusque effondrement des principaux indices boursiers mondiaux. Cependant, très rapidement, les mesures prises par les États et les banques centrales ont rassuré les investisseurs. Les cours ont mis moins d’un an pour retrouver, voire dépasser leur niveau d’avant crise (voir graphiques ci-après). Dans le même temps, l’économie productive mesurée par le PIB était en récession.
La bonne santé des indices boursiers : Nasdaq, S&P 500, Eurostoxx 600
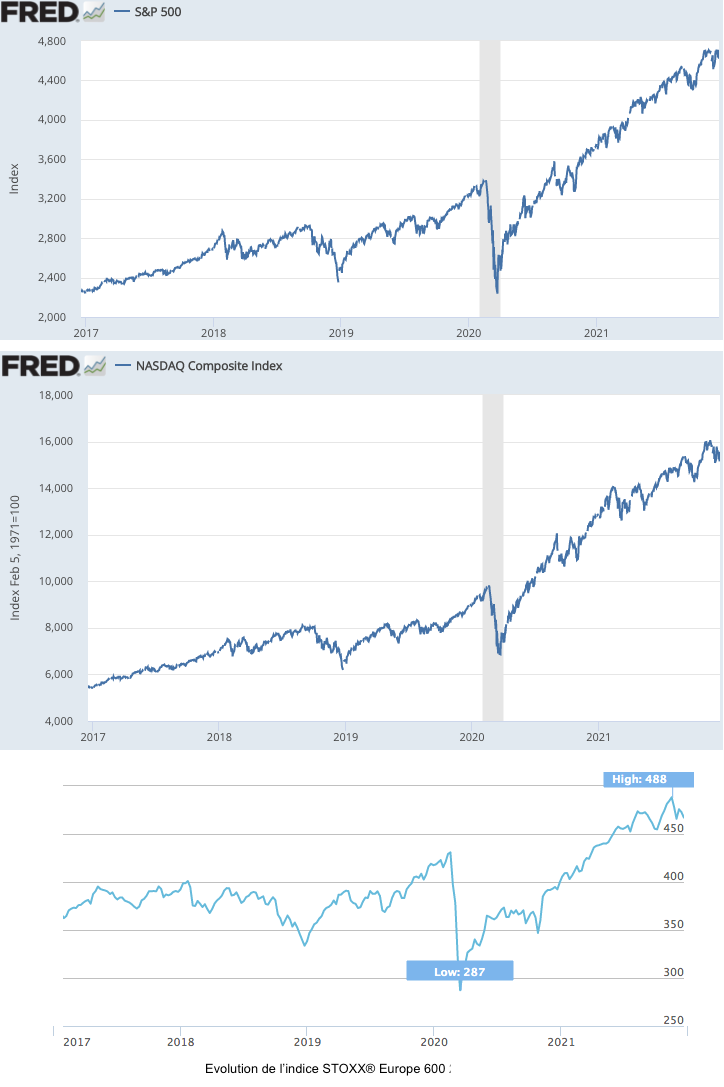
Source S&P 500, Nasdaq Composite index, Eurostoxx 600
Pour finir, les krachs boursiers (baisse prolongée de plus de 20% du prix des actions) ne sont pas des bons prédicteurs de récessions.
Ils devraient l’être si le lien était robuste entre les indices boursiers et le PIB. On attribue à Paul Samuelson (Prix Nobel d’économie en 1970) le bon mot suivant : « les krachs de Wall Street ont prédit neuf des cinq dernières récessions ». Plus récemment la chaine financière CNBC a calculé que depuis 1945, Wall Street a connu 13 situations de krach qui ne se sont traduites que par sept périodes de récession de l’économie réelle.
La croissance verte fondée sur le progrès et l’innovation technique serait la voie de la transition écologique
La croissance verte, nouvel horizon des politiques publiques
Face à la prise de conscience des impacts écologiques de la croissance, la plupart des gouvernements et des économistes réagissent en invoquant la « croissance verte » ou « durable ». Rarement utilisé avant 2008, ce concept est aujourd’hui régulièrement mobilisé comme l’horizon à atteindre en matière de politiques publiques.
« La stratégie de l’OCDE pour une croissance verte vise à formuler des recommandations concrètes et à fournir des instruments de mesure, notamment des indicateurs, qui aideront les pays à engendrer la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. »
L’émergence du concept de « croissance verte »
A la suite de la crise de 2007-2008, l’OCDE mobilise la notion de croissance verte pour appeler les États à mener des plans de relance incorporant les objectifs environnementaux. Cette notion a ensuite été progressivement adoptée par les organisations internationales et les États 107. Elle est aujourd’hui au cœur du programme de développement durable adopté par l’assemblée générale de l’ONU en 2015. Au niveau européen, le Green deal lancé en 2019 est présenté comme la nouvelle stratégie de croissance de l’Union.
La croissance verte repose sur les idées suivantes :
- La croissance est cruciale pour financer l’innovation technologique et les investissements nécessaires à la transition écologique (voir par exemple ici), ainsi que les mesures d’accompagnement des ménages et secteurs les plus vulnérables (formation et aide à la reconversion dans les secteurs sinistrés du fait de la transition).
- La transition elle-même sera un moteur de la croissance du fait des investissements massifs qu’elle nécessite, générateurs d’activité, d’emploi et donc de PIB dans une société où le sous-emploi est massif.
En termes opérationnels, la croissance verte est rendue possible par le découplage entre le PIB et les impacts sur la nature, qu’il s’agisse des pollutions ou de la surexploitation des ressources naturelles (voir l’Essentiel 9).
Il s’agit donc de mobiliser massivement le progrès et l’innovation techniques pour rendre la production plus efficiente dans l’utilisation des ressources naturelles et pour remplacer les technologies polluantes et carbonées par des alternatives « vertes » et décarbonées.
Il est indéniable que la science et la technique font partie des outils à mobiliser pour mener la transition écologique. Cependant, soulignons ici que cela ne se fera pas spontanément, en laissant faire les seules « forces du marché ».
Aujourd’hui, le progrès technologique est indifférencié et favorise autant les technologies écologiques que les technologies polluantes. Il est nécessaire d’orienter et de subventionner la recherche et le déploiement de technologies vertes, et dans le même temps de pénaliser voire d’interdire le développement de technologie fortement consommatrices de ressources naturelles et polluantes.
Par ailleurs, le progrès technique à lui seul ne suffira pas.
Le numérique, un bon exemple de l’absence de questionnement sur la technologie
Longtemps présentée comme l’allié de la transition écologique car permettant la dématérialisation de l’économie, l’industrie numérique est, contrairement à l’imaginaire qui l’accompagne, fortement matérielle et polluante. Or, aujourd’hui, la croissance du numérique est posée en objectif au moins égal à la transition écologique 108 et ceci indépendamment du questionnement sur les usages du numérique et de leur contribution au bien commun. Les réflexions et mesures sur les limitations de l’impact écologique de ce secteur sont à peine émergentes.
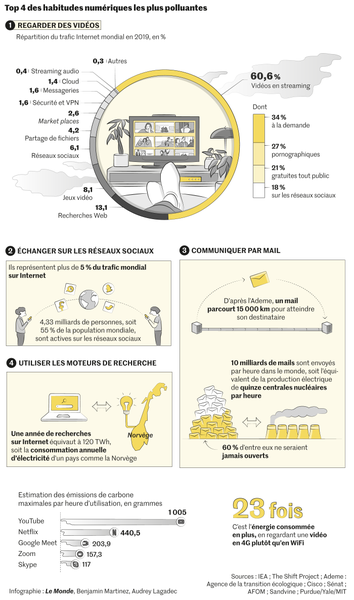
Source Pourquoi le numérique contribue de plus en plus au réchauffement climatique, Le Monde, 2022
Les limites de la croissance verte
La croissance verte est donc avant tout fondée sur la croyance dans la capacité de l’innovation et du progrès technologiques à apporter les solutions à la crise écologique. Cette vision « techno-optimiste », bien illustré notamment par le manifeste éco-moderniste, bute sur plusieurs écueils.
Sur le plan théorique, la plupart des économistes travaillant sur la croissance raisonnent sans prendre en compte la nature (voir l’Essentiel 8 sur les modèles macroéconomiques). Ceux qui ont tenté d’intégrer les ressources naturelles épuisables dans leur modèle ne parviennent à maintenir une croissance illimitée qu’à condition d’avoir un progrès technique permettant l’augmentation infinie de la productivité des ressources naturelles (c’est-à-dire la réduction permanente de la quantité de ressources nécessaire à un point de PIB). Nous détaillons ce point dans le module Économie, ressources naturelles et pollutions
Sur le plan empirique, de nombreux arguments permettent de comprendre que le progrès technique ne suffit pas.
Nous en avons déjà passé plusieurs en revue dans l’Essentiel 9 : l’effet rebond qui limite voire annule les gains d’efficacité matière, les nouveaux problèmes écologiques que peuvent susciter des solutions technologiques, le fait que les gains d’efficacité matière atteignent nécessairement une limite physique à un moment donné, le fait que le recyclage présente un potentiel limité dans une économie en expansion 109. Ajoutons que dans le cas du réchauffement climatique nombre de scénarios parient sur la mobilisation massive des technologies de capture et séquestration du carbone dont une majorité n’est pas mature (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions).
Plus généralement, la résolution de la crise écologique passera par :
- la réduction de la consommation mondiale d’énergie fossile et d’énergie tout court ; il ne sera pas possible de poursuivre la croissance de la consommation d’énergie si elle est bas-carbone 110 ;
- la réduction de la consommation de biens et services neufs (et souvent jetables à très court terme), dont la production est une composante très significative du PIB (que l’on pense par exemple à la fast fashion).
Ces réductions peuvent certes reposer sur des innovations technologiques mais aussi et surtout sur des innovations sociales, l’émergence de nouvelles normes, qui rendent désirables et « normaux » des comportements de sobriété.
L’objectif de croissance du PIB ne les favorisera en rien. Il est nécessaire de développer des stratégies volontaristes de sobriété en matière de consommation.
- Dans une tribune parue en août 2021, l’économiste Eloi Laurent note ainsi que dans le dernier rapport du GIEC (2021), le scénario permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C est celui « qui fait du bien-être humain et de la réduction des inégalités sociales les deux piliers du développement en lieu et place de la croissance économique. » ↩︎
- Les théories de la croissance sont multiples et aucune ne fait l’unanimité ; voir une première introduction historique sur le blog Annotations. ↩︎
- Il y a quand même un débat de fond : pour certains pays, le « développement » a été en fait une régression. Ils ont abandonné leurs repères, leur culture, leur rapport à la nature mais n’ont pas bénéficié des progrès de la modernité. Dans de nombreux cas, la colonisation a été un désastre et, sous couvert d’aide au développement, a conduit à une véritable prédation. ↩︎
- Un agrégat économique est une grandeur synthétique caractérisant l’économie nationale (PIB, investissement, consommation finale etc.), obtenue en combinant divers postes de la comptabilité nationale. ↩︎
- Voir le rapport National income 1929-1932: Letter form the action Secretary of Commerce in response to Senate Resolution n°220 (1934) ↩︎
- Par Clark et Kuznets aux Etats-Unis, Meade et Stone en Grande Bretagne, Tinbergen aux Pays-Bas, Vincent, Perroux et Gruson en France. ↩︎
- Le Système de comptabilité nationale est élaboré et mis à jour par l’Intersercretariat Working Group of National Accounts qui regroupe l’ONU, l’OCDE, le FMI, la Banque Mondiale et l’Union européenne. ↩︎
- Antonin Pottier, Les nouveaux indicateurs de richesse modifieront-ils la croissance ? Les limites de la critique du PIB, Le Débat, vol. 199, no. 2, 2018, pp. 147-156. ↩︎
- En réalité, c’est souvent le RNB (revenu national brut) qui est utilisé (voir la définition dans l’Essentiel 3). ↩︎
- Par exemple, dans l’Union européenne les règles de Maastricht imposent aux États un déficit public inférieur à 3% du PIB, est une dette inférieure à 60% du PIB. ↩︎
- Les objectifs environnementaux sont souvent posés par rapport au PIB (réduire l’intensité matière du PIB, l’intensité énergétique du PIB, l’intensité carbone du PIB), l’Union européenne a fixé l’objectif de consacrer dans chaque État 3% du PIB aux dépenses de Recherche et Développement. ↩︎
- Voir les explications en vidéo de Philippe Aghion, Sera-t-il possible de concilier croissance et climat ? ou l’article L’innovation, potion magique de l’économie française, Mediapart, 2022. ↩︎
- Cette feuille de route fera l’objet d’une évaluation dans un document technique en 2013. ↩︎
- Voir les Conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Trois priorités sont fixées (l’innovation, l’emploi et la durabilité de la croissance) dont découlent 5 objectifs à atteindre en 2020 (taux d’emploi de 75% ; budget de la recherche de 3% du PIB ; réduction de 25% de la pauvreté ; amélioration du niveau d’éducation ; et réaffirmation des objectifs du « paquet énergie-climat » de 2008 : baisse de 20% des émissions de GES, 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie ; 20 % d’efficacité énergétique. ↩︎
- Voir le rapport de prospective stratégique 2020 dans lequel la résilience est définie comme « l’aptitude, non seulement à faire face à des défis et à les relever, mais aussi à se soumettre à des transitions de manière durable, équitable et démocratique ». ↩︎
- Pour en savoir plus voir l’article Le dogme économique au cœur du désaveu européen, Blog des Chroniques de l’Anthropocène, 2019. ↩︎
- D’un point de vue écologique, cela peut être plus contestable. Si sur le plan microéconomique, l’objectif est bien d’utiliser au maximum les moyens de production. Sur le plan macroéconomique, il ne faudrait utiliser que ceux qui sont alignés avec les enjeux écologiques. Par exemple, est-il souhaitable de faire fonctionner au maximum les centrales à charbon afin de réduire « l’output gap » ? ↩︎
- Elle comprend également les biens et services troqués, ceux utilisés pour effectuer des paiements en nature (par exemple aux salariés d’une entreprise). Voir la définition complète sur le site de l’Insee. ↩︎
- Voir la liste complète sur le site de l’Insee. ↩︎
- Le Système européen des comptes 2010 (SEC 2010) est le nom du document qui fixe le cadre comptable applicable par tous les États membres de l’Union européenne. Cela signifie qu’il fixe toutes les règles que doivent respecter les comptables nationaux pour élaborer les comptes nationaux. C’est une déclinaison adaptée à l’Union européen du Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) élaboré par l’ONU. ↩︎
- Il s’agit des activités qui « ne sont pas observées dans le cadre des enquêtes statistiques régulières. Cela peut être dû au fait que l’activité est informelle et échappe donc à l’attention des enquêtes orientées sur les activités formelles ; le producteur peut aussi tenir à dissimuler une activité légale ou il se peut également que l’activité soit illégale. » (voir le SCN 2008, p100, et le SEC 2010, p348-349). ↩︎
- Pour une revue des méthodologies et débats sur le calcul de l’économie souterraine, voir L’économie souterraine dans le PIB : avancées et limites, présentation de François Lequiller, OCDE, Direction des statistiques, 2014. ↩︎
- Voir par exemple Décision de l’Insee d’intégrer le trafic de drogue au calcul du PIB, Question écrite au sénateur Arnaud Bazin, 8 février 2018. ↩︎
- Source : SEC 2010, p.65. L’excédent d’exploitation et le revenu mixte correspondent très schématiquement à la marge du producteur (avant paiements des intérêts sur la dette, des impôts, des dividendes etc.). Voir la partie C/ le PIB par la production pour plus d’explications. ↩︎
- C’est-à-dire la rémunération des salariés + les consommations intermédiaires + l’amortissement du capital public (SEC 2010, p.66) ↩︎
- Voir par exemple André Vanoli, Une histoire de la comptabilité nationale, La Découverte, 2002. ↩︎
- SEC 2010, p.76. ↩︎
- Moins les « paiements au titre de la production non marchande », c’est-à-dire les recettes (tels les billets de musée, les frais de scolarité, les forfaits hospitaliers…) que tirent parfois les APU de la production non marchande. En 2019, ces paiements représentaient 10,4 milliards d’euros sur les 427 milliards d’euros de la PNM. ↩︎
- L’acquisition n’est pas nécessairement un achat : elle peut être le résultat d’une production pour emploi final propre : par exemple une entreprise construisant un nouveau bâtiment dans son usine, ou menant des travaux de R&D ou développant des logiciels pour son usage propre. ↩︎
- Il s’agit par exemple des véhicules blindés, des navires de guerre, des sous-marins, des avions de combat, des transporteurs et lanceurs de missiles. ↩︎
- Plus de détails dans Les comptes nationaux passent en base 2010, Insee, 2014. A noter que le calcul des années précédentes est également modifié pour tenir compte de ces évolutions méthodologiques et disposer de séries longues cohérentes. ↩︎
- Voir SCN 2008, p.35. ↩︎
- PIN = PIB – CCF. Voir l’évolution de la CCF en France dans les comptes de variations du patrimoine Série 8.211 et suivantes. ↩︎
- Les « autres impôts sur la production » sont payés du fait de l’activité de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits (ex : impôts sur la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments et autres constructions utilisés à des fins de production, taxes sur les salaires, taxe foncière etc.). Ils se différencient des « impôts sur les produits », telle la TVA, qui sont dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Le terme « net » signifie qu’on a retiré du montant des impôts les « autres subventions sur la production » reçues des administrations publiques. ↩︎
- Une entreprise individuelle (EI) est une entreprise qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de son dirigeant (agriculteur, petit commerçant, artisan, profession libérale etc.). C’est pourquoi les comptes des EI sont intégrés dans le secteur des ménages. Voir la définition de l’Insee. ↩︎
- Eloi Laurent, Sortir de la croissance : mode d’emploi, éditions Les liens qui libèrent, 2021, p.19. ↩︎
- Voir le rapport National income 1929-1932: Letter form the action Secretary of Commerce in response to Senate Resolution n°220, 1934, p.6. ↩︎
- Au niveau international, la dernière révision de la classification des activités économiques date de 2009. C’est la CITI Rev 4 (classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique – révision 4). ↩︎
- Rappelons que la France compte 4 des 30 banques systémiques mondiales. Au Royaume-Uni la valeur ajoutée des sociétés financières oscille entre 6% et 8% depuis 1995. Source : Eurostat (VA des société financières et VA de l’économie totale) ↩︎
- Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. ↩︎
- C’est notamment lié au temps de recherche nécessaire pour élaborer les nouvelles normes et conventions. Cette inertie statistique est de plus indispensable du fait : 1/ des moyens importants que demande dans chaque État la mise à jour des normes de comptabilité nationale, 2/ de la nécessité d’éviter d’avoir des statistiques trop fluctuantes et influencées par le contexte. ↩︎
- Voir par exemple le dossier Au-delà et autour du PIB : questions à la comptabilité nationale, Insee, 2020, partie II « Nouvelles formes de production : numérique et services gratuits ». ↩︎
- Les unités résidentes sont les acteurs économiques qui exercent leur activité économique principale sur le territoire pendant plus d’un an. La question de la nationalité n’entre donc pas en ligne de compte. ↩︎
- Jean-Paul Piriou, Jacques Bourny et Vincent Biausque, La comptabilité nationale, La Découverte, 2019. ↩︎
- Voir par exemple La comptabilité nationale face aux défis du numérique et de la mondialisation : comment continuer à bien faire parler le PIB ?, blog de l’Insee, 12 février 2020 ; Didier Blanchet, Faire parler les comptes nationaux : l’importance du vocabulaire, Variances, 26 août 2021. ↩︎
- Richard Easterlin, « Does Economic Growth Improve the Human Lot? », dans Paul A. David et Melvin W. Reder, Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, New York, Academic Press, 1974. ↩︎
- C’est-à-dire corrigé de l’inflation. ↩︎
- Du PIB au PIB ressenti : en retrait sur le PIB, l’Europe dépasse désormais les États-Unis en bien-être monétaire, Insee analyses, 2020, graphique numéro 2. ↩︎
- Plus d’information dans le module Travail et chômage. ↩︎
- Le coefficient de Gini est un indicateur de distribution du revenu calculé à partir du revenu (après impôts et transferts sociaux) ajusté pour tenir compte de la taille des ménages. Sa valeur est comprise entre 0, qui correspond à une « égalité parfaite » (chaque personne reçoit la même fraction des revenus) et 1, qui représente une « inégalité parfaite » (la fraction de la population la plus riche reçoit l’intégralité des revenus). En savoir plus sur notre fiche : Comment mesurer les inégalités monétaires ? ↩︎
- Source : Panorama de la société 2019, OCDE, chapitre 6. ↩︎
- Plus de détails sur cette notion de soutenabilité faible dans le module Économie, ressources naturelle et pollutions. ↩︎
- Le terme géo-ingénierie est utilisé pour désigner tous les projets visant à modifier le climat et l’environnement global de la Terre en vue notamment de lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit par exemple d’envoyer en orbite des miroirs pour réfléchir les rayons du soleil, de projeter chaque année dans la stratosphère des millions de particules de souffre ayant un effet refroidissant sur le climat, ou encore de « fertiliser » l’océan avec du sulfate de fer pour permettre le développement du phytoplancton, stockant du CO2. En savoir plus sur Wikipedia et dans une émission dédiée sur France Culture. ↩︎
- Will Steffen et al., “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration.”, The Anthropocene Review, vol. 2, no. 1, Jan. 2015, pp. 81–98. ↩︎
- Richard Auty, Resource-Based Industrialization: Sowing the Oil in Eight Developing Countries, Clarendon Press, Oxford, 1990 ; Jamal Azizi, Pierre-Noël Giraud, Timothée Ollivier, Paul-Hervé Tamokoué Kamga, Richesses de la nature et pauvreté des nations, Essai sur la malédiction de la rente minière et pétrolière en Afrique, Presse des Mines, 2016. ↩︎
- Un indicateur synthétique regroupe de nombreux indicateurs exprimés en de multiples unités (dollars, années, pourcentages etc.). Pour pouvoir comparer et agréger des valeurs exprimées dans des unités différentes, il faut les normaliser, c’est-à-dire les convertir en une même unité (par exemple un nombre de 0 à 1). Il faut ensuite pondérer chacune des variables c’est-à-dire lui donner un poids plus ou moins important dans l’indicateur final. ↩︎
- L’IDH a été développé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la base des travaux de l’économiste Amartya Sen. De nombreux autres indicateurs ont été réalisés à côté de l’IDH pour rendre compte des inégalités, des disparités de genre, de la grande pauvreté ou de la soutenabilité environnementale. Toutes les données sont téléchargeables ici. Elles sont analysées dans le rapport annuel sur le développement humain publié par le PNUD depuis 1990. ↩︎
- Les 11 critères (logement, revenu, emploi, liens sociaux, enseignement, environnement, engagement civique, satisfaction à l’égard de la vie, sécurité, équilibre travail-vie) sont calculés à partir de 1 jusqu’à 4 indicateurs. Toutes les données sont disponibles sur le site de l’OCDE. Les informations sur la normalisation et la pondération de chacun des indicateurs sont détaillées ici. ↩︎
- Produits alimentaires, produits de l’élevage et de la pêche, bois, espaces bâtis et utilisés pour les infrastructures urbaines etc. ↩︎
- Nordhaus W., Tobin J., «Is Growth Obsolete ? », in The Measurement of Economic and Social Performance, Studies in Income and Wealth, National Bureau of Economic Reasearch, vol.38, 1973. Plus de détail sur le site de l’ENS Lyon. ↩︎
- Douze de ces indicateurs décrivent les niveaux moyens de bien-être actuel, douze les inégalités de bien-être actuel, et douze les ressources nécessaires au bien-être futur. ↩︎
- Par exemple, le semestre européen, la politique agricole commune, la stratégie biodiversité, le 7ème plan d’action environnemental, le socle européen des droits sociaux, le tableau de bord des transports de l’UE etc. ↩︎
- Voir l’article de Jean Gadrey, « Du PIB au PIB vert ou comment compter la richesse autrement », Cosmopolitiques, n°13, octobre 2006. ↩︎
- Kate Raworth, La théorie du Donut, version française parue aux éditions Plon (2018). Voir les bonnes feuilles publiées dans Le Monde. Les travaux de Kate Raworth se sont poursuivis au sein du Doughnut Economics Action Lab, centre de recherche créé en 2019. ↩︎
- Le dernier rapport sur les indicateurs de richesse date cependant de 2018. Voir les rapports 2015, 2016, 2017, 2018. Pour trouver les données ultérieures, il faut se reporter au site de l’Insee. ↩︎
- Eloi Laurent, Inscrire les indicateurs de bien-être et de soutenabilité au cœur du débat budgétaire, OFCE Policy Brief, 2017. ↩︎
- Voir par exemple le Greenness for Stimulus Index, développé par l’entreprise Vivid Economics, le Global Recovery Observatory, développé par l’Université d’Oxford, ou les analyses de Finance Watch pour certains pays européens. ↩︎
- Il y a une profusion de modèles macroéconomiques notamment dans le monde académique, mais nous nous limitons ici à ceux qui sont utilisés pour fonder des décisions publiques ou les évaluer, dans les grandes institutions publiques (ministères des finances, Commission européenne, FMI etc.) ↩︎
- Voir par exemple la note Le recours à la modélisation macroéconomique dans l’évaluation des politiques publiques, Trésor-eco n°252, décembre 2019. ↩︎
- Sur ce dernier point, il est bien établi que la croissance de la productivité des êtres humains , c’est-à-dire le ratio entre quantités produites et population, s’est améliorée substantiellement avec la révolution industrielle et les processus de mécanisation /industrialisation /automatisation /robotisation qu’elle a permis (voir module Travail et chômage). Depuis la fin des années 2000, la productivité du travail ralentit dans les pays développés, ce qui fait l’objet de nombreux débats parmi les économistes pour tenter d’expliquer ce phénomène. Voir Martin Anota, Pourquoi la productivité du travail augmente-t-elle moins vite depuis la crise financière ?, Alternatives économiques, 26 juin 2018. ↩︎
- En fait il faudrait analyser plus finement cette équation dont les termes sont très différents d’une branche d’activité à une autre et d’un métier à un autre. Mais nous n’avons pas besoin ici de rentrer dans cette analyse. ↩︎
- Pour en savoir plus sur les arguments théoriques qui sous tendent la possiblité d’une croissance infinie malgré des ressources naturelles en quantité limitée voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions ; Dans ce module nous traitons également la question de la substituabilité entre les différents capitaux, ainsi que la croyance dans l’aspect salvateur de la technologie (que nous développons également dans l’Idée reçue 6). ↩︎
- En s’inspirant des travaux de Keynes, ces chercheurs ont construit dans les années 1930-1940 une théorie de la croissance montrant qu’elle est structurellement instable. En savoir plus dans Martin Anota, Les théories de la croissance, blog Annotations, 1er septembre 2012. ↩︎
- Face au risque d’une éventuelle insuffisance de ce « vouloir d’achat », les industries ont massivement développé les techniques de publicité et de marketing pour le « doper » -ce qui pose de nombreux problèmes dès lors que le respect des limites planétaires requièrent au contraire une certaine sobriété – mais rien ne garantit que cela suffise pour que les produits trouvent vendeurs systématiquement. ↩︎
- Plus de détails dans l’Idée reçue 1. ↩︎
- Cette théorie est présentée dans l’article Richard A. Werner, Towards a more stable and sustainable financial architecture – a discussion and application of the quantity theory of credit, Kredit und Kapital, vol.46, n°3, 2013, pp. 353-389. ↩︎
- Dans les modèles d’équilibre général, le marché du travail est aussi supposé être en permanence à l’équilibre : la demande et l’offre en travail sont égales, la variation des salaires permettant l’ajustement. ↩︎
- Les deux fonctions utilisées sont soit des fonctions dites CES (Constant Elasticity of Substitution), soit des fonctions de Cobb-Douglas (qui sont des cas particuliers des fonctions CES). ↩︎
- C’est l’intrication avec d’autres sciences (en particulier les apports de Boulding et Georgescu-Roegen) qui vont ouvrir l’économie à la physique. ↩︎
- La comptabilité de la croissance consiste à décomposer, via des méthodes économétriques, la croissance du PIB selon la contribution de chacun des facteurs de production et à attribuer le résidu à la PGF. Les économistes Felipe et McCombie ont montré que tout ce que capture ce type d’exercice économétrique, c’est une identité comptable toujours vraie. Voir Jesus Felipe, John McCombie, The Illusions of Calculating Total Factor Productivity and Testing Growth Models: From Cobb-Douglas to Solow and to Romer, avril 2019. Voir également Steve Keen, L’imposture économique, éditions de l’Atelier, 2017. ↩︎
- Voir en particulier Paul M. Romer, « Endogenous technological change », Journal of political Economy, vol. 98, n°5, 1990, pp.71-102 ; Robert J. Barro, « Government spending in a simple model of endogenous growth », Journal of political economy, vol.98, n°5, 1990, pp.103-125 ; Robert E. Lucas Jr, « On the mechanics of economic development », Journal of monetary economics, vol.2, n°1, 1988, pp.3-42. ↩︎
- Les ressources épuisables (énergies fossiles et fissiles, minerais) sont à considérer en premier lieu. Cependant, les ressources dites renouvelables (poissons, sols agricoles, arbres etc.) sont également concernées car, le plus souvent, elles sont exploitées à des rythmes supérieurs aux capacités naturelles de renouvellement. ↩︎
- Source : Fiches pays de la base de données EDGAR (consultée en décembre 2021 – sélection Monde, Group by sector, all GHG, Capita per GDP). A noter que ces émissions ne tiennent pas compte des changements d’affectation des terres (l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, dite UTCATF dans les sources officielles). ↩︎
- Source : Climate Change 2021 – The Physical Science Basis, résumé à l’intention des décideurs, rapport du groupe de travail 1 du GIEC (figure SPM4). ↩︎
- Sur ce sujet, voir l’article Wood, R. et al., « Beyond peak emission transfers: Historical impacts of globalization and future impacts of climate policies on international emission transfers. » Climate Policy, vol.20, 2020. ↩︎
- The Shift Project, Scénarios énergie climat : évaluation et mode d’emploi, en partenariat avec l’AFEP, novembre 2019. ↩︎
- Au niveau microéconomique, l’efficacité énergétique d’une machine ou d’un logement désigne le fait qu’il nécessite moins d’énergie pour remplir la même fonction. Au niveau macroéconomique, l’efficacité énergétique se traduit par une baisse de l’intensité énergétique du PIB (c’est-à-dire qu’il faut moins d’énergie pour générer un point de PIB). ↩︎
- Voir également deux autres méta-analyses sur le sujet. Jason Hickel, « Is Green Growth Possible? », New Political Economy, vol.25, n°4, pp.469-486 ; Helmut Haberl et al., « A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights », Environmental Research Letters, vol.15, n°6, 2020. ↩︎
- Dans le cadre du projet GENERATE (2017-2020), l’IFPEN évalue que selon les scénarios 2°C, la consommation cumulée de cobalt pourrait atteindre entre 65% et 83% des ressources connues actuellement. Par ailleurs, près de 90% des ressources en cuivre seraient extraites d’ici 2050. ↩︎
- Olivier Vidal, « Ressources minérales, progrès technologique et croissance », Temporalités, n°28, 2018. ↩︎
- Voir par exemple : André Amar, « La croissance et le problème moral », Les cahiers de la Nef, 1973 ; Nicolas Georgescu-Roegen, « Demain la décroissance : entropie-écologie-économie », 1979 ; André Gorz, Écologie et liberté, éditions Galilée, 1977. ↩︎
- La productivité du travail désigne le rapport entre la production réalisée, mesurée en grandeur physique (nombre de voitures fabriquées par exemple) ou en valeur monétaire (on utilise alors la valeur ajoutée), et le travail nécessaire pour y parvenir (mesuré soit en nombre d’heures soit en nombre d’emplois). Pour des définitions plus détaillées voir le site de l’Insee ou le site SES Webclass. ↩︎
- Voir Bertrand Valiorgue, Refonder l’agriculture à l’heure de l’anthropocène, éditions Le bord de l’eau, 2020, p.15. ↩︎
- Voir Jean Molinier, « L’évolution de la population agricole du XVIII° siècle à nos jours », Economie et statistique, n°91, pp.79-84 et Recensement agricole 2020, Agreste, décembre 2021. ↩︎
- Voir L’Atelier Paysan, Reprendre la Terre aux machines, Seuil, 2021, pp.41-42. ↩︎
- Le premier tracteur de John Deere, en 1918, faisait 16 chevaux. La puissance moyenne des tracteurs vendus en France en 2019 était de près de 150 chevaux… ↩︎
- Remplacer dix travailleurs par une machine permet des gains de productivité mais n’augmente pas la production. Pour ce faire, il faut soit investir dans une autre machine, soit employer ces dix travailleurs à autre chose. ↩︎
- Dit autrement leur salaire n’est alors pas fonction de leur productivité (marginale ou pas), contrairement à ce qu’enseigne l’économie néoclassique qui prétend que c’est la règle. ↩︎
- Voir par exemple l’article de Michel Husson, Et si la croissance ne créait pas d’emplois ?, 2010. ↩︎
- Voir un rapport dressant le bilan de cet instrument en France : Évaluation du crédit d’impôt recherche, avis de la CNEPI, 2021, et un article du journal La Tribune résumant ce rapport. ↩︎
- Les profits d’aujourd’hui sont-ils les investissements de demain? Non, Natixis, Flash Économie n°1528, 22 décembre 2017. ↩︎
- Voir Patrick Artus, 40 ans d’austérité salariale. Comment en sortir ?, éditions Odile Jacob, 2020. ↩︎
- L’entreprise peut également avoir recours au crédit bancaire ou à l’émission de dette obligataire sur les marchés financiers. ↩︎
- Voir l’étude Éclipse ou crépuscule ? Pourquoi les Bourses n’ont plus la cote, Institut Messine, février 2021, et l’article d’Alternatives Economiques qui résume cette étude. ↩︎
- Le rachat de ses actions par une entreprise fait mécaniquement monter son cours de bourse. Lorsqu’une société rachète ses actions, les titres rachetés sont généralement détruits. Le capital et le nombre d’actions s’en trouvent ainsi réduits. Cela améliore mécaniquement la valeur du titre à court terme. C’est une technique pour distribuer de l’argent aux actionnaires, qui se fait au détriment de l’investissement et des autres parties prenantes de l’entreprise. Voir Rachats d’actions : quand le capitalisme tourne en rond et Les rachats d’actions record en Bourse relancent le débat sur le partage de la valeur avec les salariés, Le Monde, 24 décembre, 2021. ↩︎
- Source : Les grandes entreprises relancent les plans de rachats d’actions, La Croix, 5 mai 2021 ; Introductions en bourse: 2019 est le pire millésime depuis trois ans, Les Echos, 2 janvier 2020 ↩︎
- Voir par exemple : « Declaration on Green Growth », OECD, 2009 ; « Towards green growth », OECD, 2011 ; « Inclusive Green Growth. The pathway to Sustainable Development, available » Banque mondiale, 2012 ; « Towards a green economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication », UNEP, 2011. ↩︎
- Au niveau européen, le développement du numérique est ainsi placé au même niveau que le Pacte Vert parmi les priorités stratégiques de la Commission européenne. Au sein même du texte présentant le Pacte vert, la digitalisation de l’économie occupe une place importante. ↩︎
- Voir l’article de François Grosse, Le découplage croissance / matières premières – De l’économie circulaire à l’économie de fonctionnalité : vertus et limites du recyclage, Futuribles, 2010. ↩︎
- Les énergies fossiles représentent aujourd’hui environ 80% de la consommation énergétique mondiale : la croissance des énergies décarbonées (énergies renouvelables et nucléaire) qui seraient nécessaires pour remplacer les énergies fossiles est donc sans précédent. Ajoutons que le développement des moyens de production décarbonés fait face à de nombreuses limites que ce soit en termes de financement, de matières premières d’acceptabilité sociale etc. ↩︎