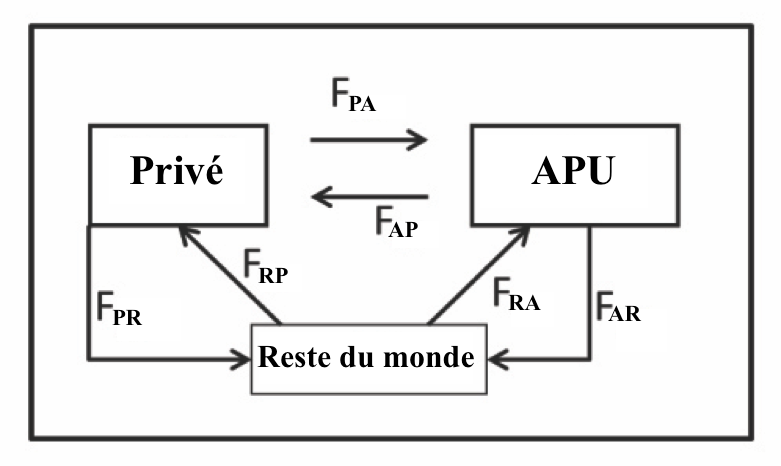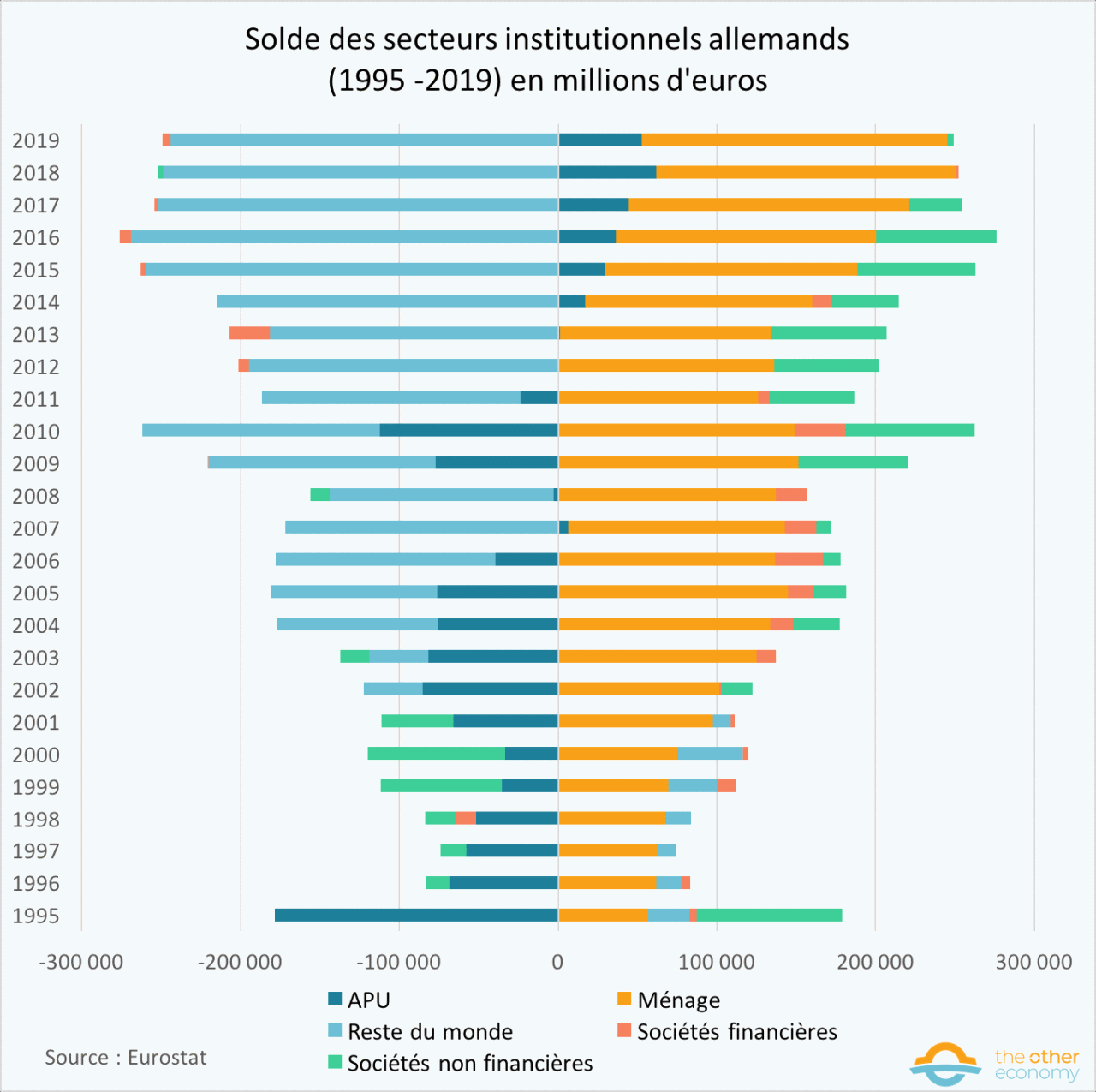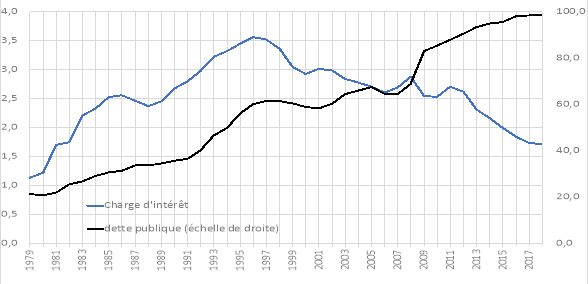Introduction
Depuis plusieurs décennies, l’obsession de la discipline budgétaire est au cœur des politiques publiques menées par les démocraties occidentales. Limiter la dette et les déficits publics a fini par constituer à la fois le guide et le baromètre de l’action publique.
Le spectre de la dette est ainsi mobilisé pour justifier les coupes dans les dépenses sociales, les nécessaires économies à réaliser dans les services publics ou encore l’impossibilité de financer la transition écologique sur fonds publics. Le discours est structuré autour de maximes moralisatrices qui semblent de bon sens : tout comme un ménage, l’État doit gérer son budget « en bon père de famille ». Pourtant, face à la pandémie de COVID-19, ce discours a été mis entre parenthèses : les citoyens ont pu constater avec stupéfaction qu’il était possible de dépenser « quoi qu’il en coûte » pour soutenir l’économie.
Dans ce module, nous nous attacherons à montrer combien ce discours est socialement construit, jalonné de nombreuses idées reçues assimilant l’État à un ménage et le déficit public à une preuve de laxisme. Nous montrerons que la dette est le résultat de nombreux facteurs résultant certes de la gestion budgétaire mais aussi et surtout des choix de politiques publiques, des modes de financement de la dette ainsi que de l’histoire économique et géopolitique. Pour répondre aux défis écologiques et sociaux du XXIème siècle, il est essentiel de déconstruire les dogmes qui paralysent aujourd’hui l’action publique et de comprendre à quel point le budget de l’État est un outil à mobiliser à la fois pour répondre aux crises et pour investir dans l’avenir.
Dette publique, solde public, soutenabilité… Quelques définitions :
Les administrations publiques (APU) regroupent non seulement l’État mais aussi les organismes divers d’administration centrale, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociales. La dette publique c’est celle de l’ensemble de ces acteurs et non pas seulement celle de l’État.
Le solde public c’est la différence entre les dépenses et les recettes des APU à la fin de l’année. Ce solde peut être en excédent quand les recettes sont supérieures aux dépenses ou en déficit dans le cas inverse.
On parle de déficit primaire (ou d’excédent primaire) pour désigner le déficit (ou l’excédent) avant paiement des intérêts de la dette.
Actuellement, les APU financent leur déficit principalement en empruntant :
– aux marchés financiers en émettant des titres de créances (bons et obligations du trésor) négociables (c’est-à-dire échangeables entre les acteurs des marchés tels les banques, fonds de pension, assurances etc.). Plus de détails dans l’Essentiel 3, sur le financement des déficits publics sur les marchés financiers.
– à une banque (c’est surtout le cas des collectivités territoriales)
– à d’autres pays ou à une institution internationale (telle le FMI) : c’est surtout le cas des Etats (comme la Grèce) n’ayant pas accès aux marchés financiers car les taux d’intérêt demandés par les investisseurs sont trop élevés.
La dette publique c’est la somme que les administrations publiques doivent à tous leurs créanciers quelle qu’en soit la forme (bons, obligations, crédit bancaire etc.) et quel que soit le moment où cette dette a été contractée. C’est donc un stock (à la différence du déficit qui est un flux annuel). Voir également notre fiche Mesurer la dette publique
La soutenabilité de la dette désigne la capacité d’un débiteur à dégager les ressources suffisantes pour faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers (payer les intérêts et rembourser le principal).
Il ne faut pas confondre la dette publique avec la dette nationale qui comprend la dette de tous les agents économiques d’un pays (administrations publiques, ménages, entreprises non financières, entreprises financières) ou avec la dette extérieure qui est la dette de l’ensemble des agents d’un pays auprès des non-résidents.
Pour en savoir plus
Ce module a été réalisé grâce notamment aux sources suivantes
- La dette publique. Précis d’économie citoyenne, Les économistes atterrés, Seuil, 2021.
- Fiscal Mythology Unmasked, Finance Watch, 2021
- Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette, Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Editions La Découverte, 2016
- Expertise économique et politique publique : examen critique des propositions sur la dette liée à la pandémie, LIEPP Working Paper, 2020
- Fiches pédagogiques : comprendre la dette publique – CGT – Pôle éco
L’essentiel
La gestion de la dette et du déficit publics n’est pas une question technique mais un enjeu politique majeur
La gestion de la dette et du déficit publics est une question éminemment politique et non une simple question comptable, ne faisant intervenir que des variables techniques tels les taux d’intérêt, ou le niveau des dépenses et des recettes publiques. C’est encore moins une question de bon sens gestionnaire et de morale comme le laissent entendre les multiples maximes qui jalonnent les discours sur la dette.
Le « danger » que représenterait la dette publique repose sur un discours socialement construit
Depuis les années 1970-1980, le discours de la plupart des gouvernements occidentaux est marqué par une dramatisation de la dette publique. C’est un récit construit, une dramaturgie mise en scène à coup de sentences choisies, telles que :
- « il n’y a pas d’argent magique » (voir module sur la monnaie),
- « nos enfants seront les victimes de nos dettes » (Idée reçue 1),
- des analogies trompeuses entre l’État et les ménages ( « une dette ça se rembourse » – voir l’Essentiel 2)
- des arguments sur la crédibilité des États vis-vis des marchés financiers. (voir Idée reçue 3 et module sur la monnaie).
L’argumentaire académique repose sur le courant de pensée de l’école des choix publics (voir encadré ci-après). Les gouvernants poursuivant leurs intérêts propres (la réélection), ils sont tentés de dépenser sans compter et de laisser filer l’inflation pour apaiser les tensions sociales. Il faut donc encadrer strictement la politique budgétaire pour contrer ses biais néfastes à l’activité économique.
La théorie des choix publics
C’est à partir des années 1980-1990 que la priorité donnée à la « saine » gestion des finances publiques revient sur le devant de la scène politique 1. Ses promoteurs peuvent s’appuyer sur le corpus théorique de l’école dite des choix publics, dont l’ambition est d’expliquer les comportements politiques (des électeurs, des élus, des fonctionnaires, des groupes d’intérêts) en s’appuyant sur des postulats issus des théories néoclassiques (rationalité des agents, individualisme méthodologique etc.)
Selon cette théorie, les gouvernants, soumis à la pression des électeurs et des groupes d’intérêts, ne pourraient prendre des décisions économiques optimales. Ils seraient, en effet, marqués par un biais pro déficit et pro inflation, du fait d’une incitation à satisfaire à court terme les électeurs en dépensant trop au prix d’un assainissement budgétaire futur (quand ils ne seront plus au pouvoir).
Concrètement, il s’agit d’encadrer (voire d’ôter) les deux principaux outils de politiques économiques que sont le budget et la monnaie.
– L’indépendance des banques centrales est vue comme la solution institutionnelle au supposé biais inflationniste des décideurs politiques. Dans la zone euro, les États ont ainsi perdu la main sur la politique monétaire, confiée à la Banque centrale européenne, juridiquement indépendante des États et focalisée sur l’objectif de maîtrise de l’inflation. (Ça n’a pas toujours été le cas : voir « Le cadre institutionnel de la monnaie n’est pas immuable », Essentiel 2 du module sur la monnaie).
– L’adoption de règles budgétaires, définie via des indicateurs automatiques sur la dette et le déficit, permet d’exercer une contrainte permanente sur la politique budgétaire et de soustraire ainsi la question du niveau de déficit au débat politique. En Europe, ce sont typiquement les critères de 3% et de 60% de Maastricht (voir l’Essentiel 9, sur les règles budgétaires européennes). La mise en place de comités indépendants en charge de surveiller la politique budgétaire des gouvernements et en particulier la soutenabilité de la dette relève également de cette logique.
Au-delà des publications académiques, le discours est légitimé via la multiplication des rapports d’experts et des comités indépendants qui, sur la base d’un diagnostic sélectif quant à la soutenabilité de la dette (oubliant par exemple la question du patrimoine public, traité dans l’Essentiel 6), structurent le champ des prescriptions possibles. Ces rapports et la communication qui les entoure permettent aux gouvernants de mettre en avant une pseudo expertise scientifique, un soi-disant « consensus » qui envahit ensuite le discours politique, technique, médiatique et devient une forme d’incontournable.
Face aux « risques » liés à la dette publique, l’action publique se structure autour de l’obsession de la discipline budgétaire
Tous ces éléments contribuent à faire de la dette un sujet externe, qui sort du domaine du choix politique, indépendamment des « couleurs » politiques. Une contrainte permanente, et souvent auto-infligée, à laquelle les gouvernements n’ont d’autres choix que de se plier.
Sur le plan institutionnel, la priorité donnée à la « saine » gestion budgétaire s’est traduite par une organisation en silos des différents outils de politique économique (monnaie, budget, encadrement de la finance) rendant très difficile toute remise en question et tout débat démocratique.
L’action publique actuelle est organisée en silos (Lemoine, 2016) : on sépare ce qui relève du budget (la recherche de l’équilibre budgétaire), de la monnaie (un contrôle apolitique de l’inflation), et de la finance (préserver la stabilité financière, l’attractivité de la place financière de Paris et des titres souverains). Une conséquence néfaste pour la qualité du cadre démocratique de ce découpage de la dette est qu’il s’accompagne largement de formes de dépolitisation de la décision en matière de finances publiques : ces décisions relèvent aujourd’hui de « comités d’experts », de « sages » ou d’organisations indépendantes (à l’image des banques centrales nationales ou européennes) qui évoluent de façon « confinée » vis-à-vis de la société et en dehors de tout processus démocratique.
Sur le plan des décisions de politique économique, l’action publique est structurée autour de l’obsession de la discipline budgétaire, et plus particulièrement sur la nécessité de réduire le poids de l’État-obèse et dispendieux, via la diminution des dépenses publiques.
C’est ainsi que début 2021, en pleine crise économique de la COVID 19, l’Allemagne avait déjà prévu l’échéancier de remboursement de la dette COVID, que le gouvernement français engageait des réflexions pour savoir comment rembourser la dette et privilégiait la voie du cantonnement 3 et de la réduction des dépenses publiques sur le long terme via des règles automatiques.
Cela conduit à soustraire du débat public le fait qu’il existe une diversité de choix de politiques économiques
« Rétablir l’équilibre budgétaire », en particulier via la réduction des dépenses publiques, est ainsi présenté comme le seul choix possible.
Pourtant, cela ne constitue en aucun cas une preuve de bonne politique. Comme développé dans l’Essentiel 10, le déficit public est un outil essentiel pour faire face aux crises financières ou aux récessions. C’est ainsi que la mobilisation des budgets publics après la crise de 2008 a permis d’éviter l’effondrement du système financier puis de relancer l’activité économique. En 2010, le tournant de la rigueur que se sont auto-imposés les gouvernements européens n’obéissait à aucune contrainte économique incontournable et a eu des conséquences écologiques et sociales importantes (voir l’Essentiel 12, sur les impacts négatifs de la « rigueur budgétaire »).
Des choix en matière de dépenses publiques
Plus généralement, le montant et le rôle des dépenses publiques relèvent du débat politique et démocratique. La priorité est-elle de reconnaître le rôle de l’État pour investir dans les infrastructures qui préparent l’avenir (voir l’Essentiel 11 et l’Idée reçue 6) ou de réduire l’investissement public, au nom de la baisse des dépenses ? Quelle part des risques contre les aléas de la vie (perte d’emploi, maladie, vieillesse) souhaite-t-on mutualiser via l’assurance sociale et quelle part doit être prise en charge par les assurances privées ? Les services collectifs (eau, énergie, gestion des déchets, éducation, santé) doivent-ils être gérés par le privé ou par le public ?
Toutes ces questions relèvent bien de choix de société qui ne peuvent être réduits à leur seule dimension comptable.
Des choix en matière de recettes de l’État
Par ailleurs, le solde budgétaire n’est qu’un solde : il peut résulter de choix bien distincts qui ne concernent pas que les dépenses mais aussi les recettes. L’appel à réduire le niveau de dette peut, ainsi, occulter des choix fiscaux, réduisant les recettes publiques pour ensuite justifier des baisses de dépenses. Là aussi le débat démocratique est essentiel. Dans quelle mesure faut-il taxer les revenus du capital, ceux du travail, la consommation, les très hauts revenus, le patrimoine, les entreprises ? Quelle est la place de la fiscalité écologique ? Le système fiscal est-il redistributif ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter sérieusement contre l’optimisation et la fraude fiscale ? L’État doit-il promouvoir sur son territoire et au niveau international la lutte contre les paradis fiscaux (ou en devenir un, comme c’est le cas notable des Pays-Bas et de l’Irlande au sein même de l’Union européenne) ?
Des choix concernant les modes de financement des déficits publics
Enfin, le mode de financement des déficits relève également de choix politiques. L’option majoritairement retenue depuis les années 1970 par les démocraties occidentales consiste à se financer sur les marchés financiers, censés exercer une discipline vertueuse sur la gestion des finances publiques. Ce faisant, les acteurs financiers s’invitent dans le débat démocratique : les politiques publiques sont soumises au dictat de certaines normes économiques, celles qui rassurent les créanciers (voir encadré).
La mise en marché de la dette soumet les politiques publiques au jugement d’acteurs sans légitimité démocratique
Dans le chapitre 3 de son livre L’ordre de la dette, Benjamin Lemoine raconte les tournées de conférences que les fonctionnaires du Trésor français réalisaient dans les grandes places financières mondiales pour vendre les produits de la dette française.
voici par exemple la liste des questions susceptibles d’être posées par les banques et investisseurs qu’ont préparés les services du Trésor en amont d’une conférence tenue à Londres en 1987 : « Quelle est la politique française en matière d’inflation ? Est-ce que le coût du travail est en train de croitre en France ? Si oui de combien ? Est-il possible que la France quitte le système monétaire européen ? Comment décririez-vous une politique financière « socialiste » ? Que pensez-vous du fait que le parti communiste gagne assez de soutien pour partager le pouvoir ? Est-ce que la France va encore céder au terrorisme ? ».
Lors de la conférence qui s’est tenue à New York en octobre 1987, JP Morgan, la banque hôte, a présenté un rapport détaillant les fondamentaux économiques qui rendent la dette publique française intéressante pour les investisseurs : « une économie de libre échange », « une orientation non inflationniste de la politique », « un haut taux de chômage » présenté comme un gage de « pression sur les bas salaires » et de « compétitivité du coût du travail », « une politique budgétaire serrée et rigoureuse ».
Source L’ordre de la dette, Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Benjamin Lemoine, Editions La Découverte, 2016
Les États n’ont pas toujours été aussi dépendant des jugements des acteurs financiers. La France de l’après-guerre et des Trente Glorieuses, par exemple, avait mis en place un mode de financement appelé « circuit du Trésor » qui consistait à faire converger vers le Trésor public de nombreuses ressources financières du pays, tout en mobilisant le concours de la banque centrale. Dans ce système, la finance était placée au service de l’État et non l’inverse comme c’est le cas aujourd’hui.
Plus fondamentalement, la politique monétaire peut être un outil de politique économique permettant de financer l’investissement public. La sanctuarisation de cet outil au sein d’une banque centrale indépendante focalisée sur la seule maîtrise de l’inflation est le résultat de l’histoire (voir module sur la monnaie), non de contraintes techniques incontournables (voir également : L’Essentiel 5 : « L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire »).
L’État n’est pas comparable à un ménage ou à une entreprise
L’un des arguments récurrents utilisés dans les discours sur la dette et le déficit publics consiste à assimiler l’État à un ménage ou à une entreprise. De là découlent les nombreuses idées reçues sur « le fardeau de la dette que nous léguons à nos enfants » (Idée reçue 1), sur la nécessité de « gérer le budget de l’État en bon père de famille » (Idée reçue 3), sur le fait que tel ou tel pays vit « au-dessus de ses moyens » (Idée reçue 5).
Comme nous allons le voir, si tous ces arguments sont de bon sens quand ils s’appliquent à un ménage ou à une entreprise, ils sont fondamentalement faux quand il s’agit de l’État (et plus généralement les administrations publiques) car ils reviennent à appliquer des raisonnements microéconomiques à un acteur qui a des impacts macroéconomiques.
Microéconomie et macroéconomie : définitions
La microéconomie étudie le comportement des agents économiques (les ménages, les entreprises etc.) et la façon dont ils se coordonnent sur les marchés via le mécanisme des prix.
La macroéconomie étudie l’économie dans son ensemble en partant des grands agrégats (l’épargne, l’investissement, le revenu, l’emploi, le PIB etc.) pour tenter de mettre en évidence et de modéliser les relations entre eux.
La macroéconomie ne peut être réduite à l’agrégation (c’est-à-dire à l’addition) des comportements des agents économiques. En effet, des phénomènes macroéconomiques peuvent « émerger » des comportements microéconomiques et donner des résultats très différents de ce que les agents économiques recherchaient initialement.
Par exemple, en période de récession, la réponse rationnelle des ménages ou des entreprises est de se serrer la ceinture. Ce faisant, leurs comportements agrégés aboutissent à la réduction de la demande globale (et donc des commandes pour les entreprises) et approfondissent la récession. Le résultat macroéconomique va dans le sens inverse de ce que cherchait à obtenir chaque agent économique (se prémunir contre la récession).
L’État est un acteur économique très particulier
Le lien entre État et politique monétaire
Si la plupart des démocraties des pays développés ont choisi de confier la gestion de la politique monétaire à une banque centrale indépendante focalisée sur la maîtrise de l’inflation, cela n’a pas toujours été le cas. Régulièrement à travers l’histoire, les banques centrales ont été contrôlées de façon beaucoup plus étroite par l’État avec notamment pour mission de participer au financement des dépenses publiques. Encore aujourd’hui certains pays, dont la Chine est l’exemple le plus notable, gardent le contrôle de leur banque centrale et la maîtrise de l’outil monétaire, comme nous l’expliquons dans le module sur la monnaie.
C’est bien évidemment une première différence fondamentale entre l’État et les autres agents économiques (ménages, entreprises).
L’État décide lui-même de ses recettes en déterminant le niveau de la fiscalité et plus généralement des prélèvements obligatoires
Même s’il ne peut pas augmenter sans limite et sans effet les impôts, cela représente une première différence significative avec des agents économiques dont les ressources financières dépendent principalement de décisions extérieures « libres » (achats des clients, décisions de l’employeur etc.).
L’État n’a pas le même horizon temporel qu’un ménage ou une entreprise
Il ne « meurt » pas. Contrairement à une entreprise4, un État ne peut pas faire faillite : il peut faire défaut sur sa dette, c’est-à-dire que l’État refuse ou ne peut plus honorer les échéances de remboursement de sa dette ou payer les intérêts. Les créanciers n’ont alors d’autre choix que de négocier avec l’État concerné.
Ainsi, les capacités d’un État à emprunter et à taxer ne s’éteignent pas ou très rarement. De ce fait, il peut reconduire sa dette beaucoup plus facilement qu’un acteur privé et n’a pas à envisager de la rembourser à un terme défini.
Tant qu’il trouve des investisseurs prêts à acheter sa dette, l’État peut la « faire rouler » c’est-à-dire emprunter de nouveau pour rembourser les emprunts qui arrivent à échéance. C’est ce qu’on peut constater sur le graphique ci-dessous : depuis des décennies, de nombreux États se contentent de faire rouler leur dette.
OECD Chart: General government debt, Total, % of GDP, Annual, 1995 – 2019
Cela ne signifie pas que l’accroissement de la dette publique est indolore (Idée reçue 2) mais juste qu’assimiler un État à une entreprise et encore bien plus à un ménage est tout simplement aberrant.
Les décisions budgétaires de l’État ont des impacts macroéconomiques
Le rôle déterminant du budget de l’État en cas de crise économique
Quand la conjoncture économique est mauvaise, les ménages en difficulté sont contraints de se serrer la ceinture tandis que les autres ont tendance, par précaution, à augmenter leur épargne plutôt qu’à dépenser ; les entreprises constatant l’atonie de la demande n’investissent pas ; la politique de crédit des banques est également réservée.
Tous ces comportements vont dans le même sens : celui de la baisse de la demande globale. La dépression puis la récession s’installent et s’approfondissent. Ce phénomène est d’autant plus fort que l’endettement privé est important, menant à la déflation par la dette identifiée par Irving Fisher .
Dans une telle situation, seul l’État est à même de compenser la baisse de la demande globale.
D’une part, l’État (et plus généralement les administrations publiques) joue un rôle important pour amortir le choc d’une crise économique via les « stabilisateurs automatiques » (c’est-à-dire la hausse automatique de certaines dépenses liées à la hausse du chômage, aux minima sociaux et la baisse des recettes fiscales).
D’autre part, en menant des politiques de relance contra-cyclique (c’est-à-dire qui va dans le sens inverse du cycle économique) 5, il peut soutenir la demande et éviter des réactions en chaine catastrophiques.
Plus de détails dans l’Essentiel 10 : « Le déficit public est un outil de lutte contre une crise économique »
Le rôle déterminant de la puissance publique pour investir et préparer l’avenir
Les infrastructures et les services dont bénéficient aujourd’hui les habitants d’un pays sont largement le résultat des investissements publics passés : réseaux d’eau, d’électricité, de transport, systèmes de santé, systèmes éducatifs, production d’énergie, etc. Il en va de même de nombre d’innovations qui n’ont été possibles que grâce à la recherche publique. L’exemple d’internet développé par l’armée américaine est bien connu. Plus récemment, les deux innovations qui ont permis un développement rapide des vaccins contre la COVID 6 viennent de la recherche publique américaine.
Ce qui était valable par le passé l’est tout autant aujourd’hui. Faire face au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité tout en adaptant nos territoires aux changements déjà en cours implique une transformation profonde de notre système productif. Pour cela, la mobilisation des budgets publics est essentielle car tous les investissements à réaliser pour décarboner nos infrastructures, réduire nos besoins en ressources naturelles et reconvertir des secteurs économiques entiers, ne seront pas financés par le secteur privé. Et les investissements nécessaires à la transition écologique sont massifs : la Cour des comptes européenne estimait en 2017 qu’il serait nécessaire d’investir au moins 1 115 milliard d’euros chaque année entre 2021 et 2030, pour tenir les objectifs 2030 de l’UE.
Plus de détails dans l’Essentiel 11 : « L’investissement public pour la transition écologique est prioritaire sur le respect de ratios comptables »
Les États financent aujourd’hui leur déficit principalement sur les marchés
Depuis les années 1970, le financement des déficits publics sur les marchés financiers est devenu la norme. Cependant, cela n’a pas toujours été ainsi. Comprenons comment ça marche.
Comme on l’a vu dans les définitions en introduction, la dette et le déficit publics concernent toutes les administrations publiques et donc pas seulement l’État. Nous nous attachons cependant ici à décrire les modalités de financement des États par souci de simplification et parce que la dette de l’État (ou dette souveraine) constitue la majeure partie de la dette publique dans la plupart des pays.
Dette des administrations publiques par sous secteur (en % du total de la dette)
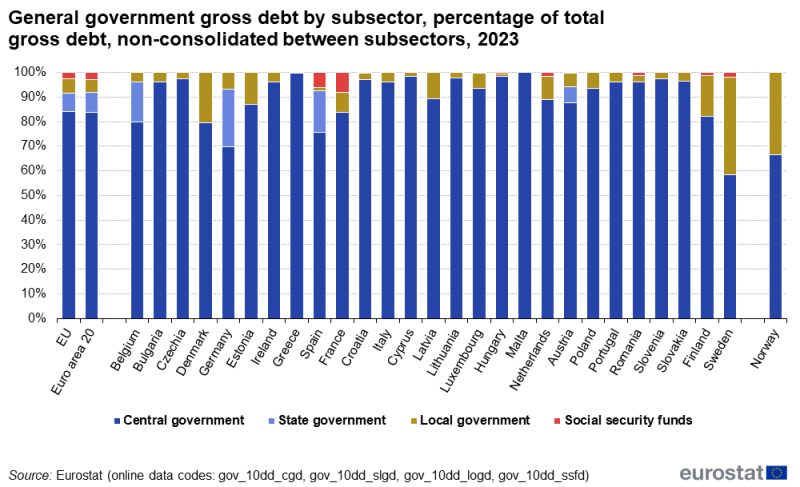
Source Eurostat statistics explained – Structure of government debt
General government = administrations publiques ; Central government = administration centrale (surtout l’État) ; state government = administrations d’États fédérés ; local government = administrations locales ; social security funds = fonds de sécurité sociale (dans certains pays la dette des administrations de sécurité sociale quand elle existe est incluse dans celle d’autres administrations, l’Etat le plus souvent).
Comment l’État peut-il financer son déficit ?
Les recettes de l’État sont principalement constituées par les prélèvements obligatoires (les impôts et les cotisations sociales). L’État dispose également de recettes non fiscales (vente de biens et services, dividendes, amendes etc.) mais elles sont marginales.
Quand les recettes de l’État sont inférieures aux dépenses, le budget de l’État est en déficit et il doit donc trouver d’autres ressources financières. Il peut ainsi :
Avoir recours à sa banque centrale
Les banques centrales ont régulièrement dans l’histoire accordé des avances ou des prêts (gratuits ou à taux très faible) à leur État. Certaines le font d’ailleurs encore aujourd’hui (en Chine par exemple).
A partir des années 1970, ce mode de financement public a cependant été de moins en moins utilisé jusqu’à disparaître dans de nombreux pays au motif que cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur la stabilité des prix en provoquant de l’inflation.
La plupart des États des pays dits développés ont ainsi renoncé à avoir recours à leur banque centrale pour financer leur déficit. Cette possibilité a même été interdite dans l’Union européenne à partir du traité de Maastricht (1992).
Emettre des titres financiers
L’État peut émettre des titres de créance 7 (ou titres de dette publique), appelés bons ou obligations du Trésor qui sont ensuite vendus à des investisseurs. Voir les détails au point 3.2 ci-après.
Ces titres sont la plupart du temps négociables sur un marché mais ce n’est pas obligatoire. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale la France a mis en place le système du « plancher des bons du Trésor » qui a perduré jusqu’à la fin des années 1980. Les établissements bancaires étaient obligés d’acheter des bons du Trésor pour un montant plancher correspondant à une partie des dépôts de leurs clients. C’est l’État qui fixait le montant du taux d’intérêt.
Avoir recours à l’aide internationale
L’État peut également emprunter à d’autres pays ou à des institutions financières internationales (tel le FMI). Cela concerne principalement les pays qui ne peuvent pas ou plus se financer sur les marchés de capitaux : les investisseurs, considérant sa dette comme trop risquée, ne veulent plus acquérir des titres de dette ou exigent des taux d’intérêt trop élevés.
Dans le cadre des politiques de développement, certains États peuvent également obtenir des prêts des banques de développement multilatérales (telle la Banque mondiale) ou nationales (telle l’Agence française de développement).
Environ 80% de la dette publique des économies développées est constituée de titres de créance négociables (debt securities)
Comme on peut le constater sur le graphique ci-après, les titres de créance négociables (debt securities) représentent plus de 80% de la dette publique dans l’Union européenne. Les ordres de grandeur sont les mêmes dans les autres grandes économies de l’OCDE (Japon, États-Unis, Royaume Uni, Canada). Ces titres sont donc majoritairement utilisés aujourd’hui pour financer les déficits publics.
La dette publique par type d’instrument financier dans l’Union européenne en 2023 (en pourcentage de la dette totale)
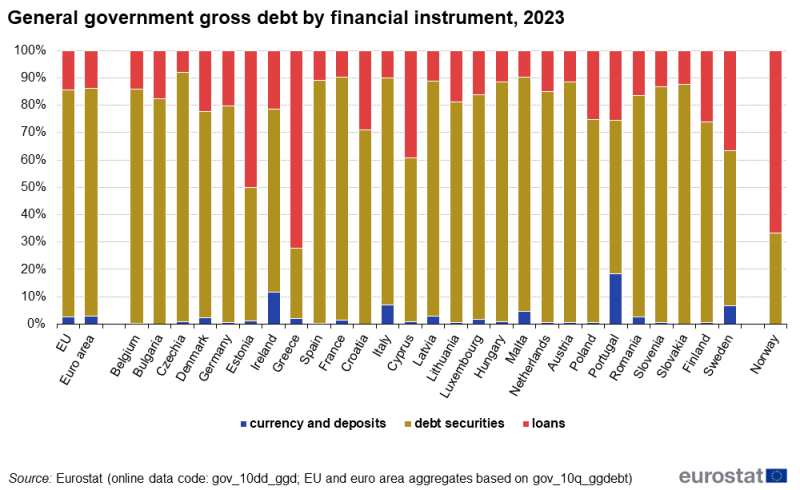
Source Eurostat statistics explained – Structure of government debt
Remarque : Les « loans » (c’est-à-dire les titres de créance non négociables, les crédits bancaires et les prêts d’institutions internationales) sont importants dans les pays dont la dette publique est peu élevée (Estonie), dans ceux où la dette des collectivités territoriales représente une part importante de la dette publique (Norvège, Suède) et dans ceux qui ont fait appel à l’aide d’institutions internationales tel le FMI (par exemple, la Grèce et Chypre).
Quelles sont les conséquences de cette prédominance des titres de créance négociables ?
Prenons l’exemple de la France pour comprendre comment les titres sont émis, comment ils sont négociés sur les marchés et ce que cela implique pour les finances publiques.
En France, c’est l’Agence France Trésor (AFT), organisme public dépendant du ministère des finances, qui est chargé de gérer la dette de l’État.
A noter que les titres de créances peuvent également être appelés obligations ou titres de dette (quand on se place du côté de l’emprunteur).
Les émissions de bons et d’obligations du Trésor ont lieu sur le « marché primaire »
Tout au long de l’année, l’AFT émet divers types de titres de créance, par exemple, les bons du Trésor à taux fixe (BTF) pour les emprunts de court terme ou les Obligations assimilables au Trésor (OAT) à plus long terme. Ces titres de créance sont acquis par des établissements bancaires (français et étrangers) ayant reçu le monopole de l’achat de dette souveraine sur le marché primaire (c’est-à-dire lors de l’émission des titres). Ces établissements s’appellent les « Spécialistes en valeurs du Trésor » (SVT).
La technique d’émission la plus employée s’appelle l’adjudication et s’apparente à une mise aux enchères : l’AFT annonce combien d’obligations ou de bons du Trésor elle souhaite vendre, et les SVT font des offres en disant combien ils souhaitent en acheter et avec quelle rémunération (taux d’intérêt).
Un titre de créance (ou titre de dette) se caractérise par trois composantes principales
> le montant prêté appelé nominal ou principal (par exemple 100€),
> la maturité ou échéance du prêt : les bons du Trésor sont des titres de créance remboursables à court terme (en général de quelques semaines à un an) et les obligations du Trésor sont remboursables à moyen et long terme (de 1 an à plus de 30 ans).
> le taux d’intérêt (par exemple 2%) qui constitue la rémunération du créancier par l’emprunteur.
A la différence d’un particulier ou d’une PME qui emprunte à une banque, l’émetteur d’un titre de créance ne paie chaque année que les intérêts. Le principal est remboursé au moment où l’obligation arrive à échéance. Dans l’exemple ci-avant, l’État doit payer chaque année 2€ et ne rembourser le principal de 100€ qu’une fois les dix ans écoulés.
Les échanges sur le « marché secondaire »
Les SVT peuvent ensuite revendre ces titres sur le marché secondaire (en gros la bourse) à d’autres acteurs financiers (autres banques, fonds de pension, fonds souverains d’autres pays etc.) qui peuvent eux-mêmes les revendre etc.
Quand un acteur financier achète un bon ou une obligation du Trésor sur le marché secondaire, cela n’apporte aucune ressource nouvelle à l’État français. Par contre, cela influe sur les taux d’intérêt des futurs titres de dette (voir encadré).
Comment les échanges de titres de créance négociables sur le marché secondaire influencent-ils les taux d’intérêt de la dette publique ?
Reprenons notre exemple précédent : une obligation de 100€, à 10 ans avec un taux d’intérêt de 2%. La « valeur nominale » de l’obligation (c’est-à-dire celle que l’État devra rembourser) est de 100€.
Par contre, sa « valeur de marché » dépend de la demande : si beaucoup d’investisseurs souhaitent acheter cette obligation, ils peuvent être prêts à payer plus que la valeur nominale, disons 120€, pour acquérir le titre de dette concerné.
Dans ce cas, le rendement de l’obligation diminue puisque le taux d’intérêt payé par l’État est toujours calculé sur la valeur nominale de l’obligation. Dans notre exemple, le rendement de l’obligation ne sera plus de 2% par an mais de 1,66% par an.
Concrètement, cela signifie que lors de la prochaine émission, l’AFT devrait avoir pour le même type d’obligation des offres avec un taux d’intérêt de 1,66% au lieu de 2%.
Quelles sont les conséquences de la mise en marché de la dette publique ?
Le marché de la dette publique pose deux problèmes majeurs.
- D’une part, le poids cumulé des intérêts peut finir par peser lourdement sur les comptes publics (voir l’Essentiel 5 : « L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire »)
- D’autre part, comme noté dans l’Essentiel 1, cela donne aux acteurs financiers un pouvoir exorbitant sur les États. Si la gestion des finances publiques ne correspond pas à leurs critères de bonne gestion, ils peuvent demander des taux d’intérêt plus importants et donc in fine renchérir le coût de la dette, voire empêcher l’État de se financer si les taux atteignent des niveaux trop importants. Or, rien ne garantit que ces critères répondent à des enjeux d’intérêt général.
La banque centrale joue un rôle déterminant
Comme on l’a vu en 3.1, la plupart des États ne peuvent plus avoir recours au financement direct de leur banque centrale. Celle-ci n’en a pas moins une influence déterminante sur la dette publique via la mise en œuvre de la politique monétaire.
Tout d’abord, en fixant son taux directeur, c’est-à-dire le taux auquel elle prête aux banques, elle influence l’ensemble des autres taux d’intérêt de l’économie (taux de marché, taux du crédit etc.) y compris celui des titres de créance publics.
Par ailleurs et surtout, à la suite de la crise financière de 2007-2008, les banques centrales des principales zones monétaires se sont progressivement mises à racheter de la dette publique sur le marché secondaire (on parle de politique de quantitative easing ou d’assouplissement quantitatif ). Ce faisant, elles ont largement contribué à la baisse des taux d’intérêt sur la dette des États dont elles gèrent la monnaie.
Ces politiques ont perduré jusqu’à la pandémie de COVID-19 où elles se sont encore accrues pour permettre aux États de faire face à la crise économique.
En savoir plus sur les outils et mécanismes de la politique monétaire dans le module sur la monnaie et dans notre fiche sur le quantitative easing.
L’exemple de la zone euro : face aux crises, la Banque centrale européenne a eu recours à l’assouplissement quantitatif
Les pays de la zone euro ne sont pas entièrement souverains en matière monétaire. La Banque centrale européenne (BCE) est en effet juridiquement indépendante des États et elle a interdiction de leur prêter directement (de même que les banques centrales nationales).
Jusqu’en 2012, elle s’est refusée à garantir leur dette. Elle a donc laissé toute latitude aux marchés financiers pour en déterminer le coût. C’est une des raisons de la crise de la dette publique dans la zone euro, pendant laquelle les taux d’intérêt de certains pays se sont élevés à des niveaux tels qu’ils ne pouvaient plus se financer sur les marchés.
Cette situation mettant en danger la zone euro dans son ensemble, la Banque centrale européenne a fini par intervenir.
En juillet 2012, Mario Draghi, président de la BCE déclare : « la BCE est prête à tout pour préserver l’euro et croyez-moi ce sera suffisant » et lance un programme visant à racheter les obligations des États dans la tourmente.
Trois ans plus tard, il va plus loin en lançant le premier programme de quantitative easing ou d’assouplissement quantitatif . Concrètement, cela signifie que la BCE (et avec elle, les banques centrales nationales) assume désormais son rôle de prêteur en dernier ressort auprès des États de la zone euro. Cette garantie « rassure les marchés ». C’est pourquoi des investisseurs ont parfois étaient prêts à acquérir de la dette publique à des taux négatifs, c’est-à-dire à payer pour détenir de la dette publique !
Ainsi, le 5 septembre 2019, la France a levé 10,14 milliards d’euros dont 1,5 milliard d’euros à échéance de quinze ans. Pour la première fois, le taux nominal à cette échéance a été négatif (-0,03 %).
Courbe de rendement des obligations d’État (notées AAA) dans la zone euro (2014-2024)
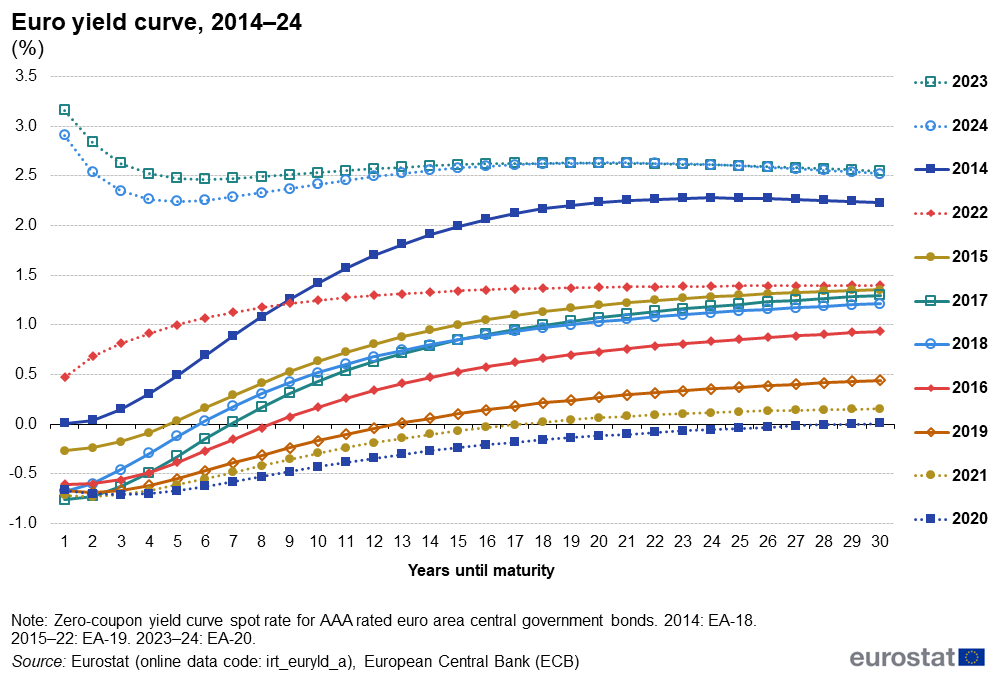
Source Source : Eurostat – Statistiques Explained
Lecture du graphique : en 2020 (courbe bleue foncée en pointillés), les obligations d’État notées AAA de la zone euro ayant une maturité restante de 1 an (c’est-à-dire qui devront être remboursées dans un an) avaient un rendement d’environ -0,66% ; celles ayant une maturité restante de 30 ans avaient un rendement légèrement supérieur à 0%.
Depuis 2022, la situation a changé. Face à l’inflation provoquée notamment par la guerre d’Ukraine (et son impact sur nombre de matière premières dont l’énergie), le resserrement des politiques monétaires (hausse des taux d’intérêts et fin du quantitative easing) a été pratiqué par la plupart des banques centrales des économies développées. Comme on peut le voir sur le schéma ci-avant cela a provoqué une hausse des taux d’intérêts des obligations d’Etat.
Tous les pays ne sont pas égaux face à la dette publique
Quand on se penche sur les crises de la dette publique des dernières décennies, on peut constater qu’elles sont presque exclusivement 8 le fait de pays émergents et en voie de développement.
Crises de change et crises de la dette souveraine (selon le niveau de revenu des pays).
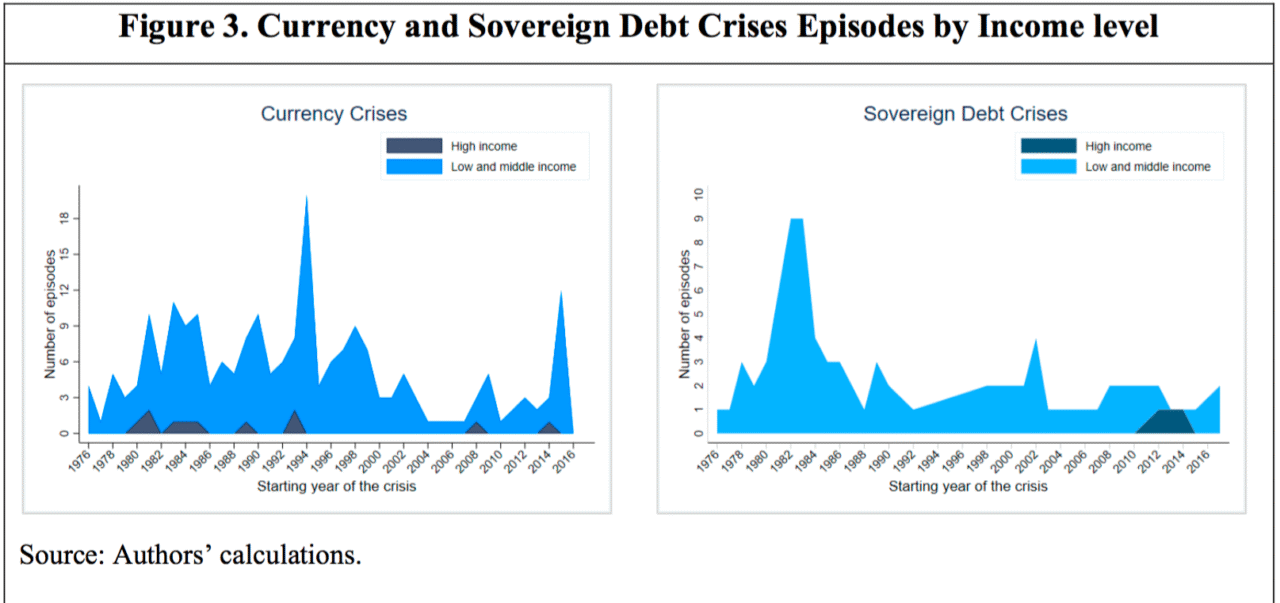
Source Laeven, L. Valencia, F., « Systemic Banking Crises Revisited » IMF working papers p. 10 (2018).
La liste précisant les années de crises ainsi que les pays dans lesquels se sont déroulées ces crises se trouve en annexe du working paper (p. 30).
Ce n’est pas un hasard car, comme nous allons le voir, la plupart de ces pays ne disposent pas de la possibilité de s’endetter dans leur propre monnaie.
Un déséquilibre récurrent de la balance des transactions courantes (voir encadré) peut alors mener à une crise de la dette publique. Nous expliquons ci-après schématiquement les mécanismes en jeu.
Définitions : balance des paiements, compte de transactions courantes, balance commerciale…
La balance des paiements est un document de comptabilité nationale qui fait le bilan annuel du solde des échanges entre tous les agents économiques d’un pays et le reste du monde. La balance des paiements est constituée de trois comptes principaux.
Le compte de transactions courantes (ou balance des transactions courantes) retrace le solde :
-des échanges de biens (balance commerciale) et de services (balance des services).
-des flux de revenus primaires : les salaires (par exemple, d’un résident français qui travaille dans un pays frontalier) ou les revenus des investissements (par exemple, une entreprise française implantée à l’étranger qui rapatrie ses bénéfices en France)
-des flux de revenus secondaires : l’aide internationale (par exemple, les subventions accordées par les banques de développement) et les envois d’argent à l’étranger (par exemple, un immigré qui envoie de l’argent à sa famille dans son pays d’origine).
Le compte de capital dresse le solde des achats ou ventes d’actifs non financiers (bâtiments, infrastructures, brevets, droits d’auteur etc.)
Le compte financier dresse le solde des flux financiers entre un pays et le reste du monde (investissements directs, investissements de portefeuille – actions, obligations… etc.).
Le compte courant et le compte de capital déterminent l’exposition d’une économie au reste du monde. Le compte financier explique comment elle est financée.
Par construction, la balance des paiements est toujours à l’équilibre (en additionnant 9 tous les postes on obtient toujours zéro). Par exemple, tout déficit de la balance de transactions courantes d’un pays (souvent lié au fait que ses importations sont supérieures à ses exportations) doit être financé par des emprunts ce qui se traduit par un excédent du compte financier.
Une crise de la balance des paiements intervient quand un État n’arrive pas à trouver les moyens financiers nécessaires pour couvrir le déficit de sa balance courante.
Source En savoir plus sur le site la finance pour tous et sur le site de Statistics explained de l’Union européenne
Pourquoi certains États doivent-ils s’endetter en monnaie étrangère ?
Nombre de pays en développement se caractérisent par une balance des transactions courantes déficitaire 10. Cela signifie que le montant des importations et des revenus versés au reste du monde est supérieur à celui des exportations et des revenus perçus du reste du monde.
Cela peut être la conséquence de l’importation de biens de consommation courante ou de biens durables non produits localement ou encore de l’emploi d’entreprises étrangères pour réaliser des travaux d’infrastructures ou de construction par exemple. Un déficit de la balance courante peut aussi résulter d’une chute brutale des cours mondiaux des biens ou des services que le pays exporte (ou inversement d’une hausse des cours des biens et services qu’il importe).
Afin de payer les entreprises concernées, les agents économiques publics et privés doivent le faire dans la monnaie qu’elles demandent. Or toutes les monnaies ne se valent pas : certaines, tel le dollar, l’euro, la livre, le yen sont convertibles. Les autres ne le sont pas. Cela signifie qu’on peut librement échanger les monnaies convertibles contre toutes les autres monnaies du monde, mais que l’inverse n’est pas vrai (pour en savoir plus, voir « La majorité des monnaies sont non convertibles » dans le module sur la monnaie).
On comprend alors aisément qu’un agent économique étranger demandera plutôt à être payé en dollar ou en euro qu’en livre libanaise par exemple.
Les agents économiques publics et privés du pays en déficit doivent alors se procurer des moyens de paiement en devise étrangère : ils doivent emprunter dans une monnaie qui n’est pas la leur.
Pourquoi une dette publique en devise étrangère fait peser un double risque sur les États
Le risque de taux d’intérêt élevé
Si les créanciers considèrent que la dette d’un État est risquée (c’est-à-dire qu’ils craignent de ne pas être remboursés du fait de considérations politiques ou économiques, tel un déséquilibre récurrent de la balance courante), ils augmentent les taux d’intérêt qu’ils demandent pour lui prêter.
Ce risque concerne tous les emprunteurs mais il est moins important pour les États qui sont en capacité de s’endetter dans leur propre monnaie puisqu’ils peuvent bénéficier du soutien de leur banque centrale 11.
Par ailleurs, les pays qui ne peuvent s’endetter dans leur propre monnaie sont tributaires des décisions de politique monétaire du pays émetteur de la monnaie dans laquelle ils s’endettent. C’est par exemple ce qui s’est passé pour les pays d’Amérique latine dans les années 1970-1980. Fortement endettés en dollars, ils ont pris de plein fouet la hausse des taux d’intérêt internationaux consécutive à la décision de la banque centrale des États-Unis (la Fed) de remonter ses taux d’intérêt directeurs à partir de 1979 12.
Le risque de change
Un État ayant une balance courante structurellement déficitaire risque de voir sa monnaie perdre de la valeur par rapport aux autres 13, puisqu’elle est de moins en moins demandée sur le marché des changes. En effet, le système monétaire international se caractérise, depuis la fin des accords de Bretton Woods au début des années 1970, par des changes flottants (voir le module sur la monnaie) : cela signifie que les monnaies évoluent librement les unes par rapport aux autres en fonction de l’offre et de la demande de monnaie. La valeur de la dette extérieure (et des intérêts) augmente alors quand elle est exprimée en monnaie domestique sans même que l’État ait emprunté de nouveau.
Quand vient le moment pour l’État de rembourser sa dette, il n’est plus en mesure de la « faire rouler », c’est-à-dire de réemprunter pour payer ce qu’il doit à ses créanciers. Il peut alors se retrouver en défaut de paiement et doit négocier avec ses créanciers ou leurs représentants (FMI, clubs de Paris ou de Londres) et bien souvent consentir à des « plans d’ajustement structurel » douloureux (voir l’Essentiel 12), destinés à rétablir l’équilibre des comptes publics.
L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire
Le lien entre création monétaire et dette publique est évident en théorie : si l’État bénéficie de la création monétaire, il ne s’endette pas à due concurrence. Et c’est le seul acteur à avoir la légitimité de le faire. On parle dans ce cas de « monétisation de la dette publique ».
Comme nous allons le voir, cette pratique est aujourd’hui interdite, condamnant les États à se soumettre aux « humeurs des marchés ».
La monnaie est créée par les banques quand elles accordent des crédits
Le système monétaire en vigueur dans un pays ou une zone est intimement lié au cadre juridique qui garantit le système de paiement et fixe le rôle des différentes institutions en charge de la création et de la circulation de la monnaie : les banques centrales et les banques de second rang 14. Il est le fruit d’une histoire et des spécificités propres à chaque pays ou chaque zone monétaire (plus d’explications dans le module sur la monnaie).
Depuis les années 1970, le système dominant dans la plupart des grandes économies de la planète est fondé sur la création monétaire par les banques secondaires quand elles accordent des crédits (plus d’explications sur la création monétaire dans le module sur la monnaie). Les banques centrales créent également de la monnaie mais celle-ci n’est utilisée que par les banques secondaires, et non par les autres agents économiques. En particulier, les banques centrales ont l’interdiction 15 de financer directement les États, que ce soit par des prêts, des avances, voire des dons.
Le financement des déficits sur les marchés financiers accroit la dette publique
Dès lors que la création monétaire publique est interdite, les États n’ont d’autre choix que de se financer sur les marchés financiers et donc de payer les taux d’intérêts demandés par les créanciers.
Cette situation est légitimée par la doctrine selon laquelle l’État doit se soumettre à la discipline de marché (voir module sur la monnaie) et sur l’idée reçue que la dette publique résulterait du laxisme budgétaire des États. En étant obligé de s’endetter auprès du marché, l’État devrait justifier de sa bonne gestion budgétaire. A l’inverse, le recours à la création monétaire de sa banque centrale lui permettrait des facilités « anti-économiques ».
Les enjeux sont considérables. En effet, en raison de l’effet boule de neige , dès que le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance, la dette publique s’accroit mécaniquement sauf à ce que l’État dégage des excédents primaires suffisants.
Dans un article de 2012 16, Rossi Abi-Rafeh, Gaël Giraud, Florent Mc Isaac ont analysé l’évolution de la dette publique française des années 1980 à 2011 : elle est passée d’environ 25% du PIB en 1978 à 86% en 2011. Les auteurs décomposent dans la formation de cette dette ce qui est dû aux poids des intérêts et ce qui est dû au déficit primaire (c’est-à-dire avant paiement des intérêts).
Ils concluent que « si l’État français s’était endetté à taux nul, notre dette publique brute, aujourd’hui, aurait été de 28,5% du PIB en 2011 (au lieu de 86%) toutes choses égales par ailleurs. » Dit autrement, si les besoins de financement de l’État avaient été satisfaits par la création monétaire sans endettement et sans intérêt, alors le taux d’endettement public de la France aurait été globalement stable.
Poids du service de la dette dans la dette publique française- 1978-2011.
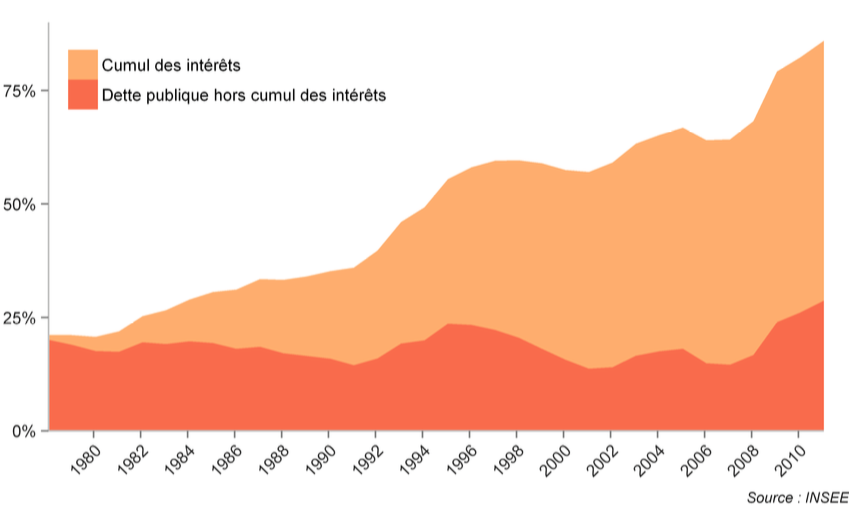
Source Rossi Abi-Rafeh, Gaël Giraud, Florent McIsaac, « La dette publique française justifie-t-elle l’austérité budgétaire ? », 2012.
Le financement de l’État par l’endettement a donc comme première conséquence négative de faire peser la charge des intérêts sur les comptes publics. Plus les taux d’intérêt sont élevés, plus les montants à payer sont importants.
On pourrait alors penser que le montant de la dette publique n’est pas en soi un problème 17 tant que les taux d’intérêt sont faibles. Dit autrement, la soutenabilité de la dette publique dépendant au premier ordre des taux d’intérêt, le recours à la monétisation ne serait pas utile en période de taux bas.
Cette analyse est peu convaincante. D’une part, il n’est pas forcément souhaitable économiquement que les taux d’intérêt (qui ne servent pas uniquement au financement de la dette publique mais se répercutent dans toute l’économie) soient nuls – cela dépend du contexte. D’autre part, leur niveau peut varier : rien ne garantit qu’il ne va pas augmenter. Dans ce cas, les charges d’intérêt pèseront à nouveau sur les comptes publics. Il s’agit donc d’une épée de Damoclès. Enfin, le montant de la dette publique (rapportée au PIB) est perçu par l’immense majorité des citoyens comme une contrainte économique majeure. Même s’il s’agit d’une croyance plus que d’une vérité, elle doit être prise en considération dans le choix des options.
En face de la dette publique, il y a un patrimoine
Le discours dominant sur la dette publique est souvent marqué par des comparaisons avec la dette d’un ménage ou d’une entreprise. « L’État vit au-dessus de ses moyens », « il faut bien rembourser ses dettes » ; le budget de l’État doit être géré « en bon père de famille »… autant de maximes récurrentes qui font passer l’État pour ce qu’il n’est pas, à savoir un agent microéconomique (voir l’Essentiel 2 « L’État n’est pas comparable à un ménage ou à une entreprise »).
Si cette comparaison est développée quand elle est à charge, elle s’arrête par contre quand elle pourrait être à l’avantage des États. Une donnée essentielle est, en effet, passée sous silence : en face d’une dette, il y a un patrimoine. Envisagerait-on d’analyser la situation financière d’un ménage ou d’une entreprise en ne regardant que leurs dettes et en oubliant ce qu’ils possèdent ? C’est pourtant bien ce qui est fait pour les États (et plus généralement les administrations publiques).
C’est évident dans les discours politiques : jamais les acteurs qui invoquent le spectre de la dette publique ne mettent en face le patrimoine public. C’est également ce qu’on constate en parcourant les sites des producteurs de statistiques : les données sur la dette et le déficit publics sont immédiatement accessibles 18, alors qu’il faut chercher longtemps avant de trouver celles sur le patrimoine public.
Le patrimoine public français est supérieur à la dette publique
Pourtant, tout comme les entreprises ou les ménages, les administrations publiques ont, face à leur dette (leur passif), un patrimoine monétarisé. Celui-ci est constitué :
- d’actifs financiers (actions et parts de fonds d’investissement, titres de créances, crédits, numéraires et dépôts);
- d’actifs non financiers : des bâtiments, des terrains, des immeubles et équipements résultats des investissements passés.
L’Insee évalue ainsi, en 2019, le patrimoine des administrations publiques françaises à 3 626 milliards d’euros, dont 2 234 milliards d’actifs non financiers.
En face, la dette brute 19 s’élève à 3 312 milliards d’euros, soit un patrimoine net positif de 314 milliards d’euros.
Selon les institutions statistiques, les éléments retenus dans le périmètre de la dette ne seront pas les mêmes ou ne seront pas comptabilisés de la même façon. C’est pourquoi, il faut être prudent dans les comparaisons historiques ou entre pays : le calcul de la dette publique (voir notre fiche) peut évoluer dans le temps et dans l’espace.
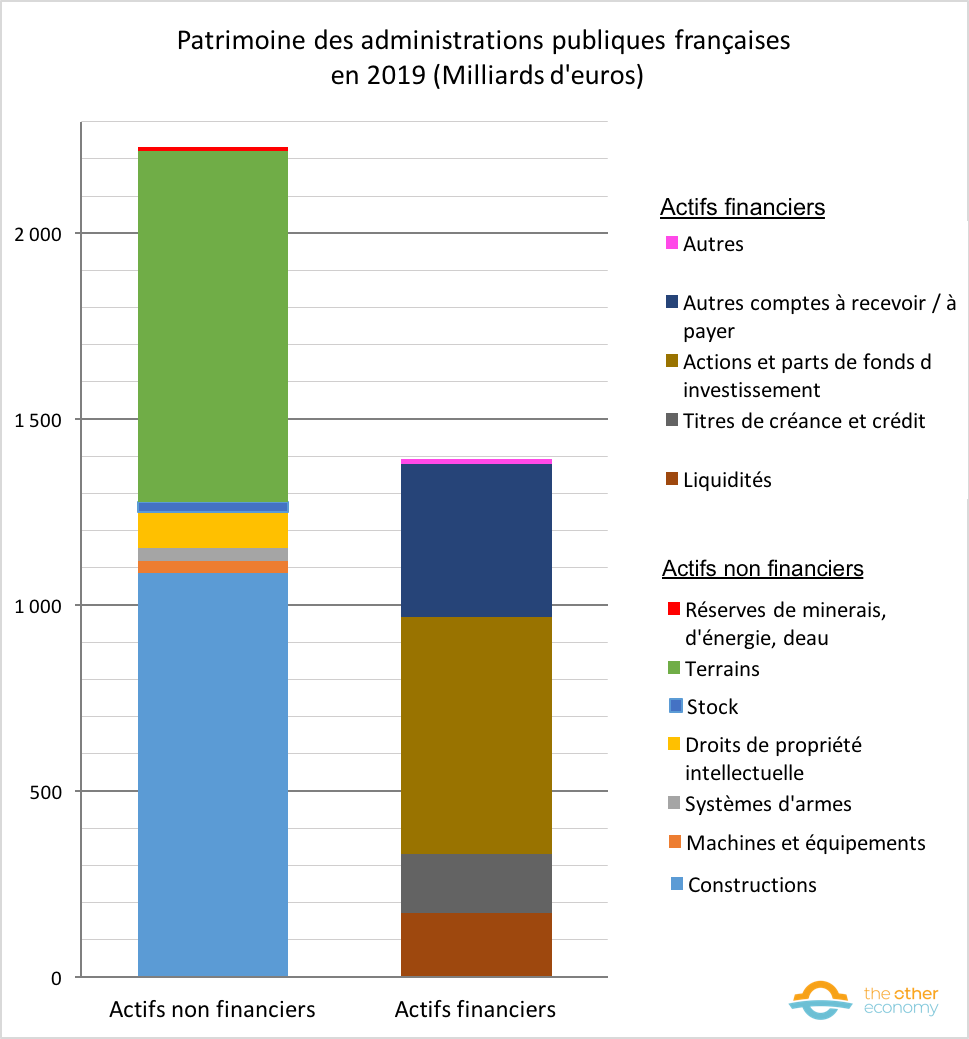
Source Insee – Comptes de la Nation 2020 – Série 8.204 Compte de patrimoine des administrations publiques
Par ailleurs, cette évaluation du patrimoine public sous-estime considérablement l’actif détenu ou contrôlé de fait par les administrations publiques.
- Elle exclut les espaces naturels non bâtis ou non exploités, les monuments historiques 20 et les œuvres d’art qui sont comptés conventionnellement à 0. Ces éléments sont difficiles à estimer et parfois d’une valeur inestimable. Comment donner un prix à la montagne Sainte-Victoire ou à la pointe du Raz ? Ils n’en existent pas moins et représentent une véritable richesse (même non monétarisée) et, d’un point de vue strictement financier, sont source de revenus (ne serait-ce que touristiques) pour le pays et l’État (via la fiscalité au moins). Voir notre fiche Faut-il donner un prix à la nature ?
- Elle exclut la valeur immatérielle de la qualité des infrastructures, des soins, de l’éducation … autant d’éléments qui font la qualité de vie d’un pays et pour lesquels les citoyens sont prêts à payer des impôts…et les entreprises à s’y installer.
Le manque de données met en danger le patrimoine public :
>Cela contribue au discours général de dramatisation de la dette publique. Face au débat sur la manière de réduire la dette, il serait intéressant d’avoir un débat sur la manière d’augmenter le patrimoine public.
>Les données sur le patrimoine public non financier sont extrêmement lacunaires pour la majeure partie des pays, voire totalement inexistantes.
C’est ce qu’on peut constater en parcourant les bases de données d’Eurostat ou de l’OCDE. Par ailleurs, les méthodologies utilisées même dans le cas de la France, un des pays qui renseigne le mieux ces éléments, sont contestables et n’ont pas évolué depuis des décennies 21. Cela nourrit un cercle vicieux : comment débattre du patrimoine, de sa conservation, de son augmentation si on ne sait pas l’évaluer ?
>Enfin, le débat sur le patrimoine public étant de second ordre par rapport à celui sur la dette, il peut être tentant de liquider ce patrimoine public pour rembourser la dette.
Les privatisations d’entreprises publiques relèvent de cette logique, alors même que ces entreprises sont particulièrement rentables (comme dans le cas des aéroports français ou de la Française de Jeux) et fournissent donc des revenus réguliers à l’État. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art ou de patrimoine architectural. C’est par exemple ce qui s’est passé en Grèce qui, pour faire face aux exigences de ses créanciers, a mis en vente 22 des plages, des îles, des aéroports…
Pour en savoir plus
Statistiques sur le patrimoine des administrations publiques.
- France : Les comptes de la Nation – Comptes de patrimoine (série 8.204 pour les données longues sur le patrimoine des administrations publiques)
- OCDE – Tableau 9B. Comptes de patrimoine des actifs non financiers (secteur : administrations publiques)
- OCDE – Tableau 720. Comptes de patrimoine financier – non consolidés – SNA 2008
- Eurostat – Compte de patrimoine non financier (tableau NAMA_10_NFA_BS)
- Eurostat – Comptes de patrimoine financier (tableau NASA_10_F_BS)
La dette et le déficit des uns sont l’épargne et l’excédent des autres
Nous développons ici l’argumentaire sur le solde financier (donc les déficits et excédents) mais il est tout aussi valable sur le plan de la dette et de l’épargne. En fait, il s’agit d’une simple évidence arithmétique.
Chacun des différents secteurs institutionnels (voir encadré) entretient des flux financiers avec les autres 23. Par exemple, les ménages reçoivent des salaires des entreprises et les payent pour acheter des biens et des services. Ils reçoivent des transferts de l’État (aides sociales, retraites, remboursements santé) et paient des impôts et des cotisations sociales.
Les différents secteurs institutionnels
Les comptables nationaux subdivisent l’économie nationale en plusieurs grands secteurs institutionnels :
– les administrations publiques (l’État, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociales),
– les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages,
– les sociétés non financières,
– les sociétés financières.
Les secteurs institutionnels nationaux échangent également avec « le reste du monde » c’est-à-dire l’ensemble des agents économiques (ménages, APU, entreprises etc.) des autres pays et les organisations internationales.
La comptabilité nationale permet de retracer ces flux et de déterminer les soldes financiers de chaque secteur institutionnel, c’est-à-dire les besoins de financement (déficits) qu’il faudra couvrir par de la dette, ou les capacités de financement (excédents) qui alimenteront l’épargne.
Les dépenses d’un secteur constituant les revenus des autres secteurs, les soldes financiers ne sont pas indépendants : leur somme conduit à un résultat nul.
Illustrons ce propos en schématisant les relations entre trois secteurs : les administrations publiques (APU), le privé (ménages et entreprises), et le reste du monde.
Chaque secteur est symbolisé par une lettre P = Privé, A = APU (administrations publiques), R = Reste du monde. Les flux sont symbolisés par la lettre F.
Par exemple, un flux du secteur Privé vers le secteur APU est noté FPA.
On a par définition :
Solde Privé = FAP + FRP – FPA – FPR
Solde APU = FPA + FRE – FAP – FER
Solde Reste du monde = FPR + FAR – FRP – FRA
On vérifie alors aisément que solde Privé + solde APU + solde Reste du monde = 0.
Autrement dit, pour qu’un des secteurs dégage un excédent, il faut qu’au moins un des autres secteurs soit en déficit.
Voici un exemple chiffré, relatif à l’économie française dans son ensemble.
Solde des secteurs institutionnels de l’économie française (2019)
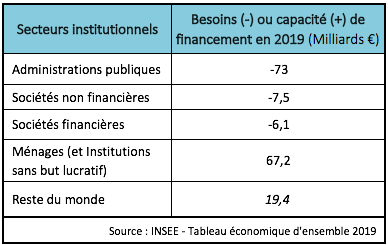
Source INSEE – Tableau Economique d’Ensemble (TEE) 2019
On peut ainsi constater que les déficits des administrations publiques et des entreprises (financières et non financières) sont la contrepartie de l’excédent des ménages et du reste du monde. On peut également constater que l’économie nationale française prise dans son ensemble est en déficit vis-à-vis du reste du monde.
Il est donc irrationnel de plaider pour que chaque secteur ait des excédents, qui seraient des preuves de bonne gestion, puisque c’est impossible !
Plaider pour que les administrations publiques de tous les pays dégagent des excédents, c’est plaider pour que les acteurs privés soient en déficit !
C’est ce qu’on peut constater sur le graphique suivant : dans ces quatre pays, les APU sont excédentaires mais au prix de soldes déficitaires pour les ménages (le cas de la Grèce est à cet égard emblématique) et/ou pour les entreprises (Autriche, Portugal).

Source Données sur les soldes financiers des secteurs d’Eurostat
L’alternative, c’est que l’économie nationale soit très excédentaire (donc que le reste du monde soit en déficit). En effet, l’évidence arithmétique mise en avant précédemment est bien sûr également vraie entre pays : les déficits de certaines économies nationales correspondent aux excédents d’autres pays.
Le cas de l’Allemagne est particulièrement frappant. Les excédents de ses différents secteurs institutionnels ne sont possibles que parce que ce pays est largement excédentaire vis-à-vis du reste du monde. Il est bien évidemment impossible de vouloir généraliser cela à l’ensemble des pays du monde.
Cette soi-disant bonne gestion est en fait prédatrice : le pays ou l’agent excédentaire détient une créance sur son débiteur et peut vouloir exercer un pouvoir à son égard et bénéficier (voire abuser) de sa position de créancier…
La focalisation sur la dette publique détourne l’attention de la dette privée, plus préoccupante sur le plan économique
Si les débats se focalisent sur la dette publique, la dette privée (celle des ménages et des entreprises non financières) occupe beaucoup moins l’espace médiatique alors qu’elle est non seulement bien plus importante mais aussi plus préoccupante par son impact au plan macroéconomique.
Le niveau de la dette privée est bien supérieur à celui de la dette publique
Les graphiques suivants permettent de constater à quel point le niveau de la dette (publique et privée) s’est inexorablement élevé depuis les années 1970. Au niveau mondial, elle est passée de 114% à 227% du PIB en 2018.
Dette mondiale de 1970 à 2018 (en % du PIB)
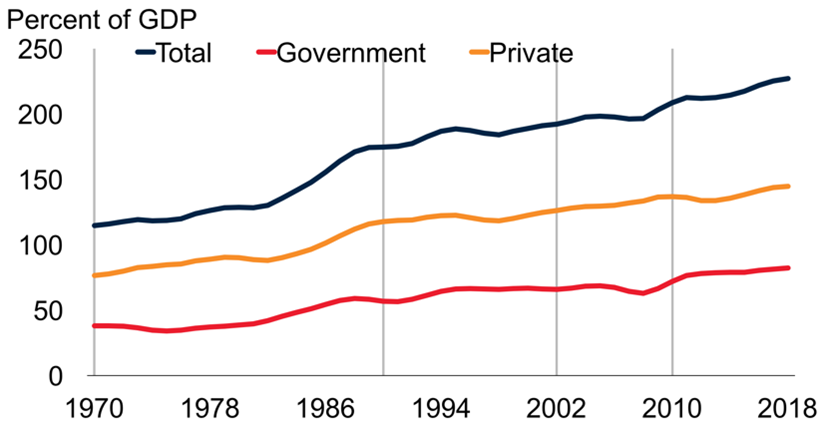
Source M. A. Kose, P. Nagle, F. Ohnsorge, N. Sugawara, Global Waves of Debt: Causes and Consequences, Banque Mondiale, 2020
Cette tendance est encore plus forte dans les pays dits avancés 24 : la dette totale atteint 267% du PIB en 2018 contre 125% en 1970.
Dette des économies avancées de 1970 à 2018 (en % du PIB)
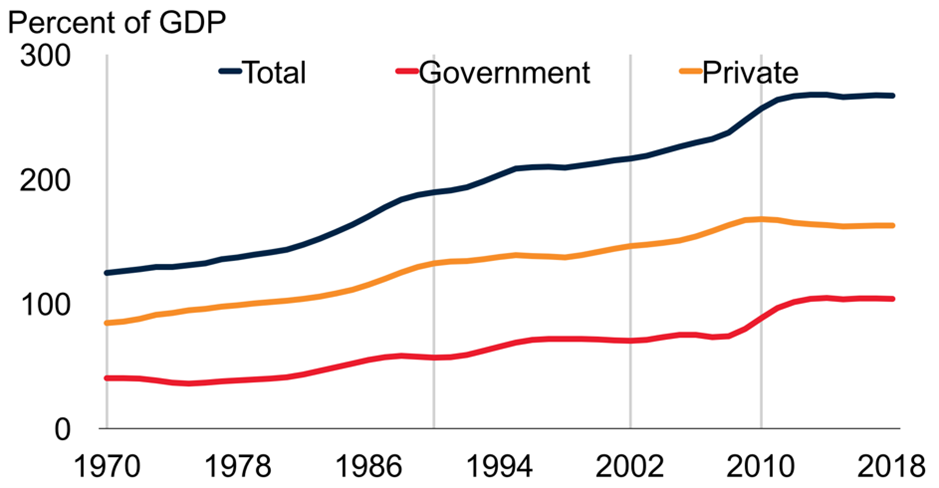
Source M. A. Kose, P. Nagle, F. Ohnsorge, N. Sugawara, Global Waves of Debt: Causes and Consequences, Banque Mondiale, 2020
Dans les années qui précèdent la crise financière de 2007-2008, que ce soit au niveau global ou dans les économies avancées, le niveau de la dette privée est plus du double de celui de la dette publique. L’écart s’est réduit depuis, notamment parce que les États ont assumé une large part des conséquences de la crise que ce soit en soutenant le secteur financier ou en supportant les dégâts sociaux de la crise (hausse du chômage, des prestations sociales, baisse des recettes publiques).
La spirale dette privée, dette publique : les exemples espagnol et irlandais
En 2007, l’État irlandais et l’État espagnol affichaient des excédents budgétaires et une dette publique très faible (respectivement 24% et 36% du PIB). Leur crédit international se situait alors au zénith. Trois ans plus tard, l’explosion de la bulle immobilière espagnole et la violente récession consécutive d’un côté, le sauvetage des banques irlandaises par l’État de l’autre, ont détruit leurs équilibres budgétaires. En 2010, Dublin avoue un déficit public supérieur à 32% du PIB, Madrid reconnaît un déficit de 9,5% du PIB. Les dettes publiques irlandaise et espagnole explosent (60% du PIB pour l’Irlande et 80% pour l’Espagne en 2010).
Source Eurostat – tableaux sur la dette publique en % du PIB et sur le solde public en % du PIB
La dette privée a été au cœur des deux plus grandes crises financières de l’histoire
Cette importance de la dette privée est très préoccupante car la cause fondamentale tant de la crise de 1929 que de la crise de 2007-2008 a été l’explosion d’une bulle spéculative financée par la dette.
En effet, accroissement de la dette et bulle spéculative vont de pair. L’une des raisons essentielles tient au fait que les crédits sont accordés avec des « collatéraux » en garantie qui sont des actifs spéculatifs (biens immobiliers ou titres financiers). L’offre et la demande de crédit augmentent tous deux en fonction de l’anticipation de la hausse des prix de ces actifs. Dans ce mécanisme, il n’y a pas de force de rappel. Les prêteurs se sentent (à tort sur la durée) protégés par la hausse de la valeur financière de la garantie (actif spéculatif). Les emprunteurs accroissent leur demande de prêt à mesure que les bulles spéculatives se développent afin de réaliser des plus-values (ils s’endettent pour acheter des actifs qu’ils pensent pouvoir revendre plus cher ensuite).
Une fois les bulles spéculatives éclatées, l’endettement excessif des agents économiques empêche toute sortie de crise. Les agents trop endettés privilégient le remboursement de leur dette et sous-investissent. Ce comportement pro-cyclique aggrave la dépression.
Ces différents mécanismes ont bien été mis en évidence par les économistes Irving Fisher et Hyman Minsky puis Steve Keen 25 . Ils sont à l’origine de la longue stagnation japonaise après la crise financière de 1991.
Dettes publiques et privées n’ont cessé d’augmenter
En se focalisant sur la seule dette publique, le débat en Europe tend à présenter les pays du Nord de l’Europe comme des pays « frugaux », ayant une saine gestion budgétaire, et les pays du Sud comme des « cigales », dispendieux et irresponsables.
Quand on regarde les chiffres de la dette globale, on peut constater à quel point cette interprétation est biaisée.
Dette publique et privée en % du PIB dans différents pays en 2019
Source Source : Global Debt Database (FMI).
Comme on peut le constater, quel que soit le pays considéré, son niveau d’endettement est très élevé. Par ailleurs, des pays affichant des niveaux de dette publique faibles comme les Pays-Bas, la Norvège, la Suède le Luxembourg ou le Danemark ont en revanche des niveaux d’endettement privé très importants. L’Allemagne et l’Autriche parviennent à limiter l’endettement de leur économie (autour de 200% du PIB tout de même). Une des raisons peut résider dans le fait que l’Allemagne et l’Autriche ont une balance des transactions courantes 26 excédentaire depuis près de deux décennies. A noter que ce n’est pas une condition suffisante, puisque c’est également le cas du Danemark, de la Suède ou des Pays-Bas. Par ailleurs, il est bien évidemment impossible pour tous les pays en même temps d’avoir une balance courante excédentaire.
Réfléchir en même temps à la dette privée et publique permet ainsi de comprendre à quel point la dette est au cœur du système économique. Il n’est alors plus question de morale, de pays « cigales » ou « fourmis ». Le niveau d’endettement généralisé des économies traduit non pas une mauvaise gestion budgétaire des agents mais bien un simple état de fait. Or, la dette est le résultat de la façon dont s’organisent les échanges, dont est financé l’investissement, dont est répartie la valeur ajoutée, dont se crée la monnaie (voir module sur la monnaie).
Ne plus se focaliser sur la seule dette publique permet ainsi de se poser de nouvelles questions. Par exemple, est-il possible de concevoir un système monétaire et financier qui ne repose pas autant sur la dette (voir l’Essentiel 5 : « L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire ») ?
Les règles budgétaires européennes n’ont pas de rationalité économique
Au cœur de la gouvernance économique européenne se trouvent deux indicateurs phares garants de la discipline budgétaire des États membres de l’Union européenne : le déficit public doit être inférieur à 3% du PIB et la dette publique à 60% du PIB.
Le choix d’inscrire ces critères au cœur même des traités 27, donc tout en haut de la hiérarchie des normes de l’Union européenne, interroge. Cela revient, en effet, à restreindre considérablement les marges de manœuvre des États en mettant au cœur des politiques économiques (et plus généralement des politiques publiques) la maîtrise de la dette et des dépenses publiques. Comment réagir à une crise financière, à une récession ? Comment investir dans les transformations que nécessite la transition écologique ?
Ces règles figées dans le marbre des traités n’ont pas la souplesse nécessaire pour répondre en tout temps et en tout lieu aux défis auxquels les gouvernants doivent faire face. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles ont été suspendues en 2020, via l’activation de la « clause dérogatoire générale », afin de permettre aux États de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.
Ces règles font aujourd’hui l’objet de multiples critiques et de nombreux acteurs appellent à réformer la gouvernance économique européenne (plus de détails dans notre rubrique Propositions). Nous développons ci-dessous certaines des principales objections à ces règles, sans être exhaustifs.
La gouvernance économique européenne
Mise en place progressivement à partir du traité de Maastricht (1992), la gouvernance économique européenne s’inscrit depuis 2011 dans le cadre d’un cycle annuel de coordination appelé « Semestre européen ».
Elle consiste en un ensemble de règles et de procédures visant à faire respecter une discipline budgétaire par les États membres, à faciliter la coordination de leurs politiques économiques et à prévenir les déséquilibres macroéconomiques. Si une telle coordination est nécessaire dans une Union économique et monétaire (pour la zone euro) d’États fortement interdépendants, la gouvernance européenne pêche à la fois par son extrême complexité et par la place prépondérante accordée à la surveillance budgétaire.
Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), pièce maitresse de cette gouvernance, traite en effet quasiment exclusivement de la façon de respecter les critères contraignants de déficit et de dette publics. Il vise en particulier à faire respecter ces deux règles budgétaires : le déficit doit être inférieur à 3% du PIB, et la dette publique à 60% du PIB. A la suite de la crise financière de 2008, une procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques a été mise en place mais elle n’a clairement pas le même poids politique.
Cette focalisation sur les niveaux de dépenses, de déficit et de dette publics maintient la qualité de vie et la durabilité environnementale à l’écart des politiques économique et financière.
La Commission a engagé début 2020 un processus de réforme de la gouvernance économique, et en son centre, du cadre budgétaire européen.
En savoir plus avec notre fiche sur la gouvernance économique européenne .
Aucune rationalité économique n’a présidé à l’élaboration des règles concernant la dette et le déficit
Le haut fonctionnaire français Guy Abeille a raconté l’histoire de la mise au point du critère de déficit de 3% du PIB 28. Il a été élaboré un soir de juin 1981 sur un coin de table pour répondre à des objectifs conjoncturels et politiques du Président François Mitterrand.
On aura compris que fixer le projecteur sur le déficit d’une année donnée n’a guère de sens; et que le rapporter au PIB de cette même année lui en fait perdre un peu plus. Le ratio déficit sur PIB peut au mieux servir d’indication, de jauge: il situe un ordre de grandeur […]. Mais en aucun cas il n’a titre à servir de boussole; il ne mesure rien: il n’est pas un critère.
Cet indicateur s’est ensuite généralisé au reste de l’Union européenne à la suite des négociations du traité de Maastricht (1992).
Quant à la limite des 60% de dette publique, elle n’a pas plus de justification : elle ne représente qu’une moyenne du niveau de la dette publique des 12 pays qui composaient alors l’Union européenne. Un calcul de cohérence entre les deux indicateurs a été fait à posteriori : si le taux de croissance du PIB est de 5% (3% en volume, 2% en inflation), le déficit (après paiement des intérêts, donc peu importe le niveau des taux d’intérêt) de 3% du PIB et si la dette publique est de 60% du PIB, alors ce niveau de 60% reste constant. On peut remarquer que les hypothèses de taux de croissance étaient « héroïques » et que le niveau de 60 % n’était pas respecté par plusieurs pays au moment de leur adhésion. Ce calcul ne peut faire illusion face à la complexité et la variété des économies européennes. Ajoutons que le ratio lui-même n’est en aucune façon suffisant pour déterminer le niveau de soutenabilité de la dette (Idée reçue 2).
En réalité, les règles de dette et de déficit ont été conçues lors des négociations du traité de Maastricht pour pallier l’inquiétude de certains États quant aux conséquences de la création de l’Union économique et monétaire (la zone euro). Celle-ci se caractérise en effet par la mise en place d’une politique monétaire commune, menée par une banque centrale indépendante focalisée sur la stabilité des prix et ayant interdiction de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort des États . Dans le même temps, il n’existe pas de politique budgétaire et de capacité fiscale commune. Les États finançant leurs déficits sur les marchés financiers, certains gouvernements ont craint le risque de contagion : une mauvaise gestion de la dette publique par certains États pourrait se manifester non seulement par la hausse des taux d’intérêt sur leur propre dette mais aussi sur celles des autres pays de la zone euro. Les règles et le principe de la surveillance budgétaire inscrits au cœur des traités relèvent donc d’une volonté d’encadrer la tendance (supposée structurelle – voir Encadré sur La théorie des choix publics dans l’Essentiel 1) des gouvernements à faire des déficits.
Les critiques récurrentes : procyclité, asymétrie, désinvestissement public
Des règles procycliques
Une fois dépassés les seuils de 3% ou de 60% du PIB, les gouvernements sont tenus de réduire leur déficit (le plus souvent en réduisant les dépenses publiques), voire de dégager des excédents, indépendamment de toute autre considération et notamment du cycle économique (c’est-à-dire de l’existence d’une croissance soutenue ou d’un ralentissement économique, voire d’une récession).
Cette obligation s’est traduite par un biais procyclique des règles budgétaires européennes, en particulier en période de difficultés économiques puisque leur strict respect interdit d’utiliser l’outil budgétaire en cas de récession 29. C’est la volonté de respecter ces règles qui a conduit à l’arrêt brutal des politiques de relance post crise financière au début des années 2010.
La mise en place de notre cadre budgétaire a transformé le choc financier mondial de 2008 en crise économique durable et a plongé, plus longtemps que nécessaire, l’Europe dans la récession. Elle a entraîné des années de sous-investissement public et privé, entravant la réalisation de nos objectifs environnementaux tout en provoquant une recrudescence des inégalités au sein et entre les pays de l’Union.
Des règles asymétriques avec un biais déflationniste
Dans son rapport de 2019, le Comité budgétaire européen souligne le déséquilibre existant entre les droits et obligations des pays de la zone euro. Tandis que les pays à niveau d’endettement jugé élevé sont tenus de mener des politiques restrictives, ceux dont l’endettement est faible, qui disposent de marges budgétaires et d’un excédent commercial importants, ne sont pas tenus de mener des politiques expansives. Il en résulte un biais déflationniste.
Ce point a été soulevé par de nombreux observateurs et notamment par le commissaire aux affaires économiques et financières Paolo Gentiloni qui, lors d’une conférence à la Banque centrale européenne, a souligné à quel point ce déséquilibre est dommageable dans un environnement de faible croissance et de faible inflation alors que l’efficacité de la politique monétaire s’épuise.
Pour le Comité budgétaire européen, cette asymétrie associée à l’indifférenciation des règles selon les pays rend inopérant le concept d’orientation budgétaire agrégée de la zone euro, qui est pourtant pertinent dans une Union économique et monétaire.
Les règles comptables européennes sont néfastes à l’investissement public
La focalisation excessive sur les limites numériques incite à une réduction indifférenciée des dépenses publiques sans tenir compte de leur qualité. Elle s’est manifestée en particulier par une baisse de l’investissement public partout en Europe, car il est souvent politiquement plus facile de s’abstenir d’investir que de réduire les dépenses régulières, comme les salaires des fonctionnaires et les prestations sociales (ce qui n’a pas empêché des coupes dans ces domaines).
C’est d’autant plus vrai que le calcul du déficit public, tel qu’établi par le Système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010) 30, s’apparente au besoin de trésorerie et, contrairement aux comptes des entreprises, ne prend pas en compte l’amortissement des investissements.
Philippe Maystadt, ancien Président de la Banque européenne d’investissement, commente ainsi la non distinction entre dépenses de fonctionnement et d’investissement :
Les conséquences sur l’investissement public de l’application stricte des normes comptables européennes SEC 2010 sont énormes. En effet, il est désormais obligatoire que les dépenses d’investissement soient imputées directement et en totalité sur le déficit de l’année durant laquelle ces dépenses sont réalisées. Il n’est plus possible de considérer que ces dépenses d’investissement puissent s’amortir sur plusieurs années. Si l’on doit imputer sur une seule année le coût d’investissements amortis en moyenne sur 6 années, il est à craindre qu’à déficit constant, les investissements publics ne diminuent par un facteur 6. Bel exemple de schizophrénie européenne.
Rappelons que la comptabilité d’entreprise vise à mettre en évidence un résultat économique (bénéfice ou déficit) permettant de rendre compte de la variation des capitaux propres de l’entreprise, et non pas uniquement de son besoin de financement annuel (qui est bien sûr également calculé). Elle prend en compte pour une année donnée non pas le montant des investissements de l’année mais leur amortissement sur une période économique ou conventionnelle. Un chef d’entreprise regardera avec attention ses actifs 32 et leur valeur présente et future. Il investira non pas uniquement en fonction de sa situation de trésorerie mais des perspectives permises par cet investissement, donc de l’évolution de son actif net (dit autrement, de ses capitaux propres) et de sa capacité à « boucler » son besoin de financement (soit par autofinancement, soit par endettement, soit par augmentation de capital).
A l’opposé, le déficit public au sens du Système européen des comptes est un solde caractérisant uniquement le besoin de financement (proche donc d’un solde de trésorerie). L’orientation donnée est manifestement liée à la gestion de l’endettement public plutôt qu’à un raisonnement patrimonial. La manière actuelle de comptabiliser les dépenses publiques présente donc un biais préoccupant, qui conduit le décideur public à sous-investir car il est plus difficile à court terme de réduire les dépenses de fonctionnement (notamment les frais de personnel) que les dépenses d’investissement. Calculé ainsi (et vu son importance dans les traités européens), le déficit public focalise l’attention du décideur public sur la situation de ses engagements financiers à court terme et pas du tout sur le « patrimoine public » et sur ses actifs (financiers et non financiers – voir l’Essentiel 6 : « En face de la dette publique il y a un patrimoine »)
FBCF des administrations publiques (en pourcentage du PIB) 2000-2019
La baisse de l’investissement public est déjà visible quand on considère les investissements brut, qui ont baissé en % du PIB.
L’indicateur traditionnellement utilisé est la formation brute de capital fixe (FBCF), agrégat de la comptabilité nationale qui peut être défini comme une mesure de l’investissement des différents acteurs publics et privés de la société (plus de détails sur le site de l’Insee).
Source Base de données Ameco de la Commission européenne (série 3.2 – General government).
Elle l’est encore bien plus pour l’investissement public net 33 qui est proche de 0, voire négatif en Europe depuis plusieurs années. Cela signifie que les pays de la zone euro investissent à peine assez pour entretenir et renouveler les infrastructures publiques (transports, bâtiments publics tels les hôpitaux, les casernes, les écoles, les stations de traitement de l’eau ou des déchets etc.). C’est ce genre de trajectoire qui mène à des catastrophes telles que le déraillement du train Corail Intercités à Brétigny-sur-Orge en juillet 2013 ou l’effondrement du pont de Gênes à l’été 2018.
Investissement public net 2000-2019 pour plusieurs pays de la zone euro (Mds €)
Source Base de donnée Ameco (Série 3.- General Government)
La gouvernance économique européenne est aveugle aux enjeux écologiques et sociaux
Plus généralement, les règles de Maastricht ont induit un biais fondamental de la gouvernance économique européenne qui, malgré des évolutions importantes, reste dominée par la priorité de la discipline budgétaire.
Par exemple, les indicateurs d’emploi et les indicateurs environnementaux ont été inclus (respectivement en 2015 et 2020) dans le Semestre européen, cycle annuel de coordination des politiques économiques, mais ils le sont principalement à titre indicatif. C’est sur les objectifs de gestion budgétaire à court terme que sont centrées la majorité des procédures contraignantes analysées lors du Semestre. Les objectifs environnementaux et sociaux de long terme sont traités dans d’autres processus de coordination, indépendamment de la coordination économique.
Il est pourtant évident que les politiques économiques ont une grande influence sur l’état de l’environnement de l’UE et l’atteinte de ses objectifs en matière de climat ou de biodiversité. Inversement, la déstabilisation du climat et de l’environnement a déjà des répercussions économiques et financières ainsi que sur les finances publiques (via par exemple les mesures de soutien public prises à la suite d’épisodes climatiques extrêmes telles que tempêtes, inondations, vagues de chaleur etc.).
Cette boucle de rétroaction entre politiques publiques et environnement devrait être placée au cœur de la gouvernance économique européenne. Or, non seulement les règles budgétaires de l’UE ne tiennent pas compte de ces enjeux mais pire, elles y contribuent négativement en limitant les dépenses et les investissements publics, sans tenir compte de leur impact sur les objectifs environnementaux ou sociaux de l’Union (comme on l’a vu dans la partie 9.2 ci-avant).
Pour en savoir plus
Les critiques et appels à une réforme du cadre budgétaire européen émanent autant d’institutions publiques qu’économiques ou de la société civile.
- Assessment of EU fiscal rules, rapport du Comité budgétaire européen commandé par la Commission (2019)
- Annual Report 2020 du Comité budgétaire européen
- Redesigning EU fiscal rules: From rules to standards Olivier Blanchard et ali, Working Paper PIIE (2021)
- Europe should not return to pre-pandemic fiscal rules, Joseph Stiglitz, Financial Times (2021)
- Lettre ouverte aux dirigeants européens, de 68 ONG et syndicats européens soutenus par une centaine d’universitaires (2021)
- Appel : Un pacte de résilience et de solidarité pour remplacer le pacte de stabilité et de croissance (2021)
- Interview de Klaus Regling (l’un des pères du PSC) directeur du Mécanisme européen de stabilité (2021)
Les propositions de réforme du cadre budgétaire européen
- The reform of the EU fiscal framework, position du Climate Action Netwaork (CAN europe) 2021
- Analyse de la faisabilité et des impacts des propositions de réforme des règles budgétaires européennes, ZOE Institute (2021)
- One Framework to rule them all, Ludovic Suttor-Sorel, Finance Watch (2021)
- Quel cadre budgétaire européen pour faire la transition écologique?, Ollivier Bodin, contribution au Think Tank de la FNH (2021)
Le déficit public est un outil de lutte contre une crise économique
La réponse des gouvernements à la crise financière de 2007-2008, et encore plus à la pandémie de COVID-19, ont montré à quel point la mobilisation des budgets publics était fondamentale pour faire face à une crise économique. Plusieurs mécanismes sont à l’œuvre.
La nécessité de mener une politique contra-cyclique
On définit une politique contra-cyclique comme une politique qui va dans le sens inverse du cycle économique. Dans le cas d’une récession, cela signifie que loin de se serrer la ceinture comme la majorité des agents économiques, la puissance publique augmente ses dépenses et/ou baisse ses recettes (les impôts).
L’exemple de la réponse à la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19
Il est évident que la mobilisation des budgets publics a été fondamentale pour faire face à la crise économique consécutive aux mesures prises en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19. Si les États, soutenus par leurs banques centrales, n’avaient pas dépensé « sans compter » pour soutenir les revenus des ménages et des entreprises immobilisés par les confinements successifs, la crise économique aurait été nettement plus forte que celle que nous avons connu. Face à une économie à l’arrêt, seule la puissance publique était en mesure de soutenir les revenus des acteurs privés et de maintenir ainsi le capital productif de leurs pays respectifs.
Si la situation est inédite, elle n’en permet pas moins de mettre en évidence à quel point l’intervention de l’État est essentielle en période de crise économique. Elle l’est également une fois le gros de la crise passée, à travers une politique de relance, pour renouer avec un niveau d’activité suffisant car la récession est un phénomène qui s’auto-entretient. Schématiquement, cela se déroule ainsi.
Le cercle vicieux de la récession
Confronté à une situation économique difficile, tout agent économique a intérêt à « se serrer la ceinture ». Le réflexe d’un chef d’entreprise constatant (ou anticipant) la baisse de ses commandes (ce qui est pour une entreprise la concrétisation d’une récession), sera de réduire ses charges 34 et, le cas échéant, de vendre une partie de ses actifs afin d’améliorer sa trésorerie et d’alléger sa dette.
Les charges de l’entreprise étant des revenus pour d’autres, leur baisse contribue ainsi à la réduction de la consommation et des investissements d’autres acteurs économiques. Confrontés à la montée du chômage, à la stagnation des salaires et à des pertes de revenus, les ménages vont également « se serrer la ceinture » en réduisant leur consommation et en constituant, quand ils le peuvent, une épargne de précaution pour affronter les jours difficiles. De la même manière, les banquiers vont se montrer plus prudents, réduire leurs prêts ou en augmenter le coût.
Tous ces comportements vont dans le même sens : celui de la baisse de la demande globale. S’il est rationnel pour une entreprise, un ménage ou une banque d’adopter un tel comportement procyclique, quand tous les agents économiques le font, c’est l’économie nationale qui s’effondre, entraînant éventuellement d’autres pays dans la récession. L’agrégation des comportements microéconomiques rationnels face à une récession ne peut ainsi que conduire à la prolonger.
Seule l’intervention des pouvoirs publics permet de sortir de ce cercle vicieux par le biais des stabilisateurs automatiques et des politiques de relance. Notons qu’il ne s’agit pas ici de faire l’apologie d’une relance par la consommation (dont l’excès est insoutenable sur le plan écologique), mais de montrer le rôle des dépenses publiques pour éviter une décroissance subie et nécessairement injuste socialement.
Le rôle des stabilisateurs automatiques pour atténuer la récession
Les finances publiques jouent un rôle d’atténuation du cycle économique, sans même que les autorités aient besoin de décider de mettre en œuvre des mesures spécifiques, par le biais des stabilisateurs automatiques. Le principe en est simple : en période de récession, les impôts prélevés diminuent automatiquement (notamment la TVA sur la consommation) alors que les prestations sociales existantes, que ce soient les allocations chômage ou les minimas sociaux, permettent de limiter les pertes de revenus liées aux pertes d’emploi. La mobilisation automatique des finances publiques contribue ainsi à atténuer les conséquences d’événements conjoncturels sur l’activité et à soutenir la demande globale. L’impact de ces stabilisateurs automatiques varie évidemment selon la fiscalité et les systèmes de protection sociale en place dans les pays concernés.
Les politiques de relance et l’effet multiplicateur des dépenses publiques
S’ils permettent d’atténuer les chocs, les stabilisateurs automatiques sont le plus souvent insuffisants pour sortir d’une récession. Il est alors nécessaire de mener une politique de relance : la demande publique doit se substituer à la demande privée pour éviter que l’économie ne s’englue dans une situation récessive. Cette politique aura un effet d’autant plus fort que le multiplicateur budgétaire est important.
Qu’est-ce que le multiplicateur budgétaire (aussi appelé multiplicateur keynesien ou multiplicateur d’investissement) ?
Le multiplicateur budgétaire désigne le rapport entre la variation du revenu national (le PIB) et la variation des dépenses publiques. S’il est supérieur à 1, cela signifie que tout euro de dépense publique supplémentaire génère plus de 1 euro d’activité économique globale supplémentaire.
Le mécanisme est relativement intuitif. Imaginons que l’État investisse 10 milliards dans la rénovation énergétique des bâtiments. Cette dépense publique constitue des revenus pour les entreprises de rénovation qui vont les utiliser pour payer leurs salariés et leurs fournisseurs. Ceux-ci dépenseront à leur tour ces revenus supplémentaires (en biens de consommation par exemple), créant ainsi une nouvelle demande pour d’autres entreprises. Et ainsi de suite, par vagues successives.
Ce mécanisme n’est cependant pas infini car plusieurs effets limitent à chaque vague le montant du revenu distribué : i/ une partie des revenus peut être dépensée à l’étranger (importations) créant donc une hausse de l’activité mais en dehors du pays ii/ une partie des revenus peut être épargnée et donc bloquer la circulation de l’argent, tant qu’il n’est pas réinvesti.
Pour en savoir plus voir notre fiche sur le multiplicateur de dépenses publiques .
Ces dernières années, de nombreuses études, notamment celles qui ont suivi la crise de 2007-2008, ont montré qu’en période de récession le multiplicateur budgétaire est largement supérieur à 1 35.
Cependant, il dépend du type de relance menée. Par exemple, une hausse des commandes publiques à destination d’entreprises nationales aura plus d’impact qu’une baisse d’impôt qui risque de se transformer en partie en épargne (notamment chez les ménages aisés). Une hausse des dépenses (ou une baisse de la fiscalité) ciblant les ménages les plus démunis aura également des effets importants car ceux-ci épargnent très peu, voire pas du tout.
L’effet multiplicateur dépend également du degré d’ouverture des économies : la hausse des dépenses publiques peut aboutir à augmenter la consommation de biens importés 36, limitant ainsi l’effet multiplicateur (ou plutôt en faisant bénéficier les pays exportateurs).
Dans le cas de pays fortement intégrés commercialement (par exemple dans l’Union européenne), une politique publique de relance (via la dépense publique) peut ainsi être vouée à l’échec si elle se déroule dans un seul pays. C’est une des raisons de l’échec de la politique de relance menée en France en 1981 : les partenaires européens de la France s’étant engagés dans des politiques d’austérité ont réduit leurs importations alors que les Français augmentaient les leurs.
Il est donc nettement préférable de mener une politique de relance contra-cyclique de façon coordonnée entre pays intégrés commercialement (comme c’est le cas dans l’Union européenne).
L’investissement public pour la transition écologique est prioritaire sur le respect de ratios comptables
Les engagements d’un État ne se limitent pas à ses créanciers
Un des problèmes fondamentaux du discours sur la dette publique c’est qu’il fixe comme première priorité le respect des engagements de l’État envers ses créanciers.
Or, un État de droit a également des devoirs envers ses citoyens, qui se manifestent par exemple par le fait d’assurer leur sécurité, la cohésion sociale ainsi que la préservation du bon état du patrimoine naturel. Il s’agit également de répondre aux besoins fondamentaux de la population et de créer les conditions du bon déroulement des activités économiques et sociales via un système judiciaire qui fonctionne, des infrastructures matérielles (énergie, transport, eau, gestion des déchets), des institutions éducatives et sanitaires de qualité.
La focalisation sur la dette et les déficits publics sert bien souvent de justification pour revenir sur ces engagements. C’est d’autant plus grave lorsque les politiques menées sont irrationnelles au niveau économique.
La soutenabilité de la dette publique dépend en effet de l’activité économique elle-même ainsi que de la qualité des infrastructures et du consensus social. Il est irrationnel de vouloir restreindre le déficit public en période de crise car cela ne conduit qu’à augmenter cette crise alors que le deficit public est au contraire un outil de lutte contre les crises économiques (Essentiel 10). Il est tout aussi irrationnel, au plan strictement économique, de dégrader ce qui, au fond, est la source de la performance économique d’un pays (ses infrastructures, le niveau de formation et la santé de sa population etc.)
Ce problème fondamental est particulièrement bien illustré par la problématique écologique.
La dette publique ne doit pas empêcher la transition écologique
Climat et biodiversité : deux défis majeurs
Limiter le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité sont les deux défis auxquels doivent répondre l’ensemble des États du monde pour préserver l’habitabilité de notre planète pour les milliards d’humains qui la peuplent. Les catastrophes en série auxquelles nous assistons chaque année (inondations, dômes de chaleur, mégafeux, tempêtes) ont bien évidemment des conséquences économiques en plus d’être des désastres humains. Pour ne donner qu’un exemple, un rapport de l’Organisation internationale du travail estime que « la productivité du travail ralentit déjà à des températures supérieures à 24-26 °C. À 33-34 °C, et pour une intensité de travail modérée, la performance du travailleur chute de 50% ».37
Ne pas agir, c’est s’exposer demain à des baisses de production et des dommages irréversibles. Une des voies d’action consiste à investir massivement dans tous les domaines d’activité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation des ressources naturelles tout en accompagnant les transformations sociales que cela implique.
Des investissements publics conséquents
Les investissements à réaliser pour décarboner les économies européenne et française et pour les rendre plus « résilientes » face aux crises à venir, climatiques et pandémiques sont lourds sans être inatteignables : il s’agit de montants de l’ordre de 2 à 3% du PIB avec des écarts entre les pays.
Bien sûr, ce n’est pas au secteur public de réaliser l’ensemble de ces investissements.
Cependant, la mobilisation des budgets publics est fondamentale car les acteurs privés ne financeront pas l’ensemble des investissements à réaliser pour décarboner nos infrastructures, réduire nos besoins en ressources naturelles et reconvertir des secteurs économiques entiers.
- Nombre d’investissements écologiques concernent directement le patrimoine public 38 et nécessitent donc principalement des financements publics.
- Les projets de transition écologique ne sont pas forcément attractifs pour les investisseurs privés car leur rentabilité financière n’est pas à la hauteur de leur utilité sociale. Certains projets sont trop peu voire pas du tout rentables dans les conditions économiques actuelles qui ne valorisent pas correctement les impacts écologiques et sociaux (ex : activités de dépollution des sols, aménagements en vue de constituer les continuités écologiques, restauration de zones humides). D’autres, sont rentables sur le long terme mais les populations concernées n’ont pas les moyens d’investir (rénovation énergétique des logements habités par des ménages précaires).
- Les filières économiques de demain 39 sont en concurrence directe avec les acteurs déjà en place. Elles n’ont pas ou trop peu de porte-parole dans le débat public. Elles ne peuvent s’appuyer sur le nombre d’emplois ou le chiffre d’affaire qu’elles représentent aujourd’hui. Elles sont mises en compétition avec des activités disposant de technologies matures, de compétences répandues, d’investissements amortis, d’infrastructures en place. L’impulsion publique est donc essentielle pour leur permettre de se structurer et de gagner en maturité.
- La transition écologique implique d’investir pour reconstruire, transformer nos infrastructures et nos appareils productifs, mais également d’accompagner le désinvestissement dans les secteurs trop carbonés ou destructeurs de capital naturel. La fermeture des centrales à charbon en est l’exemple emblématique, mais c’est loin d’être le seul. Pour éviter les effondrements industriels et leurs conséquences en terme d’emplois, il est nécessaire d’anticiper et d’accompagner la reconversion des secteurs amenés à se modifier profondément pour que la transition ait bien lieu.
Plus de détail dans la proposition Lancer un plan de reconstruction écologique.
Ces investissements conduiront pour partie à réduire la dépendance énergétique de la France et de l’Europe et la facture correspondante de gaz et de pétrole, ce qui augmente encore leurs effets positifs sur l’économie.
Il est donc totalement irrationnel de focaliser le débat sur les niveaux d’endettement plutôt que sur les investissements nécessaires, et bien plus encore sur le respect de ratios comptables comme c’est le cas dans l’Union européenne (voir l’Essentiel 9, sur les règles budgétaires européennes). C’est préjudiciable à l’intérêt des citoyens, de l’économie et même des créanciers (à quoi leur serviront leurs créances dans un monde à + 4°C) ?
La guerre en Ukraine nous a rappelé, avec honte, qu’il y a bien plus important que la réduction de la dette publique : il y a l’indépendance énergétique, l’investissement dans la sobriété et les renouvelables, ne pas commercer avec n’importe qui, n’importe comment.
L’austérité est économiquement contreproductive et néfaste sur le plan social et écologique
Les politiques d’austérité ont de nombreuses dénominations : « programmes d’ajustement structurel » pour qualifier les politiques imposées par les institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale) aux pays faisant appel à leur soutien financier, « plans de rigueur » pour ceux qui convoquent le discours moralisateur sur la « saine » gestion des finances publiques, « plans de consolidation budgétaire » pour ceux qui privilégient les termes techniques.
Quel que soit leur nom, ces politiques consistent à faire de la réduction de la dette et des déficits publics un axe majeur, et parfois premier, des politiques publiques.
Elles se manifestent par des mesures visant à restreindre ou limiter les dépenses publiques en coupant dans l’investissement public, dans les dépenses sociales, dans la masse salariale des fonctionnaires et/ou par une augmentation des recettes publiques via les impôts (et le plus souvent les impôts non progressifs c’est-à-dire ceux qui, telle la TVA, s’appliquent à tous quel que soit le niveau de revenu) ou les privatisations. Ces politiques peuvent également se doubler d’autres mesures d’inspiration néo-libérales telles que la flexibilisation du marché du travail.
Le plus souvent imposées par les créanciers, ces politiques peuvent également être auto-infligées (voir encadré).
L’austérité des années 2010 dans la zone euro
Dans le sillage de la crise financière de 2007-2008, les dettes publiques ont explosé partout en Europe du fait des mesures prises pour soutenir le secteur financier, du jeu des stabilisateurs automatiques (voir l’Essentiel 10, sur le déficit comme outil face aux crises) et des plans de relance de 2009.
La crise de la dette publique dans la zone euro s’est manifestée dès 2010 par l’envol des taux d’intérêt sur la dette publique grecque puis de l’Irlande, du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie. Les taux ont atteint des niveaux tels que ces pays ne pouvaient plus se financer sur les marchés de capitaux. Contraints de faire appel au soutien financier du Mécanisme européen de stabilité (MES) 40 et/ou du FMI, les cinq pays au cœur de cette crise se sont vu imposer des plans d’austérité et des contrôles réguliers 41 par la « troïka » (la Commission européenne, la BCE et le FMI). Les autres pays européens ont également choisi dans leur majorité de mettre fin aux plans de relance et de mener des politiques d’austérité afin de « rassurer » les marchés financiers et de revenir dans les clous des critères du Pacte de stabilité et de croissance sur la dette et le déficit publics.
Les politiques d’austérité sont contreproductives au niveau économique
L’objectif des politiques d’austérité est de dégager un excédent budgétaire permettant ainsi de rassurer les créanciers sur la soutenabilité de la dette et plus généralement de susciter une reprise de la production et des emplois via l’augmentation de la confiance et donc des investissements au sein du secteur privé 42.
Ces politiques se sont révélées contreproductives. Comme on l’a vu dans l’Essentiel 10, sur le déficit public, le budget public est un outil de lutte contre les crises économiques et les récessions. La restriction budgétaire a bien évidemment l’effet inverse : elle aggrave la récession ou, à minima, entretient une stagnation durable comme celle que l’Union européenne a connu pendant la décennie 2010. Plusieurs études ont ainsi montré à quel point le tournant de la rigueur amorcé dès 2010 par les pays européens avait nui à l’activité économique européenne 43.
Comprendre en vidéo le cercle vicieux de l’austérité
Les politiques d’austérité sont un frein majeur à la transition écologique
Faire face au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité tout en adaptant nos territoires aux changements déjà en cours implique une transformation profonde de notre modèle de développement. Pour cela, un vaste plan d’investissements est nécessaire dans de nouvelles infrastructures là où elles font défaut, et dans la mise en conformité écologique de celles qui existent déjà. Réseaux de transport, d’énergie, d’eau, flottes de véhicules et de navires, parcs de bâtiments, stocks de machines : c’est tout le stock de capital physique, tout notre héritage économique qui doit être remis à niveau des enjeux écologiques. Enfin, au-delà des infrastructures matérielles, il est également essentiel d’investir dans l’accompagnement et la transformation sociale. L’éducation, la formation professionnelle, la recherche sont donc à considérer à part entière.
Les besoins sont considérables : une étude de la Commission européenne parue en 2020 évalue ainsi les besoins d’investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs climatiques et écologiques de l’UE à 470 milliards d’euros par an d’ici 2030. Face à ces besoins, il est bien sûr important de mobiliser les financements privés, mais c’est nettement insuffisant. Il est en effet fondamental de mobiliser les budgets publics dans des proportions bien plus importantes qu’aujourd’hui à la fois pour mettre à niveau le patrimoine public, pour soutenir l’investissement privé et pour accompagner la transformation (voire la disparition) de secteurs, tel celui du charbon, incompatibles avec le respect des objectifs climatiques.
Il est bien évident que la mise en œuvre d’un tel plan d’investissement est contradictoire avec toute politique d’austérité. Les dépenses publiques liées à l’environnement sont tout autant concernées par les coups de rabot de la « rigueur budgétaire ». Par ailleurs il est exclu de combattre la crise climatique en réduisant les dépenses sociales : la transition sera juste (ou considérée comme telle par la majorité de la population) ou ne se fera pas.
Pour en savoir plus, voir l’Essentiel 11 : « L’investissement public pour la transition écologique est prioritaire sur le respect de ratios » comptables et la proposition Pour un plan de reconstruction écologique
Les politiques d’austérité ont de graves conséquences sociales
En prolongeant la récession, les politiques d’austérité augmentent évidemment le chômage mais ont d’autres conséquences sociales.
En effet, une des caractéristiques de ces politiques est de s’attaquer aux dépenses et donc aux services publics : santé, éducation, transports, accès au droit, accompagnement social… autant de domaines où les politiques d’austérité dégradent non seulement les conditions de travail des fonctionnaires, ceux qui sont chargés de prendre soin de la population, mais aussi les services rendus à la population.
Elle se caractérisent également par l’insistance sur la « nécessaire » rentabilité des services publics : adoption de modes de gestion inspirés du privé, fermeture des activités considérées comme non rentables.
C’est cette logique de rentabilité qui conduit à la saturation des hôpitaux, aux conditions de travail dégradées pour les soignants et in fine à une mise en danger des patients. C’est également cette logique qui préside à la concentration en grosses unités (et donc à la fermeture des petites structures de proximité) pour limiter les coûts de gestion. Cela contribue dans certains territoires, à un éloignement croissant des tribunaux, écoles, postes, à des déserts médicaux ; éloignement qui nourrit le sentiment d’abandon et d’injustice, ferment des contestations sociales.
Une politique d’austérité peut exister même quand les dépenses publiques augmentent
Un argument régulièrement répété est que les politiques d’austérité n’en sont pas vraiment puisque les dépenses publiques continuent à augmenter. Cette augmentation est en réalité liée au fait qu’une part importante des dépenses publiques est non pilotable à court terme : on ne peut pas changer rapidement les paramètres qui les déterminent.
Les retraites constituent un bon exemple : dans un pays où la natalité est basse et l’espérance de vie importante, le poids des retraites dans le PIB s’accroit mécaniquement (moins de travailleurs et plus de retraités). Inverser le processus nécessite d’importantes réformes paramétriques 44 qui ne donneront un effet que sur le long terme (au fur et à mesure que les nouvelles générations arriveront à la retraite). Le vieillissement de la population est également un facteur important d’augmentation des dépenses de santé (voir ici des explications très claires sur ce sujet de Benjamin Brice, Docteur en sciences politiques à l’EHESS).
Dans ces deux cas, les dépenses publiques peuvent augmenter alors même que des mesures d’austérité de court terme sont menées par le gouvernement : gel du salaire des fonctionnaires et des pensions de retraites, baisse des remboursements de médicaments, baisses des investissements dans les infrastructures de soin, fermeture des petites structures de proximité non « rentables ». Dans le même temps, les réformes structurelles de plus long terme visent à modifier les paramètres des dépenses non pilotables.
Source Qu’est-ce qu’une politique d’austérité – Fiche Dette n°9 CGT- pôle eco
L’exemple des dépenses de santé
Après 2009, ces dépenses ont été comprimées dans quasiment tous les pays européens. Les restrictions ont pris plusieurs formes : réduction du nombre d’emplois et des salaires, réduction des dépenses publiques liées aux achats de médicaments, privatisation de la délivrance des soins. Elles se manifestent également par la transformation du modèle de gestion de l’hôpital public qui doit désormais être géré comme une entreprise privée.
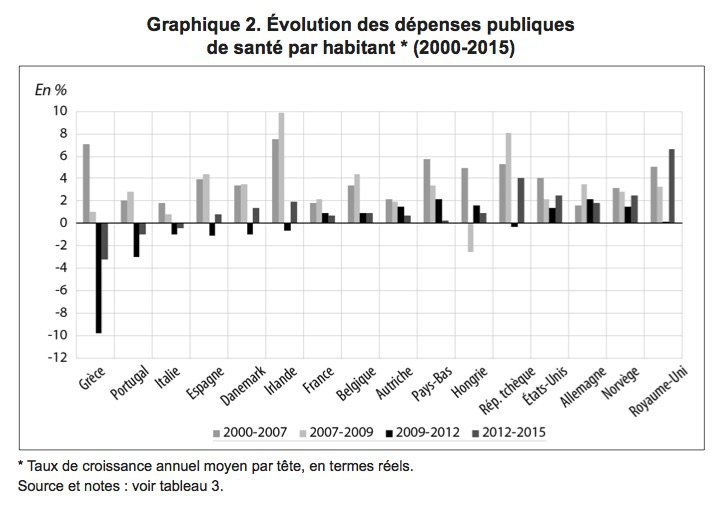
Source Antoine Math, « Les effets des politiques d’austérité sur les dépenses et services publics de santé en Europe », La Revue de l’Ires (2017)
Entre 2009 et 2015, les dépenses publiques de santé par tête ont chuté en valeur réelle en Grèce (-37,7 %), au Portugal (-16,2 %), en Espagne (-8,0 %), en Italie (-7,4 %), en Irlande (-6,9 %), et elles ont baissé de 0,2 % aux Pays-Bas, un net recul par rapport à la période précédente de forte croissance. Elles avaient également diminué sur la période 2009-2012 en Islande, au Danemark, au Royaume-Uni. Dans les autres pays où elles n’ont pas diminué, la rupture a également pu être forte, avec souvent des rythmes de croissance réduits à des niveaux jamais connus auparavant.
Or, ces politiques de restriction des dépenses publiques de santé ont bien évidemment un impact sur les conditions sanitaires de la population. La pandémie de COVID-19 a bien mis en évidence l’importance de la politique de prévention des épidémies, via notamment le nombre de masques et de lits de réanimation 45. Les exemples témoignant du recul des soins, y compris pour des maladies graves telles que le cancer, à la suite de politiques d’austérité abondent 46.
Sur un plan plus macroéconomique, Sanjay Basu et David Stuckler ont montré dans leur livre Quand l’Austérité tue, Epidémies, dépressions, suicides : l’économie inhumaine (Edition Autrement, 2014) combien les coupes dans les dépenses sociales, de santé et de prévention ont des impacts sur les conditions sanitaires des populations.
Idées reçues
La dette publique serait un fardeau injustement légué aux générations futures
Cet argument, régulièrement invoqué dans les débats sur la dette publique, repose sur le raisonnement suivant : en contractant des dettes aujourd’hui, le gouvernement fait peser le poids des remboursements sur les épaules de nos enfants et de nos petits-enfants, qui hériteraient de la dette publique. Pour les rembourser, ceux-ci devront subir des hausses d’impôt très importantes.
L’emprunt public est alors perçu comme une sorte d’impôt différé, obligeant les générations futures à payer pour des dépenses publiques passées dont elles ne bénéficient pas. Pour prévenir les inégalités intergénérationnelles et ne pas imposer aux générations futures des niveaux d’imposition élevés, les gouvernements devraient maintenir un budget équilibré avec des recettes couvrant les dépenses.
Cet argument est inexact à plusieurs titres.
Petite remise en perspective : les générations futures héritent avant tout d’un patrimoine
Une société lègue à ses descendants un patrimoine public précieux : des hôpitaux, des crèches, des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités pour se former, des bibliothèques et des musées pour se cultiver, des routes et des rails pour circuler etc.
Ce patrimoine est avant tout un ensemble de biens naturels, culturels, artistiques, intellectuels, physiques (des bâtiments, des logements, des équipements etc.) dont la création et le maintien en bon état (voire la restauration quand il s’agit de patrimoine naturel) bénéficient aux générations futures. Ce patrimoine n’est qu’en partie seulement valorisé monétairement. C’est le cas des infrastructures et des bâtiments publics, des terrains bâtis ou exploités mais pas des espaces naturels, du bon état de nos fleuves et de nos cours d’eau, du patrimoine artistique et architectural ou encore de la qualité des services publics (voir l’Essentiel 6 : « En face de la dette publique, il y a un patrimoine »).
On peut sans peine supposer que les « générations futures » nous seront plus reconnaissantes d’avoir investi pour maintenir les services publics en bon état, pour éviter des désastres écologiques (en réduisant les émissions de gaz à effet de serre) et pour rendre notre économie résiliente (à la montée des eaux, aux événements extrêmes), quitte à nous endetter que l’inverse.
Comme le note l’ONG Finance Watch dans son rapport Fiscal Mythology Unmasked (2021)
Le coût de l’absence d’investissement actuel dans la résilience et la durabilité de la société pèsera davantage sur les épaules des générations futures que le coût de la dette résultant des investissements réalisés aujourd’hui.
Concrètement, cela signifie qu’une part importante des dépenses publiques réalisées aujourd’hui bénéficie en réalité aux générations futures. Ces dernières n’auront donc pas à réaliser ces dépenses mais à assurer leur « maintenance » et pourront se consacrer à de nouveaux investissements qui, eux aussi, profiteront aux générations suivantes. Chaque génération profite ainsi de l’accumulation des connaissances et des investissements des générations précédentes.
Dans tous ces domaines, il n’est donc pas aberrant de répartir le coût sur plusieurs générations : c’est précisément à cela que sert l’emprunt. La question clef est donc bien celle de la qualité des dépenses publiques.
Ajoutons que nombre de ces dépenses et investissements ne pourraient être réalisés par le secteur privé (voir l’Essentiel 11 sur la nécessité d’investissements publics pour la transition écologique ; les Idées reçues 5 et 6 du module sur la finance, sur la finance verte et sur le fléchage de financements vers des projets écologiques plutôt que des industries carbonées ; ainsi que la Proposition pour un plan de reconstruction écologique)
La dette est bien plus une question d’équité intragénérationnelle qu’intergénérationnelle
Quand les créanciers sont des résidents
La dette publique, c’est l’endettement des administrations publiques (les APU) 47 auprès d’autres agents économiques, créanciers des APU.
Ces créanciers sont principalement les institutions financières (dont les banques centrales) et les ménages (qui détiennent de la dette publique non pas directement mais via les fonds proposés par les institutions financières).
Si la dette se transmet, les créances aussi. Les générations futures auront donc d’un côté des administrations publiques endettées mais de l’autre elles disposeront de créances en contrepartie. Au total, les dettes et les créances en question s’annulent…
Dire que la dette publique est un poids sur les générations futures parce que ce sont elles qui rembourseront une dette créée par les générations actuelles est inexact, au minimum incomplet. La vérité, c’est que les administrations s’endettent aujourd’hui auprès de créanciers qui disposent dans leur patrimoine de ces créances, et les transmettent à leur descendance.
La dette publique n’est donc pas une question d’équité entre les générations mais au sein d’une même génération entre ceux qui ont les moyens de prêter et le reste de la population. Le choix d’un gouvernement de privilégier les créanciers et de mettre la dette publique au cœur des politiques publiques peut conduire à des politiques d’austérité dont pâtira toute la population (voir l’Essentiel 12 : « L’austérité est économiquement contreproductive et néfaste sur le plan social et écologique »).
Quand les créanciers ne sont pas des résidents
Les choses se compliquent quand la dette est en grande partie détenue par des non-résidents (institutions financières et ménages). Si les créanciers sont des étrangers, la dette publique peut générer un déséquilibre récurrent de la balance des paiements, ce qui peut devenir un vrai problème économique pour une nation. C’est encore pire quand une nation contracte une dette dans une monnaie qui n’est pas la sienne. En effet, comme vu dans l’Essentiel 4, tous les pays ne sont pas égaux face à la dette publique.
Qui détient la dette publique des pays de l’Union européenne ?
La dette publique des pays de l’UE par type de détenteur
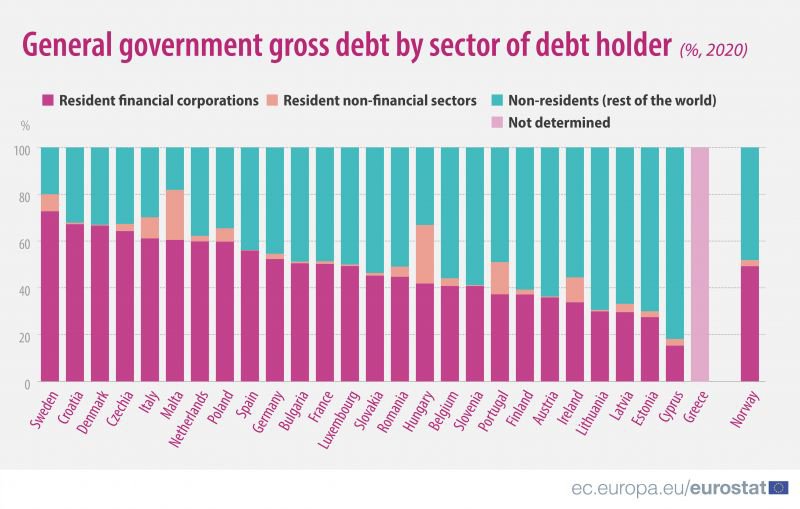
Source Eurostat – statistics explained – Structure of government debt
Mais cette remarque ne contredit pas le propos précédent. Elle conduit à considérer que ce taux de détention est un élément central d’une politique de placement de la dette. Ce n’est pourtant pas le cas en pratique en France : la dette est toujours placée auprès des « mieux offrants », résidents ou pas. Sans doute parce que nos argentiers, contrairement à leurs discours, ne craignent en rien le risque que la dette publique soit trop élevée ?
Ce qui pèse sur les générations futures n’est pas tant la dette que le poids des intérêts de la dette publique
Rappelons que depuis des décennies, la plupart des États 48 font rouler leur dette : à l’échéance du remboursement, les créanciers peuvent recouvrir leurs avoirs… ou les prêter de nouveau. Et c’est ce qui se passe en pratique : la dette est le plus souvent renouvelée et non remboursée.
Il n’en reste pas moins que le paiement des impôts actuels et futurs sert en partie au paiement des charges d’intérêt. Ainsi, en 2019, si la France n’avait pas eu d’intérêts à payer, cela aurait permis d’économiser près de 35 milliards euros. Il est donc indiscutable qu’une partie des impôts sert à financer les créanciers de l’Etat. Il s’agit d’un transfert qui n’est pas neutre socialement.
Notons enfin que le niveau des intérêts payés dépend bien sûr du niveau de l’endettement mais aussi du niveau des taux d’intérêt. Le très bas niveau des taux d’intérêt a ainsi permis une baisse de la charge de la dette dans les pays qui ont accru leur endettement (en valeur absolue). Pour l’Allemagne, qui a réduit le niveau de sa dette, les deux effets jouent à plein. Même pour la France, la réduction est très importante : en 2019 le gouvernement payait moins d’intérêts qu’en 1995 malgré un niveau de dette qui n’a fait qu’augmenter sur la période (à la fois en valeur absolue et en % du PIB).
Montant des intérêts de la dette publique payés par certains pays européens (milliards d’euros)
Source Base de données Ameco de la Commission européenne (série 16.4 – Interest)
Les intérêts de la dette publique en % du PIB dans l’Union européenne
Source Base de données Ameco de la Commission européenne (série 16.4 – Interest)
En conclusion, il semble assez légitime de dire que vu la faiblesse des taux actuels, il est opportun d’utiliser la dette publique pour payer les investissements absolument nécessaires afin de limiter les risques climatiques et écologiques massifs que devront subir nos enfants, et d’y faire face. Augmenter la dette, c’est alléger leur fardeau !
Comme nous l’avons vu, la dette publique pose cependant bien des problèmes d’équité intragénérationnelle (voir point précédent). C’est pourquoi, si le niveau d’endettement actuel ne doit pas constituer un frein à la transition écologique ou une justification de la déconstruction sociale, il n’en reste pas moins urgent de réfléchir à d’autres moyens de financement de l’Etat (voir l’Essentiel 5 sur les liens entre dette publique et création monétaire et l’Idée reçue 4 : « Il faudra bien rembourser la dette ! »).
Au-delà d’un certain niveau, la dette publique (rapportée au PIB) serait insoutenable
L’indicateur dette/PIB est communément employé pour juger de la soutenabilité de la dette publique et pour faire des comparaisons entre les pays (ainsi que dans le temps). Nous allons voir que cette notion de soutenabilité de la dette ne peut être réduite à un indicateur simple, et que le ratio dette/PIB est loin d’être le plus pertinent.
Que signifie la soutenabilité de la dette ?
Une dette est dite soutenable à partir du moment où le débiteur dégage des ressources suffisantes pour faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers : rembourser le principal et payer les intérêts.
Pour un État, cela se manifeste par sa capacité à lever l’impôt et à « placer » sa dette sur les marchés dans des conditions acceptables 49. En effet, les Etats font « rouler leur dette », c’est-à-dire qu’ils émettent de nouveaux titres de dettes pour rembourser ceux qui arrivent à échéance.
Les créanciers de l’État sont donc régulièrement remboursés mais ils sont prêts à prêter de nouveau (ou alors d’autres acteurs le font), du fait de la sécurité qu’offrent les placements publics … dans une limite difficile à apprécier et qui dépend de nombreux paramètres.
Au-delà de cette limite, franchie dans les décennies passées principalement dans les pays n’ayant pu s’endetter dans leur propre monnaie (voir l’Essentiel 4), l’État entre dans une zone de difficultés sérieuses. Il est en « cessation de paiement ». Il peut alors être contraint de faire appel à des financements d’organismes tels que le FMI qui peuvent en contrepartie lui imposer des réformes douloureuses (et souvent inappropriées), ayant pour objectif de réduire les dépenses publiques (voir l’Essentiel 12).
La question revient donc à savoir à partir de quand un État n’arrive plus à « placer » sa dette, c’est-à-dire à trouver des investisseurs prêts à acheter ses titres de dette. Cette information n’est pas donnée par l’indicateur dette/PIB.
Il n’y a pas de niveau de dette/PIB au-delà duquel un Etat ne pourrait plus placer sa dette
Que nous dit l’indicateur dette/PIB ?
L’indicateur dette/PIB compare la dette (un stock) au PIB (un flux). Concrètement, il nous informe sur le pourcentage des revenus générés par la production annuelle d’un pays qu’il faudrait consacrer pour rembourser la dette en une seule fois. C’est une information. Mais nous permet-elle de répondre à la question soulevée précédemment, à savoir dans quelle mesure un État peut-il placer sa dette dans des conditions satisfaisantes ?
Les exemples montrant que cet indicateur n’est pas pertinent abondent
Nombre d’économistes et de gouvernants ont tenté de déterminer un niveau au-delà duquel la dette deviendrait insoutenable.
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 9, sur les règles budgétaires européennes, c’est le cas dans l’UE où une limite de 60% de dette/PIB a été inscrite dans les traités. Ce chiffre, fixé arbitrairement, ne repose sur aucun fondement économique. Il a d’ailleurs été largement dépassé par plusieurs États européens, sans conséquence aucune. D’après Eurostat, la dette publique moyenne au sein de l’Union européenne était de 77,5% du PIB en 2019 et de 84% dans la zone euro sans que les États rencontrent de difficulté à placer leur dette.
Dans un article de 2010, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff ont avancé un autre niveau : au-delà de 90% du PIB, la dette publique se traduirait par un déclin important de la croissance. Cet article, largement réfuté (notamment en raison d’erreurs dans les calculs Excel !) 50, a pourtant servi de support intellectuel aux politiques d’austérité menées dans les années 2010 51.
Le Japon, exemple bien connu, continue à emprunter et à payer les intérêts avec des niveaux de dette nettement supérieurs à 200% du PIB depuis une dizaine d’années.
Inversement, certains pays ont été mis en difficulté sur les marchés financiers avec des niveaux bien moins importants de dette/PIB. C’est le cas de l’Espagne qui a dû faire appel à l’assistance financière européenne en 2012 alors que sa dette publique représentait fin 2011 environ 70% du PIB. C’est également le cas de l’Irlande qui a dû faire appel à l’aide européenne et du FMI en 2011 avec une dette de 86% du PIB fin 2010.
Ces quelques exemples mettent bien en évidence le fait que la soutenabilité de la dette dépend de biens d’autres facteurs que ceux relevant du seul ratio dette/PIB.
Un indicateur qui peut évoluer indépendamment de la gestion des finances publiques
L’évolution du ratio dette/PIB dépend de quatre facteurs :
- le taux de croissance du PIB d’une année sur l’autre ;
- le taux d’intérêt moyen de la dette publique ;
- le taux d’inflation ;
- le solde public primaire c’est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses publiques hors charge des intérêts.
Si le taux d’intérêt de la dette est supérieur au taux de croissance réel du PIB (le taux de croissance nominal du PIB moins l’inflation) alors la dette s’accroit mécaniquement même en l’absence de déficit primaire. Ce mécanisme purement mathématique s’appelle l’effet boule de neige . Il permet de comprendre pourquoi même avec une « saine » gestion budgétaire (au sens où les recettes couvrent les dépenses hors charge des intérêts de la dette) le poids de la dette peut s’accroitre mécaniquement du fait de taux d’intérêt trop élevés.
Du danger d’adopter un indicateur prépondérant
Se baser sur l’indicateur dette/PIB peut mener à des décisions contre-productives. Le ratio évolue évidemment en fonction du numérateur, le niveau de la dette publique, et du dénominateur, le niveau du PIB. Il est donc très dépendant de la conjoncture économique : il augmente automatiquement en période de récession même dans le cas où la la dette publique resterait stable.
L’adopter comme guide de la gestion des finances publiques peut donc conduire les administrations à se « serrer la ceinture » en période de crise économique. Comme on l’a vu dans l’Essentiel 10, sur le déficit public, cela revient à laisser la crise s’approfondir, le PIB à stagner voire à diminuer et donc le ratio à augmenter de nouveau etc. C’est ainsi que la politique économique restrictive adoptée en Europe dans les années 2010 s’est traduite par une décennie perdue à la fois en termes économiques, sociaux et écologiques (voir l’Essentiel 9, sur les règles budgétaires européennes et l’Essentiel 12, sur les conséquences sociales et écologiques de l’austérité).
Quels sont les facteurs influençant la soutenabilité de la dette ?
De nombreux facteurs influencent la perception de la dette publique par les investisseurs : la stabilité politique et sociale du pays, la capacité des gouvernements à lever l’impôt, les revenus et leur perspective de croissance, la stabilité monétaire, la dette extérieure, etc.
Sans être exhaustif, soulignons ici quelques facteurs 52 importants en nous concentrant sur les pays qui peuvent s’endetter dans leur propre monnaie (nous avons vu dans l’Essentiel 4 que les pays ne sont pas égaux face à la dette).
Que finance la dette ?
La situation est bien évidemment différente quand les déficits publics permettent de financer des dépenses dont on attend qu’elles créent de l’activité, des emplois, réduisent la dépendance aux énergies fossiles et aux autres matière premières, améliorent la résilience de la société (et donc de l’économie) face aux catastrophes écologiques qui ne cessent d’augmenter ou quand au contraire, ces déficits publics servent à financer des dépenses somptuaires ou à compenser des suppressions massives d’impôts, donc de recettes publiques.
Une première façon de s’en rendre compte consiste à comparer le niveau des déficits publics avec celui des investissements publics. C’est cependant insuffisant car ces derniers peuvent inclure des projets inutiles (des stades géants jamais utilisés, des dépenses ne profitant qu’à une poignée de privilégiés) ou à contre-courant de la transition écologique (des aéroports, de nouvelles routes etc.) Par ailleurs, d’autres dépenses publiques sont pertinentes : par exemple, les postes de fonctionnaires qui pilotent les investissements publics, les soutiens aux ménages pour la rénovation des logements ou les dépenses liées à la reconversion des secteurs qui ne pourront perdurer tels quels si la transition a bien lieu.
Les travaux portant sur l’élaboration de budgets verts 53 constituent également une piste intéressante mais qui souffre de deux biais principaux :
- d’une part, selon les acteurs, la définition d’une dépense « verte » ne sera pas la même (par exemple, pour certains les subventions à l’agriculture conventionnelle sont néfastes, pour d’autres elles sont neutres voire positives) ;
- et d’autre part, les « budgets verts » ne suffisent pas pour dégager une vision d’ensemble : mettre en évidence les dépenses écologiques (ou à l’inverse anti-écologiques) ne constitue pas en soi une stratégie.
Fondamentalement, il est nécessaire d’élaborer une stratégie publique de transformation écologique de la société 54 évaluée au moyen d’indicateurs concrets de suivi 55 et, enfin, de renseigner les moyens mis en œuvre que ce soit en termes financiers ou réglementaires.
La balance des transactions courantes
Si la balance courante 26 est déficitaire, cela signifie que les déficits publics servent en partie à alimenter les importations en biens et services de consommation courante. Cela peut poser problème à moyen ou long terme. En effet, l’argent public injecté dans le circuit économique sort du pays et ne contribue pas au développement de son tissu économique et de ses capacités de production. Or, celles-ci sont les capacités de remboursement de demain. En réalité, la dette publique du pays X va stimuler l’économie du pays dont il importe ses biens et services.
Le coût de la dette : les taux d’intérêts
Les taux d’intérêt donnent une indication de la perception de la dette publique par les investisseurs. S’ils sont bas, c’est que les investisseurs estiment qu’il s’agit d’un placement sûr ; s’ils sont élevés c’est qu’ils considèrent la dette comme risquée et font donc payer une prime de risque. Pour certains économistes, les hauts niveaux de dette et de déficit publics, reflets d’une mauvaise gestion des finances publiques, se traduiraient nécessairement par des taux d’intérêt élevés.
Ceci est totalement contredit dans les faits. Les taux d’intérêt dépendent bien plus de la politique monétaire menée par la banque centrale du pays ou de la zone concernée que du niveau d’endettement. C’est ainsi que le programme d’achat de dette publique par la Banque centrale européenne dans la zone euro a considérablement fait baisser les taux d’intérêts (voir notre explication sur le quantitative easing dans l’Essentiel 3).
L’économiste Frank van Lerven a compilé des données longues de la Bank of England pour montrer l’absence de corrélation entre stock de dette et niveau des taux d’intérêt.
Source : Article de Frank van Lerven, New Economic Foundation (2021)
La baisse des taux d’intérêt se manifeste par une baisse de la charge des intérêts, donc du coût de la dette à payer par les Etats chaque année.
Sur le graphique ci-après on peut constater que depuis 2008 la charge de la dette payée par l’État français baisse à mesure que la dette augmente. Plus la France emprunte, moins elle paie pour cela (le graphique ci-après est en % du PIB mais c’est également valable en euros courant – voir les graphiques à la fin de l’Idée reçue 1, qui présente l’endettement public comme un fardeau pour les générations futures).
Malgré la très forte progression de l’endettement durant la crise de la Covid-19, cette charge de la dette a continué à baisser en 2020 pour s’élever à 29 milliards d’euros (contre 35 milliards en 2019) 57
Qui détient la dette publique ?
La question de la détention de la dette publique devrait également être au centre du débat. Si elle est massivement détenue par des résidents comme au Japon, cela signifie que ce sont les bénéficiaires des dépenses publiques qui utilisent leur épargne pour les financer. C’est une situation évidemment bien plus soutenable que si la dette publique est détenue par des agents non-résidents, davantage intéressés par les seuls aspects financiers.
Notons par ailleurs, que la dette publique est aujourd’hui principalement détenue par des institutions financières. Les ménages n’y ont plus accès directement (mais par le biais des fonds gérés par les institutions financières). Cela n’est pas sans conséquence non plus.
Enfin, la part de la dette publique détenue par la banque centrale constitue également une information importante. D’une part, cela signifie que la perception de la dette de l’Etat concerné est moins soumise aux « humeurs » des marchés : en cas de crise de confiance sur les marchés, la banque centrale ne va pas se mettre à vendre massivement les titres de dette qu’elle détient comme le font les autres acteurs financiers. D’autre part, les banques centrales étant le plus souvent à capitaux publics, les intérêts qu’elles perçoivent reviennent à leur Etat sous forme de dividendes.
Qui détient la dette publique française ?
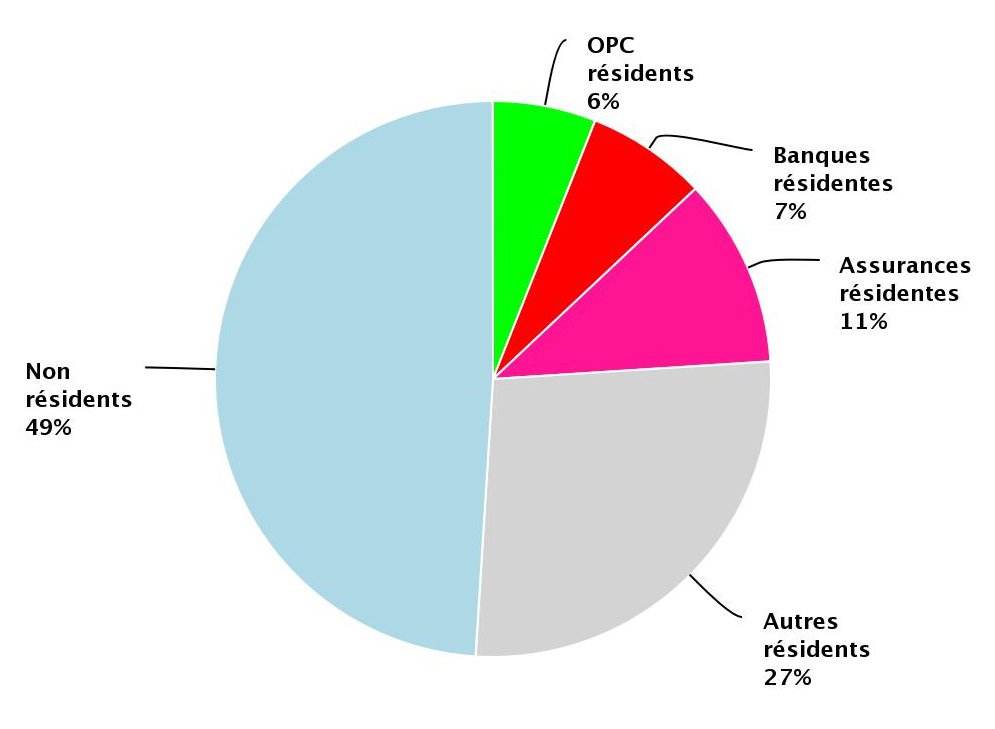
Source Répartition par secteur détenteur des titres émis par les résidents (dettes totales et actions cotées) à fin mars 2022 – Banque de France
OPC : organismes de placement collectif
Dans quelle monnaie la dette est-elle émise ?
Nous avons vu dansl’Essentiel 4, combien le fait d’émettre sa dette dans une monnaie étrangère pouvait être déstabilisant pour un Etat.
Frank van Lerven résume très clairement à quel point la situation inverse peut être favorable.
L’approche politique actuelle de la soutenabilité budgétaire ignore le fait que les pays à haut revenu comme le Royaume-Uni sont « monétairement souverains » : ils ont des dettes libellées dans leur propre monnaie et un taux de change flottant.
En tant que tel, contrairement aux ménages, le gouvernement britannique ne peut pas faire défaut sur sa dette. La Banque d’Angleterre peut toujours créer de la nouvelle monnaie pour rembourser la dette publique, étant donné que la dette publique est émise dans la monnaie créée par la Banque.
L’importance d’une véritable souveraineté monétaire
Les pays de la zone euro sont dans une situation particulière. Ils peuvent s’endetter dans leur propre monnaie mais ils ne sont pas entièrement souverains. La Banque centrale européenne est en effet indépendante du pouvoir politique et elle a interdiction de prêter aux Etats. Jusqu’en 2012, elle s’est refusée à garantir leurs dettes. Elle a donc laissé toute latitude aux marchés financiers pour en déterminer le coût. C’est une des raisons de la crise de la dette publique dans la zone euro, pendant laquelle les taux d’intérêt de certains pays se sont élevés à des niveaux tels qu’ils ne pouvaient plus se financer sur les marchés et ont été contraints de faire appel à l’aide des autres pays européens.
La BCE est intervenue à partir de 2012 et surtout de 2015 pour mettre fin à l’envolée des taux mais cela n’a pas été sans conséquence pour les pays concernés. Soumis à une surveillance renforcée de la Commission européenne, avec l’appui de la BCE et parfois du FMI, ils ont été contraints de mettre en œuvre des plans d’ajustement macroéconomique 58. Cela fait plus de dix ans que la Grèce est ainsi sous tutelle et doit adopter des « réformes structurelles » aux conséquences sociales et économiques dévastatrices.
Concrètement, cela montre que les institutions européennes, appuyées par les pays européens « vertueux » (les pays du Nord), peuvent imposer aux autres (les pays « laxistes » du Sud) des mesures de politique économique en utilisant le chantage de l’action monétaire.
Le niveau de la dette publique serait le résultat du laxisme budgétaire des Etats
A écouter les promoteurs de la rigueur budgétaire, la hausse de la dette publique serait le résultat d’une mauvaise gestion des finances publiques, les administrations dépensant plus que leurs recettes. Si le constat d’un excès des dépenses par rapport aux recettes est réel (il s’agit d’une simple évidence comptable), l’interprétation teintée de jugement moral est contestable à plus d’un titre.
Le niveau de la dette publique dépend, en effet, bien plus de l’histoire politique, économique et des arrangements institutionnels que du supposé laxisme des États.
Guerres et crises économiques
Quand on se penche sur l’histoire longue, on peut constater que l’augmentation des dettes publiques est avant tout le fait des « accidents » de l’Histoire : les guerres et les crises économiques.
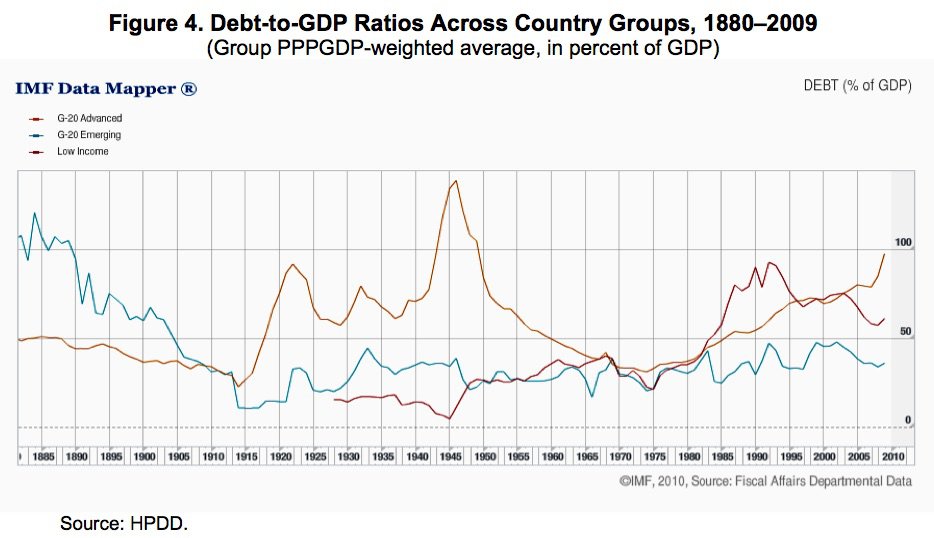
Source A Historical Public Debt Database, IMF Working Paper p. 11, 2010.
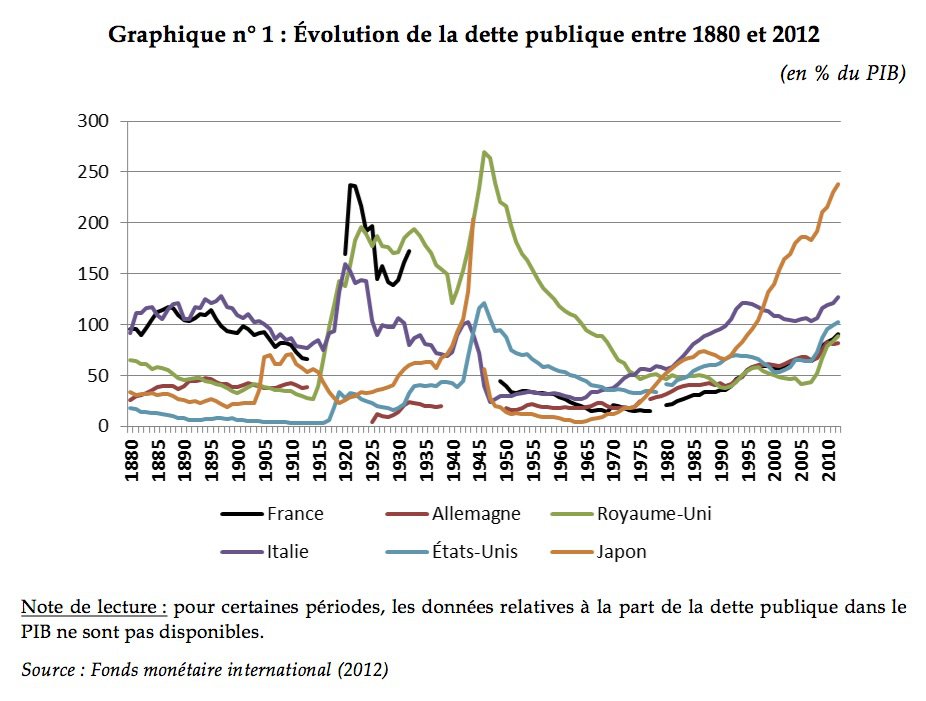
Source Rapport de la commission des finances du Sénat sur les évolutions, les perspectives et la gestion de la dette publique de la France (2017)
La crise financière de 2007-2008 a, par exemple, coûté très cher aux finances publiques non seulement du fait des ressources mobilisées pour sauver le système financier mais aussi et surtout des conséquences de la crise économique qui en a découlé : stabilisateurs automatiques qui creusent mécaniquement le déficit et plans de relance de l’économie par les gouvernements pour tenter de juguler la crise (voir L’essentiel 10, sur le déficit comme outil face aux crises).
Il n’est pas question ici de laxisme budgétaire car les causes de cette crise sont à rechercher dans le fonctionnement de la finance libéralisée (voir module sur la finance).
Par contre, il serait intéressant de se pencher sur le « laxisme réglementaire », que ce soit celui des Etats-Unis avec le développement des crédits immobiliers accordés à des ménages non solvables (les crédits subprimes) ou celui des autorités publiques de régulation financière (nationales et internationales), incapables de percevoir 59, et encore moins de prévenir, la croissance de risques systémiques au sein du système financier international.
A quoi sert le déficit public ?
Comme déjà exprimé dans l’Idée reçue 2, sur la soutenabilité de la dette, il est important de regarder ce que permet le déficit public et plus généralement à quoi servent les dépenses, d’où viennent les recettes et quels est leur impact sur l’économie et la société.
Notons, par exemple, que la concurrence fiscale généralisée ne peut qu’avoir des effets négatifs sur les finances publiques, de même que la fraude et l’optimisation fiscale (voir module sur la finance).
Inversement, mener un vaste programme de reconstruction écologique (comme nous en faisons la proposition ici) relèverait aujourd’hui non d’un « laxisme » mais au contraire, d’une saine gestion, non seulement par l’impact positif sur les finances publiques de la stimulation des activités économiques (qui augmente les recettes) et de la réduction du déficit commercial 60, mais aussi en limitant l’ampleur des dérèglements écologiques et en améliorant la capacité du tissu économique et de la société à faire face aux évolutions déjà inévitables.
Comment se financent les Etats ?
Comme on l’a vu dans l’Essentiel 3, la plupart des Etats 61 financent leur déficit principalement en émettant des titres de créance négociables sur les marchés financiers. Cette « mise en marché » de la dette publique est censée exercer une discipline vertueuse sur les finances publiques (voir module sur la monnaie).
Cette hypothèse est bien évidemment invalide dans les faits : la dette publique des économies avancées n’a cessé d’augmenter depuis les années 1970 (voir graphique dans le point A), notamment du fait du poids des intérêts cumulés.
Des analyses portant sur les crises de la dette des dernières décennies 62 ont mis en évidence le fait que les coûts d’emprunt des Etats pouvaient changer de façon importante sans évolution majeure des fondamentaux de l’économie concernée. Les acteurs des marchés financiers peuvent surréagir à certaines informations économiques nationales, régionales ou internationales. Par crainte d’un défaut de paiement, ils peuvent exiger des primes de risque si importantes qu’elles font précisément advenir ce que ces acteurs redoutaient. C’est le mécanisme des prophéties autoréalisatrices, caractéristiques des comportements sur les marchés financiers.
La mise en marché de la dette n’a rien d’une fatalité
Il existe des périodes de l’histoire pendant lesquelles certains États ont pu maitriser leur endettement en recourant à des modes de financement indépendants des marchés financiers. Le circuit du trésor en France pendant les Trente Glorieuses en est un bon exemple. Il consistait à faire converger vers le Trésor public de nombreuses ressources financières tout en mobilisant le concours de la Banque de France.
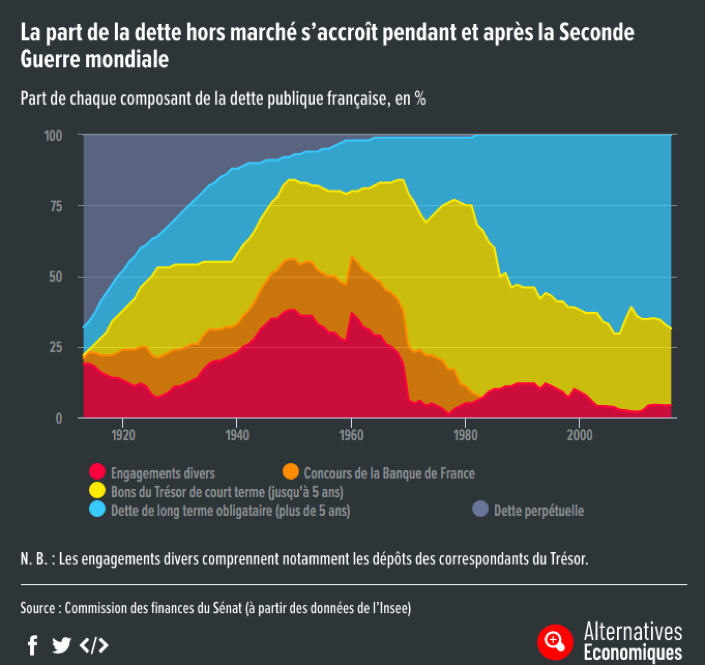
Source Dette : quand l’Etat dictait sa loi à la finance, Jean-Christophe Catalon, Alternatives économiques (2021)
La question de la « monétisation » de la dette publique, c’est-à-dire du financement de la dette par la création monétaire de la banque centrale, n’a pas toujours été un tabou comme c’est le cas aujourd’hui (voir l’Essentiel 5 sur les liens entre dette publique et création monétaire et l’Idée reçue 4 : « Il faudra bien rembourser la dette ! »). C’est, par exemple, ce que note Adair Turner dans son article « Le retour du financement monétaire ».
Les économistes Anna Schwartz et Milton Friedman ont estimé, dans leur ouvrage Une histoire monétaire des États-Unis, que 15 pour cent environ des dépenses de guerre avaient été financées par la monnaie de banque centrale, au lieu de l’être par des impôts ou par une monétisation des titres de dette publique qui n’ont en finale jamais été remboursés. Au Japon, où 25 ans de déficits budgétaires importants ont été compensés par des rachats tout aussi importants d’obligations d’État par la Banque du Japon, il est également évident que les portefeuilles obligataires de la banque centrale ne seront jamais vendus : un financement monétaire permanent a de fait été entériné.
« Il faudra bien rembourser la dette ! »
Cette affirmation, qui semble de bon sens, est cependant fausse.
Déjà, la majorité des États dont la dette est émise dans leur propre monnaie font rouler leur dette c’est-à-dire qu’ils réempruntent pour rembourser les prêts initiaux (voir l’Essentiel 2, sur l’absurdité de comparer l’État à un ménage ou une entreprise).
Par ailleurs, une politique budgétaire expansionniste peut, via l’effet multiplicateur des dépenses publiques , générer une hausse plus que proportionnelle de l’activité économique, générant ainsi davantage de recettes publiques (qui dépendent du niveau de l’activité) et réduisant les dépenses (chômage, minimas sociaux etc.) (voir L’essentiel 10, sur le déficit comme outil face aux crises).
Enfin et surtout, il existe dans l’histoire économique de nombreux exemples où d’autres mécanismes que les remboursements ont permis de faire baisser la dette publique.
L’inflation est un premier moyen de réduire la dette
Quand l’inflation est supérieure au taux d’intérêt de la dette, elle permet de réduire mécaniquement la valeur réelle de la dette.
Petit exemple numérique (très) simplifié pour comprendre pourquoi l’inflation fait baisser la dette :
Imaginons qu’en l’an 2000, je prête 1000€ à mon ami Jeff pour qu’il achète un ordinateur en lui demandant de me rembourser dans dix ans (sans intérêts). Si, pendant cette période, l’inflation a été de 2% chaque année, en 2010 le même ordinateur coûtera environ 1220 €. Il en va de même pour tous les autres biens de consommation 63. Le remboursement des 1000€ que je lui avais prêtés me permettra d’acheter moins de choses que si j’avais utilisé cette somme en l’an 2000. La valeur faciale de sa dette (les 1000€) est restée la même. Par contre, sa valeur réelle (c’est-à-dire la valeur ramenée à ce que le montant de la dette permet d’acquérir) a baissé.
Si j’avais demandé un taux d’intérêt de 2% chaque année, le montant global des paiements de Jeff se serait élevé à 1000€ de remboursement de principal et 220€ d’intérêts cumulés. J’aurais donc récupéré ma mise de départ en valeur réelle.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’inflation a ainsi joué un rôle important dans la réduction des dettes contractées par les pays pendant le conflit. Rappelons qu’on est en pleine période des Trente Glorieuses et que cette inflation n’a alors pas nui à l’activité économique, au progrès social et au développement des structures de l’État-providence dans un grand nombre de pays occidentaux.
L’inflation n’est cependant pas une solution mobilisable en tant que telle. D’une part, elle ne se décrète pas : cela fait dix ans que les banques centrales des pays occidentaux tentent de faire remonter l’inflation autour d’une cible de 2% sans y parvenir (et près de 30 ans pour le Japon). D’autre part, face à une inflation jugée trop forte, les banques centrales pourraient relever leur taux directeur 12 et les acteurs des marchés financiers la prime de risque, le tout résultant en une hausse des taux d’intérêt pouvant contrebalancer ou dépasser l’effet de l’inflation.
Restructurer la dette
On parle de restructuration de dette quand un État débiteur conclut un accord légal avec ses créanciers afin d’échanger sa dette souveraine (prêts ou obligations) contre des liquidités ou un nouvel instrument financier. Les restructurations peuvent intervenir après un défaut (c’est-à-dire une suspension du paiement total ou partiel) ou en prévention.
Il en existe trois grands types :
- la réduction de la valeur du stock de dette ;
- le refinancement de la dette en réduisant les taux d’intérêt pour faire baisser le service de la dette, ou en allongeant le calendrier de remboursement du stock de dette déjà existant (on dit qu’on allonge la maturité de la dette) ;
- et beaucoup plus rarement, le rachat de la dette contre des liquidités : cela revient pour l’État concerné à rembourser immédiatement la dette à un montant avantageux.
Dans un article portant sur la période 1950-2010 65, le FMI a recensé plus de 600 opérations de restructuration touchant 95 pays dont 186 opérations avec les créanciers privés (banques étrangères, ou fonds détenteurs d’obligation souveraines) et 447 restructurations via des négociations bilatérales avec des créancier publics regroupés au sein du Club de Paris 66.
L’annulation de la dette allemande
L’annulation de la dette allemande en 1953 constitue l’un des exemples les plus emblématiques, en raison de la position actuelle de ce pays sur la dette publique.
Avec les Accords de Londres de février 1953, la RFA (Allemagne de l’Ouest) obtient via différents mécanismes une annulation de plus de 50% de la dette contractée à la suite des deux guerres mondiales. Les conditions de remboursement des montants restants lui sont de plus particulièrement favorables. Cet accord a contribué à la forte croissance économique des années suivantes en créant un espace budgétaire pour les investissements publics et les dépenses sociales, en rétablissant la convertibilité du Deutsche Mark et en stabilisant l’inflation 67.
Plus de détail dans notre fiche sur l’annulation de la dette de l’Allemagne .
Éric Toussaint, porte-parole du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM), donne dans une interview de très nombreux exemples concrets de restructuration de la dette avec des impacts plus ou moins positifs selon les pays.
Il développe aussi les exemples de l’Équateur et de l’Islande qui ont imposé avec succès à leurs créanciers de nouvelles conditions sur leur dette publique sans négociation.
Les propositions débattues à la suite de la pandémie de COVID-19
Les mesures de soutien budgétaire massif à l’économie prises par les gouvernements dans le sillage de la pandémie de COVID-19 ont permis de faire émerger la question de la création monétaire dans le débat public (en savoir plus sur la création monétaire dans le module sur la monnaie).
Après une décennie de discours sur le surendettement de l’État, sur l’impossibilité de financer la transition écologique et la nécessité de réduire les dépenses sociales, certaines propositions, jusqu’alors totalement inaudibles, ont ainsi pu être enfin débattues, au moins dans les journaux (mais pas dans les couloirs des administrations fiscales).
C’est, par exemple, la proposition d’annuler la dette publique détenue par la banque centrale, celle de la transformer en dette perpétuelle, ou encore de mobiliser directement la création monétaire de la Banque centrale pour financer des programmes ciblés d’investissement public.
Ces différentes propositions s’inscrivent dans un changement de paradigme profond concernant la création monétaire et le financement de l’économie. Elles imposent de revenir sur la logique de la mise en marché de la dette publique et sur la réhabilitation de l’idée que l’outil monétaire peut être mis délibérément au service du bien commun.
Pour en savoir plus
Quelques propositions renouvelant la pensée sur l’outil monétaire.
- Une monnaie Ecologique, Alain Grandjean et Nicolas Dufrêne, Editions Odile Jacob, 2020
- La transition monétaire. Pour une monnaie au service du bien commun, Institut Veblen (2021)
- Pour un nouveau mode de création monétaire libre et ciblé sous contrôle démocratique, Policy Brief du résean PocFin et de l’Institut Rousseau (2021)
- Des annulations de dette publique par la BCE : lançons le débat, Terra Nova, 2020
Un pays avec une dette publique importante vivrait au-dessus de ses moyens
C’est également un argument récurrent des discours sur la dette publique. Il alimente notamment les débats européens entre les pays du Nord de l’Europe « vertueux », qualifiés de « fourmis », et les pays du Sud « laxistes », ayant une gestion « irresponsable » de leurs finances publiques, qualifiés de « cigales ».
Notons que cette caricature ne repose pas nécessairement sur des données empiriques même quand on se limite aux indicateurs budgétaires. L’Italie, un des pays les plus endettés d’Europe, a dégagé des excédents primaires tout le long de la période 1995-2019 (à une exception près) contrairement aux Pays-Bas… Mais la dette publique italienne est une histoire ancienne. Elle pesait déjà 119 % du PIB en 1995 (Source : Eurostat).
Par ailleurs, les écarts de taux d’intérêt entre les pays peuvent contribuer à alourdir encore le charge de la dette, sans lien avec la qualité de gestion des finances publiques. L’Italie a, par exemple, financé sa dette publique a des taux systématiquement supérieurs à ceux des Pays-Bas sur la période 2010-2015 (voir Base de données Ameco – Série 13-2 Long term nominal).
Source : L’Italie plus « fourmi » que l’Allemagne, Alternatives Economiques, 2020
Au-delà des indicateurs budgétaires, nous souhaitons interroger ici l’idée de « vivre au-dessus de ses moyens ».
Quels sont les « moyens » d’un pays ?
On peut regrouper les « moyens » d’un pays en deux grandes catégories.
Les ressources dont il dispose sur son propre sol pour produire ce dont ses citoyens ont besoin :
- les ressources naturelles (énergie, eau douce, matières premières minérales), les espaces agricoles, forestiers et espaces naturels, l’accès à la mer et donc aux ressources halieutiques ;
- les habitants, leur force de travail, leurs compétences, savoir-faire et niveau de formation ;
- les infrastructures physiques (réseaux d’électricité, d’eau, de transport, de télécommunication, gestion des déchets) ;
- le capital productif : les usines et les machines
- le patrimoine immobilier et sa qualité (à la fois utile pour bien vivre et pour l’activité touristique)
- les institutions (justice, police, armée, éducation, santé, système bancaire), nécessaires pour créer un environnement productif attractif.
La capacité à dégager des ressources financières suffisantes pour se procurer les biens et les services qu’il n’a pas sur son propre sol (ex : l’énergie, les aliments, les biens de l’économie numérique).
On le voit, les moyens d’un pays dépendent à la fois de son patrimoine naturel (et de sa capacité à l’entretenir) et de son histoire, de ses investissements passés dans le capital productif mais aussi dans toutes les infrastructures et institutions qui permettent le bon fonctionnement d’une société et donc d’une économie.
Qu’est-ce qu’un pays qui vit au-dessus de ses moyens ?
Il est exact qu’une nation (donc au niveau économique l’ensemble des agents qui la composent et pas seulement l’Etat) ne peut vivre durablement au-dessus de ses moyens. Mais, comme on vient de le voir, ses moyens ce ne sont pas les recettes de l’Etat (les prélèvements obligatoires), mais ses ressources, ses institutions et sa capacité à acheter hors de ses frontières.
Un pays qui vit au-dessus de ses moyens, c’est donc un pays qui ne dégage pas assez de ressources sur son territoire pour financer ses achats hors de ses frontières. La balance des transactions courantes 26 est pour cela un indicateur pertinent.
A ce titre, la France apparaît bien comme un pays qui vit au-dessus de ses moyens (voir un argumentaire de Benjamin Brice, Docteur en sciences politiques à l’EHESS, ici). Mais ce n’est pas nécessairement lié au niveau de la dette publique. Le Japon qui a le niveau de dette publique le plus élevé du monde mais une balance courante positive depuis plus de dix ans est un bon contre-exemple. De même que l’Italie. Voir les statistiques des comptes courants ici.
Une nation qui vit au-dessus de ses moyens, c’est également une nation qui dilapide son patrimoine naturel. L’exemple dramatique de l’île de Nauru est là pour nous le rappeler. Grâce à l’exploitation du phosphate, cette île, la plus petite République du monde, fut dans les années 1970-1980 l’un des pays les plus riches de la planète. A la suite de l’épuisement de cette ressource, l’économie de l’île ne parvint pas à rebondir. Aujourd’hui, Nauru est un État en ruine, une île littéralement dévastée.
A cet égard, c’est bien l’humanité dans son ensemble qui vit au-dessus de ses moyens tant parce que nous dilapidons les ressources naturelles et parce que nous mettons à mal les grands équilibres écologiques de notre planète (voir notre module Ressources naturelles et pollutions)
Quels sont les critères de bonne gestion pour un Etat ?
L’Etat étant le garant de l’intérêt général, il a la responsabilité de gérer les ressources de la nation. Ses critères d’une bonne gestion doivent donc être macroéconomiques et non microéconomiques. En particulier, il doit pouvoir, si nécessaire, investir ou orienter les investissements privés pour économiser les ressources rares de la nation et valoriser celles qui permettent de développer la capacité nationale d’achat hors de ses frontières (via les exportations de biens et services) afin d’acquérir les ressources dont il n’est pas richement doté. Ces investissements concernent plusieurs domaines clés : le patrimoine naturel et physique, les infrastructures y compris urbaines et immobilières visant à économiser l’énergie et les ressources rares importées, ainsi que la santé, l’éducation et la formation, la recherche.
Une vision étroitement comptable du rôle de l’Etat peut donc le conduire à faire des choix stupides au plan collectif. Par exemple, un Etat qui investirait massivement pour exploiter ses ressources naturelles afin de les exporter et de faire grimper le PIB sans développer par ailleurs les moyens d’une production nationale. Que veut dire être bon gestionnaire, si on laisse son pays sous-investir et, notamment, ne pas réaliser les dépenses nécessaires à la prévention de risques pandémiques ou climatiques ?
L’investissement public évincerait les investissements privés
La théorie de l’éviction de l’investissement privé par l’investissement public a été avancée pour la première fois dans les années 1920-1930 dans le cadre des débats opposant au Royaume Uni l’économiste John Maynard Keynes (1883-1946) à certains économistes tenant de la rigueur budgétaire. Elle a été formulée ainsi par Winston Churchill, alors chancelier de l’Échiquier :
Quand le gouvernement emprunte sur le marché de l’argent, il entre en compétition avec l’industrie, attire à lui des ressources qui autrement auraient été utilisées par le secteur privé et, ce faisant, il fait grimper le loyer de l’argent pour tous ceux qui en ont besoin.
Ainsi, en s’endettant pour investir, l’Etat accroitrait la demande de financement dans l’économie, ce qui provoquerait une hausse des taux d’intérêt et pénaliserait l’investissement privé. Deux arguments sous-tendent cette assertion : les ressources financières seraient limitées et l’investissement public serait moins bénéfique que les investissements privés.
Cette théorie a ensuite été reprise Milton Friedman (1912-2006) et les monétaristes à partir des années 1960 pour critiquer des politiques budgétaires expansionnistes.
Keynes avait déjà contrecarré cette assertion en mobilisant deux arguments majeurs.
- L’investissement ne dépend pas seulement du loyer de l’argent mais aussi et surtout de l’anticipation des entrepreneurs quant à l’évolution de leurs carnets de commandes ;
- En situation de dépression économique, l’épargne et la main d’œuvre étant abondantes, l’investissement public n’évince pas les investissements privés mais mobilise des ressources inutilisées, oisives. Or, c’est précisément en situation de ralentissement économique que Keynes recommande de mener une politique budgétaire expansive.
Par ailleurs, l’investissement public présente souvent des caractéristiques peu attractives pour les acteurs privés. Ecoles, hôpitaux, réseaux d’électricité, d’eau ou de transport : il s’agit d’investissement très onéreux dont la rentabilité attendue ne peut intervenir que sur le très long terme, quand elle existe. Ils apportent des bienfaits à la société bien au-delà de leur seule rentabilité économique. Il en va de même pour nombre d’investissements nécessités par la transition écologique. A partir du moment où ces projets ne peuvent rencontrer l’intérêt des investisseurs privés, il ne peut y avoir d’effet d’éviction.
Enfin, en période de récession, l’investissement public peut constituer un puissant moteur de redynamisation de l’activité économique grâce au multiplicateur budgétaire (voir L’essentiel 10, sur le déficit comme outil face aux crises et notre fiche sur le multiplicateur de dépenses publiques . ).
Toutes les conditions que nous venons d’énumérer sont bien présentes dans la période actuelle. La main d’œuvre inemployée est abondante, de même que les ressources financières (du fait des politiques monétaires accommodantes et des hauts niveaux d’épargne). Les taux d’intérêt sont à des niveaux historiquement bas. Enfin, les besoins d’investissement de long terme pour répondre aux enjeux de la transition écologique sont très importants (voir la proposition Lancer un plan de reconstruction écologique). L’argument de l’effet d’éviction visant à discréditer l’investissement public est donc nul et non avenu !
- La question de la discipline budgétaire était déjà au cœur des débats opposant l’économiste John Maynard Keynes et les économistes de Cambridge dans les années 1930. L’argument principal pour s’opposer à l’intervention publique était alors celui de l’éviction des investissements privés par les investissements publics. Pour en savoir plus, voir Idée reçue 6. ↩︎
- « Expertise économique et politique publique : examen critique des propositions sur la dette liée à la pandémie », LIEPP Working Paper, 2020 ↩︎
- Cantonner la dette COVID consisterait à isoler la dette contractée pour faire face à la pandémie puis à définir un échéancier de remboursement soit via des ressources nouvelles soit via des ressources existantes. ↩︎
- La situation est bien différente dans le cas d’une faillite d’entreprise qui est mise en liquidation judiciaire (les créanciers pouvant alors se rembourser sur la vente des machines, locaux, stocks) ou du défaut d’un ménage dont les biens peuvent être saisis. ↩︎
- Dans le cas d’une récession, cela signifie que loin de se serrer la ceinture comme la majorité des agents économiques, la puissance publique augmente ses dépenses et/ou baisse ses recettes (les impôts). ↩︎
- « L’ARN messager est une innovation de l’université de Pennsylvanie, qui a laissé à une biotech du Wisconsin le soin de faire fructifier le brevet, BioNTech et Moderna ayant payé seulement 75 millions de dollars chacun pour avoir le droit de l’utiliser. La deuxième innovation, celle liée à la fameuse protéine « spike » qui permet aux vaccins d’être efficaces, provient des travaux de l’université du Texas et du National Institutes of Health. » Extrait de l’article Libérez les vaccins !, Alternatives Economiques, 2021. ↩︎
- Une créance est la somme d’argent que le créancier doit recevoir de son débiteur (l’individu ou l’organisation qui lui a emprunté de l’argent). ↩︎
- La seule exception est la crise de la dette publique qui a touché certains pays européens au début des années 2010. ↩︎
- En fait, pour obtenir 0 il faut inverser le signe du solde de la balance financière. En effet, le solde du compte financier est interprété comme une capacité de prêt net au reste du monde lorsqu’il est positif, et un emprunt net au reste du monde lorsqu’il est négatif. Voir plus ici ↩︎
- Voir les statistiques de tous les pays du monde sur le site de la Banque Mondiale. ↩︎
- En effet, la banque centrale peut toujours créer de la monnaie soit pour acheter directement les titres de dette émis par l’Etat dont elle gère la monnaie, soit pour les racheter sur le marché secondaire (comme dans le cas de la zone euro où la banque centrale européenne n’a pas le droit d’acheter directement les titres de dettes des Etats membres). Voir l’Essentiel 3. ↩︎
- Le taux directeur est le taux auquel la banque centrale prête de la monnaie centrale aux banques secondaires. Il influence l’ensemble des autres taux d’intérêt de l’économie (taux de marché, taux de crédit). En savoir plus dans le module sur la monnaie. ↩︎
- Il peut également décider de dévaluer sa monnaie afin de rendre ses exportations plus attrayantes. ↩︎
- Le système monétaire est organisé en plusieurs niveaux hiérarchiques : au premier niveau se trouve la banque centrale qui crée la monnaie qui circule entre les banques ; au second niveau, se trouvent les banques secondaires (d’où cette appellation) qui créent la monnaie qui circule dans l’économie. Le dernier niveau est constitué par les autres agents économiques (ménages, entreprises, institutions financières non bancaires) qui utilisent la monnaie créée par les banques. A noter, qu’il existe d’autres appellations pour les banques selon leurs activités ou leurs types de clients (banque commerciale, de détail, d’investissement, de financement etc.) ↩︎
- Selon les pays ou les zones monétaires, cette interdiction peut être formellement inscrite dans le droit (c’est le cas dans l’Union européenne où elle est inscrite dans les traités) ou résulter de la pratique, des croyances dominantes sur ce que doivent être le rôle et les moyens d’action des banques centrales. ↩︎
- Rossi Abi-Rafeh, Gaël Giraud, Florent McIsaac, « La dette publique française justifie-t-elle l’austérité budgétaire ? », 2012. ↩︎
- Indépendamment des contraintes formelles ou juridiques liées en Europe aux règles budgétaires inscrites dans les traités (voir l’Essentiel 9). ↩︎
- Voir par exemple le tableau de bord de l’économie française ou les « tendances sur l’économie » sur la page d’accueil d’Eurostat. ↩︎
- Il ne faut pas confondre la dette publique brute des comptes nationaux (3312 milliards en 2019) et la dette publique au sens de Maastricht (2380 mds en 2019). Deux différences fondamentales : la première est non consolidée (elle inclut les dettes que les administrations publiques se doivent les unes envers les autres) et elle est exprimée en valeur de marché (c’est-à-dire la valeur à laquelle s’échangent les titres de dette sur les marchés financiers). La dette au sens de Maastricht est consolidée et exprimée en valeur nominale (c’est à dire la valeur de remboursement). ↩︎
- Dans la plupart des pays, les monuments anciens ne sont pas enregistrés dans les actifs publics, alors que les monuments relativement récents – pour lesquels des investissements sont observables – le sont plus souvent. En France, par exemple, le musée du Louvre n’est pas inscrit à l’actif du bilan de l’État (seule la valeur du terrain sous-jacent aux bâtiments est enregistrée). Par contre, la pyramide du Louvres, construite en 1989, est enregistrée et évaluée sur la base de ce qui a été payé pour la construire. Voir « Les comptes de patrimoine et de variations de patrimoine » Insee, 2008. ↩︎
- Voir les explications sur la fiche consacrée aux actifs des administrations publiques sur le site de Fipeco et pour plus de détails sur les méthodes employées « Les comptes de patrimoine et de variations de patrimoine » Insee, 2008. ↩︎
- Voir le site du Hellenic Republic Asset Development Fund, le fonds chargé des privatisations en Grèce. ↩︎
- Il existe bien sûr également des échanges entre les agents économiques au sein d’un même secteur institutionnel. Les entreprises échangent entre elles par exemple. Cependant, en comptabilité nationale on adopte une approche macro-économique dite consolidée ce qui signifie que les transactions entre les agents économiques d’un même secteur sont supprimées pour ne garder que celles avec d’autres secteurs. ↩︎
- ll s’agit d’une catégorisation réalisée par la Banque mondiale. Pays pris en compte : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Corée du Sud, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni et États-Unis. ↩︎
- Voir L’Imposture économique, Les Editions de l’Atelier, 2017 ↩︎
- La balance courante dresse le solde des échanges (de biens, de services et de revenus) entre un pays et le reste du monde. Si elle est positive, cela signifie (en simplifiant) que le pays exporte plus qu’il n’importe. Si elle est négative, c’est l’inverse. Pour en savoir plus, voir l’encadré dans l’Essentiel 4. ↩︎
- Inscrits dans le droit européen dès le traité de Maastricht en 1992, ils sont aujourd’hui retranscrits dans l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pour le principe) et dans le Protocole n°12 pour les valeurs à respecter. ↩︎
- Guy Abeille a été chargé de mission au ministère des Finances sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, au début de celle de François Mitterrand. Lire son témoignage La petite histoire des 3 % du PIB, publié dans le numéro 40 de Variances et un résumé Déficit : comment est née la règle européenne des 3% (Le Figaro – 10/09/16). ↩︎
- Ces différents éléments sont inscrits dans les articles 123, 127 du traité de fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole n°4 annexé au traité. L’interdiction d’être prêteur en dernier ressort a été contournée par la BCE depuis 2015 via les politiques d’assouplissement quantitatif qui consistent à racheter des titres de dette publique sur le marché secondaire. La BCE n’achète toutefois pas de titres de dette directement aux Etats (voir module sur la monnaie). ↩︎
- Les réformes de la gouvernance économique européenne de 2005, puis de 2011-2013 ont tenté de remédier à ce biais procyclique en créant une nouvelle règle relative au déficit structurel. Très schématiquement, il s’agit pour les Etats de définir un objectif budgétaire à moyen terme (OMT) en excluant du calcul du déficit les éléments liés à la conjoncture. Cependant, cette règle est venue s’ajouter et non remplacer celle des 3%. Elle repose, de plus, sur un indicateur non observable « le PIB potentiel », dont le calcul est largement contesté (voir notre fiche Déficit structurel et PIB potentiel). ↩︎
- La dernière version du SEC, le SEC 2010, a été adoptée via le Règlement 549/2013. Il comprend des règles méthodologiques contraignantes afin de garantir la comparabilité des agrégats de la comptabilité nationale, ainsi qu’un programme obligatoire de transmission de données. Ces règles sont appliquées par les services statistiques des Etats membres et validées par Eurostat. ↩︎
- Dans un texte paru fin 2014 sur le site de la Fondation Robert Schuman. ↩︎
- Les actifs désignent ici ce que possède l’entreprise : usines, bâtiments, machines, brevets, titres financiers, trésorerie etc. ↩︎
- Réduire ses achats auprès de ses fournisseurs et sous-traitants, reporter à plus tard des investissements, réduire le temps de travail de ses salariés, éventuellement en licencier. ↩︎
- Voir des références sur ce sujet à la fin de notre fiche sur le multiplicateur de dépenses publiques. ↩︎
- Que ce soit lors de la première vague (par exemple si l’Etat a soutenu la consommation des ménages) ou des vagues suivantes (par exemple, l’Etat réalise des commandes auprès d’entreprises nationales mais le revenu généré grâce à ces commandes est ensuite dépensé en biens importés). ↩︎
- Travailler sur une planète plus chaude: L’impact du stress thermique sur la productivité du travail et le travail décent OIT 2019 ↩︎
- Rénovation des parcs de bâtiments publics, entretien des forêts et des espaces naturels, développement des réseaux de transports en commun etc. ↩︎
- Par exemple : énergies renouvelables (électriques et thermiques) versus énergie fossiles ; agroécologie et agroforesterie vs agro-industrie ; véhicule électrique versus véhicule thermique ; chimie du pétrole versus chimie verte. ↩︎
- Créé en 2012 dans le sillage de la crise des dettes publiques européennes, le Mécanisme européen de stabilité (MES) pallie l’un des défauts originels de l’Union monétaire : l’absence de mécanismes de solidarité internes à la zone euro. Schématiquement, quand un Etat n’a plus accès aux marchés financiers (car les taux sont trop élevés), il peut emprunter au MES (qui lui-même emprunte sur les marchés à des taux très bas grâce à la garantie apportée par l’ensemble des pays de la zone). ↩︎
- La législation européenne prévoit que les pays qui demandent une assistance financière au MES, au FMI ou à un autre Etat doivent faire l’objet d’une « surveillance renforcée » par la Commission et remettre un plan d’ajustement macroéconomique. En savoir plus dans notre fiche sur la gouvernance économique européenne (partie 3.B). ↩︎
- C’est l’hypothèse de « contraction budgétaire expansionniste », développée pour la première fois en 1990 dans Giavazzi, F. Pagano, M. « Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries », NBER Macroeconomics Annual. ↩︎
- Voir par exemple : Fatas, A. Summers, L. H. « The Permanent Effects of Fiscal Consolidations » Journal of International Economics, 2018 ; Gechert, S. Horn, G. & Paetz, C. « Long-term Effects of Fiscal Stimulus and Austerity in Europe », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2018 (preprint accessible ici). ↩︎
- Par exemple, en France les principaux paramètres du régime général sont : l’âge de départ à la retraite, le nombre de trimestre qu’il faut avoir travaillé pour toucher une retraite à taux plein, le revenu sur la base duquel est calculé le montant de la retraite (ex : 10 dernières années, 10 meilleurs années etc.). ↩︎
- Voir la série du journal Le Monde « La France et les épidémies » (cinq articles) ↩︎
- Voir Andreas Tsounis, Pavlos Sarafis, Evangelos C Alexopoulos « Austerity and its consequences on cancer screening in Greece », The Lancet (2014) ; Wrong prescription: The impact of austerity measures on the right to health in Spain, Amnesty international (2018). Exemples issus du livre La dette publique, Précis d’économie citoyenne, Les économistes atterrés, Seuil (2021). ↩︎
- C’est à dire l’Etat, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale. ↩︎
- On parle ici des Etats qui peuvent s’endetter dans leur propre monnaie. La situation est bien plus difficile pour ceux dont ce n’est pas le cas. Voir L’essentiel 4. ↩︎
- Pour plus de détails sur la façon dont les Etats émettent des titres de dette, voir l’Essentiel 3. ↩︎
- Pour en savoir plus voir Pollin, R. « Public debt, GDP growth, and austerity: why Reinhart and Rogoff are wrong », LSE blog, (2014) et la vidéo Les politiques d’austérité : à cause d’une erreur excel ! sur la Chaine Youtube Sciences étonnantes. ↩︎
- Voir dans l’article How influential was the Rogoff-Reinhart study warning that high debt kills growth?, Quartz (2013) différents exemples où l’article de Reinhart et Rogoff a été utilisé pour justifier des discours promouvant les politiques d’austérité. ↩︎
- D’autres facteurs sont présentés dans le rapport Fiscal Mythology Unmasked (2021 – Myth n°1) de l’ONG Finance Watch. ↩︎
- La budgétisation verte consiste à catégoriser chacune des dépenses publiques en fonction de son impact positif, négatif (subventions aux énergies fossiles) ou neutre sur l’environnement. ↩︎
- En France, la stratégie nationale bas carbone pourrait constituer la dimension climat de cette stratégie globale. ↩︎
- Dans l’étude L’État français se donne-t-il les moyens de son ambition climat ? (2021), la société Carbone 4 a par exemple identifié dans trois secteurs clés (transport de passager, logement, agriculture) les indicateurs permettant d’évaluer si la France est en passe d’atteindre ses objectifs climatiques. ↩︎
- La balance courante dresse le solde des échanges (de biens, de services et de revenus) entre un pays et le reste du monde. Si elle est positive, cela signifie (en simplifiant) que le pays exporte plus qu’il n’importe. Si elle est négative, c’est l’inverse. Pour en savoir plus, voir l’encadré dans l’Essentiel 4. ↩︎
- Source : Base de données Ameco de la Commission européenne (série 16.4 – Interest). ↩︎
- Pour en savoir plus sur les procédures auxquelles sont soumis les Etats européens demandant une assistance financière, voir notre fiche sur la gouvernance économique européenne point 3.B. ↩︎
- Dans les années précédant la crise financière, la tendance était plutôt à l’autosatisfaction. C’est ainsi que le FMI écrit dans son bulletin d’avril 2006 « La sophistication et la robustesse du système financier sont en partie dues à la récente explosion des dérivés du crédit et du crédit structuré, qui a permis de répartir les risques de crédit au sein d’un groupe plus large et plus diversifié d’investisseurs. La capacité d’absorption des chocs du système s’en trouve accrue, ce qui contribue à sa stabilité. » ↩︎
- En effet, un plan de reconstruction écologique aura notamment pour objet de réduire la dépendance aux énergies fossiles et plus généralement aux ressources naturelles (donc le coût de la facture énergétique et de l’importation de matières premières) ainsi que de relocaliser une partie de la production, notamment pour les biens essentiels. ↩︎
- On parle ici principalement des pays à haut niveau de revenus, émettant leur dette dans leur propre monnaie (voir L’Essentiel 4 sur les problèmes posés par le fait d’émettre sa dette dans une autre monnaie). Les pays en développement sont endettés sur les marchés financiers mais aussi auprès d’autres Etats ou d’agences de financement publiques, nationales ou internationales. ↩︎
- Voir par exemple : Kaminsky, G. (1999). « What triggers market jitters? A chronicle of the Asian crisis » The World Bank ; Longstaff, F. et al. (2011), « How sovereign is sovereign credit risk? », American Economic Journal: Macroeconomics ; DELATTE, A. L., et al. (2017). « Regime-dependent sovereign risk pricing during the euro crisis » Review of Finance. ↩︎
- En réalité, c’est évidemment bien plus complexe. Par exemple, le prix de l’ordinateur peut avoir baissé et celui de l’électroménager ou de la nourriture augmenté. Selon la définition de l’Insee, « l’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. » C’est une donnée macroéconomique qui concerne l’économie nationale dans son ensemble (ménages, entreprises, etc.). Elle ne se limite donc pas à la seule consommation des ménages et encore moins à un seul type de bien. ↩︎
- Le taux directeur est le taux auquel la banque centrale prête de la monnaie centrale aux banques secondaires. Il influence l’ensemble des autres taux d’intérêt de l’économie (taux de marché, taux de crédit). En savoir plus dans le module sur la monnaie. ↩︎
- « Sovereign Debt Restructurings 1950-2010 : Literature Survey, Data, and Stylized Facts », IMF Working Papers (2012) ↩︎
- Créé en 1956, le Club de Paris est un groupe informel de pays créanciers dont le rôle est de trouver des solutions coordonnées aux difficultés de paiement rencontrées par les pays débiteurs. Il regroupe aujourd’hui 22 membres permanents (principalement des pays occidentaux à haut niveau de revenu). Il compte également des participants ad-hoc et des observateurs (principalement des institutions internationales tels le FMI, l’OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne et des banques régionales de développement). ↩︎
- Voir Galofré-Vilà, G. Meissner, C. McKee, M. Stuckler, D., (2019) « The economic consequences of the 1953 London Debt Agreement, European Review of Economic History ↩︎
- La balance courante dresse le solde des échanges (de biens, de services et de revenus) entre un pays et le reste du monde. Si elle est positive, cela signifie (en simplifiant) que le pays exporte plus qu’il n’importe. Si elle est négative, c’est l’inverse. Pour en savoir plus, voir l’encadré dans l’Essentiel 4. ↩︎
- Discours sur le budget du 15 avril 1929 cité par Jacques Généreux La déconnomie, Edition du Seuil, 2016 (p194). ↩︎