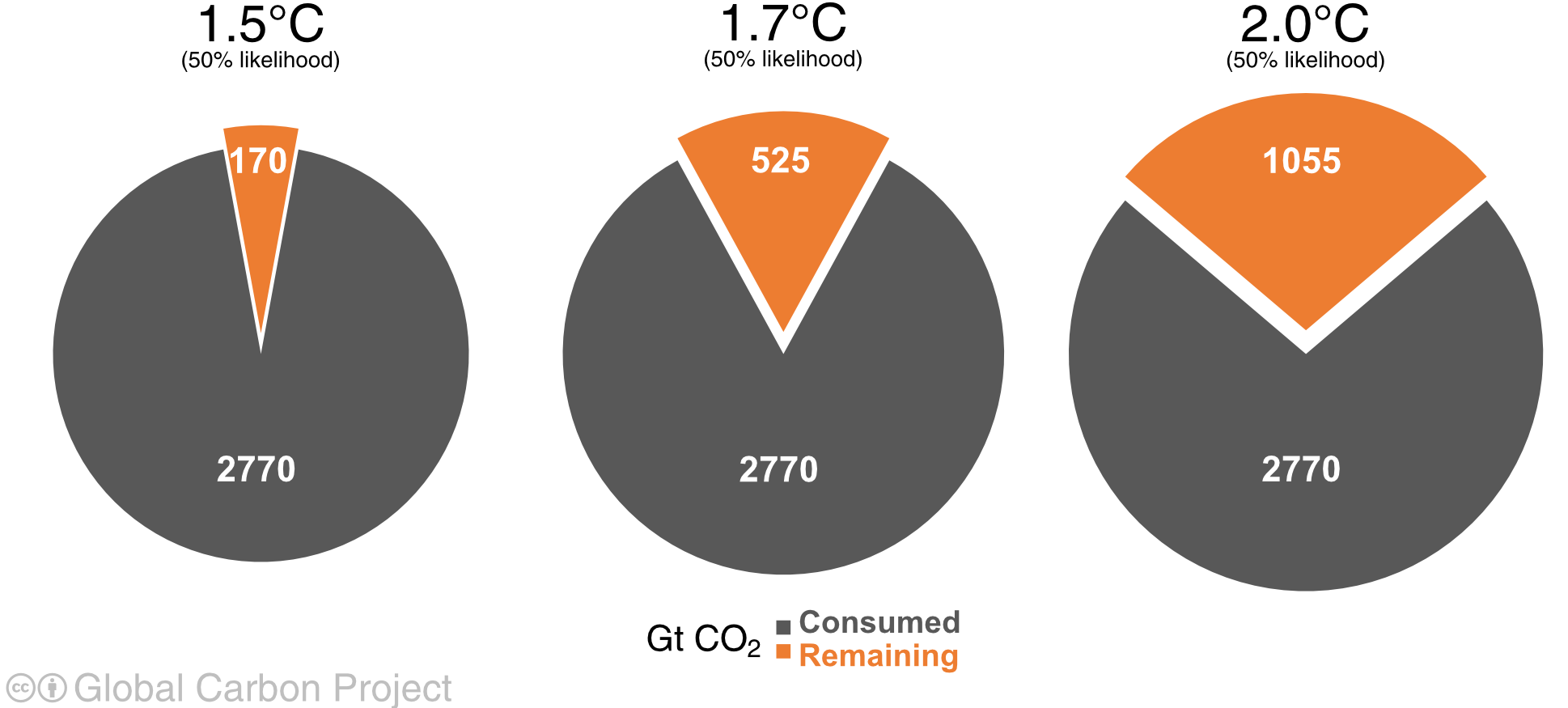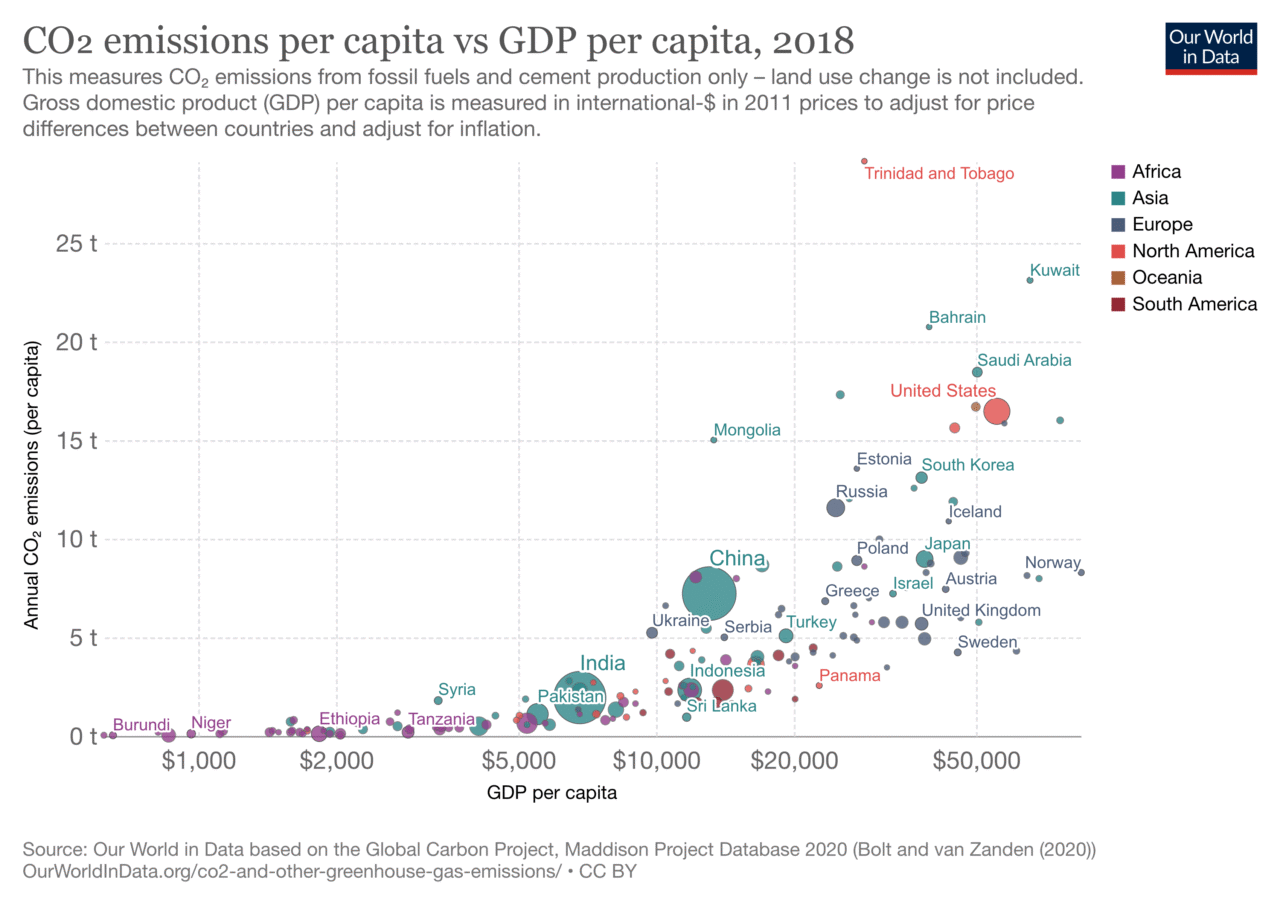Introduction
« Il sera bientôt trop tard ». Ce « cri d’alarme de 15 000 scientifiques pour sauver la planète » était en première page de l’édition du Monde fin 2017 1. Le constat de la crise écologique n’est pas nouveau. En 1972, le rapport « The Limits to Growth » commandé par le Club de Rome concluait déjà à l’impossibilité d’une croissance économique infinie dans un monde aux ressources naturelles limitées et aux pollutions croissantes. Depuis, les nombreux rapports alertant sur l’état de la planète se sont succédés, tout comme les sommets de la dernière chance.
En cause, le modèle de développement économique né à la fin du XVIIIe siècle en Europe. A l’entrée du système, nous consommons toujours plus de ressources naturelles et en sortie nous produisons toujours plus de déchets et de pollutions, le tout générant des déséquilibres planétaires tels le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’élévation du niveau de toxicité générale de notre planète.
En moins de 200 ans, l’humanité est devenue une force géologique capable de transformer profondément les conditions de vie sur Terre. C’est pourquoi certains scientifiques à la suite du prix Nobel Paul Crutzen proposent d’identifier une nouvelle ère géologique et de lui donner le nom d’Anthropocène 2.
Dans ce module vous trouverez des éléments pour comprendre :
- le constat de la crise écologique dans sa double dimension : les déséquilibres planétaires et la raréfaction des ressources ;
- l’absence d’une véritable prise en compte des enjeux écologiques par la majorité de la discpline économique ;
- les idées reçues : tant celles qui reviennent à nier l’existence des dégats environnementaux que celles qui parient sur une régulation autonome de notre modèle économique pour résoudre la crise écologique : la dématérialisation de l’économie, le développement économique permettant de réduire les pollutions, le progrès technologique salvateur.
L’essentiel
Climat, biodiversité, de nombreux déséquilibres globaux sont à l’œuvre
Tous ces déséquilibres ont déjà été étudiés et expliqués dans de nombreux rapports, livres, articles et vidéos. Nous n’en donnons donc ici qu’une vision synthétique ainsi que des pistes pour aller plus loin.
Quelques éléments communs au déséquilibres globaux
- Leurs conséquences sur les conditions de vie de l’humanité sont graves. Les déséquilibres naturels à l’œuvre accroissent et amplifient des événements naturels destructeurs et meurtriers (inondations, glissements de terrains, incendies etc.), détériorent l’accès à des ressources et services vitaux comme l’eau potable, la nourriture ou la qualité de l’air, et rendent inhabitables des régions aujourd’hui peuplées (désertifications, montée des eaux). La compétition d’accès aux ressources qui se raréfient et les migrations (internes ou externes aux pays) sont sources de déstabilisation sociale et de conflits.
- Les analyses globales doivent être complétées d’analyses locales. Si les causes du dérèglement climatiques sont globales, les conséquences sont inégalement réparties et sont plus marquées dans des zones pauvres aujourd’hui, qui ont en outre moins de capacités d’adaptation. Les enjeux d’érosion de la biodiversité, ou de pollution de l’air et des eaux varient selon leur localisation : un raisonnement sur ces impacts en moyenne au niveau mondial n’a parfois aucun sens.
- Ce sont des phénomènes dynamiques se déroulant sur des temporalités variées qui peuvent avoir une très forte inertie. Une forêt met 300 ans à devenir mature, un stock de poissons peut lui se reconstituer en 15 ans. En raison de l’inertie du système climatique, le réchauffement planétaire se poursuivrait pendant des décennies si l’on arrêtait aujourd’hui d’émettre des gaz à effet de serre. La montée des eaux, elle, a une inertie bien plus longue, et se poursuivra pendant des milliers d’années.
- Les multiples manifestations de la crise écologique sont liées et interdépendantes. Chaque crise nourrit et aggrave les autres. Par exemple, les forêts ont un rôle clé dans la filtration des eaux et leur stockage dans le sol. La déforestation dégrade donc la disponibilité et la qualité de l’eau. Les forêts atténuent le changement climatique (par leur capacité de stockage du carbone). Ce dernier aggrave la déforestation qui en retour augmente le réchauffement. La résilience aux conséquences de chaque crise dépend également des autres : la déforestation et l’érosion des sols aggravent fortement les conséquences des précipitations intenses pour en faire des inondations majeures ou coulées de boue meurtrières.
- Les effets ne sont pas progressifs et linéaires : il existe des points de bascule, des seuils qui une fois franchis provoquent un emballement. Un processus est dit « à effet de seuil » quand il existe un certain niveau de perturbation (qualifié de seuil, ou de point de bascule) en dessous duquel la conséquence est proportionnelle à la perturbation, et au-delà duquel les choses se mettent à évoluer de manière totalement différente. Notre climat est rempli de tels processus : arrêt des courants océaniques, température maximale que supportent les coraux, ou encore l’élévation de température maximale que le Groenland peut supporter sans fondre 3. De la même manière, les équilibres de la biodiversité sont complexes et une pression relativement plus forte peut conduire à un effondrement brutal de la population d’une espèce.
Le dérèglement climatique et ses nombreuses répercussions
Depuis le début de la révolution industrielle, le climat planétaire se réchauffe.
Ce point ne fait aujourd’hui plus débat tant les preuves physiques abondent. Le sixième rapport du groupe 1 du GIEC 4 paru en 2021 met ainsi en évidence une hausse de la température moyenne à la surface de la planète d’environ 1,1°C entre 1850 et 2020 ; une élévation du niveau moyen des océans de 20 cm depuis 1901 ; une baisse de 40% de la banquise arctique depuis 1979, un recul global des glaciers continentaux depuis les années 1990, une déstabilisation des calottes glaciaires aux pôles ; une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur en Europe, en Asie, ou encore en Australie ; un dérèglement du système des précipitations etc.
Evolution de la température globale de surface
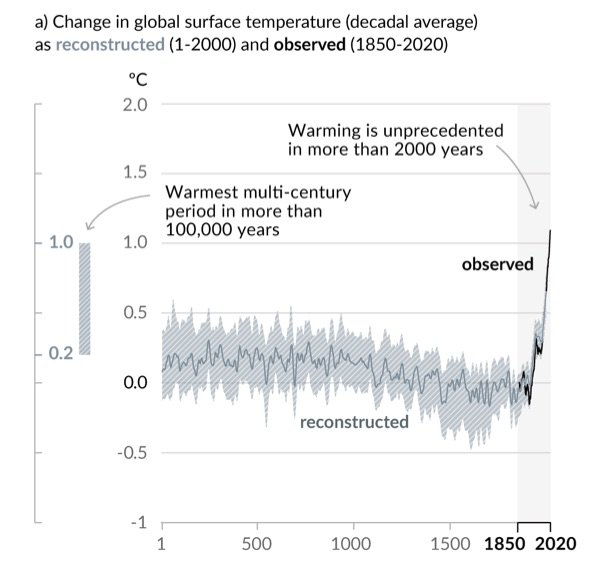
Source Climate Change 2021 – The physical science Basis – Résumé pour décideur du rapport du groupe de travail 1 du GIEC (Figure SPM1)
La température moyenne de la surface de la planète a été au cours de la décennie 2010 supérieure de 1,1°C à celle de la période 1850-1900.
Notons qu’il s’agit là de changements moyens globaux pour la planète dans son ensemble. En réalité, les changements de température, l’élévation du niveau des océans, les modifications du régime de précipitations sont bien évidemment différents d’une région à l’autre du globe.
La hausse des températures est différentes d’une région à l’autre du globe.
Le climatologue Ed Hawkins a conçu un graphique sur lequel les rayures allant du bleu (le plus froid) au rouge permettent de visualiser simplement l’évolution des températures de la fin du XIX° siècle à nos jours au niveau de la planète, d’une région ou d’un pays. Sur les graphiques suivants, on peut constater la réalité du réchauffement et surtout le fait qu’il est nettement plus prononcé en Arctique.
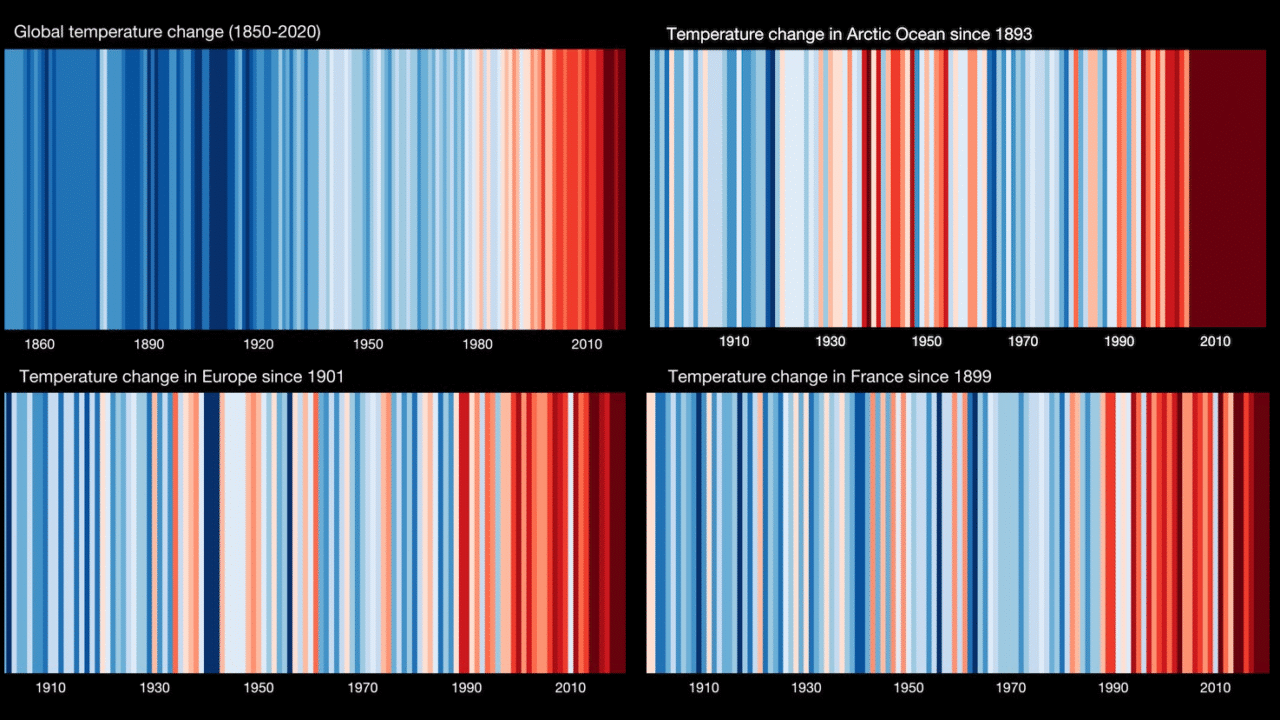
Source Sur le site #ShowYourStripes vous pouvez générer le graphique pour tous les pays du monde.
Les causes du dérèglement climatique sont désormais bien établies
Il est provoqué par les émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques, c’est-à-dire liées aux activités humaines . L’effet de serre est un phénomène naturel qui rend possible la vie sur Terre : sans lui, la température moyenne à la surface de la planète ne serait pas de +15°C mais de -18°C ! Les GES, responsables du phénomène, sont présents à l’état naturel dans l’atmosphère en très petite quantité.
Mais, comme on peut le voir sur le graphique suivant, depuis la fin du XIX° siècle, les activités humaines se sont traduites par des émissions croissantes de GES conduisant à une augmentation rapide de leur concentration atmosphérique.
Émissions de gaz à effet de serre mondiales 1850-2019
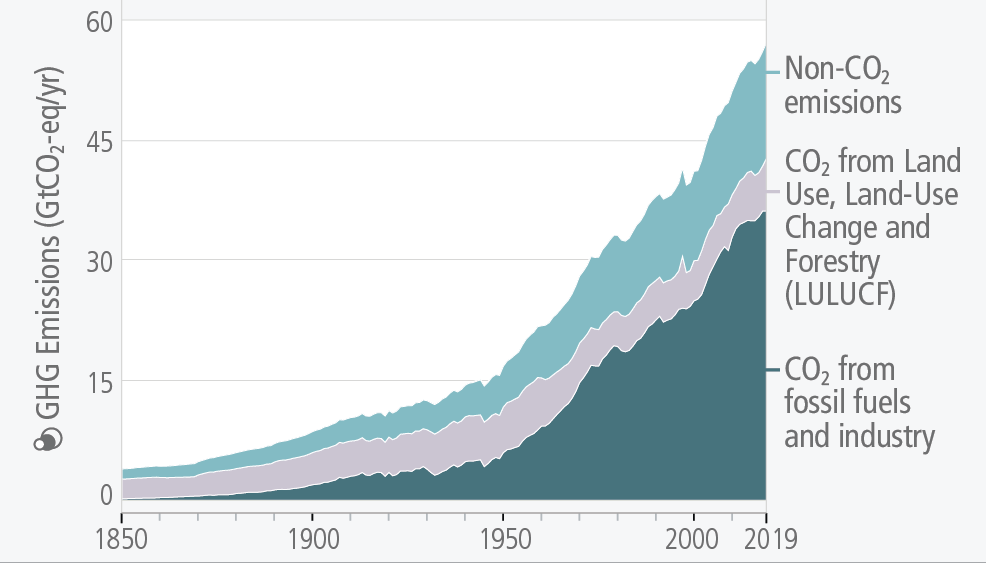
Source AR6 Synthesis Report – Climate Change 2023 – IPCC (Longer report p.43)
Les émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2019 sont proches de 59 GtCO2-eq (pour en savoir plus sur cette unité reportez-vous à notre fiche compter les émissions des gaz à effet de serre).
Quels effets du réchauffement climatique ?
Si nous ne parvenons pas à réduire drastiquement les émissions de GES, les impacts déjà constatés ne feront que s’accroitre au long du XXIè siècle.
Cela se manifestera par la hausse globale des températures 5 et l’accroissement des vagues de chaleur. Par exemple, selon une récente étude, pour un scénario d’émissions menant à plus de +4°C en 2100, environ 74 % de la population mondiale serait confrontée plus de 20 jours par an à des conditions de températures et d’humidité potentiellement mortelles car elles excèdent les capacités physiologiques d’adaptation du corps humain.
D’ici 2100, le niveau des océans pourrait s’élever de plus d’1 mètre par rapport à la période 1995-2014 (selon le 6è rapport du GIEC), ce qui touchera directement près d’une personne sur 10 dans le monde.
Autre préoccupation : l’extension des zones propices à la propagation de maladies portées par certains insectes, tels les moustiques vecteurs de la dengue, la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift ou du paludisme.
La puissance et le nombre des tempêtes (cyclones, ouragans, typhons etc.) augmenteront de même que les incendies de grande ampleur qu’on peut déjà constater aujourd’hui. Les pénuries d’eau se développeront tandis que la productivité agricole diminuera. Tous cela provoquera des migrations massives de populations 6 à l’intérieur des pays ou entre les pays ce qui constituera une source considérable d’instabilité politique.
Un point fondamental mis en évidence dans le dernier rapport du GIEC c’est que chaque demi-degré compte. C’est ce qu’avait également montré le rapport du GIEC Global warming of 1,5°C (2018) 7. Plus le réchauffement est important, plus les impacts sur l’humanité le sont.
La fréquence et l’intensité des phénomènes extrêmes augmenteront avec chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire
Les graphiques ci-après montrent comment des phénomènes extrêmes (températures extrêmes, fortes précipitations, sécheresses) qui se produisaient en moyenne une fois par décennie dans un climat sans influence humaine (période de référence 1850-1900) augmentent en fréquence et en intensité selon différents niveaux de réchauffement (+1°C c’est-à-dire aujourd’hui, +1,5°C, + 2°C et +4°C par rapport 1850-1900).
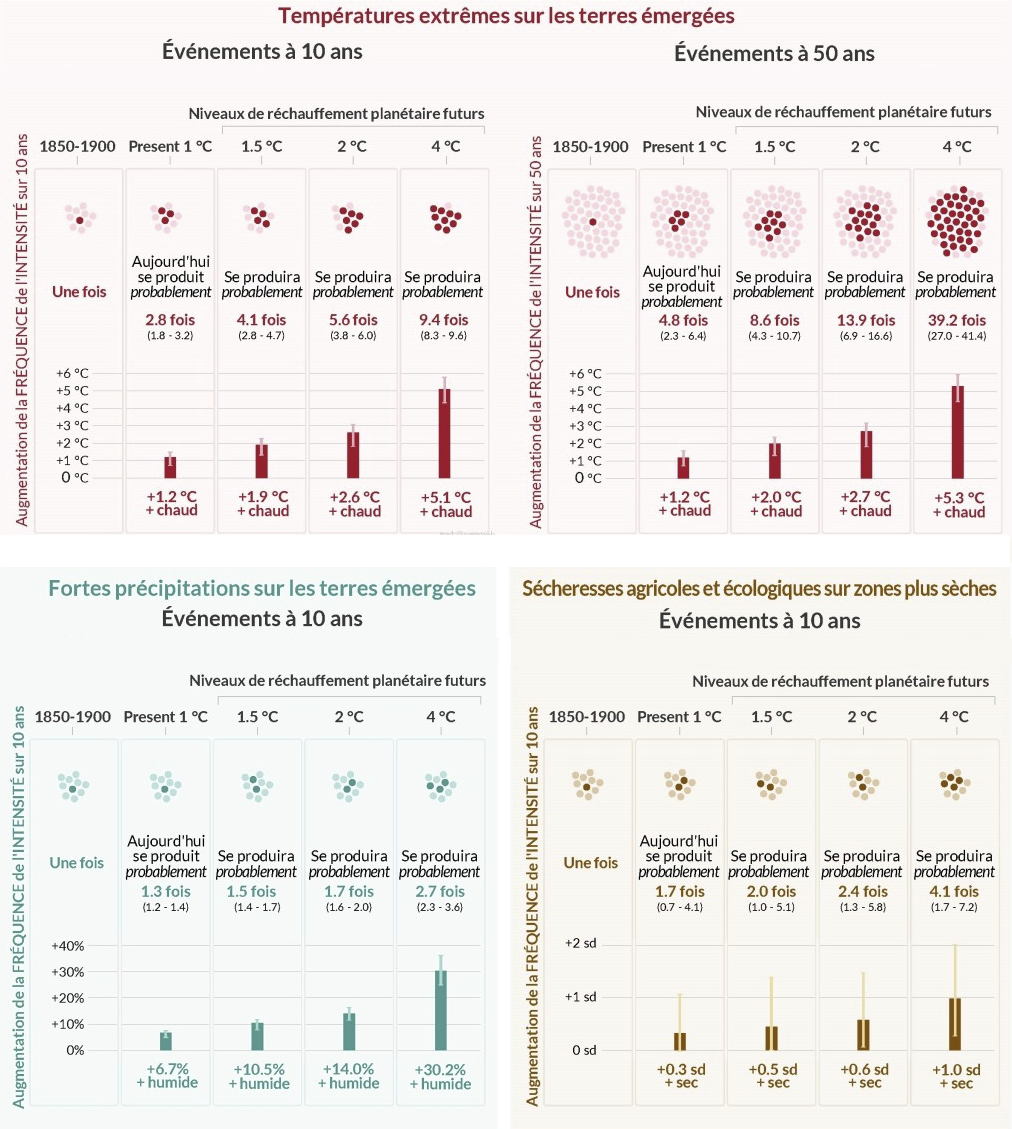
Source Climate Change 2021 – The physical science Basis – Résumé pour décideur du rapport du groupe de travail 1 du GIEC (Figure SPM6).
Lecture : le graphique en haut à gauche montre que les températures maximales quotidiennes qui étaient atteintes une fois par décennie dans la période 1850-1900, sont atteintes 2,8 fois par décennie avec un réchauffement globale de 1°C (qui correspond au climat actuel) et seront probablement atteintes 9,4 fois par décennie avec un réchauffement de 4°C. En plus de cette augmentation de leur fréquence, ces phénomènes augmentent aussi en intensité (ils sont 1,2°C plus chauds avec un réchauffement global de 1°C, et 5,1°C plus chaud avec un réchauffement de +4°C).
Où en sommes nous ?
Dans l’Accord de Paris adopté lors la COP21 fin 2015, les Etats du monde entier ont énoncé l’objectif de limiter « l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels« , seuil au-delà duquel les scientifiques craignent un effet d’emballement du système climatique 3.
Pour y parvenir, il faudra réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous pour limiter le réchauffement à + 1,5°C ou +2°C, il faut que les émissions de CO2 diminuent jusqu’à devenir nulles (vers 2050 pour 1,5° C et entre 2050 et 2100 pour 2°C), puis négatives (c’est-à-dire qu’on met en place des technologies qui retirent du CO2 de l’atmosphère _ voir ici). Les réductions nécessaires sont également très importantes pour les autres gaz à effet de serre (division par trois d’ici 2100 pour le méthane).
Emissions annuelles mondiales de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) d’ici 2100 selon 5 scenarios du GIEC.
Le GIEC travaille sur cinq scénarios d’émissions : émissions très élevées ou élevées, émissions moyennes, et émissions faibles ou très faibles. Chacun de ces scenarios correspond à différents niveaux de réchauffement futurs. Les scenarios SSP1-1.9 et SSP1-2.6 correspondent à une hausse des températures de respectivement +1,5°C et de +2°C. Le scenario SSP5-8,5 a une augmentation supérieure à 4°C.
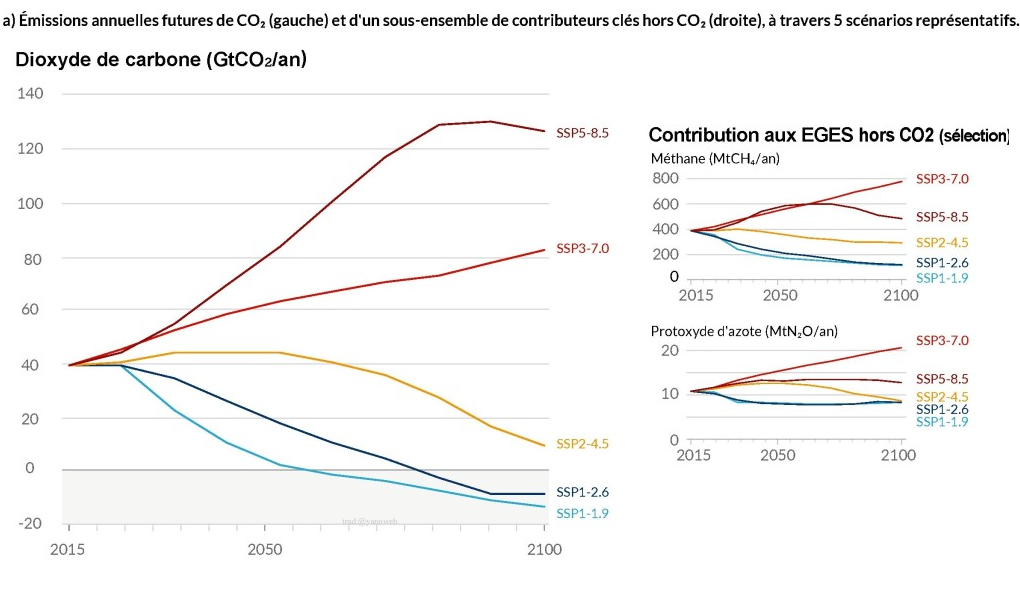
Source Climate Change 2021 – The physical science Basis – Résumé pour décideur du rapport du groupe de travail 1 du GIEC (Figure SPM4).
Une telle réduction des émissions de GES est un défi de taille car non seulement les émissions n’ont jamais cessé de croitre mais en plus elles sont liées à toutes les activités humaines : production d’énergie, agriculture et élevage, transport, process industriels, gestion des déchets etc.
Malheureusement, nous n’en prenons pas le chemin. Déjà, lors de la COP21, les engagements volontaire de réduction des émissions pris par chaque Etats étaient insuffisants pour atteindre l’objectif global de +2°C maximum. Les tendances actuelles nous mènent bien au-delà comme l’illustre l’image ci-après issue de l’Emission gap report 2024 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Projection des émissions mondiales de GES selon différents scénarios et écart avec les besoins de réduction des émissions en 2030 et en 2035
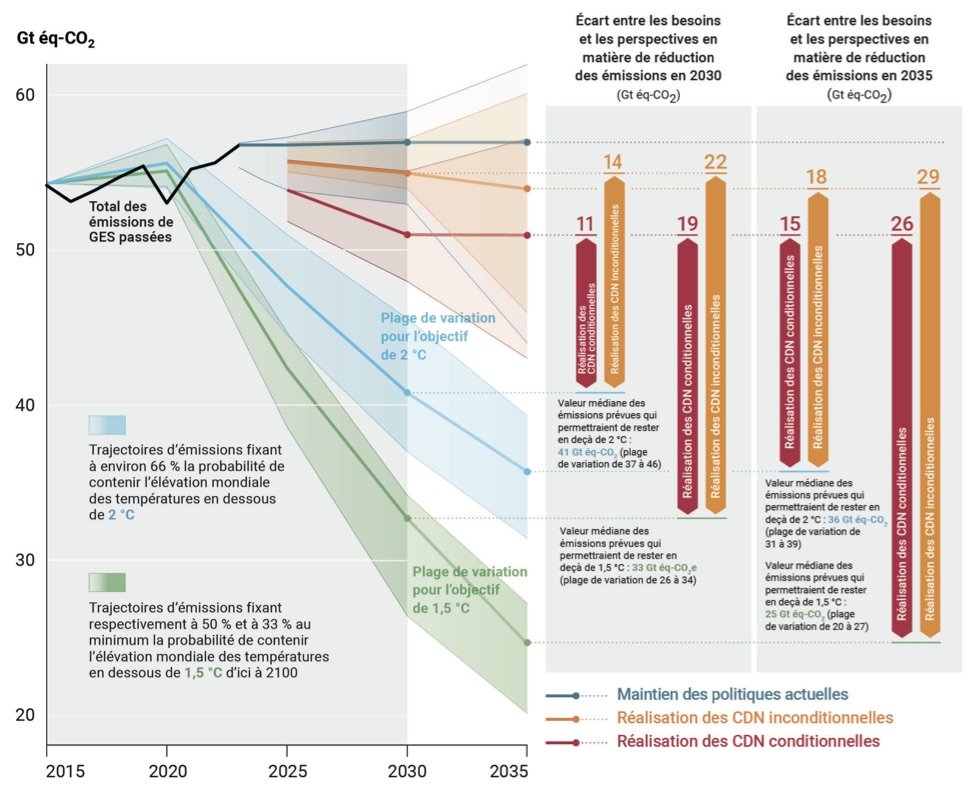
Source Emission gap report 2024 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (Résumé exécutif en français). CDN = Contribution Déterminée au niveau National (c’est-à-dire les engagements volontaires des Etats).
Selon les scénarios qui prennent pour hypothèse une poursuite des politiques climatiques déjà en cours, l’humanité atteindrait en 2030 des niveaux d’émissions supérieurs d’environ 25 GtCO2e à ce qu’il faudrait faire pour limiter le réchauffement à 1,5°C.
Pour en savoir plus
Des ressources pour comprendre le climat et le réchauffement en cours
- Un cours très pédagogique pour comprendre le fonctionnement du climat, son évolution, et les liens avec les autres défis environnementaux
- Très nombreux articles sur le site de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici
- Podcast – Le climat en questions
Ressources pédagogiques sur le 6ème rapport de synthèse du GIEC
- Synthèse vulgarisée du 6ème rapport du GIEC par le think tank The Shift Project
- Une synthèse du rapport du GT1 sur le blog pédagogique « Bon pote »
- L’atlas interactif du GIEC : les évolutions régionales de température et de précipitations selon différents niveaux de réchauffement
Les conséquences du réchauffement climatique
- Une interview du climatologue Christophe Cassou qui fait le point sur les dernières connaissances scientifiques en matière d’impact du réchauffement
- Les impacts d’un réchauffement de 2°C bien supérieurs à ceux d’un réchauffement de 1,5°C – World ressource institute
- Impacts du réchauffement sur la santé humaine – Site de l’Encyclopédie de l’environnement
- Cartes de l’Agence européenne de l’environnement montrant certains impacts en Europe
- Dataviz et cartes montrant certains impacts du réchauffement aux Etats-Unis
Répondre aux climatosceptiques
L’effondrement de la biodiversité
Qu’est-ce que la biodiversité ?
La Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, définit la biodiversité comme étant la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, et entre les espèces et ainsi que celle des écosystèmes ». C’est donc un concept large, qui ne se limite pas au nombre d’espèces vivantes. C’est à la fois la diversité du vivant (des gènes aux écosystèmes en passant par les différentes espèces), ainsi que celle des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Pour reprendre les termes de l’écologue Robert Barbault c’est « la vie, dans ce qu’elle a de divers ».
Vidéo de Pierre-Henri Gouyon, écologue, expliquant dans Les Ernest ce qu’est la biodiversité
Une sixième extinction de masse
Selon les scientifiques, les activités humaines sont à l’origine d’une 6ème extinction de masse 9. Cela se manifeste non seulement par la disparition d’espèces et la chute drastique des effectifs de populations animales ou végétales au sein des espèces mais aussi par la destruction et la perturbation de grands écosystèmes tels les forêts sur les continents 10 ou les coraux dans les océans 11
Or, l’effondrement de la biodiversité est loin de concerner uniquement les amoureux des oiseaux ou des papillons. Les humains sont étroitement liés aux autres êtres vivants : nous sommes interdépendants, comme l’illustre la notion de services écosystémiques présentée ci-après. Comme le dit Robert Watson, président de l’IPBES 12, « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, comme toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier ».
Les services écosystémiques
Elaborée à la fin du XXème siècle, la notion de services écosystémiques traduit la multiplicité des biens et services que les humains retirent du bon fonctionnement du monde vivant et des écosystèmes.
C’est le rapport du Millenium Ecosystem Assessment 13 (2005) qui ancre la notion dans le débat public et dresse la typologie de ces services : services d’approvisionnement (nourriture, eau potable, bois etc.), services culturels (bénéfices spirituels, récréatifs, culturels, et pédagogiques), services de régulation (pollinisation des plantes, épuration de l’eau par les plantes et les micro-organismes, dispersion des graines, régulation du climat, protection contre l’érosion ou contre les inondations) et services de support de la vie (recyclage des éléments nutritifs, rétention et formation des sols, production d’oxygène atmosphérique, cycle de l’eau).

Source Rapport planète vivante 2016, WWF
Déjà en 2005, le rapport du Millenium Ecosystem Assessment mettait en évidence la très forte dégradation des services écosystémiques « Environ 60 % (15 sur 24) des services écosystémiques évalués dans cette étude (dont 70 % des services de régulation et des services culturels) sont dégradés ou utilisés de manière non durable. »
Les causes de l’effondrement de la biodiversité
Dans son premier Rapport d’évaluation globale de la biodiversité (2019), l’IPBES 12 identifie les principales causes de l’érosion de la biodiversité :
- la destruction et la fragmentation des habitats : changement d’usage des terres avec en particulier la déforestation au profit de l’agriculture et de l’élevage, mais aussi exploitation minière, construction de routes et étalement urbain ;
- la surexploitation des ressources naturelles : pêche, chasse, coupe de bois ;
- les changements climatiques
- les pollutions des eaux et des sols (par les pesticides, les déchets industriels, et les plastiques) ;
- et enfin les espèces exotiques envahissantes, c’est-à-dire les espèces introduites délibérément ou non dans une zone dont elle n’est pas originaire et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes (par exemple : le moustique tigre, les frelons asiatiques, ragondin etc. Voir une liste pour la France et l’UE ici)
Les causes de l’effondrement de la biodiversité
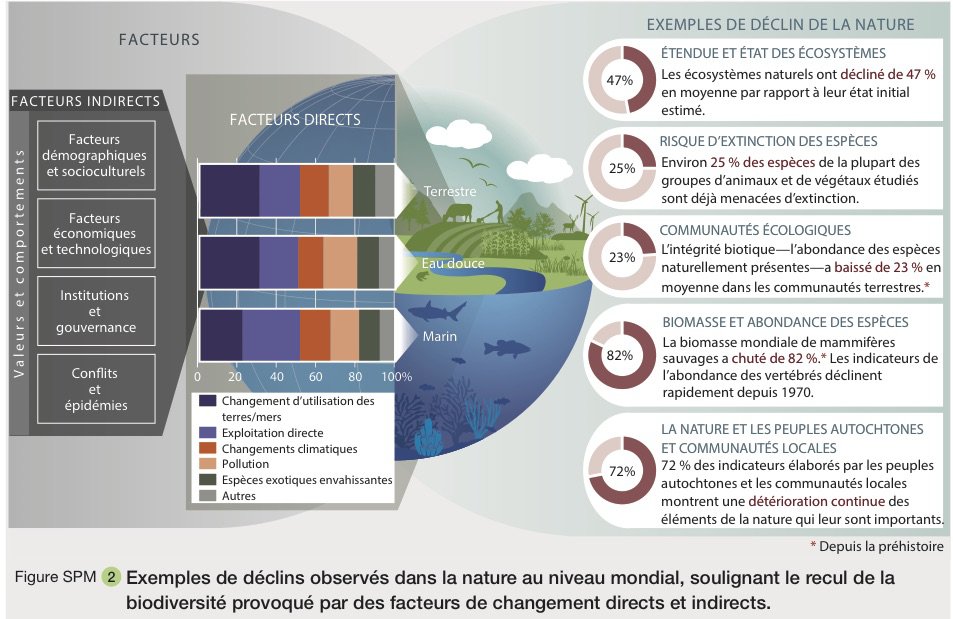
Source Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystèmiques (IPBES 2019) – Résumé pour décideurs (p25).
Où en sommes-nous ?
Lors de la COP10 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui s’est déroulée au Japon en 2010, les Parties à la Convention ont adopté le « Plan stratégique 2011-2020 » ainsi que les 20 « Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique » (décision X/2 de la COP10) afin d’enrayer l’effondrement de la biodiversité. Dix ans plus tard, le secrétariat de la CDB a publié son cinquième rapport sur Les perspectives mondiales de la diversité biologique : dans leur très grande majorité les objectifs d’Aichi n’ont pas été atteints. Face à ce constat, il appelle à un changement de cap de tout urgence. Le rapport décrit les transitions qui s’imposent dans huit domaines : terres et forêts, agriculture durable, systèmes alimentaires durables, pratiques de pêche et océans, villes et infrastructures, eau douce, approche « un monde, une santé ». Encore une fois c’est l’ensemble des activités et du mode de vie humain qui est concerné.
Pour en savoir plus
Ressources générales sur la biodiversité
- Qu’est-ce que la biodiversité ? article sur l’Encyclopédie de l’environnement
- Un éléphant dans un jeu de quilles (Seuil – 2008), un livre très pédagogique de Robert Barbault sur la biodiversité
- Le site de l’IPBES : les rapports traduisant le consensus scientifique international sur la biodiversité
- Le rapport Perspective Mondiale de la diversité biologique – CBD
Des ressources sur des domaines particuliers
Nos prélèvements croissants sur les ressources naturelles ne peuvent que conduire à leur épuisement
La dynamique exponentielle de nos prélèvements sur les ressources naturelles
Les volumes mondiaux de production-consommation de matières premières donnent le vertige. D’abord vient l’eau douce avec 4 000 milliards de tonnes par an, puis le sable et les graviers qui représenterait entre 40 et 50 milliards de tonnes par an. Du côté des énergies fossiles, le charbon vient en tête (8 milliards de tonnes annuelles, soit une tonne environ par habitant), suivi du pétrole avec plus de 93 millions de barils par jour (soit plus de 4,4 milliards de tonnes en 2022). Pour nous alimenter, nous avons produit près de 3 milliards de tonnes de céréales en 2018. Nous avons extrait environ 2,5 milliards de tonnes de minerai de fer en 2019 15.
Ces volumes ont fortement augmenté lors des dernières décennies. Les graphiques de la « Grande Accélération », publiés originellement en 2004 et actualisés en 2015, représentent de façon marquante l’accélération de la consommation globale de ressources naturelles depuis le 18ème siècle.
La grande accélération
En 2015, une équipe de chercheurs de l’IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme) et de l’Université de Stockholm dirigée par Will Stephen ont publié dans The Anthropocene Review un tableau de bord de 24 indicateurs planétaires pour la période 1750-2010 : 12 indicateurs physiques illustrant la dégradation de notre planète et 12 indicateurs socio-économiques reflétant les activités humaines.
A partir des années 1950, tous ces indicateurs connaissent une croissance exponentielle. C’est ce que les chercheurs ont nommé la « Grande Accélération ».
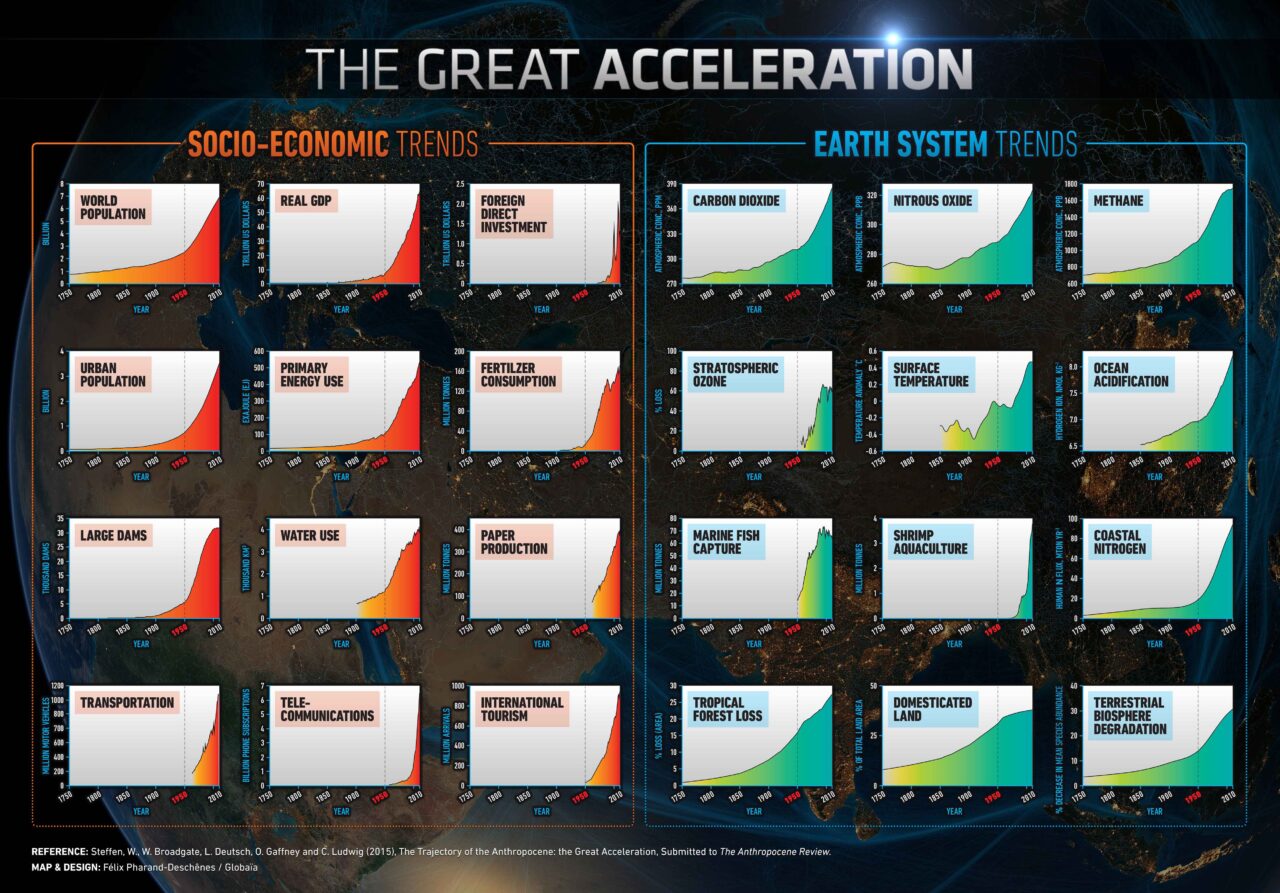
Source – Retrouvez les graphiques et les données sur le site de l’IGPB.
Consommation d’énergie, d’engrais, d’eau, de papier…. les courbes sont exponentielles. D’autres indicateurs économiques comme ceux concernant les transports (nombre de ventes de véhicules) ou les télécommunications (nombre d’abonnements téléphoniques) reflètent eux-aussi la consommation exponentielle des matières premières sous-jacentes.
Pour autant, bien que les volumes déjà atteints soient impressionnants, ils nous sembleront peut-être faibles d’ici quelques temps si l’augmentation suit une pente exponentielle.
Les propriétés mathématiques de l’exponentielle
Si une production suit une croissance exponentielle de 5% par an, elle sera multipliée par 131 au bout de 100 ans. En un siècle, la production cumulée sera égale à 2 740 fois le montant initial, et 39% de la production totale aura été réalisée au cours des dix dernières années.
A titre d’exemple, le taux de croissance annuel moyen de la production minière de Lithium sur la période 1985-2015 a été de 6,4% ; il est de 2,8% pour le cuivre 16.
Pour une réflexion plus élaborée sur les exponentielles, voir l’article Crise écologique : notre cerveau n’est pas programmé pour se la représenter !
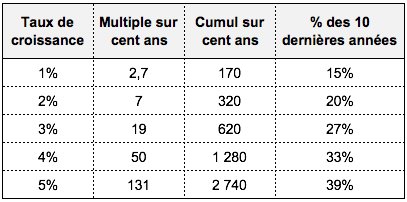
Les chiffres sont encore plus incroyables si l’on se penche sur la production cumulée et non plus annuelle.
Dans une étude parue dans la revue Nature 17, les chercheurs de l’Institut Weizmann ont calculé la « masse anthropique », c’est-à-dire la masse de matières inertes utilisées pour les constructions et productions humaines (bâtiments, infrastructures, véhicules, produits divers) depuis 1900.
En 2020, elle atteint 1154 milliards de tonnes et dépasse la masse de l’ensemble des êtres vivants sur la planète. Elle est composée pour moitié de béton et pour un tiers de granulats (matériaux particulaires utilisés dans la construction : sables, graviers, pierres concassées etc).
Evolution de la masse anthropique de 1900 à 2020
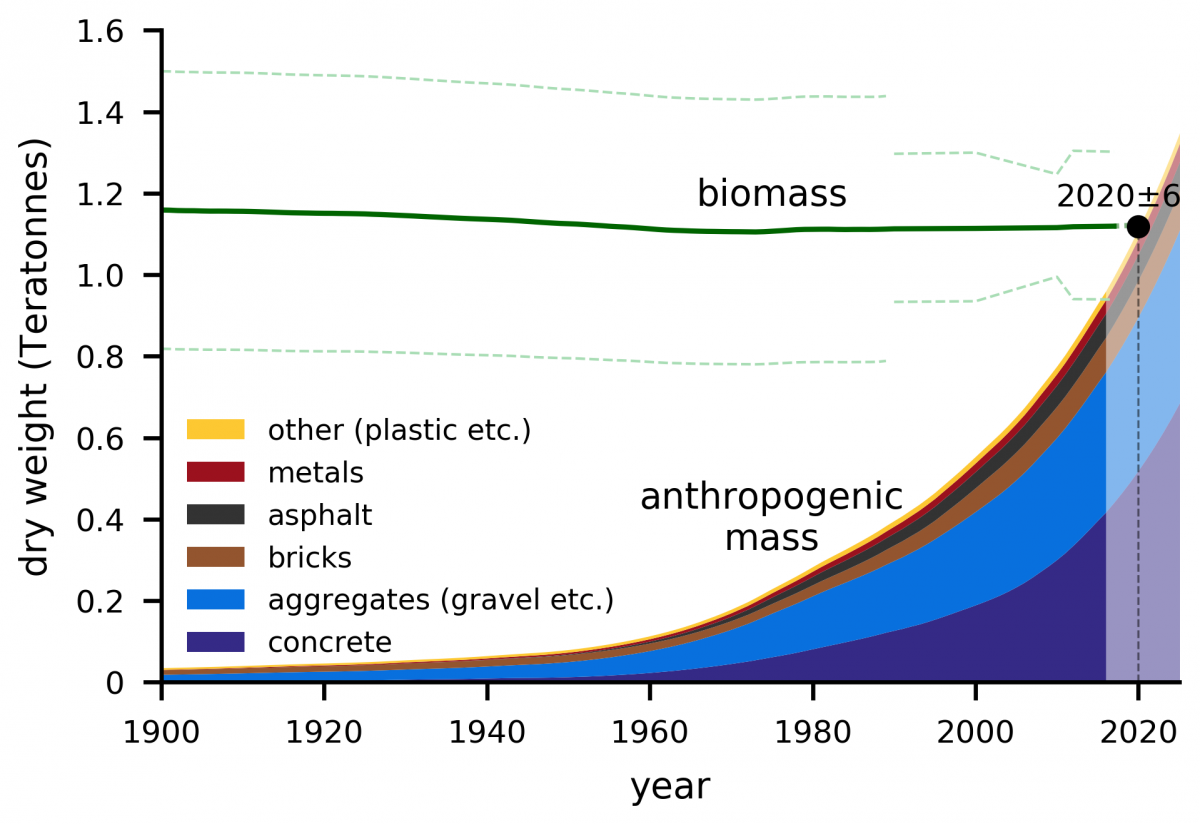
Source Graphique issu du communiqué de presse réalisé à l’occasion de la parution de la publication.
Consultez également le site visualcapitalist.com pour voir une infographie très bien faite représentant la masse anthropique en 2020 (et les différents matériaux qui la composent).
On peut là aussi constater une accélération depuis les années 1950 : la masse anthropique a été multipliée par 10 passant d’un peu moins de 100 milliards de tonnes à plus de 1100 milliards. La poursuite de ces tendances mènerait selon les auteurs à une « une jungle de béton » dépassant d’ici 2040 deux mille milliards de tonnes, soit plus de deux fois la masse des être vivants sur terre.
La distinction entre ressources épuisables et renouvelables n’est pas toujours évidente
Étudier la dynamique de dépassement des limites de production de ressources naturelles nécessite de distinguer deux grandes catégories.
- Les ressources « épuisables » : elles sont en quantité fixe sur la planète en raisonnant à l’échelle des temps de l’humanité. Il s’agit par exemple des énergies fossiles ou des ressources minérales ;
- Les ressources « renouvelables » : des prélèvements sont possibles sans épuiser la ressource car elle se renouvelle (croissance végétale, reproduction animale, cycle de l’eau) ou parce qu’elle n’est pas détruite par l’usage (flux d’énergie solaire, vent).
Attention, cependant à ne pas se laisser tromper par la terminologie : certaines ressources dites « renouvelables » peuvent également disparaitre si le niveau des prélèvements excède leur capacité à se reproduire. C’est ce qui est en train de se passer pour les ressources halieutiques.
Les stocks halieutiques marins surexploités sont passés de 10% en 1974 à près de 38% en 2021
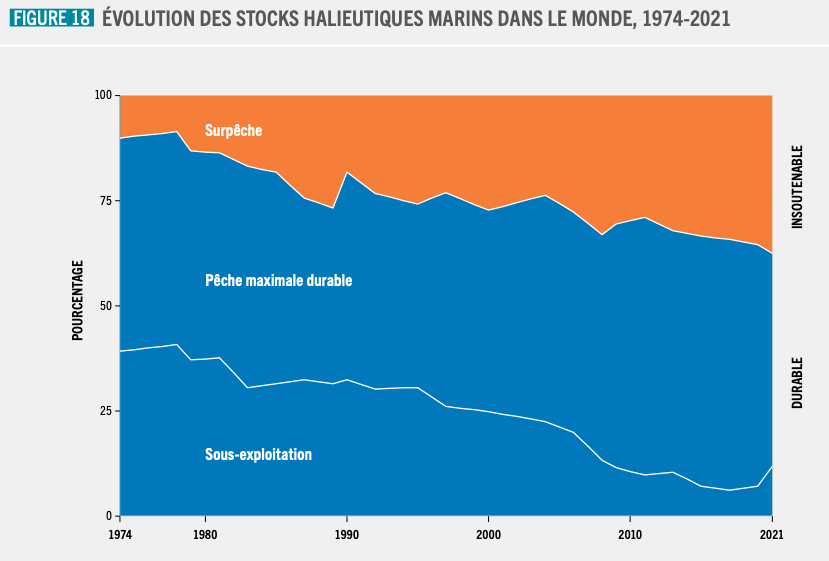
Source La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture – Rapport 2024 – FAO
Il n’est pas toujours évident de qualifier une ressource naturelle d’épuisable ou de renouvelable
Par exemple, le bois est une ressource renouvelable à partir du moment où après une coupe on replante ou on laisse le temps à la forêt de se régénérer. Cependant, les forêts primaires, forêts très anciennes peu ou pas perturbées par les activités humaines, sont extrêmement productives et riches en biodiversité. On ne peut pas considérer qu’elles sont renouvelables dans le sens où il sera impossible de retrouver une telle richesse après les avoir coupée même en replantant.
Les ressources en eau douce sont pour partie renouvelables – l’eau des fleuves ou des nappes souterraines utilisées par les hommes (irrigation, usages domestiques et industriels) est renouvelée à travers le cycle de l’eau – et pour partie non-renouvelables, si l’on considère l’eau des nappes phréatiques qui se sont formées bien avant l’ère des civilisations humaines et dont le renouvellement peu prendre des siècles voire des millénaires : on parle alors« d’eau fossile ».
Que les ressources soient « épuisables » ou « renouvelables », leur consommation exponentielle ne peut que conduire à leur épuisement
C’est une simple réalité mathématique. La fin du phosphate sur l’île de Nauru et de la morue à Terre Neuve au Canada sont deux exemples bien connus d’épuisement de ressources des deux types. Pourtant, certains économistes mettent en cause cette évidence mathématique en invoquant l’argument du progrès technologique ou de la substituabilité des ressources entre elles ou par du capital artificiel. Nous en discutons dans les idées reçues 3 et 4.
Les ressources épuisables sont par définition en quantité limitée sur la planète
Qu’elles résultent d’un stock initial fixe (ex : substances minérales présentes sur la Terre depuis sa formation ou par apport de météorites) ou de processus se déroulant sur les temps géologiques imperceptibles à l’échelle des temps humains (énergies fossiles), les ressources dites « épuisables » sont en quantité limitée sur notre planète. Le charbon par exemple est le résultat de la fossilisation des immenses forêts du carbonifère sur plusieurs centaines de millions d’années (en savoir plus sur la formation du pétrole, du gaz ou du charbon).
Dès lors, un prélèvement non décroissant et a fortiori exponentiel de cette ressource conduit nécessairement à un son épuisement. C’est une simple réalité mathématique.
Prenons un exemple : la production d’acier est passé de 189 millions de tonnes en 1950 à 1,8 milliard en 2019 soit une multiplication par 10 en 70 ans. La croissance annuelle moyenne aura été, sur cette période, d’environ 3,4 % par an. Si on prolongeait cette tendance, la production annuelle serait multipliée par 100 tous les 135 ans. On produirait ainsi, dans 270 ans, 10 000 fois plus d’acier qu’aujourd’hui ! Inutile d’être très précis dans l’estimation des réserves de minerai de fer pour comprendre qu’un tel rythme est impossible à maintenir, même pour un minerai aussi abondant.
Avant l’épuisement physique d’une ressource donnée, nous sommes confrontés à une limite pratique plus pertinente au plan économique : la quantité totale que nous sommes en mesure d’exploiter peut devenir inférieure à la demande souhaitée que ce soit pour des raisons techniques, économiques ou géopolitiques. Cela peut conduire à des tensions élevées sur les prix, des difficultés d’approvisionnement, voire des pénuries plus ou moins graves.
Dans un rapport de 2017, l’Ademe établit une synthèse claire des enjeux concernant les métaux et les minéraux.
- La plupart des gisements importants et facilement exploitables ont été découverts. Les nouveaux gisements potentiels ont des concentrations plus faibles ou relèvent de conditions d’exploitation extrêmes : sous une couche de glace au Groenland, dans les fonds océaniques, à plusieurs km sous terre (telle la Mine d’or de Tau Tona située à 3,9km de profondeur en Afrique du Sud) etc.
- A l’enjeu de l’épuisement des ressources exploitables s’ajoute celui de la capacité à satisfaire la demande en temps réel, à produire le flux de ressources nécessaires. Il faut notamment anticiper la demande car le temps entre la découverte d’un gisement et son exploitation à débit maximal peut prendre jusqu’à plusieurs décennies.
- L’analyse globale n’est pas suffisante : il faut également comprendre les différences régionales. Certaines ressources sont réparties de manière très inégale sur le globe. L’enjeu de leur utilisation par tous doit tenir compte des équilibres ou tensions géopolitiques. C’est un élément souvent avancé sur les terres rares produites à plus de 80% en Chine.
- L’activité minière présente des besoins considérables en eau et en énergie. Le développement minier dans des zones pauvres en eau et plus largement la raréfaction des ressources en eau (par surexploitation et par les effets du dérèglement climatique) peuvent limiter l’exploitation de certains gisements. La production mondiale de métaux représentait en 2012 environ 10% de la consommation mondiale d’énergie finale 18. Les besoins en énergie par unité produite devraient s’accroitre du fait de la diminution de la teneur en métaux des gisements, ce qui nécessite d’extraire et de traiter un plus grand volume de roche pour obtenir un même tonnage de métal.
Ajoutons enfin que l’activité minière est extrêmement polluante : elle peut se heurter à des problèmes d’acceptabilité sociale (en particulier dans les pays riches) 19 ou être mise à l’arrêt suite à des accidents provoquant des pollutions massives de l’eau et des sols comme cela a été le cas dans la vallée du fleuve Rio Doce au Brésil en 2015
Les limites à l’exploitation des ressources renouvelables
Parmi les ressources renouvelables on peut distinguer
- Des flux d’énergie primaire (soleil, vent, gravité pour l’énergie hydraulique) : ces sources d’énergie peuvent apparaître inépuisables car elles ne sont pas détruites par l’usage.
Cependant, leur captation et transformation en énergie utilisable par les humains (en électricité par exemple) impliquent l’utilisation d’autres ressources naturelles qui sont elles limitées (les matières minérales pour fabriquer des éoliennes, des barrages, des panneaux solaires). Par ailleurs, comme tous les modes de production d’énergie, les énergies renouvelables ne sont pas sans impact (sur la biodiversité pour les éoliennes ou les barrages, besoins de terres pour installer les centrales de production etc.)
- Des biens et services d’origine biologique c’est-à-dire tout ce que nous tirons des autres êtres vivants pour nous alimenter, nous vêtir, nous soigner, nous chauffer, et produire divers objets.
La caractérisation principale des ressources renouvelables pour leur gestion est le « taux de prélèvement maximal soutenable » : c’est le prélèvement maximum sur une période (sur un an en général) qui ne diminue pas le stock de la ressource pour la période suivant.
Par exemple, si l’on s’intéresse au stock d’une espèce de poissons, le taux de prélèvement maximal sera celui qui assure d’une année sur l’autre un nombre stable de poissons adultes, en tenant compte de l’ensemble des dynamiques naturelles d’évolution de cette population : nouveaux nés, mortalité hors pêche, nombre de poissons accédant au stade adulte, etc. Cet indicateur est devenu une référence au niveau mondial dans la pêche. Il est cependant aujourd’hui considéré comme insuffisant au plan écologique et social. Il doit être complété, dans une perspective de pêche durable, par d’autres critères restrictifs (telle la taille minimale des poissons prélevés, qui dépend des espèces et des lieux de pêche).
La consommation exponentielle d’énergie est notre moteur de transformation de la nature
Dans les pays développés, l’énergie est omniprésente. Aucune activité économique ne peut s’en passer. Capacité à extraire et transformer toutes les autres matières premières, à transporter les hommes et les marchandises, à fournir lumière, chauffage et cuisson des aliments. L’énergie permet de fabriquer et faire fonctionner toutes nos machines (dont celles de l’économie digitale qui est loin d’être dématérialisée), ainsi que de construire les bâtiments et infrastructures. Elle est également à la base de notre alimentation (machine agricole, engrais et pesticides via la pétrochimie) et de notre santé (matière première pour les médicaments, matériel médical).
Depuis le début de la révolution thermo-industrielle, la consommation d’énergie a augmenté de façon continue.
C’est le cas pour la la consommation d’énergie primaire qui est passé de presque rien à plus de 14 GTep aujourd’hui.
On observe une forte accélération à partir du milieu du 20ème siècle : de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, la consommation mondiale d’énergie primaire a été multipliée par 10.
Les seuls pauses ou légère réduction de la consommation sont occasionnées par les crises majeures (guerres, crises économiques, pandémies).
Consommation d’énergie primaire mondiale (1860-2019)
Source Schilling & al + Observatoire énergie + AIE + BP Statistical review 2020
La consommation d’énergie est d’abord fondée sur le charbon, auquel s’est ajouté le pétrole à partir du milieu du XX° siècle puis le gaz dans les années 60-70.
Elle est d’abord le fait de l’Amérique du Nord et de l’Europe qui consommaient près de 60% de l’énergie primaire mondiale en 1975. A partir des années 80, la région Asie-Pacifique entre dans la course : elle représente désormais plus de 40% de la consommation énergétique mondiale.
Energie primaire, énergie finale de quoi parle t-on ?
L’énergie que nous consommons au quotidien (l’essence à la pompe, l’électricité qui alimente nos ampoules, nos appareils électroménagers ou nos ordinateurs, la chaleur produite par nos radiateurs, le gaz qui alimente nos cuisinières) n’est pas directement disponible dans la nature. Avant d’arriver jusqu’à nous, des sources d’énergie dite primaires doivent être extraites du sous sol (pétrole, gaz, charbon, uranium) ou captées dans la nature (l’énergie du vent, du soleil ou des marées) puis transformée en énergie utilisable, et enfin transportée jusqu’aux utilisateurs finaux.
L’énergie primaire c’est l’énergie disponible dans la nature avant toute transformation (le pétrole, le gaz, le charbon ou l’uranium, le bois, le vent ou le soleil etc.).
L’énergie finale c’est celle qui est disponible pour l’utilisateur. L’extraction/captation de l’énergie primaire, sa transformation et son transport nécessitent de consommer de l’énergie. L’énergie finale consommée par les utilisateurs ne représente donc qu’une partie de l’énergie primaire initiale.
Quand on se penche sur la consommation d’énergie finale, les constats sont les mêmes.
Consommation mondiale d’énergie finale par source (Mtep)
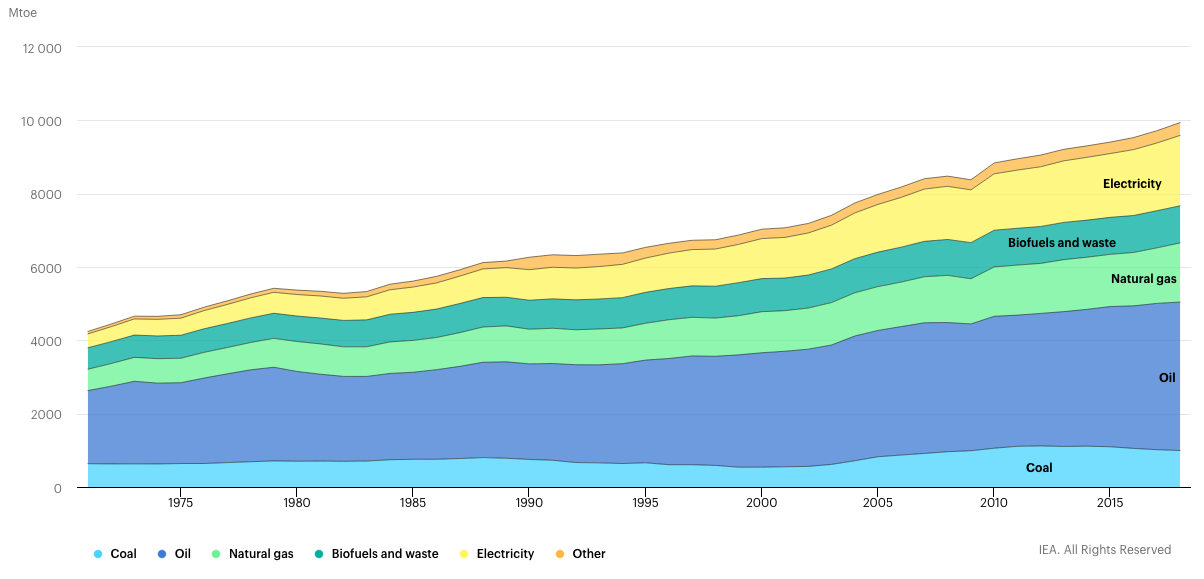
Source Key World Energy Statistics 2020 – AIE
Elle a été multipliée par 2,5 depuis les années 1970 et est issue à 80% d’énergies fossiles 20.
Malgré ces consommations croissantes, les inégalités en termes d’accès à l’énergie restent considérables.
Alors que la moyenne de la consommation d’énergie finale par habitant se situe en 2022 à environ 1,8 tep au niveau mondiale, les disparités entre pays sont très importantes : moins de 0,4 tep pour un habitant de l’Afrique contre plus de 3 tep/hab En Europe et plus de 7 aux Etats-Unis.
En 2021, près de 10% de la population mondiale n’avait toujours pas accès au services que procure l’électricité 21.
Consommation d’énergie primaire par habitant (en tep – tonne équivalent pétrole)
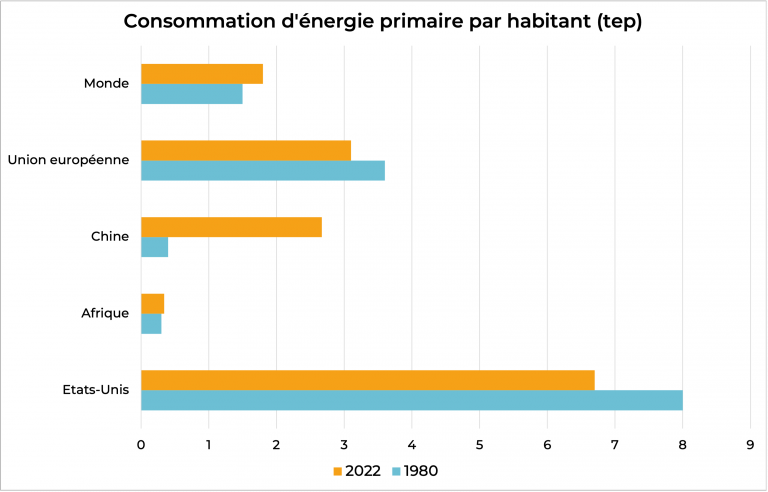
Source Statistical Review of World Energy (Energy Institute – 2023)
Il n’y jamais eu de transition énergétique
Certains discours sur l’histoire de l’énergie sont ambiguës laissant croire que le pétrole (et la voiture) et le gaz auraient succédé au charbon du début de la révolution industrielle, et que le début du XXIème serait marqué par l’avènement des énergies renouvelables.
Un tel narratif est tout simplement faux : au cours des deux derniers siècles, il n’y a jamais eu substitution d’une énergie à une autre mais bien addition de nouvelles sources d’énergies à celles déjà existantes. Les énergies fossiles représentent toujours aujourd’hui plus de 80% du total de la consommation d’énergie primaire
C’est pourquoi, il est important de bien donner tout son sens au terme transition énergétique aujourd’hui largement utilisé pour pour désigner les objectifs de politiques publiques en la matière. Les énergies bas-carbone actuelles (nucléaire et renouvelables) ne sont pas une solution à la crise climatique si elles ne font que s’additionner aux énergies carbonées sans les remplacer.
Pour en savoir plus
Quelques sources statistiques sur l’énergie
- Statistical Review of World Energy – Diffusé par l’Energy Institute depuis 2023
- Statistical Review of World Energy – Diffusé par BP avant 2023
- Les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie
Sur le fait qu’il n’y a encore jamais eu de transition énergétique
Les énergies fossiles ne sont pas inépuisables
Le pétrole, le gaz et le charbon sont appelées énergies « fossiles » parce qu’ils résultent de processus naturels de fossilisation des êtres vivants qui ont pris des millions d’années. A l’échelle des temps humains, ces énergies sont donc présentes en quantité limitée sur la planète : la poursuite de leur exploitation mènera nécessairement à leur épuisement.
Cette question, importante pour toutes les ressources épuisables, est fondamentale pour l’énergie car, d’une part, l’énergie est une composante essentielle de l’ensemble des activités humaines et, d’autre part, les énergies fossiles représentent 80% de l’énergie primaire consommée dans le monde (voir l’Essentiel 3) et près de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre . Parmi ces énergies, le pétrole occupe une place essentielle. C’est un liquide facile à transporter, peu dangereux en l’état et très dense énergétiquement ; il est encore ultra-majoritaire dans le monde des transports. C’est le « sang » de l’économie, qui s’arrêterait très vite sans transport de marchandises. Ce n’est pas sans raison que les gouvernements du monde entier craignent les conflits avec les camionneurs ! Enfin, si l’on peut en théorie le remplacer par des fiouls issus de charbon, de gaz (CTL et GTL) ou des fiouls synthétiques, les capacités de production22 à mettre en place sont considérables et demanderaient des investissements très lourds, impliquant de longs délais.
Définition : ressources, réserves ultimes, réserves prouvées
*Les « ressources » désignent la totalité des gisements : il s’agit d’une donnée physique, mais elle peut ne pas être connue. Par ailleurs, les ressources ne sont pas nécessairement entièrement exploitables.
*Les « réserves ultimes » désignent la totalité de la ressource qui finira par sortir d’un gisement (ou d’une zone, ou de la planète dans son ensemble). Elles tiennent donc compte de l’ensemble des gisements (existants et restant à découvrir) ainsi que de conditions techniques et économiques plus favorables que celle de l’instant présent.
*Les « réserves prouvées » désignent, en théorie, la quantité de ressource dont l’opérateur garantit l’extraction future aux conditions techniques et économiques du moment dans les gisements en exploitation. Elles n’incluent donc ni les gisements non encore découverts, ni les gisements découverts mais pas encore exploités, ni les évolutions techniques (nouveaux procédés) et économiques (hausse du prix de la ressources sur les marchés) qui permettraient de mieux exploiter les gisements existants.
La validité des chiffres divulgués par les opérateurs ou les Etats sur une base déclarative et non auditée peut, cependant, être questionnée. Par exemple, les quotas d’exportation de pétrole des pays de l’OPEP sont fixés en fonction du volume des réserves prouvées qu’ils déclarent, ce qui peut les amener à gonfler les chiffres. C’est ainsi que les réserves du Venezuela (les premières au niveau mondial selon les chiffres de l’OPEP), sont passées de 99 à 296 milliards de barils entre 2007 et 201023 à la suite de la décision du gouvernement Chavez d’y ajouter les réserves de pétrole extra lourd et difficilement exploitable de l’Orénoque. C’est une des raisons pour lesquelles depuis 2020, les réserves prouvées ne sont plus publiées dans la Statistical Review of World Energy publication annuelle de référence sur le secteur énergétique.
L’intervention des Etats-Unis au Venezuela a suscité un renouveau des débats sur les réserves prouvées de pétrole24.
Le concept important pour envisager l’impact économique de l’épuisement des énergies fossiles, n’est pas tant le moment où il n’en restera plus que celui du « plafond de production » (aussi appelé pic de production). Ce terme désigne le moment où la production stagne puis commence à décroître. De nombreux débats déchirent les spécialistes sur la forme de la courbe de production (qui n’est pas nécessairement symétrique autour du maximum et peut connaître un assez long plateau en tôle ondulée), mais l’existence d’un plafond est un fait mathématique 25.
Production de pétrole en Europe de 1965 à 2019 (Million de tonnes) : exemple d’un territoire ayant franchi le plafond de production
Source BP Statistical Review of World Energy (2020) – Les chiffres de production incluent le pétrole conventionnel et non conventionnel (pétrole de schiste, sable bitumineux) ainsi que les liquides de gaz naturel.
Les problèmes liés à la disponibilité énergétique ne naissent pas à la date d’épuisement d’une source d’énergie mais proviennent de la tension entre l’offre et la demande. La première question qui se pose n’est donc pas tant celle du stock restant sous terre, que du flux disponible à chaque instant (même si les deux questions sont bien sûr liées).
- Dans un contexte de croissance continue de la production, ces flux peuvent être impactés par de multiples facteurs tant économico-techniques (investissements dans le transport et la transformation suffisamment en amont), que financières (volatilité du prix du baril due à la financiarisation des marchés pétroliers induisant en erreur sur les besoins d’investissement voir Nicolas Bouleau) ou politiques. Les chocs pétroliers des années 70, dont les causes étaient essentiellement géopolitiques, ont bien montré combien une hausse brutale du coût de l’énergie (et donc de sa disponibilité conjoncturelle) pouvait impacter l’économie mondiale. L’effondrement du prix du pétrole suite à la pandémie de COVID19, risque d’impacter les investissements des compagnies pétro-gazières ou charbonnières.
- L’atteinte du « plafond de production », dans un contexte où la demande souhaitée continue à croître, introduit une tension structurelle, puisque l’offre ne peut plus que décroître. On entre alors dans un nouveau régime d’exploitation de la ressource marqué par une production mondiale structurellement à la baisse et des conditions d’accès de plus en plus difficiles : un contexte géopolitique toujours incertain du fait de la localisation des principaux gisements, des investissements plus lourds pour exploiter des gisements plus difficiles d’accès, des risques écologiques de plus en plus importants (exploitation à de très grandes profondeurs, dans des régions fragiles et difficiles telles l’Arctique, procédés techniques très impactants pour les gaz de schistes….).
La question du plafond ou « pic » de production de pétrole (cas le plus étudié à ce jour), fait couler beaucoup d’encre. Malgré les nombreux débats entourant ce sujet, les analyses tendent à converger sur une fourchette d’atteinte du pic de pétrole conventionnel entre 2015 et 2030. Mais les débats sont encore importants pour ce qui concerne les pétroles de schiste et les ultra-lourds ; la plupart des experts ne voient pas de décroissance de la production « tout-pétrole » avant 2040 26.
Concernant les autres énergies fossiles, le plafond de production interviendrait selon la majorité des experts plus tard que celui du pétrole non conventionnel. Là aussi, les incertitudes sont fortes et les estimations, tant des ressources exploitables que du plafond de production, sont très variables. Pour autant, il va bien falloir que l’humanité se passe progressivement d’énergies fossiles en priorité en raison de leur impact sur le climat et à plus long terme car la production de pourra croitre à l’infini.
Pour en savoir plus
- Le site de l’Association pour l’étude des pics pétroliers et gaziers (ASPO)
- Site de Jean-Marc Jancovici : comprendre comment se forment les énergies fossiles, quelles sont les « réserves », la notion de pic de production etc.
- Livre – Matières premières et énergie: les enjeux de demain, Olivier Vidal, Iste Group (2018)
- Livre : Or noir, la grande histoire du pétrole, Mathieu Auzanneau, La Découverte, 2015
Il reste bien assez d’énergie fossile pour dérégler le climat
L’expression « budget carbone » désigne la quantité cumulée de CO2 que nous pouvons encore émettre pour rester en-deçà d’un certain niveau de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle (généralement celui correspondant aux objectifs internationaux à savoir +2°C ou +1,5°C) 27.
Selon le rapport 2025 du Global Carbon Budget, les émissions de CO2 historiques cumulées de l’humanité s’élevaient fin 2024 à 2770 Gt CO2. Pour avoir 50% de chance de limiter le réchauffement climatique à +2°C par rapport à la période pré-industrielle, nous ne pourrions plus émettre qu’environ 1055 GtCO2, soit 26 années d’émissions au rythme actuel (environ 40 Gt CO2 par an).
Penchons-nous maintenant sur les « réserves » d’énergies fossiles.
Comme nous l’avons vu dans l’encadré sur la définition des ressources et réserves, les « réserves prouvées » ne représentent qu’une petite fraction des ressources fossiles présentes dans les sols et sous les océans de la planète. Très schématiquement, il s’agit des gisements en exploitation.
Réserves prouvées et émissions annuelles de CO2 des énergies fossiles
Le tableau ci-après montre sans équivoque que les « réserves prouvées » sont largement suffisantes pour dépasser allègrement notre budget carbone (et ceci quelle que soient les incertitudes pesant sur ces réserves, voir encadré sur le sujet).
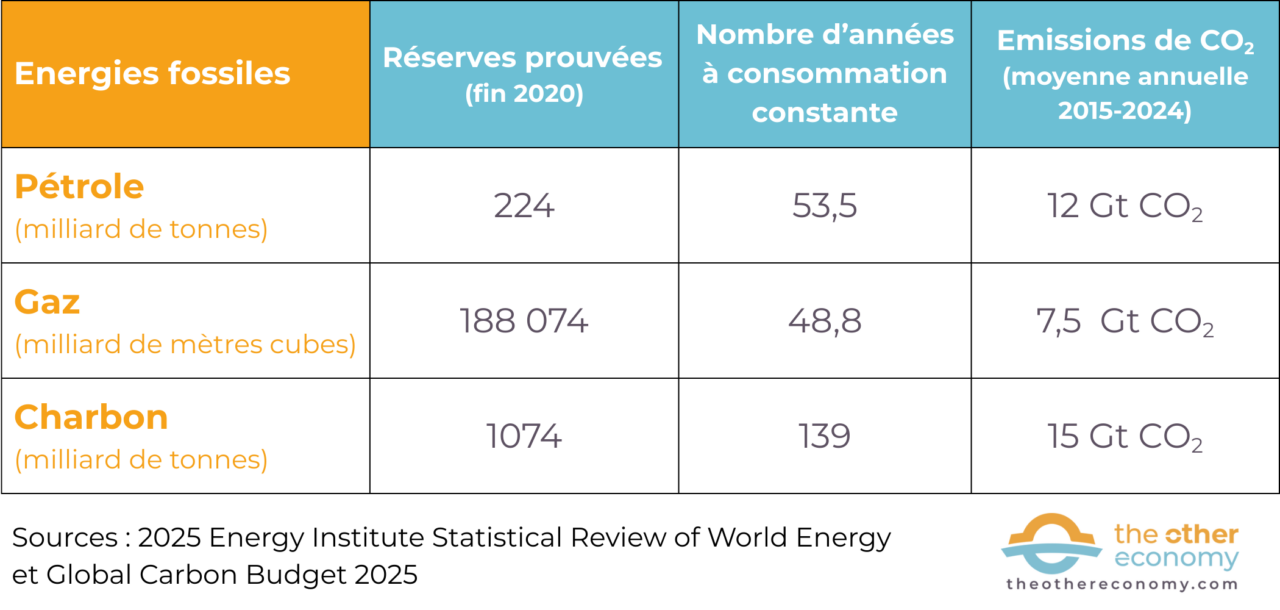
Sources : Réserves prouvées et nombre d’année de consommation : Statistical Review of World Energy 2025 ; Emissions de CO2 : Global carbon budget 2025.
Notons l’existence d’un débat sur la crédibilité des scénarios conduisant à la plus forte croissance de la température (scénarios RCP 8.5 28). Certains experts 29 estiment qu’il n’y aura pas assez d’énergie fossile sous terre pour l’atteindre ; d’autres que le monde sera devenu chaotique bien avant, et dès lors que nous serons incapables de produire les fossiles nécessaires. D’autres30 encore indiquent à l’inverse que des scénarios aux émissions plus élevées sont possibles. Ces débats sur les trajectoires à très hautes émissions sont peu utiles et créent de la confusion. Le vrai enjeu est de savoir comment faire pour laisser sous nos pieds des ressources que l’on connait déjà et pour arrêter d’en chercher de nouvelles !
Deux points complémentaires méritent d’être soulignés.
- On a vu que le pétrole jouait un rôle spécifique dans nos économies. L’incertitude sur les ressources « non-conventionnelles » est telle qu’on ne peut exclure une crise économique comme celle consécutive aux chocs pétroliers des années 70 et qui aurait un effet significatif sur la consommation mondiale de pétrole et les émissions induites.
- Abondance mondiale ne veut pas dire abondance régionale. En particulier, l’Europe est la région du monde la moins richement dotée en énergies fossiles et sa dépendance s’accroit. La guerre d’Ukraine a bien mis en exergue les risques de renchérissement du prix de l’énergie (voire de pénurie) liés à une crise géopolitique impactant les décisions de pays exportateurs.
En conclusion, que la pénurie mondiale d’énergie fossile ne permette pas d’elle-même de limiter assez vite et suffisamment la dérive climatique ne nous immunise pas contre les risques économiques liés à des tensions sur notre approvisionnement énergétique.
Ces deux arguments conduisent à la conclusion qu’il est impératif de réduire rapidement notre consommation d’énergie fossile, en réduisant notre consommation d’énergie et en développant des énergies peu carbonées.
L’environnement n’est pas un thème structurant d’étude pour la majorité des économistes
Pour qui s’intéresse à l’écologie, il semble évident que le système productif repose sur un socle physique et vivant : les ressources naturelles (dont l’énergie) dans lesquelles nous puisons pour nous nourrir, nous vêtir, nous chauffer, nous loger, nous déplacer, construire nos logements et nos infrastructures ainsi que l’ensemble des objets du quotidien. Peut-être moins évident mais tout aussi essentiel, la production dépend également du maintien des grands équilibres planétaires qui déterminent les conditions dans lesquelles se déroule l’activité économique 31. Ces équilibres reposent eux-mêmes sur le bon état des écosystèmes et sur les capacités de notre planète à absorber et neutraliser les déchets et pollutions générés par la production.
Pourtant, comme nous allons le voir, la nature est loin de constituer un sujet majeur d’étude au sein de la discipline économique. Si nombre d’économistes se sont penchés sur les questions écologiques, l’environnement naturel n’occupe pas une place structurante au centre de la discipline au même titre par exemple que l’étude de la croissance et de ses déterminants.
Les enjeux écologiques relèvent de champs d’études spécialisés au sein de « l’économie standard »
Malgré des écoles de pensée très diverses et les multiples controverses qui animent la communauté des économistes, la discipline est depuis plusieurs décennies marquée par un courant dominant, celui qui repose sur l’analyse économique de l’école néo-classique, marquée par la figure de l’homo-oeconomicus (individu rationnel et calculateur cherchant à maximiser son intérêt personnel – voir notre fiche ) ainsi que par la prédominance des marchés comme institution régulatrice de la société grâce aux prix. Nous parlerons par la suite « d’économie standard ». C’est ce type d’analyse qui est le plus représenté parmi les chercheurs et les enseignants du supérieur sur les campus américains ou dans les universités françaises 32 ; ce type d’analyse encore que l’on retrouve dans les revues académiques les plus cotées 33 ou dans les manuels d’enseignement de l’économie.
Au sein de ce courant dominant, les questions environnementales sont abordées dans le cadre de branches spécialisées : économie de l’énergie pour la gestion du système énergétique ; économie des ressources naturelles, pour l’étude de l’allocation efficace d’une ressource rare (voir notre fiche sur la règle d’Hotelling ) ; l’économie de l’environnement pour l’étude des pollutions (dont le changement climatique), considérés comme des effets externes à l’activité économique qu’il s’agit de réintégrer en leur donnant un prix (voir idée reçue 1).
Ressources naturelles et pollutions sont donc étudiées par ceux qui se sont spécialisés sur ces sujets. Dans leur majorité, les économistes mènent ainsi leurs travaux en faisant abstraction du socle physique et vivant sur lequel repose l’économie réelle. Par exemple, les économistes spécialistes de la croissance, n’intègrent ni les ressources naturelles dont elle se nourrit ni les pollutions qu’elle génère.
De plus, la division des champs d’étude implique l’absence de toute vision systémique. Elle ne permet donc pas de comprendre que pollutions, déchets et dégradations environnementales sont le résultat de processus de production fondés sur des prélèvements croissants de ressources naturelles. Nous verrons par la suite, que cette façon très compartimentée d’aborder les liens entre économie et écologie, ajoutée aux postulats fondateurs du cadre analytique standard (marché, prix, rationalité, retour à l’équilibre) peut mener à des analyses et des conclusions particulièrement défavorables voire dangereuses en termes de prise en compte de l’environnement par l’économie (voir idée reçue 2).
Pour en savoir plus
Approfondir les liens entre économie et écologie à travers l’histoire
- Economistes et écologie : des physiocrates à Stiglitz, A. Lalucq – L’Économie politique (2013)
- Une histoire asynchrone de l’économie et de l’écologie, et de leurs « passeurs », S. Boutillier et P. Matagne, Vertigo (2016)
- L’économie dans l’impasse climatique, Thèse de doctorat d’Antonin Pottier (chapitre 2), EHESS (2014)
« Prix Nobel », revues académiques, enseignement : l’absence de l’écologie
Sans prétendre à l’exhaustivité, voici quelques exemples emblématiques permettant de constater à quel point l’écologie reste un sujet périphérique. Qu’on regarde les grands espaces de reconnaissance de la discipline (revues les plus influentes, prix Nobel) ou l’enseignement : l’écologie est abordée de façon marginale voire totalement absente.
50 ans de « Prix Nobel » d’économie sans environnement
Créé en 1969, le prix Sveriges Riksbank en mémoire d’Alfred Nobel, permet de distinguer les économistes qui ont « apporté le plus grand bénéfice à l’humanité » 34. C’est précisément à cette époque que commence véritablement la prise de conscience de l’impact de l’humanité sur sa planète. Il faudra pourtant attendre près de 50 ans pour que le prix soit remis à un économiste en récompense de ses travaux sur un thème spécifiquement écologique, le climat 35, et ce alors même que nombre d’économistes « nobélisés » pour des apports autres qu’écologiques, tels Joseph Stiglitz, Robert Solow ou Ronald Coase, ont apporté des contributions importantes à l’économie de l’environnement et des ressources naturelles (qui sont rappelons-le des branches de l’économie standard).
L’environnement absent des grandes revues généralistes
Dans une étude bibliographique parue en 2019 36, Nicholas Stern et Andrew Oswald ont étudié l’occurrence des mots « climat », « carbone » ou « réchauffement » dans les quelques 77 000 articles publiés par les 10 revues économiques les plus influentes de la discipline. Leur méthodologie vise à « fournir une image de ce que l’on pourrait considérer comme une économie standard et représentative telle qu’elle est décrite dans les principales revues de notre profession ». Leur conclusion est sans appel : « l’économie académique (…) a produit remarquablement peu d’articles sur l’une des plus grandes questions scientifiques, économiques et politiques de notre époque », à savoir le réchauffement climatique. En effet, d’après leur étude, seule une petite soixantaine d’articles, soit moins de 0,1%, traite du climat.
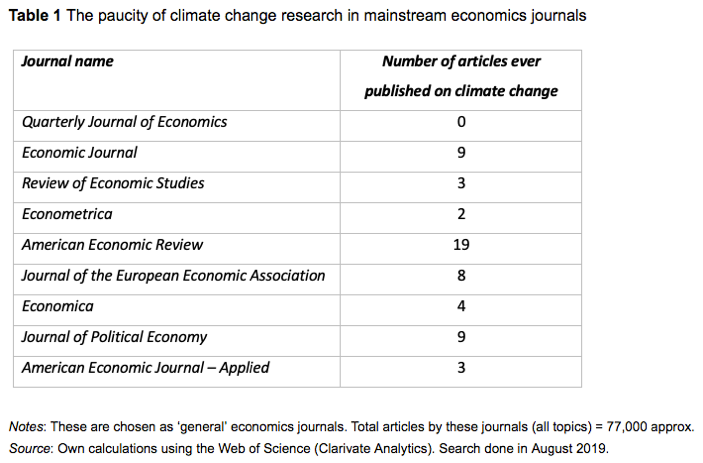
Comme le soulignent les auteurs, le Quaterly Journal of Economics (QJE), première des revues économiques, n’en a jamais publié. « C’est moins que ce que le QJE a publié sur le baseball ou le basketball ». L’économie du sport est donc mieux représentée que l’économie du climat dans cette grande revue économique !
Pour les auteurs, ce manque de publication sur le climat s’explique principalement par une forme d’autoreproduction des thèmes étudiés par les économistes : « le déficit de recherche sur le changement climatique en économie provient, dans une large mesure, de l’aversion au risque des jeunes économistes (et de certains plus âgés) qui se concentrent principalement, pour des raisons de carrière, sur la manière de produire des articles publiés dans des revues prestigieuses. De nombreux économistes semblent croire que la façon de procéder consiste à envoyer aux revues principales le type d’article que les évaluateurs considéreront comme satisfaisant au regard des perspectives conventionnelles et standards des analyses principales ». En résumé, « peu d’économistes publient sur le réchauffement climatique, car les autres économistes n’écrivent pas sur le climat ».
Dans sa thèse de doctorat, Antonin Pottier s’est livré à un exercice moins exhaustif mais néanmoins instructif. Il a étudié les titres et les résumés des articles parus dans le Journal of Economic Growth, l’une des principales revues économiques étudiant la croissance. Sur les quelques 240 articles parus entre sa création en 1996 et mars 2014 aucun article n’examine le rôle de l’énergie et des ressources naturelles dans le processus de croissance 37. Suite à notre demande, l’auteur a poursuivi sa recherche jusqu’en septembre 2020 : le constat reste le même.
Qu’apprend-on dans les manuels d’économie ?
La question de la formation en économie est fondamentale non seulement concernant l’univers académique, mais encore bien plus pour comprendre la perception des milieux économiques quant aux risques écologiques. En effet, elle ne conduit pas nécessairement à devenir chercheur, bien au contraire ! Qu’ont appris les milliers d’économistes qui peuplent les organisations économiques internationales (FMI, Banque mondiale, Banque de développement multilatérale ou nationale, OCDE), les banques centrales et les instances de régulations financières, les ministères de l’économie et des finances (et leur équivalent au sein de la Commission européenne) ou encore les banques et autres institutions financières ? Que perçoivent des liens entre ressources naturelles, pollutions globales et systèmes productifs, les membres des gouvernements, les fonctionnaires, les chefs d’entreprises et leur top management qui, sans avoir suivi un cursus économique complet, ont néanmoins reçu des cours d’introduction à l’économie ?
Les manuels d’introduction à l’économie constituent pour s’en rendre compte un bon terrain d’étude car non seulement ils constituent la première pierre d’un cursus économique mais ils entrent également dans des cursus plus généraux tels le cours « Social Analysis 10: introduction to economics », du département d’économie d’Harvard, ou le Master Philosophy, Politics and Economics au Royaume-Uni qui forment les futurs décideurs politiques, économiques ou les personnels administratifs. Ils permettent de prendre conscience des connaissances économiques de base que sont sensés acquérir les étudiants.
Samuel Bowles et Wendy Carlin ont étudié l’importance accordée à 100 thèmes dans différents manuels d’introduction à l’économie ayant occupé une place majeure dans l’enseignement depuis les années 1950 38. Les deux auteurs ont participé au projet CORE, Curriculum Open-access Resources in Economics. Lancé en Angleterre en novembre 2013, ce projet vise à concevoir un nouveau manuel répondant aux critiques des étudiants pour apporter davantage de pluralisme et de lien avec le réel. Lancé en 2017, la première version en ligne du manuel est aujourd’hui utilisée par de nombreuses universités et écoles d’économie. L’objet de l’article est notamment de montrer à quel point ce manuel répond mieux aux enjeux de ce siècle que les précédents. Une initiative bienvenue mais qu’en est-il vraiment ?
Quel que soit le manuel considéré (y compris CORE) la place dédiée à l’environnement atteint au maximum 2,5% des contenus. Depuis la parution du manuel de Samuelson en 1948, et malgré l’accroissement des problèmes écologiques, la place dédiée aux interactions entre économie et écologie n’a quasiment pas bougé. Ce sujet est ainsi réduit à la portion congrue pour tous les étudiants qui n’auront qu’une introduction à l’économie dans leur cursus, de même que pour les étudiants en économie qui ne choisiront pas de se spécialiser en environnement.
Cette faible place accordée aux enjeux écologiques n’est pas limitée au cours d’introduction à l’économie. Ainsi, dans la huitième édition de leur manuel de Macroéconomie (2020)39 , Olivier Blanchard et Daniel Cohen définissent dès l’introduction le PIB et sa croissance à court et long terme comme la principale variable macroéconomique. Le livre consacre dix pages (sur 676) à la pandémie COVID19 et ignore entièrement la question des ressources naturelles, sauf trois pages sur le changement climatique. Deux de ces trois pages rappellent la physique du réchauffement climatique. La troisième ne fait qu’énoncer la solution traditionnellement mise en avant par les économistes, à savoir un prix mondial uniforme du carbone, et liste les raisons pour lesquelles cela n’a pas encore été fait. Aucune mention n’est faite des solutions alternatives. La négligence avec laquelle le changement climatique est traité est d’autant plus paradoxale que les auteurs reconnaissent que ce dernier « est peut-être le défi le plus important pour la croissance » (P. 312), « principale variable » analysée dans leur livre. Les auteurs restent muets sur les conséquences à tirer pour la validité des théories et modèles macroéconomiques qui sont l’objet du manuel.
Les économistes qui placent l’écologie au coeur de leur analyse ne sont pas au centre de la discipline
La naissance d’un nouveau paradigme en économie
Au tournant des années 1960-1970, alors qu’émerge la question écologique comme enjeu de débat public international, certains économistes forgent un paradigme totalement nouveau mettant la nature au centre du système économique et liant la problématique des ressources naturelles à celle des pollutions.
En 1966, lors du sixième forum de Resources for the Future, l’économiste Kenneth E. Boulding expose les prémices de ce nouveau paradigme. Comme nous l’explique Antonin Pottier dans sa thèse (p114), il « décrit la prise de conscience d’un monde fermé, qui n’échange pas de matière avec l’extérieur. La matière prise sous forme de ressources entre dans le processus économique et en ressort sous forme de déchets. (…) Il compare la Terre à un vaisseau spatial, dans lequel tous les matériaux utilisés doivent être recyclés pour être à nouveau disponibles. ».
Cette conception suscite de nombreux travaux 40 visant notamment à chiffrer les flux de matières qui traversent l’économie pour se transformer en déchets solides ou gazeux et leurs interactions avec les systèmes naturels. L’économiste Nicholas Georgescu-Roegen franchit un cran supplémentaire en appliquant à la réflexion économique le deuxième principe de la thermodynamique, qui affirme la dégradation de l’énergie de formes concentrées vers des formes de plus en plus diffuses.
Des travaux, étudiés au centre de la discipline, lors d’une brève période
Ces travaux sont, au départ, relativement bien acceptés par les économistes qui occupent le centre de la discipline. Un article de 1971 écrit par Robert Solow, théoricien de la croissance reconnu de ses pairs, est emblématique de cette période. Dans cet article, Solow aborde la question des pollutions via une approche beaucoup plus systémique que ce qu’on trouve dans la littérature sur les externalités (voir l’idée reçue 1 qui explique le concept d’externalité).
à mesure que l’économie se développe, même l’air et l’eau deviennent rares. L’air et l’eau n’ont qu’une capacité limitée à assimiler les déchets ou à les évacuer. On pensait autrefois que ces effets externes ou environnementaux étaient des exceptions, mais dans la société industrielle moderne, ils peuvent devenir la règle. Toute économie industrielle moderne génère apparemment tellement de déchets _ sous forme de matière et d’énergie _ que leur élimination grève la capacité de l’atmosphère, des fleuves et éventuellement même de l’océan.
Il établit, ainsi, clairement un lien entre déchets, pollutions et disponibilité des ressources et affirme que les externalités sont la règle plutôt que l’exception. Plus loin, dans le chapitre intitulé, « Le problème universel de l’élimination des matières », il retranscrit la vision systémique de l’économie qui prélève des matières pour les transformer en déchets :
Nous parlons de la « consommation » des biens comme s’il n’en restait plus rien une fois consommés. Mais bien sûr, il en reste tout. Chaque tonne de matière retirée de la terre et transformée en marchandise doit encore être éliminée lorsque les marchandises en question sont finalement utilisées.
L’économie écologique s’institutionnalise dans les années 1980, à l’écart de l’analyse économique dominante
La publication en 1972 du rapport The Limits to Growth met fin à cette brève période où la vision systémique de l’économie comme processus de transformation de la matière, se nourrissant d’un flux de ressources et rejetant un flux de déchets, aurait pu intégrer peu à peu le corpus des savoirs économiques reconnus et enseignés.
Commandé par le Club de Rome à une équipe de scientifiques du MIT dirigé par Dennis Meadows, le rapport affirme l’impossibilité d’une croissance sans fin dans un monde limité en termes de disponibilité des ressources et de capacité à absorber les déchets. Malgré (ou à cause de) son très fort retentissement public, ce rapport est vivement critiqué par les économistes standards qui lui reprochent notamment de ne pas se fonder sur des données empiriques, de ne pas intégrer de prix dans le modèle utilisé et de ne pas tenir compte du progrès technique (voir idée reçue 3 sur la réfutation du rapport Limits to growth).
C’est ainsi que ce referme cette brève période où les interactions entre la croissance, les ressources et les pollutions ont été étudiés de concert au centre même de la discipline.
Les économistes à l’origine de la vision systémique de l’économie, tels Robert Ayres ou Hermann Daly, sont peu à peu marginalisés et ne trouvent plus d’interlocuteurs parmi les économistes standards. C’est donc à l’écart, que se constitue l’économie écologique. La création de l’ISEE (International Society for Ecological Economics) en 1988 et de la revue Ecological Economics l’année suivante permettent de donner une visibilité à cette école de pensée qui fait aujourd’hui partie intégrante du champ académique, même si elle n’a pas le poids et la reconnaissance des économistes standards.
Pour en savoir plus
- Manuel d’économie écologique. Une perspective européenne, De Boeck Supérieur (2022)
- Que peut-on apprendre de l’économie écologique ? – La vie des idées (2012)
- Qu’est-ce que l’économie écologique ? – L’Economie Politique n°069 (2016)
- Articles sur le rapport Limits to Growth : origines, méthode et contenu , réception, héritage.
Qui sont les économistes qui étudient l’écologie aujourd’hui ?
Si la grande majorité des économistes fait toujours abstraction de l’écologie, le sujet n’en devient pas moins un objet d’étude croissant depuis le début du XXIè siècle.
Certains économistes de renom s’inscrivant dans le cadre analytique standard tels Nicholas Stern ou Joseph Stiglitz, ont apporté des contributions significatives au débat public sur la nécessaire prise en compte de l’écologie par l’économie, mais le plus souvent en prenant de la distance, voire des libertés méthodologiques avec leurs outils analytiques (comme en témoignent par exemple les polémiques autour du choix d’un taux d’actualisation très faible par Nicholas Stern).
Parmi les économistes qui réfutent le cadre analytique néoclassique, l’environnement est longtemps resté un angle mort de leur champ d’étude qui s’est concentré bien d’avantage sur la relance de l’activité, le bouclage macroéconomique, la croissance, la distribution du revenu, le « marché » du travail et la justice sociale… et rarement sur les ressources ou la pollution. On constate, cependant, depuis le début du XXIe siècle un intérêt croissant pour l’écologie chez des économistes dont ce n’était pas initialement le cœur de spécialité. C’est par exemple, le cas de Steve Keen ou de Gaël Giraud, du réseau Pocfin et de nombreux contributeurs de The Other Economy.
Enfin, l’économie écologique n’est pas une école de pensée homogène. Elle est traversé par une grande diversité de courants dont l’économiste Clive Spash a, tenté de dresser une typologie. Dans un article paru en 2013, il distingue, ainsi, les « new resource economists », qui adoptent le cadre d’analyse de l’économie standard pour traiter de nouveaux objets écologiques ; les « new environmental pragmatists« , qui entendent avant tout convaincre les décideurs de prendre des mesures effectives pour la protection de l’environnement et enfin la « social ecological economics » qui s’oppose clairement aux approches économiques dominantes et donne la priorité aux enjeux d’équité sociale et de valeur intrinsèque de la nature.
Le système économique est aveugle aux destructions de la nature car elle est invisible dans nos outils comptables
Comme vu à l’Essentiel 6, la plupart des économistes représentent le système économique en faisant totalement abstraction de la nature. Or l’état du monde qui a présidé à la naissance de la discipline économique s’est inversé. Le « facteur » travail est devenu abondant comme en témoignent les masses de population inactives. C’est le résultat de la croissance démographique (et donc de la main d’œuvre disponible) et surtout du développement du capital artificiel et du progrès technique, c’est-à-dire du remplacement dans de nombreux domaines du travail humain par des machines (et donc in fine par des matières et de l’énergie – voir module travail et chômage).
Le « facteur » de production naturel, quant à lui, s’est raréfié parce que nous touchons aux limites des stocks de ressources naturelles (y compris de leur capacité de renouvellement, pour celles qui sont dites renouvelables) ou aux capacités de la planète à absorber nos déchets (physiques et invisibles tels les gaz à effet de serre, les pollutions chimiques etc.) (Voir L’essentiel 1, 2, 3 et 4).
De nos jours encore, pour la majorité des économistes, la nature n’est toujours pas un sujet d’étude économique. Dans leurs raisonnements, il n’existe que deux facteurs de production : le travail et le capital C’est également le cas des modèles macroéconomiques utilisés par les gouvernements et les grandes institutions internationales (FMI, Banques mondiales) qui n’intègrent ni les ressources naturelles nécessaires à la production, ni le réchauffement climatique ou l’effondrement de la biodiversité.
La nature est bien un facteur de production
Nous avons besoin de terres arables pour cultiver les aliments, de bois et de minerais pour construire les bâtiments et les machines, de chaleur etc. L’économie suppose, ainsi, l’extraction, la transformation et la mise au rebus (ou le recyclage) de ressources naturelles. Ces processus consommant ou dégradant de l’énergie, toute représentation de l’économie devrait respecter les lois de la physique et en particulier les deux premiers principes de la thermodynamique 41.
L’économie fonctionne également grâce aux services que nous retirons du fonctionnement des écosystèmes : épuration de l’eau et de l’air, protection contre les inondations, pollinisation des plantes agricoles, réserves de gènes pour les médicaments, support du tourisme etc.
Plus généralement, la vie économique se déploie sur une planète dont les équilibres écologiques peuvent être impactés par les activités économiques, et inversement les catastrophes naturelles peuvent en retour impacter l’économie. Dit autrement le système économique s’inscrit dans une réalité physique et dans un ensemble d’écosystèmes dont l’économiste « sérieux » devrait tenir compte.
Cette faille fondamentale de la pensée économique s’est traduite concrètement dans nos outils comptables qu’on se situe au niveau macro-économique, avec l’indicateur phare qu’est le PIB, où au niveau d’une entreprise. Loin d’être neutre, les systèmes comptables traduisent une représentation du réel, structurante pour l’organisation économique. Dans cet univers de gestion, la nature n’existe pas. Dès lors, elle ne compte pas.
Le PIB mesure des flux monétaires, les échanges marchands entre les hommes. Il ne mesure ni la (re)constitution ni la destruction du capital qu’il soit humain, artificiel, ou naturel.
La destruction des ressources et les atteintes majeures aux grands équilibres naturels tels la stabilité du climat ne font pas l’objet de provision pour dépréciation d’actifs dans les comptes des entreprise. Ce que nous comptabilisons, c’est toujours une estimation (généralement issue du résultat d’un échange monétaire) de la contribution des hommes dans la chaîne de production : les coûts de la comptabilité consistent en un empilement de revenus humains soit sous forme de salaires, soit sous forme de « profits » (dividendes et autres revenus non salariaux, y compris rentes). Nous utilisons de l’eau, des sols, des métaux, de l’énergie mais le prix de la constitution (par la nature) de ces ressources n’apparaît jamais sur nos factures. Nous payons uniquement le travail et les rentes liées à leur extraction, leur transport, leur transformation, leur commercialisation, au marketing, à la publicité, mais jamais le prix de la quantité de ressources utilisées, c’est-à-dire, in fine, celui de leur rareté que notre utilisation accentue. De même, nous ne payons rien pour le cycle de l’eau, la stabilité du climat, l’existence d’un océan propice à la vie ou pour l’action des abeilles et autres pollinisateurs indispensables à la reproduction de très nombreuses plantes, base de notre alimentation.
Cette défaillance majeure de notre système comptable est assez bien identifiée au niveau macroéconomique. Depuis plus de deux décennies, de nombreux rapports et ouvrages ont mis en évidence les limites du PIB en tant qu’indicateur de la bonne santé d’une économie et plus généralement d’une société 42. Pourtant, la croissance de cet indicateur continue à être un objectif majeur des politiques publiques et des discours économiques.
Au niveau microéconomique, les travaux mettant en évidence l’impact de la comptabilité d’entreprise sur la consommation de ressources, la génération de pollutions ainsi que sur les propositions alternatives sont tout juste balbutiants même si prometteurs 43.
Parce que nous n’avons pas les instruments nécessaires, nous continuons à ne pas voir que nous détruisons le socle naturel dont nous dépendons. Sans nature, pas de PIB et pas d’entreprise viable.
Idées reçues
Pour régler le problème des pollutions, il suffirait de leur donner un prix
Précisons au préalable qu’il ne s’agit pas de remettre en cause l’intérêt de mobiliser l’outil prix (que ce soit par des taxes ou des marchés de quotas) pour renchérir les pollutions et contribuer ainsi à leur diminution. L’idée reçue que nous souhaitons dénoncer ici c’est le fait de faire de cet outil l’alpha et l’oméga des politiques climatiques et écologiques.
Le concept « d’externalité » en économie
Le terme « externalité » désigne les répercussions positives ou négatives de l’activité d’un agent économique sur d’autres agents sans contrepartie monétaire marchande « spontanée » 44. Un exemple célèbre dans la littérature économique est celui des externalités positives croisées entre agriculteur et apiculteur 45. Les abeilles de l’apiculteur pollinisent gratuitement les fleurs des arbres du verger mitoyen et contribuent ainsi positivement à la production de l’agriculteur ; en retour, les arbres fournissent aux abeilles le pollen ingrédient majeur du miel que produira l’apiculteur 46.
Autre exemple assez classique, les rejets d’une usine polluant une rivière ont des effets négatifs sur les usagers de l’eau en aval de l’usine, sans que l’entreprise n’ait rien à payer pour cela. Les coûts liés à ces effets négatifs (coûts sanitaires, dépollution, détérioration d’un site touristique etc.) sont reportés à la charge de la collectivité : ils sont « externalisés » par l’entreprise.
Les externalités négatives environnementales ne sont pas uniquement des pollutions, elles peuvent être la conséquence de la surexploitation de ressources ou d’espace naturels qui n’ont pas de prix en soi (la qualité de l’air par exemple) ou dont le prix ne reflète qu’une partie des services rendus aux sociétés humaines. Par exemple, la valeur marchande d’une forêt ne traduit généralement pas le fait qu’elle stocke du carbone, héberge une grande diversité d’êtres vivants, préserve de l’érosion des sols et des inondations etc.
Au début du XXème siècle, Arthur C. Pigou 47 développe l’idée que les externalités sont des défaillances de marché car le prix ne représente plus l’ensemble des coûts et bénéfices engendrés par l’activité économique. Pour reprendre l’exemple de l’usine polluant une rivière, le coût privé d’exploitation de l’usine (supporté par le propriétaire) est inférieur au coût social (supporté par l’ensemble de la société) car l’usine n’intègre pas la pollution qu’elle génère dans ses coûts. Il en résulte une situation sous optimale qui mènera l’usine à surproduire.
« Internaliser les externalités négatives » : donner un prix aux pollutions
Une des caractéristiques majeures de ces externalités c’est qu’elles sont hors marché donc hors système de prix à partir desquels les agents économiques prennent leur décision.
Pour remédier à cette défaillance de marché, il est donc nécessaire « d’internaliser les externalités » c’est-à-dire d’introduire les coûts ou avantages externes dans l’arbitrage privé. Cela peut passer par des normes et réglementations (par exemple interdire ou limiter le niveau des rejets de polluants dans la rivière) ou par l’introduction d’un signal prix, solution qui a la préférence des économistes 48. Le prix matérialise l’externalité et permet de répartir les coûts sociaux entre les agents qui en sont à l’origine et ceux qui les subissent.
Pigou recommande l’utilisation de taxes équivalentes au coût du dommage causé à autrui. Dans la même logique, l’État devrait subventionner ceux qui créent des externalités positives, à la mesure de ce qu’elles apportent à autrui. Dans les années 60, John Dales 49 propose quant à lui de faire appel au marché ouvrant ainsi la voie aux marchés de quotas, tel celui mis en place en Europe sur le carbone. La puissance publique fixe le montant maximum de pollution et répartit les quotas de « droits à pollution » entre les agents économiques. Ceux-ci peuvent ensuite les échanger sur un marché, la confrontation de l’offre et de la demande permettant d’en fixer le prix. Cette solution permettrait une gestion plus efficace des externalités que les taxes car elle offrirait plus de flexibilité aux agents économiques. Chaque entreprise serait, en effet, en mesure d’arbitrer entre payer le coût de la dépollution ou acheter des quotas. Cela permettrait d’optimiser le coût total de dépollution, laquelle serait ainsi réalisée là où elle est la moins chère. Deux conditions sont cependant nécessaires à cette efficacité : les droits de propriétés doivent être bien définis et les coûts de transactions très faibles.
Quel que soit l’outil utilisé (taxe ou marché), le prix est supposé permettre d’aboutir à un niveau de pollution ou de dégradation de la nature dit « optimal » dans le sens où il permet d’équilibrer les coûts supportés par l’agent économique (par exemple, ses investissements pour réduire ou supprimer une pollution) et les dommages subis par la collectivité.
L’objectif n’est donc pas de supprimer la pollution en soi mais de refléter le coût des dommages présents et futurs afin que les agents économiques puissent en tenir compte dans leurs décisions de consommation et d’investissement.
Si l’idée peut paraître simple, elle pose, en pratique, de très nombreuses difficultés.
Comment valoriser ce qui n’a pas de prix ?
Comment évaluer ce qu’une pollution (ou une surexploitation) dégrade ou détruit étant donné que, par définition, la majeure partie du capital naturel est hors marché ? Reprenons l’exemple de la rivière polluée par l’usine. Elle va dégrader la qualité de l’eau pour ceux qui la consomment mais aussi rendre la zone non baignable, tuer une partie de la faune et la flore qui habite la rivière, éventuellement rendre plus difficile la navigation etc. La rivière rend ainsi de nombreux services (voir encadré sur les services écosystémiques) à la société.
Comment en déterminer la valeur ? Et plus généralement doit-on donner un prix à la nature ?
Quelques méthodes utilisées par les économistes pour tenter d’évaluer ce qui n’a pas de prix
-Estimation des coûts de remplacement : par exemple si on rase une forêt combien cela couterait-il de la remplacer à l’identique ?
-Estimation des coûts des dommages que le service permet d’éviter, ou que la pollution génère : par exemple, quel serait le coût des dommages que l’érosion ou les avalanches provoquerait dans une montagne dont on raserait la forêt.
– Méthode des prix hédoniques qui consiste à déduire la valeur d’un service écosystémique en observant les prix des biens marchants à proximité : par exemple, on déduira la valeur du service récréatif d’un site naturel exceptionnel en mesurant la différence entre le prix des propriétés ayant une vue sur le site en question et le prix de celle n’en ayant pas.
-Méthodes reposant sur des enquêtes, telle l’évaluation contingente qui consiste à poser à un échantillon de personnes la question suivante : « Combien seriez-vous prêt à payer pour préserver tel bout de nature ou telle caractéristique ? ».
Ces méthodes posent chacune des problèmes spécifiques : capacité à recréer un espace naturel à l’identique, à évaluer les dommages au-delà de ceux qui sont directement observables, à prendre en compte l’irréversibilité de certains phénomènes naturels ; pour les enquêtes, les résultats sont biaisés en fonction des revenus des personnes interrogées (une forêt située près d’une zone riche sera évaluée plus cher qu’une forêt près d’une zone pauvre) ou de leur méconnaissance des services rendus par l’espace naturel dont il est question. Enfin, de façon générale, ces méthodes ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble des services écologiques et en particulier des services de régulation et support de vie.
Source En savoir plus dans l’article Que valent les méthodes d’évaluation monétaire de la nature ? Aurore Lalucq et Jean Gadrey, L’Economie Politique n°069, 2016
L’équité intergénérationnelle : l’outil du taux d’actualisation
A la question de la valorisation du capital naturel détruit ou dégradé, s’ajoute une dimension temporelle. En effet, les dommages liés à la destruction d’un espace naturel, à la pollution d’une rivière s’étendent dans le temps. Ils peuvent impacter la génération présente mais également les générations futures. Pour prendre en compte cette dimension intertemporelle, les économistes utilisent l’outil du taux d’actualisation qui permet de ramener en valeur d’aujourd’hui un montant dépensé ou reçu plus tard. Un taux d’actualisation nul revient à dire que ces valeurs sont équivalentes, un taux d’actualisation élevé écrase l’avenir et revient à accorder plus de valeur au présent. Derrière cet indicateur technique se cache un débat profondément éthique : quelle place accorder aux générations futures ?
L’analyse coûts-bénéfices : un outil fort contestable
Enfin, se pose la question de la prise en compte de la valorisation respective des externalités positives et négatives d’un même projet. Prenons l’exemple, des investissements publics. Pour décider d’investir, la puissance publique est sensée regarder non pas seulement l’impact économique mais aussi les impacts environnementaux et sociaux c’est-à-dire la plus value de l’investissement en termes d’intérêt général. Entre une nouvelle route et une voie de chemin de fer comment décider ? Comment prendre en compte les gains de temps, les gains de sécurité et les impacts sur l’environnement ? Les économistes ont produit pour cela l’analyse coûts-avantages ou coûts-bénéfices. Elle consiste à comparer dans un bilan monétarisé les coûts d’une action aux avantages qu’elle procure. Par exemple, on va comparer les coûts de construction d’une route aux avantages qu’elle va procurer en termes d’accroissement de la mobilité ou de baisse des accidents. Il s’agit également d’intégrer les externalités négatives : émissions de GES pendant la construction et l’usage de la route, fragmentation des espaces naturels, artificialisation des sols etc. On le voit les problèmes de valorisation de ce qui n’a pas de prix sont démultipliés. La dimension intergénérationnelle de l’investissement est également à prendre en compte et nécessite de décider d’un taux d’actualisation plus ou moins important. Notons enfin que le fait de tout ramener à un même calcul monétarisé conduit à rendre les différents éléments du calcul substituables les uns par rapport aux autres : la valorisation de l’accroissement de la capacité à se déplacer peut contrebalancer la perte de valeur liée aux émissions de GES ou aux impacts sur les espaces naturels.
Comme on le voit, derrière une théorie en apparence assez simple se cache une multiplicité de problèmes méthodologiques, de choix éthiques et d’approximations. On peut alors se demander s’il est raisonnable de continuer à focaliser les recherches sur le seul outil du prix.
Le mythe du prix unique mondial au carbone comme solution au réchauffement climatique
Le traitement du réchauffement climatique est assez emblématique des errements où peut conduire la théorie des externalités prise au pied de la lettre ; et ceci, même sans tenir compte de la difficulté à fixer le prix du carbone, des questions d’équité intergénérationnelle ou des problèmes méthodologiques de l’analyse coûts-bénéfices.
En préalable, précisons qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’intérêt des outils de tarification du carbone (et plus généralement des outils de tarification des pollutions), qui sont essentiels à mobiliser. Par contre, il est très problématique d’en faire l’alpha et l’oméga des politiques climatiques.
C’est d’ailleurs ce que reconnaissent de nombreux économistes tels ceux qui ont participé à la Commission de haut niveau sur la tarification du carbone présidée par Nicholas Stern et Joseph Stiglitz.
La seule tarification du carbone peut ne pas suffire à induire des réductions d’émissions à la vitesse et à l’échelle requises pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris (…). Une combinaison d’instruments de politique climatique sera probablement plus efficiente et attrayante que l’utilisation d’un seul instrument. Il peut s’agir de l’investissement dans les infrastructures publiques de transport et la planification urbaine, d’un soutien à la production d’électricité renouvelable, de normes d’efficacité énergétique, de gestion des terres et des forêts, d’investissement pour l’innovation et la découverte de nouveaux procédés et technologies, et d’instruments financiers pour réduire les risques, et donc le coût du capital investi dans les technologies et les projets bas-carbone.
Seulement, il reste encore aujourd’hui des économistes de renom 50 pour lesquels la tarification du carbone reste l’outil majeur à mobiliser. Ils vont même plus loin et recommandent la mise en place d’un prix unique mondial. C’est le cas par exemple de William Nordhaus, lauréat du « prix Nobel » 51 d’économie 2018 « pour l’intégration du changement climatique dans l’analyse macroéconomique de long terme. »
Selon les recherches de M. Nordhaus, la solution la plus efficace aux problèmes causés par les émissions de gaz à effet de serre serait un système mondial de taxes sur le carbone imposé uniformément à tous les pays. Cette recommandation s’appuie sur un résultat formulé dans les années 1920 par un économiste britannique, A.C. Pigou, à savoir que chaque émetteur devrait payer le coût social des dommages causés par ses émissions via un prix approprié. Un système mondial d’échange de droits d’émission peut faire le même travail, à condition que les limites d’émissions soient fixées à un niveau suffisamment bas pour que le prix du carbone soit suffisamment élevé.
D’une part, une telle recommandation conduit à faire abstraction des difficultés concrètes de mise en place. Les négociations climat achoppent sur ce sujet depuis toujours, en raison notamment de l’impact redistributif et des coûts sociaux qu’une telle politique impliquerait tant à l’intérieur qu’entre les pays. Les questions d’acceptabilité et de justice sociales sont déterminantes pour la mise en place d’une taxe, comme en témoignent par exemple les manifestations des gilets jaunes en France. Nombre d’experts insistent ainsi sur l’importance de réfléchir à l’usage des recettes de la taxe et à l’accompagnement social des acteurs économiques les plus vulnérables et dépendants aux énergies fossiles. Quand la tarification passe par les marchés de quotas, la puissance du lobbying des grandes entreprises auprès de leurs Etats conduit à des attributions de quotas trop importants, comme en témoigne le niveau ridiculement bas du prix du CO2 sur le marché européen EU-ETS depuis son origine.
Ainsi, même si un prix unique du carbone au niveau mondial était vraiment une solution efficace, recommander sa mise en œuvre en dépit de son infaisabilité revient tout simplement à prôner l’inaction.
D’autre part, le prix unique est loin d’être une solution si efficace. Il apparaît évident que le niveau de prix permettant de faire évoluer consommations et investissements peut varier d’un pays à l’autre (en fonction du développement économique) ou d’un secteur à l’autre (la production d’énergie, ou le secteur textile par exemple).
Le réchauffement climatique ne serait pas un problème économique pour le XXIe siècle
C’est ce qu’affirmait l’économiste du climat Richard Tol en 2016 dans une interview pour le magazine Books en 2016.
Une telle déclaration peut paraitre surprenante ! Et pourtant l’idée que le réchauffement climatique, quelle que soit son ampleur, aurait un impact négligeable sur la croissance économique a longtemps été prépondérante parmi les économistes travaillant sur les liens entre macroéconomie et climat.
Elle est malheureusement toujours d’actualité. C’est ainsi que William Nordhaus, récompensé par le « prix Nobel d’économie » 51 en 2018 pour ces travaux sur ce sujet, écrivait encore en 2023 « les dommages sont estimés à environ 3,12 % du PIB dans le cas d’un réchauffement global de 3°C par rapport aux températures préindustrielles et à 12,5 % du PIB dans le cas d’un réchauffement de 6°C. » 53
Nous avons consacré une fiche entière à ce sujet dans laquelle nous expliquons quelles sont les méthodes employées par les économistes qui aboutissent à de tels résultats, en quoi elles sont profondément criticables et surtout pourquoi ces travaux sont dangereux : En tenant compte de tous ces ajustements, les dommages sont estimés à environ 3,12 % du PIB dans le cas d’un réchauffement global de 3 °C par rapport aux températures préindustrielles et à 12,5 % du PIB dans le cas d’un réchauffement de 6 °C.
Pour en savoir plus consultez notre fiche Réchauffement climatique : quel impact sur la croissance ?
La poursuite infinie de la croissance économique serait possible
Le succès international du rapport Limits to Growth paru en 1972 installe dans le débat public une question nouvelle : le maintien de la croissance économique est-il possible malgré la raréfaction des ressources naturelles et les pollutions globales ?
Les économistes critiques du rapport répondent par l’affirmative (sur le thème des ressources naturelles). Quand une ressource devient rare sont prix augmente et des mécanismes correcteurs se mettent en place : la demande diminue, on trouve des substituts, le progrès technique permet de s’en passer, de réduire sa consommation, de mieux recycler ou de les remplacer par du capital physique.
Quarante ans plus tard, les arguments n’ont pas changé comme en témoigne par exemple le bref passage « Are natural resources a limit to growth ? », d’un des manuels de référence d’Introduction à l’économie 54.
Que dit le rapport « The Limits to Growth » commandé par le Club de Rome ?
En 1970, le Club de Rome, tout jeune think tank centré sur les crises planétaires, commande à une équipe dirigée par Dennis Meadows du Massachusetts Institute of Technology une étude sur la possibilité du maintien de la croissance démographique et économique dans un monde fini. L’équipe de Meadows s’appuie, pour cela, sur le modèle World3 conçu par Jay Forrester, première tentative de modélisation intégrée du fonctionnement économique des sociétés avec leur environnement physique.
Publié en 1972, le rapport The Limits to growth conclut à l’impossibilité de la poursuite de la croissance économique dans un monde limité en termes de disponibilité des ressources et de capacité à absorber déchets et pollutions. Tous les scenarios testés 55 montrent la même tendance à l’effondrement de la production (agricole et industrielle) et de la population. Les ressources naturelles utilisées par le système productif (énergies, terres arables, forêts, poissons, minerais etc.) ne peuvent croitre indéfiniment, pas plus que les espaces disponibles pour stocker ou assimiler nos déchets (rebuts solides mais aussi gaz à effet de serre, substances chimiques etc.). La seule manière de stabiliser le système global, c’est de limiter la population et la production. Plusieurs chercheurs ont depuis comparé les courbes du rapport avec les données historiques, qui se révèlent très proches du scenario « Business as usual » 56.
Le raisonnement des économistes qui récusent le rapport
L’intervention de Robert Solow au Symposium on the Limits to Growth, retranscrit le raisonnement des économistes qui récusent le rapport. Ce qu’il appelle le « doomsday model » 57 de Forrester souffre d’un défaut majeur : il n’intègre pas de système de prix menant à la mise en place de mécanismes correctifs.
Les marchés financiers permettent d’anticiper la rareté future
Tout en affirmant qu’il n’est pas de ceux qui croient que le marché a toujours raison, Solow rappelle néanmoins que « le système des prix est, après tout, la principale institution sociale développée par les économies capitalistes (…) pour détecter et réagir à la rareté. »
C’est l’évaluation des prix futurs par les marchés financiers qui permet de détecter cette rareté. « Si les participants expérimentés et experts du marché pensaient maintenant que le prix des ressources seraient nettement plus élevés à un moment prévisible, les prix seraient déjà en hausse (…). La stabilité historique du prix des ressources suggère que les acheteurs et les vendeurs sur le marché n’ont pas agi comme s’ils prévoyaient leur épuisement en l’absence de substitut, et donc des prix nettement plus élevés. »
Notons déjà que cette première partie de l’argumentation repose sur la croyance dans la capacité des marchés financiers à anticiper les rareté futures des ressources considérées et à la retranscrire dans les prix actuels. C’est une condition essentielle à la suite du raisonnement car il est nécessaire que les mécanismes correctifs induits par la hausse des prix se mettent en place AVANT que les problèmes ne surviennent. C’est loin d’être une évidence.
Solow détaille, ensuite, les différents mécanismes qui se mettent en place du fait de la hausse des prix.
Quand les ressources seront plus chères, elles représenteront une part plus importante des coûts conduisant les producteurs à les économiser ou à leur en substituer d’autres (par exemple en remplaçant le pétrole par le charbon ou l’énergie nucléaire). Les prix des produits contenant beaucoup de ressources augmenteront par rapport à ceux qui en utilisent peu menant ainsi les consommateurs à acheter moins de produits intenses en ressources et plus d’autres choses. « Tous ces effets se traduisent automatiquement par une augmentation de la productivité des ressources naturelles, c’est-à-dire par une réduction des besoins en ressources par unité de PNB »« . »
Cette argumentation qui apparaît logique à première vue est pourtant elle-même sous-tendue par une hypothèse plus difficile à accepter. Solow affirme en effet que la productivité des ressources peut augmenter à l’infini. « Il n’y a donc aucune raison pour lesquelles nous ne pourrions croire que la productivité des ressources ne pourrait pas croitre de façon plus ou moins exponentielle à travers le temps »« . »
Quelques exemples permettant de douter de l’efficacité des mécanismes induits par les prix
La morue de Terre Neuve et le phosphate de l’île de Nauru sont deux exemples bien connus et documentés d’effondrements économiques locaux, liés à l’épuisement de ressources naturelles exploitées, non anticipés par les prix.
Les ressources naturelles ne sont pas indéfiniment substituables les unes aux autres.
- La capacité d’exploitation d’une ressource dépend de la disponibilité des autres (l’énergie et l’eau en particulier), de la maîtrise des procédés techniques permettant de l’extraire en concentration toujours plus faibles et dans des zones difficiles d’accès ainsi que des conséquences environnementales et sociales que la société est prête à accepter
- Si les animaux et les végétaux peuvent être considérées pendant un temps comme substituables en tant que ressources alimentaires, il n’y aura plus de substitut alimentaire en cas d’effondrement généralisé du vivant (comme cela semble être l’aboutissement de la dynamique actuelle _ voir au début du module). De la même manière, il est possible de remplacer pendant un temps un métal par un autre mais le tableau de Mendeleiev est fini. On ne peut donc indéfiniment trouver de nouveaux substituts à des minéraux qui manqueraient.
Ce n’est pas parce que l’offre baisse et que le prix augmente que les agents économiques peuvent immédiatement réduire leur demande (l’élasticité de la demande au prix de l’énergie peut être plus ou moins importante). Par exemple, au-delà d’un certain seuil, ménages et entreprises ne pourront pas réduire leur consommation d’énergie car ils en sont trop dépendants (voiture pour aller au travail, logement mal isolé, consommation excessive d’outils de production industriels non amortis etc.). Pour y parvenir, ils doivent investir ce qui nécessite des financements (pas toujours disponibles) et du temps.
La « démonstration » mathématique
En 1974, la Review of Economic Studies, publie un numéro (n°41 -issue 5) consacré à la question des ressources épuisables.
Dans son article, Solow cherche à prouver via une modélisation mathématique que la consommation peut se poursuivre malgré un stock de ressources naturelles limité. Dans son modèle, la fonction de production intègre les flux de travail et de capital physique 58, comme c’est le cas traditionnellement, mais aussi les flux de ressources extraites d’un stock préexistant et limité. Dans ce modèle, les ressources naturelles sont donc bien supposées épuisables.
Seulement, il note ensuite que « si la productivité moyenne des ressources est bornée, alors on ne peut produire qu’un montant fini de production avec le stock limité de ressource ; et le niveau de consommation agrégé qui peut être maintenu indéfiniment est nulle ». Il écarte alors cette option comme « inintéressante » pour se concentrer sur le cas où la productivité moyenne des ressources est infinie. Il en conclut sans surprise qu’il est possible de maintenir une consommation constante en substituant du capital aux ressources.
Dans son article, Joseph Stiglitz 59 part lui aussi d’un modèle de croissance dans lequel la production dépend des flux de travail, de capital physique et de ressources naturelles épuisables. Il étudie ensuite différents régimes de croissance. Certains ne permettent pas le maintien de la croissance régulière de la consommation. D’autres oui, mais il faut pour cela remplir une des deux conditions suivantes :
- soit le capital et les ressources naturelles sont substituables et la part du capital dans la production est plus importante que la part des ressources
- soit le progrès technique est en augmentation constante.
Cette démonstration mathématique ne dit pas quel est le régime de croissance qui décrit le mieux la réalité. Pourtant, dans sa conclusion Stiglitz énonce « Si l’on considère le modèle simple présenté comme une première approximation raisonnable, non seulement une croissance soutenue de la consommation par habitant est possible, mais le taux optimal d’utilisation de la ressource pour des valeurs raisonnables des paramètres est de l’ordre de grandeur observé pour de nombreuses ressources naturelles. » Il ne mentionne plus les conditions, pourtant essentielles, sous lesquelles cette croissance « continue » est possible.
Comme l’écrit Antonin Pottier dans sa thèse (p131) :
Pour qu’il soit possible de maintenir constante la consommation, il faut un progrès technique ou une substituabilité tels que le produit moyen des ressources tende vers l’infini à mesure que la ressource s’amenuise. (…) Les économistes peuvent éluder la question des limites à la croissance, non pas grâce à un certain montant de progrès technique, mais grâce à un progrès technique en croissance exponentielle. Les économistes sauvent, sur le plan théorique, la croissance de la consommation par l’appel à une autre forme de croissance, le progrès technique.
La méthode choisie pour présenter l’argumentation est importante. L’abstraction des modèles mathématiques donne une dimension « scientifique », « sérieuse » aux conclusions. Seulement, ces modèles ne décrivent que des possibilités parmi lesquelles les économistes choisissent celles qui sont conformes aux conclusions auxquelles ils veulent parvenir et non pas les plus proches de la réalité.
L’économie peut échapper théoriquement à la finitude des ressources grâce à une vision de la production totalement désincarnée, et, en définitive, déconnectée de la réalité. Les raisonnements des économistes sur un progrès technique tel que le produit moyen des ressources soit infini ne sont possibles que dans un monde idéel, qui ne conserve rien des caractéristiques réelles de la production
Dit autrement, la croyance en la capacité de la technique à résoudre la crise écologique est précisément de l’ordre de la croyance et non de la démonstration scientifique, même quand elle en prend l’apparence.
Pour en savoir plus
- Le rapport limits to Growth – 1972
- Un résumé de ce rapport sur le site de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici
- une vingtaine d’article sur le Rapport Limits to growth : origines, contenu et méthodologie, réception par le public et les économistes, impact, héritage
Pour une analyse détaillée de la réfutation du rapport Limits to Growth pas les économistes (et du débat qui s’ensuivit avec les tenants de l’économie écologique) consultez le chapitre 2.2 de la thèse d’Antonin Pottier
Il suffirait de remplacer les ressources naturelles par du capital artificiel (des machines)
En 1987, le rapport Brundtland Notre avenir à tous 60 met sur le devant de la scène internationale le concept de développement durable « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». Ce rapport va susciter de nombreux débats sur le concept de durabilité 61 parmi lesquels va émerger l’opposition entre durabilité forte et de durabilité faible qui constitue l’une des lignes de partage entre l’économie standard (voir L’essentiel 6) et l’économie écologique (voir L’essentiel 7).
Au cœur de la notion de développement durable, se trouve l’idée que les générations actuelles doivent léguer aux générations futures la capacité à éprouver un niveau de bien-être au moins équivalent à celui dont elles ont hérités, ce dernier reposant sur plusieurs « capitaux » 62 :
- le capital humain : le travail mais aussi les compétences, le niveau de formation de la main d’œuvre et les institutions qui contribuent à l’entretenir (système éducatif, de santé, de formation etc.) ;
- le capital productif (ou artificiel) : les moyens de production durables permettant de produire les biens et services (machines, bâtiments, infrastructures de transports etc.) ;
- le capital naturel : les ressources naturelles et les capacité d’épuration de la planète.
Les concepts de durabilité faible et forte 63 s’opposent sur la question de la substituabilité entre ces différents types de capitaux.
- Le concept de durabilité faible place au centre la substituabilité des différents types de capitaux entre eux : il est toujours possible de compenser la destruction de capital naturel par l’augmentation du capital humain (le travail) ou du capital physique (les machines notamment) créé par les hommes, grâce au progrès technique. Il s’inscrit en cela dans la lignée des travaux des économistes qui ont récusé les conclusions du rapport Limits to Growth selon lesquelles la croissance économique ne pourrait se poursuivre dans un monde aux ressources naturelles limitées (voir idée reçue 2). L’article de J.M. Hartwick (1977) qui poursuit les travaux de Solow est ainsi une des références en la matière. Il y énonce une règle de compensation intergénérationnelle, appelée depuis règle de Hartwick, selon laquelle afin de maintenir constante la consommation dans le temps il est nécessaire que les rentes prélevées au fur et à mesure de l’épuisement des ressources naturelles soient réinvesties pour produire du capital (des machines) à même de remplacer les ressources naturelles épuisées.
- Le concept de durabilité forte récuse cette hypothèse de substituabilité sans limite. La production nécessite toujours des ressources naturelles qui sont présentes en quantité limitée. De plus, les sociétés humaines tirent des bénéfices du simple fait du bon fonctionnement des écosystèmes (voir encadré), or ces bénéfices ne sont pas nécessairement identifiés et compris (sauf une fois qu’il est trop tard). Enfin, la disparition du capital naturel est sujet à des irréversibilités qui obèrent les choix dont peuvent disposer les générations futures.
L’économiste italien Mauro Bonaïuti résume ainsi la problématique : penser que les différentes formes de capitaux sont substituables c’est penser qu’on pourrait obtenir le même nombre de pizzas en diminuant la quantité de farine mais en augmentant le nombre de fours ou de cuisiniers. Plus simplement encore, on ne remplacera jamais l’air que nous respirons par un composé artificiel en bouteille…
Peut-on remplacer les abeilles ?
Face à la réduction du nombre de pollinisateurs naturels à commencer par les abeilles, les exploitants agricoles peuvent avoir recours à de la main d’œuvre pour polliniser à la main (c’est ce qui se passe en Chine par exemple), ou pourraient utiliser des drones 64 Il s’agit bien du remplacement du capital naturel par du capital humain ou du capital artificiel. Seulement, pour les remplacer dans l’agriculture, il faudrait mobiliser là aussi d’avantage de ressources naturelles que ce soit pour nourrir les ouvriers ou pour construire et alimenter les drones en énergie. Par ailleurs, les pollinisateurs ne peuvent être réduits à leur seul rôle agricole : ils pollinisent également des milieux naturels, jouent un rôle majeur dans les écosystèmes et sont insérés au sein de chaînes alimentaires. Leur disparition entrainerait celle de nombreuses plantes sauvages, irremplaçables, plantes qui auraient pu constituer, par exemple, la base de nouveaux médicaments.
Si les économistes écologiques se rassemblent sur ce constat des limites à la substituabilité entre capitaux, leurs propositions pour y faire face diffèrent. Pour certains, le développement durable nécessite au minimum le maintien d’un stock de capital naturel critique. Pour d’autres, tel Herman Daly il est nécessaire de maintenir constant le stock de capital naturel et de poser la question de la taille de l’économie. Il propose pour cela un ensemble de principes opérationnels à respecter pour tendre vers un développement durable : utilisation modérée des ressources non renouvelables, usage des ressources renouvelables respectant leur capacité de reproduction et stricte limitation des rejets et déchets à ce qui peut être recyclé par des processus naturels.
La technologie va nous sauver !
L’argument de la technologie salvatrice se nourrit de la croyance dans le génie humain et dans l’inéluctabilité du progrès. Cependant, confronté à la réalité, il est difficile à soutenir : jamais l’humanité n’a autant mobilisé la technologie qu’aujourd’hui, pourtant les problèmes écologiques n’ont fait que croitre ; ils sont d’ailleurs majoritairement dus aux machines et équipements 65 que la science et la technologie nous ont permis de mettre au point.
Ceci étant dit, on pourrait argumenter que la technologie mise résolument au service de la transition écologique serait la solution majeure aux problèmes de notre temps.
Sur le plan théorique, nous avons vu dans l’idée reçue 3, que miser sur le progrès technique pour maintenir la croissance malgré des ressources naturelles limitées revient à considérer que ce progrès technique permettra l’augmentation infinie de la productivité des ressources naturelles (c’est-à-dire la réduction infinie de la quantité de ressources nécessaire à un point de production).
Sur le plan empirique, les exemples suivants permettent de douter de la toute puissance de la technique pour résoudre nos problèmes.
L’effet rebond : l’efficacité énergétique (ou matière) n’est pas suffisante pour réduire les consommations.
Pour réduire les consommations d’énergie, certaines politiques publiques 66 favorisent l’efficacité énergétique qui consiste à mobiliser la technologie pour produire des biens consommant moins d’énergie à l’unité. Malheureusement, cette baisse unitaire de la consommation énergétique est généralement compensée par « l’effet rebond », théorisé dès 1865, par l’économiste William Stanley Jevons dans son ouvrage The Coal Question 67. Il y explique notamment comment l’augmentation du rendement des machines a vapeur a permis l’utilisation de davantage de machines conduisant à l’augmentation de la consommation totale de charbon.
L’Histoire lui a donné raison. Le plus souvent l’accroissement de l’efficacité énergétique de nos équipements ne conduit pas à une diminution de la consommation énergétique totale mais permet de développer de nouveaux usages de l’énergie. Comme l’explique l’ingénieur Philippe Bihouix « Indéniablement, la consommation d’énergie des véhicules, des avions, des centres de données, des procédés industriels baisse régulièrement, les innovations sont nombreuses et les progrès réels. Mais la croissance du parc automobile, des kilomètres parcourus, des données échangées et stockées est largement supérieure aux gains unitaires. Entre 2000 et 2010, le trafic internet a été multiplié par cent. Que vaut alors une amélioration de quelques dizaines de points d’efficacité énergétique par octet ? ». Cet effet peut être direct (la baisse du prix d’une ressource en accroît la consommation) ou indirect (la hausse du pouvoir d’achat, issue des gains d’efficience, se reporte sur d’autres produits ou d’autres services énergivores).
Si l’efficacité énergétique reste un outil important à mobiliser pour mener la transition écologique : il n’est pas suffisant seul. Il est important de lui adjoindre la sobriété énergétique c’est-à-dire une démarche de réduction volontaire des consommations par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective : moindre usage de la voiture, moindre chauffage, consommation de produits locaux et de saisons, infrastructure de transports en commun etc.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre « fiche détaillée sur l’effet rebond » .
Les technologies visant à extraire du CO2 de l’atmosphère (de la reforestation à l’extraction directe du CO2 de l’atmosphère) n’ont qu’un « potentiel limité. »
C’est la conclusion à laquelle est arrivée, le conseil consultatif des académies des sciences européennes (EASAC) dans son rapport Les technologies à émissions négatives – quelle rôle pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris paru début 2018 68. De nombreux scenarios visant à respecter l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle supposent l’utilisation massive de technologies permettant de retirer du CO2 de l’atmosphère. Il s’agit, par exemple, de la reforestation, des pratiques culturales accroissant le stockage du carbone dans les sols, des bioénergies, de la capture et du stockage du CO2 directement à partir de l’atmosphère ou à la source des émissions (en sortie de centrale électrique au charbon par exemple), ou encore de la fertilisation des océans. Dans l’avant propos du rapport, le président de l’AESAC avertit :
Penser que la technologie nous sauvera si nous échouons à suffisamment réduire les émissions de GES peut être une vision séduisante. Si ces technologies sont considérées comme une solution de secours potentielle, cela pourrait influencer les priorités des stratégies d’atténuation à court terme, car la promesse de futures technologies rentables est politiquement plus attrayante que l’adoption de politiques d’atténuation rapides et ambitieuses dès maintenant. Placer des attentes irréalistes sur ces technologies pourrait donc avoir des conséquences irréversibles et préjudiciables pour les générations futures dans le cas où elles ne tiendraient pas leur promesse.
En résumé, parier sur la technologie présente un risque : celui de perdre du temps en reportant les actions à entreprendre dès aujourd’hui pour réduire les émissions de CO2, au nom de promesse incertaines. Or sur ce plan, les conclusions de l’EASAC sont claires :
Ces technologies n’offrent qu’un potentiel réaliste limité pour enlever le carbone de l’atmosphère, et pas à l’échelle envisagée dans certains scénarios climatiques (jusqu’à quelques gigatonnes de carbone chaque année après 2050). Les technologies à émissions négatives peuvent avoir un rôle utile à jouer mais, sur la base des données actuelles, pas aux niveaux requis pour compenser l’insuffisance des mesures d’atténuation. (…) De plus, les tentatives de déploiement de ces technologies à plus grande échelle entraîneraient des incertitudes importantes quant à l’ampleur du retrait du CO2 qui pourrait être atteint, ainsi que des coûts économiques élevés et des impacts majeurs probables sur les écosystèmes terrestres ou marins.
Les auteurs du rapport ne plaident donc pas pour l’abandon de la recherche en la matière ou pour l’arrêt du déploiement de ces technologies quand elles sont opérationnelles (en particulier celles qui visent le stockage biologique via la reforestation et les pratiques culturales) mais bien pour arrêter de les considérer comme une « solution miracle ».
Pour en savoir plus
- Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon – T. Santarius, H.J. Walnum, C. Aall (Springer 2016)
- Negative emission technologies – What role in meeting Paris Agreement targets? (EASAC 2018)
- Les enjeux des technologies de capture et stockage du carbone, Blog Nourritures Terrestres (2021)
- Le mythe de la technologie salvatrice – Philippe Bihouix – Revue Esprit (2017)
La révolution numérique serait l’alliée de la transition écologique
La révolution numérique est souvent présentée comme l’alliée de l’écologie : le travail à distance, les plateformes collaboratives, le e-commerce, les usages « dématéralisées » (livres, films, musiques), les transports et objets connectés, les réseaux, bâtiments et villes « intelligents » viendraient à notre rescousse pour optimiser et réduire nos consommations de ressources et les pollutions consécutives. Cette idée reçue est en fait une déclinaison de la précédente, le progrès technologique étant aujourd’hui assimilé au numérique.
Voici quelques éléments permettant de montrer à quel point la révolution numérique, telle quelle est engagée, constitue bien plus un obstacle qu’un appui pour la transition écologique.
La révolution numérique est très matérielle
Si la littérature sur les impacts matériels de la révolution numérique est émergente, elle permet déjà de réfuter les argumentaires portant sur la supposée « dématérialisation » de l’économie qu’elle permettrait.
-Le numérique permettrait de dématérialiser nombre de nos usages. Au lieu de remplir nos maisons de livre, CD et DVD nous pourrions nous contenter d’une tablette. Dans une revue de littérature analysant une trentaine d’articles sur les effets de la digitalisation des biens (remplacement de biens matériels _ livres, journaux, musiques, films, jeux vidéos_ par leur équivalent numérique), deux chercheurs ont montré que non seulement cette substitution n’était pas toujours favorable en termes énergétiques mais qu’en plus aucune des études passées en revue ne tenait compte de l’effet rebond.
-La digitalisation de l’économie est très intense en énergie que ce soit pour la production ou l’utilisation des équipements : serveurs, bornes wifi, antennes-relais, routeurs, câbles terrestres et sous-marins, satellites, centres de données, et multiples terminaux (ordinateur, smartphone, tablettes). D’après le think tank The Shift project, le numérique est aujourd’hui responsable de 4 % des émissions de gaz à effet de serre mondiale, et sa consommation énergétique s’accroît de 9 % par an. Le renouvellement sans cesse plus rapide, de même que la course à l’augmentation des débits de data, laisse présager une accélération de ces émissions et consommations alors même que l’utilité sociale de toujours plus de numérique n’est jamais questionnée. Comme l’exprime très clairement Hugues Ferreboeuf et Jean-Marc Jancovici dans une tribune où ils alertent sur les impacts énergétiques et économiques du déploiement de la 5G en France : « ne sommes nous pas en train de confondre, comme un gamin excité à la veille de Noel, ce qui est nouveau et ce qui est utile, ce qui semble urgent avec ce qui est important ?«
Répartition de la consommation énergétique du numérique par poste
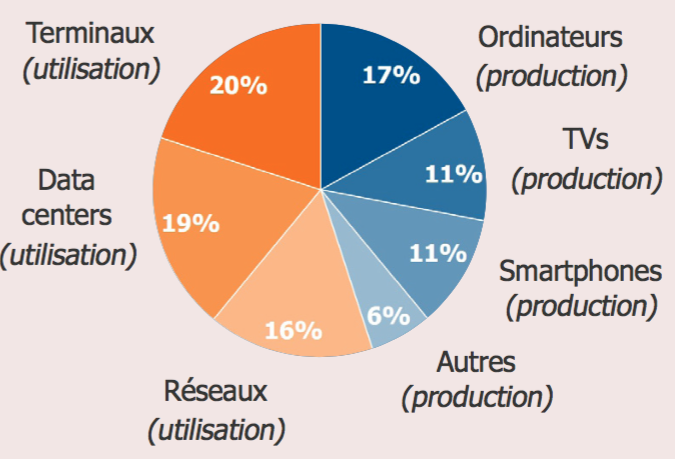
Source Projet Lean ICT, The Shift Project 2018
La consommation énergétique du numérique est à 45% liée à la production (en bleu) et à 55% causée par l’utilisation des équipements (dont 80% pour les usages vidéos ).
La production des réseaux de télécommunication, des data centers, des milliards de terminaux (ordinateurs, smartphones, TV et objets connectés) requiert également des quantités croissantes de métaux rares et/ou critiques dont l’extraction et la transformation ont des impacts majeurs en termes de pollutions et de perturbation des écosystèmes. De plus, ces métaux sont souvent présents en très petites quantités dans les multiples équipements numériques et mélangés les uns aux autres rendant leur recyclage très complexe voire impossible.
L’industrie du numérique qui se revendique « disruptive » continue, ainsi, à s’inscrire dans la culture productiviste et prédatrice de l’environnement typique du siècle passé.
L’économie numérique concurrente de la transition écologique
Une autre raison moins évidente mais pourtant bien réelle : la révolution numérique est bien souvent davantage concurrente qu’alliée de la transition écologique.
Tout d’abord nombre de métaux utilisés dans les équipement numériques sont également requis pour les besoins des technologies de la transition énergétique (énergies renouvelables, voitures électriques, LED, batterie etc). Leur consommation croissante peut donc faire craindre des conflits d’usage.
En matière d’objectif de politique publique et donc de régulations visant à orienter l’activité économique, la révolution numérique est souvent placée sur le même plan que la transition écologique. C’est ce qu’on peut constater en lisant les priorités stratégiques 2019-2024 de la Commission européenne, le Pacte productif proposé par le gouvernement français en 2019 ou encore les objectifs mis en avant pour les plans de relance suivant la crise du COVID19. Le maintien de l’habitabilité de notre planète et donc mis au même niveau que la poursuite du progrès technologique aujourd’hui assimilé au numérique.
Si l’on considère la question des ressources financières et humaines mobilisées pour mener ces deux révolutions, le numérique est bien au-dessus de l’écologie. La Silicon Valley en constitue un exemple presque caricatural comme le note avec beaucoup d’à-propos Jacques Attali dans une tribune des Echos « On gagne bien mieux sa vie en Californie à développer le dernier jeu vidéo à la mode qu’à concevoir des logiciels capables de réduire la consommation d’énergie, d’économiser l’eau ou d’améliorer l’éducation et la santé. Et plus encore qu’à bâtir des ponts, des routes, des usines de gestion des déchets, des barrages ou des centrales électriques. »
Les entraves symboliques, psychologiques et sociales à la transition écologique
Dans un article éclairant, l’économiste Eloi Laurent, montre qu’en plus de sa dimension fortement matériel, le tout numérique est également porteur d’entraves plus symboliques, psychologiques et sociales à la transition écologique. Sans prétendre ici retracer l’ensemble de la pensée de l’auteur, voici quelques faits saillants. Caractérisée par l’instantanéité et par l’hypertrophie de la sphère virtuelle, la transition numérique nous éloigne de la reconnexion au réel et de la capacité à penser le temps long si nécessaires à la transition écologique. En colonisant peu à peu le temps hors travail (familial, amical, amoureux), en accaparant l’attention des individus et en induisant des diversions permanentes, la multiplication de nos écrans connectés limite et ralentit la capacité de coopération sociale sur le temps long.
La transition numérique enferme donc les individus dans des sociétés d’intermittence et de diversion, de haute fréquence mais de basse intensité, alors que les défis sociaux et écologiques du début du 21e siècle exigent une énergie sociale maximale et continue. Elle favorise l’hypertrophie du monde virtuel (jeux vidéo, photographies numériques, réseaux sociaux) à proportion de l’atrophie du monde réel.
Pour en savoir plus
- Publications sur les impacts environnementaux du numérique – The shift Project
- L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Guillaume Pitron, (2021)
- Et si nous nous trompions de transition ? Pour un luddisme écologique – Eloi Laurent
- L’impasse collaborative – Pour une véritable économie de la coopération, Eloi Laurent (Les Liens qui Libèrent, 2018)
Le mythe de la dématérialisation de l’économie
La dématérialisation de l’économie signifierait qu’à mesure de son développement économique un pays utiliserait de moins en moins de ressources naturelles et génèrerait de moins en moins de déchets et pollutions. Cette vision est sous tendue par le constat de la prédominance du secteur des services dans les économies à haut revenu et par les discours sur les bienfaits du numérique qui permettrait de dématérialiser de nombreux usages (livres, musiques, films), de réduire les déplacements (télétravail, achats en ligne, visio-conférence), d’optimiser les consommations d’énergie et de ressources (réseaux intelligents). Dans quelle mesure, cette vision est-elle fondée sur une analyse de la réalité ?
Il n’y a pas de dématérialisation au niveau planétaire. Au contraire !
Concrètement la dématérialisation implique un découplage entre croissance économique, consommation de ressources et pollutions. Ce dernier peut prendre deux formes.
- Découplage « relatif » : la quantité de matière ou la pollution concernée croit moins vite que le PIB.
- Découplage « absolu » : la croissance économique s’accompagne d’une baisse en valeur absolue de la consommation des ressources naturelles et des pollutions d’une année sur l’autre.
Au niveau planétaire, on constate bien un découplage relatif dans certains domaines.
- L’intensité énergétique est passée 0,166 tep pour 1000 $ de PIB en 1990 à 0,12 tep en 2014. (Source)
- L’intensité matière est passée de 1,7 kg par $ de PIB en 1970 à 1,47 en 2015. (Source)
- L’intensité GES (hors changement d’affectation des terres) de 613 gCO2eq par unité de PIB (en USD) en 1990 à 423 en 2015 (Source).
Malheureusement, ce découplage relatif, très insuffisant pour contrebalancer la croissance économique globale, ne s’est pas traduit en découplage absolu. Au niveau mondial, les courbes de la consommation d’énergie, de l’extraction de matière ou des émissions de GES n’ont fait qu’augmenter.
Zoom sur l’indicateur d’extraction de matière : la re-matérialisation de l’économie à partir des années 2000
La quantité physique de matières extraites est un indicateur global de la pression de l’humanité sur la planète. Il agrège la biomasse (cultures, résidus de cultures, biomasse pâturée, bois et pêche), les énergies fossiles, les métaux et les minéraux non métalliques (sable, gravier, argile).
L’extraction de ressources a été multipliée par plus de 3,5 en 50 ans passant de 30 milliards de tonnes en 1970 à 106 en 2024.
La dynamique s’est accélérée au début des années 2000 : la croissance de l’extraction de ressources est ainsi passée de 2,1% par an en moyenne entre 1970 et 2000 à 3,5% entre 2000 et 2012. C’est notamment lié aux investissements importants dans les infrastructures et l’amélioration du niveau de vie matériel dans les pays à revenu intermédiaire, en particulier en Asie. Après un ralentissement (1% de croissance) pendant les années 2010 à la suite des conséquences économique de la crise financière et de la pandémie, la tendance est repartie à la hausse (2,9% par an).
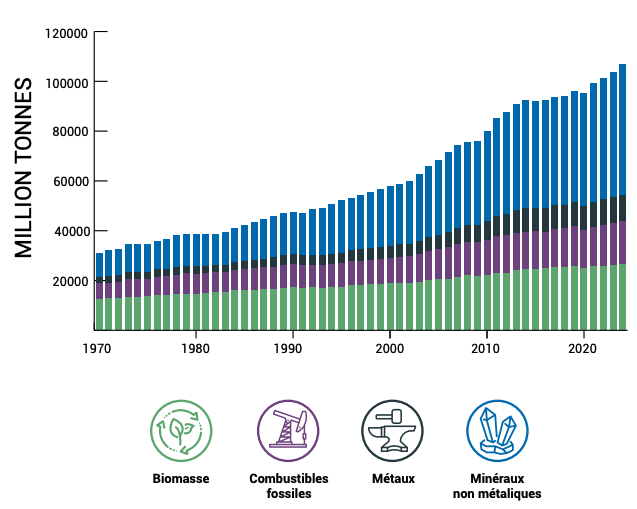
Source Résumé exécutif du Global Ressources Outlook 2024 (Figure 2a)
Comme le notent les auteurs du Global Ressources Outlook 2024 « L’accélération de l’extraction mondiale de matières premières depuis 2000 a coïncidé avec un ralentissement de la croissance du PIB et de la population. L’un des facteurs à l’origine de ce phénomène est probablement la concentration disproportionnée de la croissance du PIB dans les économies qui passent d’un mode économique agricole à un mode économique urbain et industriel, particulièrement intensif en matière d’utilisation de matières premières et d’énergie. »
Qu’en est-il dans les pays développés, caractérisés par une économie de service ?
C’est l’économiste anglais Colin Clark qui a conçu dans The Conditions of Economic Progress (1940) la typologie séparant les activités économiques en trois grands secteurs : le secteur primaire (l’agriculture, la pêche, l’exploitation de la forêt), le secteur secondaire (les activités d’extraction, de transformation, le bâtiment et les travaux publics, l’eau, l’énergie, la gestion des déchets) et le secteur tertiaire qui comprend tout le reste et est souvent assimilé au secteur des services.
Un peu partout, le développement économique s’est accompagné d’une part croissante du secteur tertiaire au détriment des deux autres que ce soit dans l’emploi (voir le site de l’INSEE pour les pays de l’Union européenne) ou dans le PIB : il représente ainsi près de 70% du PIB dans les pays à haut revenu. Ce passage à une économie de service serait concomitant d’une dématérialisation car le secteur tertiaire, à la différence des activités industrielles et agricoles, ne repose pas sur l’extraction puis la transformation (gourmande en ressources naturelles et génératrice de pollutions) de matières premières en produits.
Notons tout d’abord qu’il existe bien dans nombre de pays à haut revenu, un découplage absolu entre croissance économique et certains impacts environnementaux.
Ainsi, les émissions de GES de l’Union européenne ont connu un pic à 6,3 GteqCO2 à la fin des années 1970 pour décroitre ensuite jusqu’à 4,5 GteqCO2 en 2015 (Voir ici). C’est également le cas des Etats-Unis dont les émission baissent entre 2007 et 2015 de 7,1 à 6,4 GtCO2eq (cette évolution est cependant trop récente pour conclure à découplage pérenne entre PIB et GES aux USA, en particulier dans le contexte de la présidence Trump).
Cette évolution n’est cependant pas le cas de tous les pays à haut revenu. Et surtout elle reste largement insuffisante. Alors que les marges de manoeuvre pour progresser via la tertiarisation de l’économie sont faibles 69, les niveaux d’émissions par habitants sont toujours très supérieurs à ce qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement climatique en-deçà de 2°C.
Cette très nette insuffisance des résultats est mise en évidence par les auteurs d’une méta-analyse récente. Après avoir étudié 835 articles de recherche portant sur le thème du découplage entre PIB et différentes variables écologiques (émissions de GES, énergie finale, consommation de matières), ils concluent :
des réductions absolues rapides et importantes de l’utilisation des ressources et des émissions de GES ne peuvent être obtenues par le biais des taux de découplage observés ; le découplage doit donc être complété par des stratégies axées sur la sobriété et une application stricte des objectifs de réduction absolue des émissions.
Plusieurs éléments permettent d’expliquer pourquoi l’avènements de société de service ne conduit pas à la dématérialisation.
- Le secteur tertiaire comprend des activités très différentes dont certaines, tels les transports, sont très consommatrices d’énergie et génératrices de pollution. Par ailleurs, le classement entre les différents secteurs obéit à des conventions qui peuvent être trompeuses. Ainsi, quel que soit le métier exercé, les travailleurs sont classés en fonction de l’activité principale de leur employeur. L’intérim relève ainsi du secteur tertiaire même quand les employés travaillent dans l’industrie ou le bâtiment. Il en va de même quand une industrie externalise les activités de gardiennage, de nettoyage ou de gardiennage à des entreprises prestataires de service. Plus de détail dans cet article.
- Ce n’est pas parce que la part de l’industrie ou de l’agriculture a régressé en valeur dans la production globale, que cette évolution s’est également traduite par une réduction des volumes produits et des matières premières utilisées. C’est particulièrement évident au mondial. La part du secteur primaire (agriculture, forêt) dans la valeur ajoutée a baissé de 7,5% à 4% depuis les années 1990 (voir ici) pourtant la production de céréales et de viande n’a fait qu’augmenter. En clair, une réduction en valeur, ne signifie pas que moins de terres sont exploitées, moins de quantités produites, moins d’intrants (eau, engrais, pesticides) utilisés. Le même raisonnement est valable pour le secteur secondaire (industrie et biens manufacturés) dont la part dans la valeur ajoutée est passé de (voir ici).
- Les économies de service reposent bien pour fonctionner sur une production agricole et industrielle importante que celle-ci se déroule sur le territoire nationale ou proviennent des importations.
La matérialité des économies de service est encore plus importante quand on considère la consommation et pas seulement la production nationale
Si la part des activités industrielles et agricoles a effectivement reculé dans les pays développés par rapport aux services, ce n’est pas le cas de la consommation qui n’a cessé de croître. En complément de l’approche fondée sur la seule production nationale, il est donc intéressant d’analyser les flux transfrontaliers : nous achetons des matières premières, des produits manufacturés, ou des machines industrielles à l’étranger dont les impacts environnementaux se constatent hors de notre territoire. C’est la notion d’empreinte qui permet de rendre compte du phénomène. Elle consiste à calculer la pression de la consommation intérieure d’un pays sur une donnée environnementale spécifique. La plus connue et documentée est « l’empreinte carbone » 70.
L’empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre (GES) induite par la demande finale intérieure d’un pays (consommation des ménages, administrations publiques, organismes à but non lucratifs, investissement), que ces biens ou services soient produits sur le territoire national ou importés. L’empreinte carbone est donc constituée : i/ des émissions directes de GES des ménages (principalement liées à la combustion des carburants des véhicules particuliers et la combustion d’énergies fossiles pour le chauffage des logements) ; ii/ des émissions de GES issues de la production intérieure de biens et de services destinée à la demande intérieure (c’est-à-dire hors exportations) ; et iii/ des émissions de GES associées aux biens et services importés, pour les consommations intermédiaires des entreprises ou pour usage final des ménages. En tenant compte du contenu en gaz à effet de serre des importations, l’empreinte carbone permet d’apprécier les pressions sur le climat de la demande intérieure française quelle que soit l’origine géographique des produits consommés.
Comparaison de l’empreinte carbone de la France et des émissions directes du territoire nationale
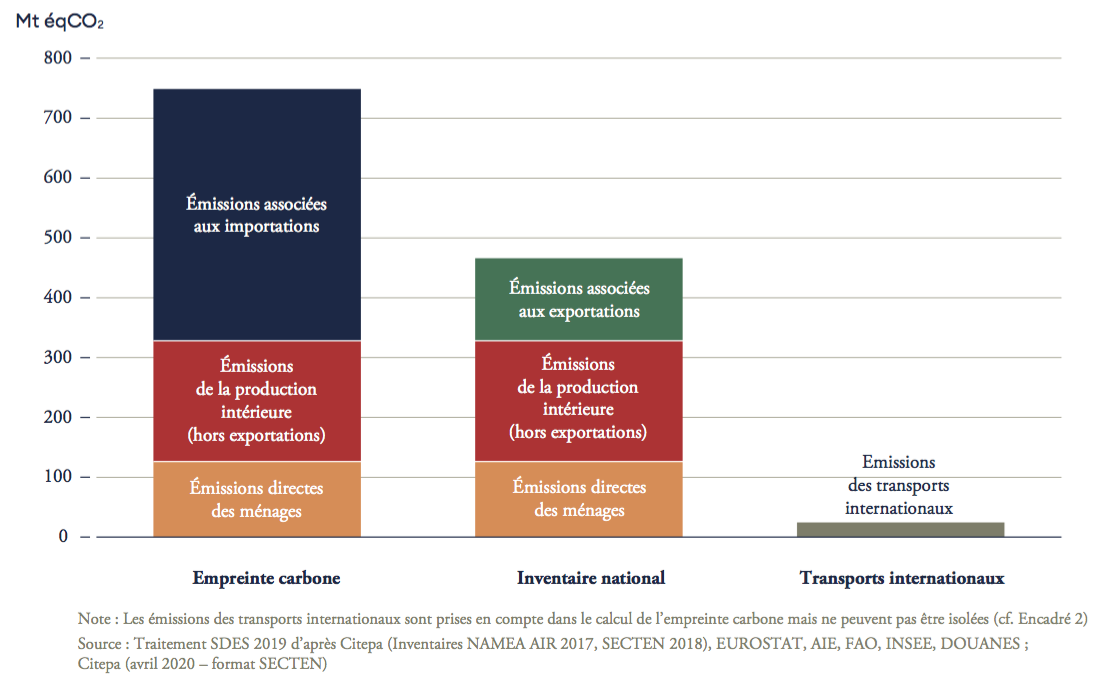
Source Maitriser l’empreinte carbone de la France (Figure 3), Rapport du Haut Conseil pour le Climat (2020)
L’empreinte carbone de la France est environ 70% plus élevée que ses émissions territoriales (qui correspondent à celles sur lesquelles le pays a pris des engagements climatiques au niveau international).
Il existe également des calculs d’empreinte pour d’autres types d’impacts environnementaux. Par exemple, l’empreinte eau (aussi appelée eau virtuelle) ou l’empreinte matérielle qui représente la quantité totale de matières premières extraites pour satisfaire les demandes de consommation finale.
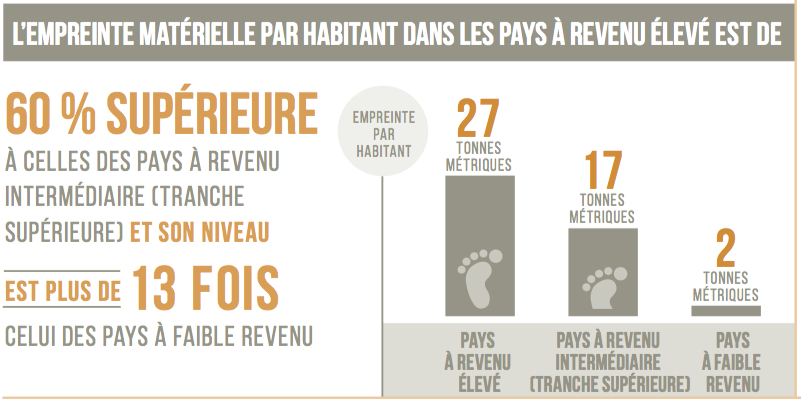
Source Rapport sur les objectifs de développement durable – ONU (2019)
Au-delà d’un certain niveau de revenu, l’état de l’environnement s’améliorerait
Une idée reçue consiste à affirmer qu’au-delà d’un certain stade de développement économique, l’état de l’environnement s’améliorerait à mesure de la croissance économique. Les besoins de base étant satisfaits, la demande sociale pour un environnement sain s’accroit et engendre des régulations publiques limitant les pollutions et favorisant les innovations technologiques environnementales. Les territoires concernés étant plus riches, ils ont des moyens financiers à allouer à l’amélioration de la qualité de l’environnement.
Cette affirmation a été popularisée par les travaux de Grossman et Krueger (1994) qui ont mis en évidence le phénomène pour quatre indicateurs environnementaux aux Etats-Unis (un sur la qualité de l’air en ville et trois sur les pollutions de rivières) : les pollutions augmenteraient avec le revenu par habitant puis décroitraient au-delà d’un revenu de $8000/an. La courbe de leur résultat est appelée « courbe environnementale de Kuznets » car sa forme en ∩ est semblable à celle des travaux de Simon Kuznets 40 ans plus tôt sur le lien entre inégalités et revenus par habitant.
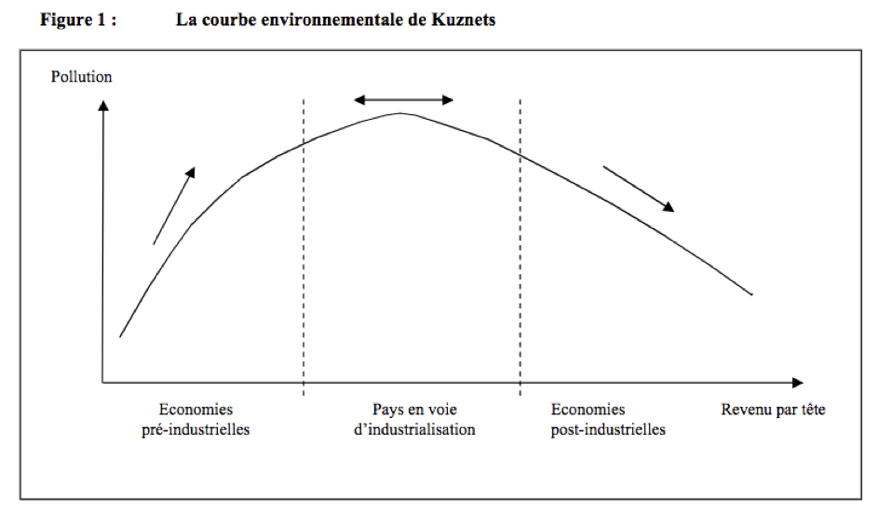
Source Meunié A. (2004). Controverses autour de la courbe environnementale de Kuznets
Cette théorie est attirante car elle explique que la croissance devient d’elle-même soutenable : il n’est pas nécessaire de changer fondamentalement notre modèle de développement économique, tout au plus faut-il réorienter les investissements vers les innovations vertes. Ses adeptes la présentent souvent comme une théorie « optimiste » comme en témoigne par exemple l’article Sortir du pessimisme écologique (article dans lequel on retrouve également d’autres idées reçues : importance des solutions technologiques, capacité du système prix à prévenir les pénuries de ressources).
La force de l’argumentation réside dans le fait qu’elle repose sur des éléments empiriques : effectivement à mesure qu’un pays devient plus riche, la demande sociale pour un environnement plus sain s’accroit ; nombre d’études mettent bien en évidence une corrélation entre diminution des pollutions et niveau de PIB. C’est ce que montre par exemple la méta-analyse réalisée par Bishwa Koirala, Hui Li et Robert Berrens en 2011 qui reprend 878 observations tirées de 103 études empiriques sur la courbe de Kuznets réalisées entre 1992 et 2009.
Il existe, cependant, plusieurs contre-arguments fondamentaux.
- Si des réductions de certaines pollutions sont bien observés au niveau local ou d’un pays, ce n’est clairement pas le cas au niveau global : volume des déchets (notamment plastiques), émissions de gaz à effet de serre, concentration d’azote dans les zones côtières ne sont que quelques exemples de courbes de pollutions toujours croissante. En supposant que la courbe de Kuznets soit réellement avérée, si on attend que l’ensemble de l’humanité atteigne un niveau de vie suffisant pour que la tendance s’inverse d’elle même, il sera bien trop tard pour préserver l’habitabilité de la planète pour l’espèce humaine.
- Il est indéniable que dans les pays développés les normes et règlements environnementaux contribuent à réduire les pollutions émises par les activités agricoles, industrielles ou minières. Il en va de même pour les réglementations sanitaires touchant à la qualité de l’eau potable, au traitement des déchets ou des eaux usées. Cependant, ce phénomène visant à réglementer les acteurs économiques locaux s’est accompagné de nombreuses délocalisations vers les pays à bas salaire et à faible (voire absence de) réglementation environnementale ainsi que de l’exportation massive des déchets (et donc des pollutions qui les accompagnent).
- La courbe de kuznets n’est pas observée pour les pollutions globales et en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre. C’est une des conclusions majeures de la méta-analyse de 2011 citée plus haut : « la littérature sur la courbe environnementale de Kuznets n’apporte aucune base pour prédire que la poursuite de la croissance économique entraînera une réduction significative des émissions de CO2, en l’absence de mesures politiques spécifiques à cet effet. »
Le graphique ci-avant montre une corrélation assez nette entre le niveau de développement et les émissions de CO2. Certains pourraient rétorquer qu’on commence à constater pour certains pays un découplage entre niveau de PIB par habitant et émissions de CO2 par habitant (ex : UK, USA, France, Allemagne _ voir les graph ici). Il n’en reste pas moins que ces pays se situent toujours dans la fourchette haute des émissions de CO2 par habitant. Concernant les pollutions globales, les pays développés restent bien parmi les plus gros pollueurs.
Tous ces éléments permettent de comprendre combien il est faux et dangereux d’espérer que le problème se règle de lui-même grâce à la croissance économique et l’innovation technologique. C’est d’un autre type de développement dont nous avons besoin, mettant au centre de son fonctionnement la prise en compte des pollutions et des impacts que nous souhaitons éviter ou réduire.
La crise écologique serait avant tout liée à la démographie
De façon assez évidente, la pression de l’humanité sur la planète dépend du nombre d’humains et du mode de vie de chaque individu 71. Certains discours récurrents en la matière insistent sur la dimension démographique : les humains sont déjà trop nombreux sur la planète ; il est prioritaire de réguler les naissances, en particulier dans les pays où elles sont les plus importantes à savoir les pays du Sud. Que signifient concrètement de telles affirmations et quelle est la part de la démographie et du mode de vie dans la crise écologique actuelle ?
Que signifie vraiment limiter la croissance démographique ?
Il est tout d’abord utile de rappeler quelques ordres de grandeur. L’humanité compte aujourd’hui 7,7 milliards de personnes. Sur la période 2015-2020, il y a eu en moyenne 140 millions de naissances et 57 millions de morts par an 72. Stopper la croissance démographique signifierait donc environ 80 millions de naissances en moins ou 80 millions de morts en plus soit l’équivalent des plus grandes catastrophes qu’ait connues l’humanité au cours des deux derniers siècles 73.
Puisque personne ne va ouvertement jusqu’à appeler de ses vœux un génocide massif, des pandémies planétaires (bien plus mortelles que celle de la COVID 19), des famines affectant la planète entière ou autres scenarios catastrophes 74, c’est principalement du côté de l’évolution de la natalité qu’il faut se tourner.
Selon le scenario central du World Population Prospect (WPP) 2019 de l’ONU, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards pour atteindre 9,7 milliards d’individus en 2050. Comme on peut le voir sur le graphique suivant, ces projections intègrent des hypothèses assez conséquentes de réduction du taux de fertilité : il passerait, au niveau mondial, de 2,5 enfants par femme aujourd’hui à 2,2 en 2050 et se rapprocherait presque partout du taux de remplacement des générations (2,1 enfants par femme). Seule l’Afrique subsaharienne maintient une fécondité significativement supérieure (de 4,6 enfants par femme aujourd’hui à 3,1 en 2050) 75. Le WPP 2019 étudie également un scenario « bas », avec en particulier un taux de fécondité en Afrique subsaharienne de 2,7 enfants par femme en 2050 (soit 2 enfants de moins en une génération) mais la population atteint quand même 8,9 millions en 2050.
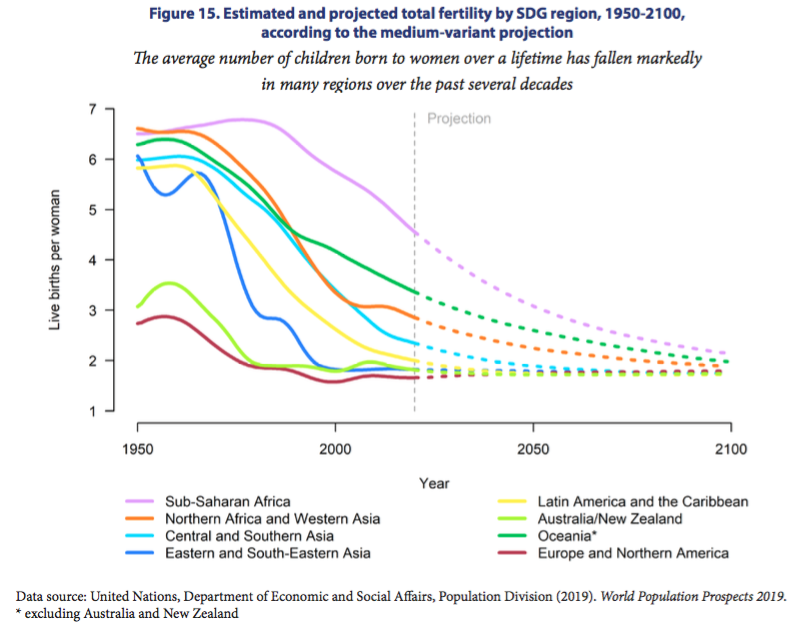
Source World Population Prospects 2019 – Higligths (p 23)
Il n’en reste pas moins nécessaire de mener des politiques de régulation des naissances dans les régions du monde où la natalité est importante pour des raisons écologiques et surtout sociales : les pays à forte natalité étant parmi les plus pauvres du monde. Pour le démographe Hervé Le Bras, la clefs de ces politiques « passe par les femmes et tient en deux mots : éducation et autonomie » (éducation au-delà du primaire et capacité à décider elle-même de leur fertilité). Sachant que nombre de régions à forte natalité connaissent une grande instabilité politique, voire des conflits (deux points défavorables à l’émancipation des femmes), les marges de manœuvre pour aller plus vite que les projections semblent bien faibles.
Certains n’hésitent pas à recommander de mener des politiques autoritaires comme la politique de l’enfant unique lancée en Chine à partir des années 1970. Notons d’abord que ce type de mesures a d’autres conséquences que la seule baisse de la fertilité (avortement et stérilisation forcées, déséquilibre garçon-fille, enfants cachés, infanticides et abandons d’enfants, trafic d’êtres humains, vieillissement rapide de la population et déséquilibre entre les générations). L’envisager à grande échelle est aussi et surtout totalement irréaliste : le simulateur de l’évolution de la population mondiale de l’INED montre ainsi que pour atteindre un pic de population de 8 milliards en 2050, il faudrait adopter un taux de fertilité mondial de 1,5 enfants par femme dès aujourd’hui partout dans le monde.
Comme l’écrit le démographe Henri Leridon, les projections à l’horizon 2050 sont assez largement déterminées par l’importance des générations présentes de « reproducteurs »(les mamans…).
Il semble donc assez vain d’escompter une baisse de la population mondiale à l’horizon 2050, sauf effondrement complet de la fécondité si des générations entières refusaient de se reproduire. C’est principalement en raison de l’inertie acquise au cours des années de forte croissance démographique : la structure par âge de la population mondiale porte encore la trace de ces années, avec des générations d’âge reproductif nombreuses qui contribuent à un nombre de naissances relativement élevé malgré une fécondité moyenne par femme assez faible.
Démographie et climat
Maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2°C par rapport au niveau pré-industriel constitue l’un des grands défis du XXIè siècle. Pour y parvenir la limitation de la croissance démographique est-elle une variable clef ?
Commençons par rappeler quelques évidences.
- Les émissions de gaz à effet de serre de l’humanité se sont élevées en 2015 à 49 GT CO2eq (hors changement d’affectation des terres) 76. Atteindre l’objectif de l’Accord de Paris implique de les ramener à 0 autour de 2050-70 (en réalité il reste des émissions résiduelles qui sont compensées par la séquestration physique et biologique). Les efforts à faire sur l’appareil productif existant sont donc déjà considérables indépendamment de la croissance démographique.
- La responsabilité historique des émissions penche très nettement du côté des pays qui ont amorcé en premier leur développement économique. En 2018, l’UE28, les USA et la Chine étaient ainsi responsables de 60% des émissions cumulées de CO2 fossile depuis 1850.
- Les émissions de GES par habitant sont largement corrélées au niveau de vie (mesuré par le PIB/ habitant)77. Voir sur Our World in Data un graphique pour le seul CO2.
Penchons-nous maintenant sur les émissions des dernières décennies. Entre 1970 et 2015, la population mondiale a doublé, de même que les émissions de GES. Une analyse sommaire pourrait donc laisser penser à une relation de cause à effet. C’est pourtant loin d’être le cas tant les situations sont contrastées entre les pays comme l’illustre le graphique ci-après.
Evolution des émissions de GES des 4 plus grands émetteurs 1970-2015 (Mt CO2eq)
Source Base de données EDGAR (n’inclut pas le changements d’affectation des terres)
En 2015, les 4 premiers émetteurs étaient responsables de 56% des émissions mondiales de GES pour 48% de la population.
Parmi eux, on compte deux géants démographiques : l’Inde et la Chine. Dans les deux cas, c’est principalement la croissance économique qui est responsable de l’augmentation des émissions.
- La population chinoise a été multipliée par 1,7 depuis 1970 et les émissions du pays par 6,5, pour représenter plus du quart des émissions mondiales de 2015. C’est donc bien plus le développement économique (celui du pays et celui de ses clients, la Chine étant devenue l’usine du monde) que la démographie qui a fait de la Chine le premier pays émetteur. Si la population avait été l’unique déterminant, les émissions chinoises s’élèveraient en 2015 à 4 GteqCO2 (soit 9 GteqCO2 en moins, 20% des émissions mondiales).
- En Inde, la dynamique est similaire (population multipliée par 2,5 et émissions par plus de 4) même si la part de l’économie est moindre, le pays restant parmi les plus pauvres du monde.
Du côté des pays de la révolution industrielle, on constate une baisse des émissions par habitant qui conduit même en Europe à une réduction des émissions en valeur absolue (les USA augmentant quant à eux leurs émissions de 13% par rapport à 1970). Malgré cela, Etats-Unis et UE28 restent responsables de 22% des émissions mondiales (pour 11% de la population), quasiment autant que les Chinois et nettement plus que le géant indien.
Notons par ailleurs, que le raisonnement est ici réalisé sur les émissions nationales des pays. Les conclusions seraient différentes si l’analyse portait sur l’empreinte carbone qui se focalise non sur la production nationale mais sur la consommation (et intègre donc les émissions liées aux importations). Comme vu dans l’idée reçue 7 sur la dématérialisation de l’économie, l’empreinte carbone de la France est nettement plus importante que ses émissions directes.
Quid des projections démographiques ?
D’après le World Population Prospect 2019 de l’ONU, plus de la moitié de la croissance démographique attendue d’ici 2019 (1 milliard de personnes) serait le fait de 9 pays : l’Inde, le Nigeria, le Pakistan, la RDC, l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Indonésie, l’Egypte et les USA. Etant donné le niveau très faible des émissions de CO2 par habitant de ces pays (à l’exception des Etats-Unis), cela impliquerait une hausse de 3 Gt de CO2 (dont près d’1 Gt pour les seuls Etats-Unis).
N’est-il pas nettement prioritaire de réduire les émissions des plus grands émetteurs et d’empêcher que les grands pays démographiques suivent la voie de développement carboné qui a été celle de l’humanité jusqu’à présent. Pour ne prendre que deux exemples, si les Etats-Unis réduisaient leurs émissions par habitant au niveau de celles de l’Union européenne (ce qui reste très insuffisant au regard de l’Accord de paris), ils diviseraient par 2 leurs émissions globales de 2015 (en incluant la croissance démographique). Symétriquement, si l’Inde suivait la voie de la Chine (mais sans accroitre sa population) elle émettrait en 2050 près de 13 GTeq CO2 soit 4 fois ses émissions actuelles.
Extraction de ressources naturelles et démographie
La quantité physique de matière extraite est un autre indicateur global de la pression de l’humanité sur la planète, qui regroupe la biomasse (cultures, résidus de cultures, biomasse pâturée, bois et pêche), les énergies fossiles, les métaux et les minéraux non métalliques (sable, gravier, argile). Les chiffres mondiaux établissent déjà clairement que la démographie n’est pas la seule variable explicative de cette pression : l’extraction de ressources est passée de 27 millions de tonnes en 1970 à 92 en 2017, soit une multiplication par plus de 3. Dans le même temps, comme déjà noté la population mondiale doublait.
Quand on raisonne au niveau des territoires, l’indicateur d’extraction de matière peut se décliner de trois façons différentes :
- l’extraction de matière directement réalisée sur le territoire ;
- la consommation intérieure apparente de matières (matières extraites directement sur le territoire + matières importées – matière exportées)
- l’empreinte matière, qui attribue au consommateur final toutes les ressources mobilisées au niveau mondial : elle ajoute donc à la consommation intérieure apparente, les matières incorporées dans les objets, machines importés (et retranche les exportations).
Selon la perspective adoptée, le poids des différents territoires n’est clairement pas le même comme en témoignent les deux graphiques suivants qui permettent de comparer consommation intérieure et empreinte matière selon les quatre groupes de revenus des pays.
Consommation intérieure de matière et empreinte matière selon les niveaux de revenus
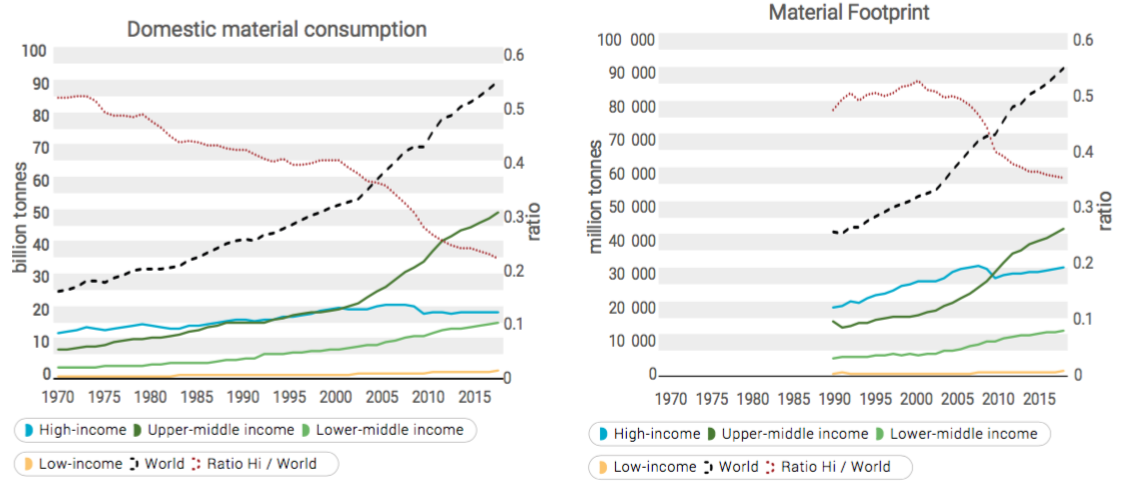
Source Global Ressources Outlook 2019 (Fig. 2.21 et 2.25). « Ratio Hi/World » (échelle de droite) indique la part des High Income / monde.
- L’empreinte matière des pays à revenu intermédiaire supérieur (auquel appartient la Chine) augmente régulièrement (reflétant leur développement économique), mais reste inférieure à leur consommation intérieure : cela traduit notamment le rôle « d’atelier du monde » de la Chine.
- L’empreinte matière des régions à haut revenu est supérieure à leur consommation intérieure de matière : cela indique que la consommation dans ces pays dépend, en partie, de matières provenant d’autres pays via les chaînes d’approvisionnement internationales.
- Les pays à niveau de revenu « moyen inférieur » et « faible » (qui sont donc ceux qui auraient le plus besoin de matière pour leur développement) ne représentent respectivement que 22% et 18% de la consommation mondiale.
Rapportés à la population, ces chiffres sont encore plus disproportionnés. C’est l’un des messages clefs du Global Ressources Outlook 2019. « L’empreinte matière dans les pays à revenu élevé est d’environ 27 tonnes par personne, soit 60 % de plus que le groupe à revenu moyen supérieur en 2017 et plus de 13 fois le niveau du groupe à faible revenu. »
Les impacts environnementaux
Ajoutons un dernier point : la question de l’extraction de ressources et de leur répartition est importante non seulement car l’humanité ne dispose pas de réserves infinies mais aussi en raison des impacts environnementaux.
Impacts environnementaux de l’extraction et la transformation des ressources en matières, combustibless et denrées alimentaires
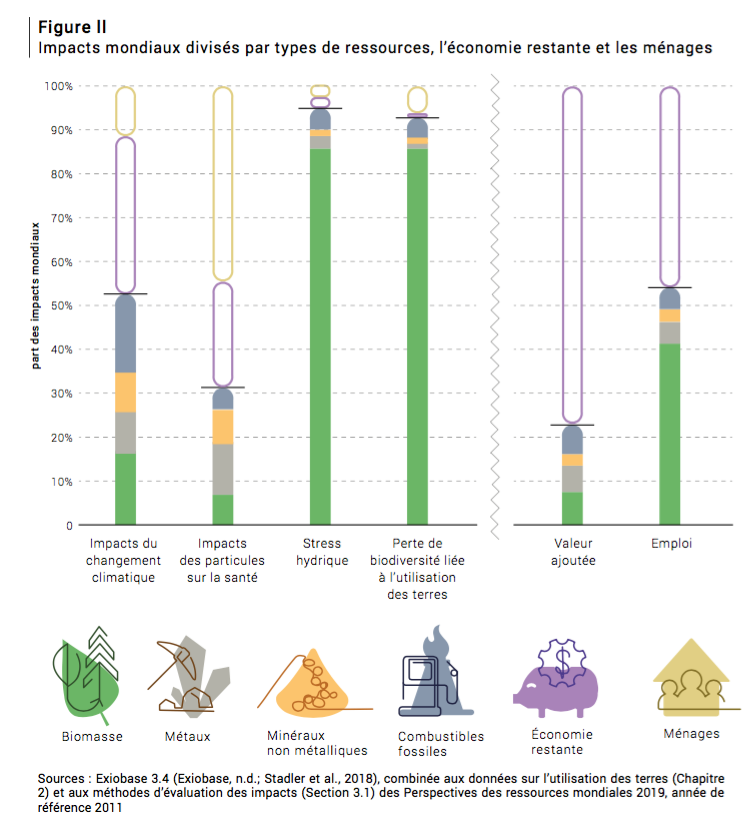
Source Global Ressources Outlook 2019 – Résumé pour décideur en français (p16)
D’après le Global Ressources Outlook, « l’extraction et la transformation des ressources en matières, combustibles et denrées alimentaires représentent environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la planète (sans prise en compte des impacts climatiques liés à l’utilisation des terres) et plus de 90 pour cent de la perte de biodiversité et du stress hydrique. » (Résumé pour décideur FR p15). Or ces impacts ont bien évidemment lieu là où se déroule l’extraction directe de matière : les pays qui externalisent les étapes les plus intensives en matériaux et en énergie des chaînes de production externalisent ainsi également les impacts environnementaux qu’ils soient globaux (comme les émissions de GES) mais aussi locaux (ressources en eau, destruction d’espace et biodiversité etc.).
Pour en savoir plus
Quelques articles et interviews
- Population mondiale : vers une explosion ou une implosion ? Population & Sociétés (2020)
- Démographie et climat – Blog Enquête écosophique
- 10 milliards d’humains, et alors ? Interview croisée d’Hervé Le Bras et de Gilles Boeuf – Le Monde (2017)
- Hervé Le Bras : « L’explosion démographique est derrière nous » – La Croix (2020)
Outils pédagogiques sur l’évolution de la population
L’amélioration de l’état de l’environnement reposerait avant tout sur les comportements individuels
Il existe sur wikiHow un guide pour sauver la planète en 17 étapes : économies d’eau et d’énergie dans le logement, achats locaux et responsables, usages de moyens de transport doux etc. Ce guide s’inscrit dans nombre de discours mettant la modification des comportements individuels au cœur de la résolution des crises écologiques que ce soit par les activités quotidiennes (consommation d’eau et d’énergie, tri des déchets, modes de déplacements) ou par les choix de consommation (prise en compte des critères environnementaux lors d’un achat).
Bien sûr, l’évolution des comportements individuels est fondamentale et les initiatives diffusant ces actions concrètes sont importantes. Quand on sait qu’un aller retour Paris-New York pour une personne émet autant de GES que la consommation annuelle moyenne de chauffage de cette personne, il est certain que la pratique du week-end shopping sur la 5ème avenue n’arrange pas le bilan climatique…
Néanmoins, tout miser sur l’évolution de la sensibilité environnementale des citoyens et des consommateurs n’est clairement pas suffisant.
Dans la publication Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’Etat face à l’urgence climatique, l’entreprise Carbone 4 a montré combien les actions individuelles, bien que nécessaires, sont loin de suffire à répondre à l’enjeu climatique.
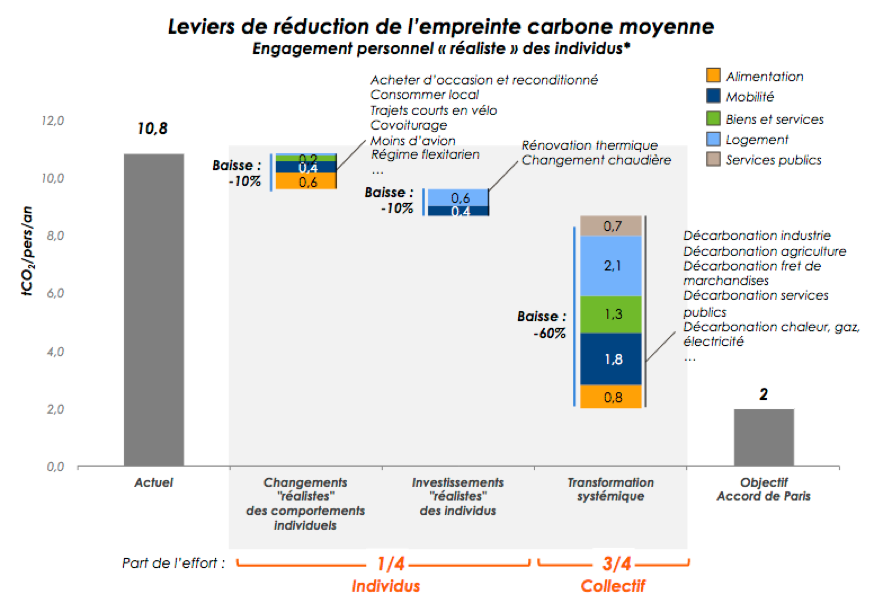
Source Faire sa part – Carbone 4 – juin 2019
En 2017, l’empreinte carbone d’un Français était en moyenne de 10,8 tonnes de CO2 équivalent. D’après l’étude, une modification « réaliste »78 des comportements individuels permettrait de la réduire de 10%. Si on ajoute les investissements réalisables par les individus (ex : rénovation thermique), on constate qu’en gros un quart de la baisse de l’empreinte carbone moyenne est à la main des individus. Le reste de l’effort doit relever d’actions et d’investissements collectifs qu’il s’agisse de l’Etat des collectivités ou des entreprises.
Ce résultat est en réalité assez compréhensible.
Au niveau économique, la transition écologique en France implique d’investir massivement pour mettre en conformité écologique les infrastructures de transport, d’énergie, d’eau, de gestion des déchets, les flottes de véhicules et de navires, les parcs de bâtiments, les stocks de machines. C’est tout le stock de capital physique, tout notre héritage économique, qui doit être rénové pour limiter au maximum les prélèvements de ressources naturelles, la consommation d’espace et les pollutions locales et globales (dont les émissions de GES). Il s’agit également d’investir dans la formation et la recherche pour transformer les pratiques industrielles et agricoles et pour accompagner la reconversion professionnelles de ceux qui travaillent aujourd’hui dans des activités, telle l’industrie du charbon, qui ne pourront perdurer si la transition a bien lieu.
Face à un tel défi, on comprend facilement que les seuls comportements individuels ne suffisent pas. Voici quelques exemples.
- Les citoyens bénéficient de services publics (santé, enseignement, justice et défense, réseaux d’eau et d’énergie) qui sont consommateurs de ressources et émetteurs de gaz à effet de serre dont il n’a pas la maîtrise. Seuls l’Etat et les collectivités peuvent entreprendre la rénovation des bâtiments publics, mettre en place des politiques d’achat responsables ou aménager le territoire pour placer les services au plus près des usagers et limiter l’artificialisation des sols.
- L’usage de transports collectifs dépend en grande partie de l’offre : nombre d’individus n’y ont pas accès pour leurs déplacements quotidiens.
- Le consommateur ne peut choisir que parmi ce qu’on lui propose : parfois le choix « écologique » n’existe pas ou il est trop coûteux. Il n’a alors d’autre alternative que d’attendre qu’une offre satisfaisante se structure et émerge. Si les véhicules électriques sont aujourd’hui de plus en plus répandus ils restent chers. Il en va de même de l’alimentation « bio », longtemps bien plus chère que la nourriture « conventionnelle ».
- Les consommateurs n’ont que peu d’impacts sur les process industriel eux-mêmes (ex : méthode de fabrication de l’aluminium, de l’acier ou des autres métaux incorporé dans les objets etc), sur les méthodes de traitement des déchets.
Ajoutons qu’adopter un comportement de citoyen et de consommateur responsable n’est pas forcément simple.
- Changer ses habitudes nécessite un temps d’appretissage et d’adaptation. Par exemple, adopter une alimentation ayant peu d’impact sur l’environnement, c’est non seulement mieux choisir ses produits mais aussi réapprendre à faire la cuisine. Toute les pratiques relevant du Do It Yoursel prennent beaucoup de temps.
- Consommer responsable nécessite d’avoir et de prendre le temps de s’informer. Même si la transparence a progressé, consulter et comprendre les informations sur la qualité environnementale des produits indiqués par divers labels et standards demande un temps, une formation et une compétence auxquels tous les individus n’ont pas forcément accès.
- Le nombre de critères différents à prendre en compte lors d’un achat demande au consommateur d’arbitrer entre des choix dont aucun ne le satisfait mais pour des raisons différentes. Par exemple, entre un cosmétique bio provenant d’une entreprise avec de fortes inégalités salariales, et une entreprise produisant des cosmétiques classiques avec une bonne politique salariale, quel pouvoir a le consommateur pour exprimer à la fois ses attentes environnementales et sociales ?
- En 1992, 1700 scientifiques et l’Union of Concerned Scientists signaient le World Scientists’ Warning to Humanity appelant à prendre en compte l’environnement. 25 ans plus tard, le World Scientists’ Warning of Climate Emergency est signé cette fois par près de 15000 scientifiques. L’article qui l’accompagne publié dans la revue Bioscience montre qu’à part le trou de la couche d’ozone tous les indicateurs mis en évidence n’ont fait qu’empirer. ↩︎
- Inventé en 2001 par les scientifiques Paul Crutzen et Eugene Stoermer, le concept d’Anthropocène désigne une nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact massif des activités humaines sur la planète. Si ce concept est largement utilisé, il n’est pas validé officiellement. En 2009, l’Union internationale des sciences géologiques a lancé un groupe de travail dédié qui après 15 ans d’études a abouti à la proposition de qualifier d’Anthropocène une nouvelle ère géologique démarrant en 1950. Cette proposition a été rejeté début 2024. ↩︎
- Le réchauffement climatique ne sera pas linéaire : il existe des « points de bascule », tels la disparition de la banquise arctique ou la fonte du Groënland, qui une fois franchis provoqueront des réactions en chaine menant à un emballement du réchauffement planétaire quelles que soient les actions humaines. Voir Lenton, T. M., Held, H., et al. (2008), Tipping elements in the Earth’s climate system Proceedings of the National Academy of Sciences ; et Steffen, W., Rockström, J., et al. (2018), Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, Proceedings of the National Academy of Sciences ↩︎
- Créé en 1988, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est une organisation intergouvernementale rassemblant tous les Etats membres de l’ONU. Il a pour mission de fournir aux responsables politiques une évaluation des connaissances scientifiques sur les changements climatiques, leurs impacts environnementaux, économiques et sociaux ainsi sur les mesures à prendre pour y faire face. Les rapports d’évaluation du GIEC sortent tous les 5 ans environ. La première partie du 6ème rapport qui traite de la compréhension physique du climat et du réchauffement en cours et à venir est parue en 2021. ↩︎
- Avec des effets différents selon les régions du monde : le réchauffement sera plus prononcé sur les continents que sur les océans, aux pôles qu’aux Tropiques, la nuit que le jour. ↩︎
- Les estimations actuelles varient de 250 millions à 1 milliard de personnes. Voir par exemple: Climate Change and Migration: Improving Methodologies to Estimate Flows, International Organization for Migrations (2008). Voir aussi le rapport 2017 du « Lancet countdown ». ↩︎
- Consulter le Rapport du GIEC Global Warming of 1.5 °C, l’article du Monde qui en fait la synthèse Climat : il y a un espoir de limiter le réchauffement mais au prix d’un sursaut international ou en vidéo l’audition de la climatologue Valérie Masson-Delmotte au Sénat. ↩︎
- Le réchauffement climatique ne sera pas linéaire : il existe des « points de bascule », tels la disparition de la banquise arctique ou la fonte du Groënland, qui une fois franchis provoqueront des réactions en chaine menant à un emballement du réchauffement planétaire quelles que soient les actions humaines. Voir Lenton, T. M., Held, H., et al. (2008), Tipping elements in the Earth’s climate system Proceedings of the National Academy of Sciences ; et Steffen, W., Rockström, J., et al. (2018), Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, Proceedings of the National Academy of Sciences ↩︎
- Le vivant a déjà connu au moins 5 extinctions de masse. La dernière, il y a 65 millions d’années, a vu s’éteindre les dinosaures, en même temps que les trois quarts des espèces présentes sur Terre. Quelques articles scientifiques sur l’extinction en cours : Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction, Sciences Advances (2015) ; Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines, PNAS (2017) – article du Monde présentant cette étude ; Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers, Biological Conservation, (2019) – article de Sciences Avenir présentant cette étude. ↩︎
- Voir le rapport de la FAO Situation des forêts du monde ; consultez également le site de l’ONG Global forest watch qui comprend notamment de nombreuses datavisulisation et données ↩︎
- Voir l’article Global warming impairs stock–recruitment dynamics of corals, Nature (2019) et l’article Dans la Grande Barrière, « les coraux ne font plus de bébés » (Le Monde 2019) résumant cette étude. ↩︎
- L’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) est un organisme intergouvernemental indépendant comprenant plus de 130 Etats membres. Instauré en 2012, il fournit aux décideurs des évaluations scientifiques objectives sur l’état des connaissances sur la biodiversité de la planète, les écosystèmes et les contributions qu’ils apportent aux populations, ainsi que les outils et les méthodes pour protéger et utiliser durablement ces atouts naturels vitaux. Le premier rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques a été publié en 2019. Consultez un résumé sur le site du Monde. ↩︎
- L’initiative du Millenium Ecosytem Assessement a été lancée en 2000 par l’ONU avec pour objectif d’évaluer les conséquences des changements écosystémiques sur le bien-être humain et de proposer les actions nécessaires au maintien des écosystèmes et à leur gestion durable par les êtres humains. Plus de 1300 experts du monde entier ont participé à ce projet dont les résultats ont été publiés en 2005. ↩︎
- L’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) est un organisme intergouvernemental indépendant comprenant plus de 130 Etats membres. Instauré en 2012, il fournit aux décideurs des évaluations scientifiques objectives sur l’état des connaissances sur la biodiversité de la planète, les écosystèmes et les contributions qu’ils apportent aux populations, ainsi que les outils et les méthodes pour protéger et utiliser durablement ces atouts naturels vitaux. Le premier rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques a été publié en 2019. Consultez un résumé sur le site du Monde. ↩︎
- Sources. L’eau : AQUASTAT – FAO’s Global Information System on Water and Agriculture. Le sable : Sand and Sustainability: Finding New Solutions for Environmental Governance of Global Sand Resources UNEP, 2019. Les énergies fossiles : Statistical Review of World Energy 2023. Les céréales : FAOSTAT. Le minerais de fer : USGS – National Minerals Information Center – Commodity Statistics and Information. ↩︎
- Source : Fiches de criticité des métaux réalisées par le BRGM. Indicateur TCAM (taux de croissance annuel moyen) lissé sur 5 ans. ↩︎
- Consultez le communiqué de presse et l’article lui-même Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J. et al. « Global human-made mass exceeds all living biomass. » Nature (2020). ↩︎
- Florian Fizaine, Victor Court (2015) Renewable electricity producing technologies and metal depletion: A sensitivity analysis using the EROI Ecological Economics ↩︎
- Par exemple au Canada, des collectivités locales peuvent déclarer des zones incompatibles avec l’activité minière. Voir aussi les déboires du projet Montage d’or en Guyane française ↩︎
- Il faut ajouter à la consommation d’énergies fossiles proprement dites, la part de l’électricité produite à partir de centrales électriques fossiles (soit 64% de la production d’électricité – voir AIE) ↩︎
- Source : Banque Mondiale – Indicateurs : Accès à l’électricité (% de la population) et Population totale ↩︎
- Il s’agirait en effet de remplacer et/ou adapter l’ensemble des raffineries qui transforment aujourd’hui le pétrole brut en carburants utilisables par les consommateurs (gazole, fioul, essence). Pour mémoire, l’ensemble des raffineries dans le monde ont produit en 2024, près de 83 millions de barils par jour (pour une capacité de 104,5 millions de barils) (Source Statistical Review of World Energy 2025) ↩︎
- Les réserves prouvées sont publiées par pays pour la période 1980-2020 Statistical Review of World Energy 2025. ↩︎
- Voir par exemple : Les chiffres des réserves pétrolières sont surestimés et c’est dangereux, Alexandre Mirlicourtois, Xerfi Canal (janvier 2026) ; Le Venezuela a-t-il réellement 300 milliards de barils de pétrole en réserve ? Le Grand Continent (08/01/26). ↩︎
- Elle résulte du théorème des intégrales bornées : toute fonction dont l’intégrale est finie passe par un maximum et converge vers 0 à l’infini. ↩︎
- Voir par exemple une mise au point récente et synthétique dans Quel avenir pour le pétrole ? par Denis Babusiaux et Pierre-René Bauquis ? revue AFIS – 2019. ↩︎
- Consultez ce fil twitter de Météo France qui explique très bien le concept de budget carbone. ↩︎
- RCP, pour « Representative Concentration Pathways » ou « Profils représentatifs d’évolution de concentration ». En 2100 le forçage radiatif d’un scenario 8.5 est de 8,5 W/M2. Plus d’explication sur les scenarios sur le site de météo France. ↩︎
- Voir Ritchie, J., et Dowlatabadi H. (2017), The 1,000 GtC Coal Question: Are Cases of Vastly Expanded Future Coal Combustion Still Plausible? Energy Economics et Why do climate change scenarios return to coal?, Energy ↩︎
- Schweizer, V. et Kriegler, E. (2012) Improving environmental change research with systematic techniques for qualitative scenarios, Environmental Research Letters ; Christensen, P., Gillingham, K. et Nordhaus, W. (2018) Uncertainty in Forecasts of Long-Run Economic Growth, PNAS. ↩︎
- Ex : un climat suffisamment stable pour permettre l’agriculture ou le maintien en état des infrastructures ; des terres et des océans en suffisamment bon état pour permettre la reproduction de la faune et la flore supports de l’alimentation de milliards d’humains ↩︎
- L’AFEP a publié un rapport sur ce sujet en France : sur 209 nouveaux professeurs recrutés à l’Université entre 2000 et 2011, près de 85% dédient leurs recherches au courant dominant de la science économique. ↩︎
- Dans l’article la « Tyrannie du top 5 », deux économistes montrent l’importance d’avoir publié dans une des 5 premières revues économiques pour obtenir un poste dans les 35 meilleurs départements économiques des Etats-Unis. Voir J. Heckman & S. Moktan, Publishing and Promotion in Economics: The Tyranny of the Top Five, Journal of Economic Literature, 2020. ↩︎
- C’est la formule utilisée par Alfred Nobel dans son testament, ouvert en 1895, pour désigner les récipiendaires du prix dans les 5 disciplines d’origine (physique, chimie, littérature, médecine, paix). Quand le prix de la banque de suède en mémoire d’Alfred Nobel a été créé en 1969, la même formule a été choisie. ↩︎
- Il s’agit de William Nordhaus. Comme nous le montrons dans notre fiche dédiée à l’étude des impacts économiques globaux provoqués par le réchauffement climatique, il a plutôt eu un rôle de frein dans la prise de conscience de l’enjeu climatique. A noter qu’Elinor Ostrom a été récompensée « pour son analyse de la gouvernance économique, en particulier des biens communs », un thème fondamental en matière d’écologie. ↩︎
- Oswald, A. J. and Stern, N. (2019), Why does the economics of climate change matter so much, and why has the engagement of economists been so weak? Voir également Why are economists letting down the world on climate change? dans lequel les auteurs résument leur propos et interpellent leurs confrères. ↩︎
- Pottier, A. (2014), L’économie dans l’impasse climatique : développement matériel, théorie immatérielle et utopie auto-stabilisatrice, Thèse de doctorat EHESS – pp. 136-137. ↩︎
- Bowles, S. and Wendy, C. (2020), What Students Learn in Economics 101: Time for a Change Journal of Economic Literature. ↩︎
- La microéconomie étudie le comportement d’un agent économique ou d’un groupe d’agents homogène (ex : les ménages, les entreprises). La macroéconomie étudie les relations entre les grands agrégats économiques (l’épargne, l’investissement, la consommation, la croissance). En cela, elle concerne des ensembles d’agents, typiquement à l’échelle d’une nation voire du monde entier. Voir fiche XXX ↩︎
- Voir notamment : Daly, H. E. (1968), On Economics as a Life Science, The Journal of Political Economy ; Ayres, R.U. and Kneese, A.V. (1969), Production, Consumption, and Externalities, The American Economic Review ; Coddington, A. (1970), The Economics of Ecology, New Society ; Georgescu-Roegen, N. (1970) The Economics of Production The American Economic Review ; Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, (1971). ↩︎
- Le premier s’énonce ainsi « Au cours d’une transformation quelconque d’un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d’énergie échangée avec le milieu extérieur, par transfert thermique (chaleur) et transfert mécanique (travail) » et le deuxième ainsi « Toute transformation d’un système thermodynamique s’effectue avec augmentation de l’entropie globale incluant l’entropie du système et du milieu extérieur. » ↩︎
- Vous pouvez également consulter les ouvrages suivants : Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte (2016) ; Eloi Laurent, Sortir de la croissance : mode d’emploi, Les liens qui libèrent (2019) ; Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social (2009) ; initiative Beyond GDP de l’Union européenne. ↩︎
- Quelques ressources : Les publications de Chaire Comptabilité Ecologique. Des livres : Quelles normes comptables pour une société du commun ? Édouard Jourdain, Ed° Charles Léopold Meyer (2019), et Révolution comptable – Pour une entreprise écologique et sociale, Jacques Richard et Alexandre Rambaud, Editions de l’Atelier (2020). Des articles de journaux : Il faut intégrer les enjeux écologiques dans la comptabilité des entreprises, Le monde (2019) Transformer nos systèmes comptables pour se réorganiser avec ce qui compte -The conversation (2020) ; Une révolution comptable pour rendre compte d’un nouveau contrat avec la nature – Le Monde (2020) ↩︎
- Les externalités ne concernent pas que l’environnement. Ainsi, Alfred Marshall évoque dès le début du XIXème siècle le fait que les firmes bénéficient par leur implantation géographique d’économies externes qui « résultent du progrès général de l’environnement industriel », ou qui « sont liées à l’accroissement des connaissances et du progrès technique ». Alfred Marshall, Principles of Economics, Macmillan (1890). ↩︎
- Cet exemple a été développé par John Meade qui est également celui qui a pour la première fois employé le terme d’externalité dans Meade, J. (1952), External economies and diseconomies in a competitive situation, Economic Journal. ↩︎
- Cette relation n’est plus nécessairement vraie aujourd’hui : les apiculteurs subissent des externalités négatives quand les champs proches des ruches sont traités avec des pesticides. Face à l’effondrement des populations d’abeilles, la marchandisation du service de pollinisation se développe : les apiculteurs sont par exemple rémunérés en Californie pour polliniser les amandiers. ↩︎
- Arthur C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan (1920) ↩︎
- Ils pensent en général d’une part que les normes et règlements peuvent engendrer des coûts élevés non révélés et que, d’autre part, les marchés sont mieux à même que la puissance publique d’identifier les technologies les plus efficaces. ↩︎
- John H. Dales, Pollution, Property and Prices, University of Toronto Press (1968). Il s’inspire en cela de Coase, R. (1960), The problem of social cost, Journal of Law and Economics. ↩︎
- C’est par exemple le cas de Jean Tirol ou Christian Gollier en France, de Kenneth Rogoff aux USA. ↩︎
- Voir Pourquoi le « Nobel d’économie » n’est pas un prix Nobel comme les autres – Les Décodeurs, Le Monde (09/10/2023) ↩︎
- Voir Pourquoi le « Nobel d’économie » n’est pas un prix Nobel comme les autres – Les Décodeurs, Le Monde (09/10/2023) ↩︎
- L. Barrage & W.D Nordhaus, Policies, projections, and the social cost of carbon : results from the DICE-2023 model, NBER Working paper series, 2023 (p.9). ↩︎
- Il s’agit de Principles of Economics de Gregory Mankiw, économiste d’Harvard. Publié pour la première fois en 1997, ce manuel a connu un succès retentissant dans les pays anglophones avant d’être traduit en 20 langues et vendu à plus de 20 millions d’exemplaires. Le passage concernant les ressources naturelles et la croissance se trouve page 524 de la 8è edition (2018), disponible en ligne. ↩︎
- Ces scénarios évaluent par exemple des ressources deux fois plus importantes qu’envisagé à l’époque, ou un fort contrôle de la pollution, ou une hausse de la productivité agricole, ou un progrès technique permettant de recycler les matériaux. ↩︎
- Publié initialement en 1972, le rapport Limits to Growth a été mis à jour en 1992 (Beyond the Limits, Chelsea Green Publishing) et en 2004 (The limits to growth: The 30-year update. Chelsea Green Publishing). ↩︎
- Le rapport Limits to growth est basé sur le modèle Wolrd3 développé par Forrester. On pourrait traduire « Doomsday model », par « modèle catastrophiste » ou « modèle de la fin du monde ». ↩︎
- C’est-à-dire les stocks de machines, d’infrastructure, de bâtiments etc. nécessaires à l’économie. Voir fiche sur le capital XXX ↩︎
- Notons que si Joseph Stiglitz a contribué au début de sa carrière à forger le consensus dominant sur la question ressources naturelles et croissance, il a ensuite apporté des contributions importantes en matière d’économie et d’écologie par exemple sur la remise en cause du PIB. ↩︎
- Ce rapport a été produit par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, lancée par l’ONU en 1983. Dirigée par Gro Harlem Brundtland, première ministre de Norvège, elle avait pour mission de définir un programme de coopération internationale et pluridisciplinaire sur les problèmes environnementaux. ↩︎
- Ces débats s’inscrivent dans la lignée de ceux qui ont suivi la sortie du rapport Limits to Growth au début des années 1970 (abordé dans l’idée reçue3 de ce module). A noter que la plupart des articles ne sont plus publiés dans dans les grandes revues économiques généralistes mais dans les revues spécialisées en environnement. Pour une revue de littérature sur le sujet, voir Pezzey, J. C. V. and Toman, M. A. (2002), The Economics of Sustainability: A Review of Journal Articles, Ressources for the Future Working Paper. ↩︎
- Il existe de nombreux débat sur les différentes formes de capitaux (certains parlent également du capital social, du capital institutionnel, etc. ), sur leur définition ou sur la pertinence d’appliquer la notion de capital à l’humain ou à la nature. Le propos n’est pas ici d’entrer dans ces débats. ↩︎
- U article très pédagogique sur ce sujet : Créer une économie durable : la notion de soutenabilité, sur Easynomics.fr ↩︎
- Voir par exemple cet article qui décrit les expériences récentes visant à utiliser des bulles de savon et des drones. ↩︎
- à leur puissance de transformation / destruction de la matière, à leurs consommations énergétiques, et à leurs effluents gazeux, liquides ou solides ↩︎
- Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre des débats sur l’énergie qui se sont tenus dans les années 1860 en Angleterre, pays qui a vu naître la révolution industrielle grâce en particulier à une utilisation importante du charbon. Suite au traité Cobden-Chevalier (1860) de libre-échange entre la France et l’Angleterre qui prévoyait de lever les restrictions et taxes douanières sur le commerce du charbon, les Anglais craignaient une érosion de leur suprématie industrielle si le charbon venait à manquer. Pour une analyse plus poussée du livre the Coal question – Pottier (2014) chapitre 2.1.2 p 107 ↩︎
- Par exemple : retrait du marché des équipements les plus polluants (ex : les ampoules à incandescence sont interdites en Europe depuis 2013), promulgation de normes maximales de consommation d’énergie ou d’eau pour les machines ou les bâtiments, règles d’information du consommateur (les étiquettes-énergies qui notent la performance énergétique des appareils ménagers ou des habitations) etc. ↩︎
- Une mise à jour publiée en 2019 ne change pas fondamentalement les conclusions. Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update, EASAC, Février 2019. ↩︎
- Les services représentent déjà plus de 65% du PIB mondial. Voir ici ↩︎
- L’empreinte carbone peut concerner un territoire (cas considéré ici) mais aussi un produit ou d’une entreprise particulière. La définition est alors différente. L’empreinte carbone d’un produit consiste à calculer les émissions de GES liées à sa fabrication, à son usage ainsi qu’à sa fin de vie. Celle d’une entreprise consiste à prendre en compte les émissions directes de cette entreprise mais aussi celles des activités amont et aval sur la chaine de valeur dans laquelle s’insère l’entreprise. ↩︎
- Ce mode de vie incluant non seulement les comportements individuels mais aussi les infrastructures et services collectifs auxquels il a accès. ↩︎
- Voir le World Population Prospects 2019 Vol2 (p5). ↩︎
- D’après le démographe Henri Leridon, la famine mondiale de 1876-1879 aurait entrainé 30 à 60 millions de morts, l’épidémie de grippe espagnole de 40 à 100 millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale entre 50 et 80 millions de morts, les grandes famines de l’URSS en 1918-1920, ou de la Chine en 1958-1961, plusieurs dizaines de millions de décès en 3 à 5 ans et le le VIH-Sida a causé 35 millions de décès depuis le début de l’épidémie dans les années 1980 jusqu’en 2018. ↩︎
- Il est à noter que la poursuite sans frein des dynamiques actuelles de réchauffement climatique et d’effondrement de la biodiversité pourraient conduire à de tels scenarios. ↩︎
- L’Océanie (hors Australie et Nouvelle-Zélande) aurait également un taux de fertilité important mais les pays de cette région ne représentent qu’un faible part de la population mondiale (de 12 millions aujourd’hui à 19 millions en 2050). La région « Afrique du Nord et Asie de l’Ouest » passe quant à elle de 2,9 à 2,3 enfants par femme. ↩︎
- Sauf mention contraire l’ensemble des chiffres relatifs aux émissions de GES de cette section sont issus de la Base de donnée Edgar – Booklet 2019. il est important de noter que cette base de donnée n’intègre pas les changements d’affectation des terres (donc les émissions de CO2 liées à la différence entre déforestation et reforestation). ↩︎
- Le niveau de vie (mesuré par le PIB/habitant) n’est pas le seul déterminant. La « qualité environnementale » de ce niveau de vie est également importante. Pour le CO2, l’équation de KAYA permet par exemple de comprendre que le contenu en énergie du PIB et le mix énergétique plus ou moins carboné sont fondamentaux. ↩︎
- La liste des actions individuelles envisagées dans l’étude mêle des « petits gestes » (baisse de la température de chauffage du logement, achat de LED, achat d’une gourde) et des changements plus significatifs (adopter un régime végétarien, ne plus prendre l’avion, n’acheter que des biens d’occasion…). La vision « réaliste » considère que seule une partie des actions activables à l’échelle individuelle sera réalisée, en fonction de la volonté de changement des ménages à l’échelle française. L’étude présente également une vision « héroïque » où tous les ménages effectuent l’ensemble des actions ce qui permet une baisse de 25% de l’empreinte carbone moyenne des Français. ↩︎